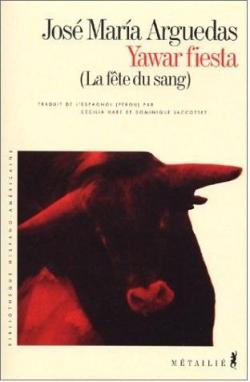>
Critique de lglaviano
L'OeUVRE D'UN GRAND ÉCRIVAIN NOBÉLISABLE ET D'UN "HONNÊTE HOMME" :
Oui, c'est un chef d'oeuvre! On peut dire que la description qui est faite ici dans la présentation (résumé) du livre par "Scarbo" est particulièrement juste : il y a une vraie dimension épique dans l'affrontement, que met en scène ce récit, entre les populations autochtones amérindiennes et le groupe des notables (colons et grands propriétaires blancs, les "mistis"), entre la sierra indienne et la côte créole et "blanche", affrontement qui rejoue à sa façon le grand traumatisme et le choc civilisationnel que fut la "conquista", par une poignée d'aventuriers espagnols, du grand empire inca au XVIe siècle.
L'observation précise des faits, des coutumes et des peuples est extraordinaire et révèle l'ethno-anthropologue savant que fut aussi Arguedas, ainsi que l'enfant sensible et émerveillé qui découvrit très jeune ces modes de vie et traditions autochtones, puis à l'adolescence avec son père (voir le roman suivant, en partie autobiographique, « Les fleuves profonds »). Auparavant, orphelin de mère très tôt, à deux ans, et son père s'étant remarié, souvent absent (il était avocat itinérant), sa marâtre et sa fratrie du côté de sa belle-mère l'obligeaient à vivre avec les serviteurs indiens. C'est auprès d'eux qu'il découvre la culture et la langue quechua (qu'on écrit kechwa dans la langue). En 1921, à l'âge de dix ans, il s'échappe de la tyrannie de sa belle famille avec son frère Aristide. Ils se sont réfugiés dans une communauté indigène de la Hacienda Viseca, où ils vécurent deux ans en contact étroit avec les Indiens, parlant exclusivement leur langue, apprenant et vivant leurs coutumes… Jusqu'à ce que, en 1923, les recueille leur père, qui les emmena dans son itinérance à travers les villages et les villes de la sierra, permettant ainsi au jeune José María de parfaire sa connaissance du monde andin, pour finalement s'établir en Abancay, la capitale du département d'Apurímac (centre-sud du Pérou).
Comme romancier, figure phare de toute la mouvance indigéniste, et ayant contribué à la renouveler, José María Arguedas rejoint Ciro Alegría, son compatriote et contemporain, dans la tentative délibérée, complexe, et plus réussie que jamais d'envisager, de décrire "de l'intérieur" l'Indien des Andes, et dans le dessein de portraiturer le visage composite de la réalité péruvienne, de désigner précisément, sans faux-fuyants culpabilisés et sans illusion historique, la confluence de « tous les sangs mêlés » de son identité. Ceci est dû en bonne partie au fait qu'il est originaire de la sierra du centre-sud du Pérou (régions d'Ayacucho, Apurímac, et Cuzco, soit le coeur même du Tawantinsuyu, l'empire Inca), qui est toujours restée plus liée à la langue kechwa et à l'héritage pré-hispanique que la sierra du nord, celle de Ciro Alegría et de César Vallejo. Alors, dès le début de son écriture, Arguedas se place du point de vue de l'Indien et exprime sa vision à la fois réaliste, ancrée dans le quotidien, et imprégnée d'un "fantastique concret", parvenant à une intensité esthétique et une identification avec l'optique populaire sans équivalent dans la littérature hispano-américaine (si ce n'est peut-être, plus tard, dans les romans et nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, ou bien sûr du colombien García Márquez), dans une démarche qui se situe au sein des grands courants de celle-ci mais de façon vraiment originale, qui tient à la fois du « réalisme merveilleux » promu par le cubain Alejo Carpentier et du « réalisme magique » d'un García Márquez (dans «Cent ans de solitude», «…Histoire de la candide Eréndira…», «Les funérailles de la Grande Mémé» ou «Chronique d'une mort annoncée», cette dernière très proche dans sa fatalité tragique et cosmique d'un autre roman d'Arguedas : «Diamants et silex»).
De fait, les récits d'Arguedas des années 1935-1954, en particulier le charmant conte «Warma Kuyay» (dans le recueil «Agua»), et ce vigoureux roman-ci de «Yawar fiesta», témoignent de ce sentir-être-entre-deux-mondes d'Arguedas : blanc de naissance (il était issu d'une famille riche d'"hacendados", les "établis" par l'empereur Charles Quint en récompense des conquêtes et dons faits à la couronne), mais Indien de coeur. Parfaitement bilingue, il a d'abord appris le kechwa et nourri son enfance de culture andine (musique, chants, danses, cosmogonies, récits fondateurs, croyances) plus que de culture occidentale, qu'il a fini par connaître solidement tant dans sa jeunesse étudiante (il a fait une licence de littérature, puis plus tard un doctorat d'ethno-anthropologie) que dans sa maturité, mais en la "transculturant" notablement : en effet, il a "quechuisé" l'idiome espagnol et subverti l'écriture romanesque bourgeoise moderne avec des éléments empruntés à la tradition orale (y compris des chants, même aux moments-clés de la narration) et à la pensée mythique (chamanisme, danse rituelle "des ciseaux": la « danza de tijeras » , amarus, etc.).
Publié en 1941 et, dans une nouvelle version en 1958, Yawar Fiesta raconte les mouvements et conflits qui agitent un gros bourg des Andes péruviennes quand les autorités de Lima interdisent la traditionnelle corrida locale, indienne, donnée rituellement tous les ans à l'occasion de la fête nationale, pendant laquelle les habitants des villages affrontent dans les rues et sur la place centrale les taureaux. Or cette année la corrida s'annonçait mémorable avec la venue espérée du taureau le plus puissant et sauvage de la région, véritable mythe vivant, un vrai totem : le “Misitu”. le gouvernement central ordonne que la dite corrida sauvage soit remplacée par une corrida moins féroce et dangereuse, "civilisée", de type espagnol, et menée par des toreros professionnels dans une arène fermée entourée de tribune. le titre original du roman, bilingue, mi-kechwa (Yawar : le sang) /mi-espagnol (la fiesta : la fête, et donc, littéralement «la fête sanglante»), indique le thème plus général, caractéristique de toute l'oeuvre d'Arguedas, de la coexistence et du contraste entre les Indiens, dont on célèbre la dignité et les traditions, la détermination unitaire malgré la joute aux rivalités simulées, et les blancs, maîtres des lieux, qui résistent aux nouvelles dispositions (contraires à des traditions qu'eux aussi ressentent comme leur appartenant en propre, comme une particularité locale qu'ils ont intégrée à leur identité), mais qui ne se risquent pas à s'opposer au sous-préfet, représentant l'autorité gouvernementale, et incarnant la "civilisation" hispanique occidentale dominante à laquelle ils souhaitent se rattacher : les voilà pris en flagrant délit de conflit identitaire, mais honteux et culpabilisé, et donc complètement intériorisé.
Le roman se terminera par le triomphe du peuple indien ; les toreros indigènes feront irruption dans l'arène, remplaçant le torero espagnol intimidé puis terrifié. Avec «Les fleuves profonds», «Yawar fiesta» est sans conteste le meilleur roman d'Arguedas. Il nous offre un tableau haut en couleur de la vie sociale complexe du Haut-Plateau andin, où l'aspect ethnique s'entrecroise avec des facteurs socioéconomiques et culturels d'une richesse et d'une subtilité infinies. L'écrivain péruvien réussit à témoigner encore ici de toute la sensibilité indienne, et en particulier dans la langue il transmet une certaine musicalité de type choral, laquelle dans «Yawar fiesta» se coule dans le son omniprésent des instruments autochtones [Wakawak'ras(1), charango(2), harpe andine(3), grandes flûtes des hauts-plateaux(4)], vrais motifs structurant en leitmotiv le roman dans son ensemble.
Car la langue d'Arguedas est riche et poétique, musicale, au souffle puissant ; elle aussi trahit une féconde dualité linguistique entre le castillan et le kechwa (la langue vernaculaire des Indiens des Andes et des anciens Incas), son récit est parsemé de "quechuismes" dont la lecture est facilitée par les notes du traducteur en cours de texte, et le glossaire complet à la fin (qui n'est pas si long en fait : Arguedas a choisi les mots et les concepts les plus importants, les plus fréquemment employés par les Indiens, et les plus révélateurs de leur vision du monde). Quechuismes dont on prend facilement l'habitude, si bien que très vite, on n'a plus besoin de consulter le glossaire (sauf exception, alors le traducteur vient à notre secours et propose une note en cours de récit). Mais, au-delà de ce vocabulaire "métissé" ou en fusion (comme on parle de « musique-fusion »), depuis son premier roman « Agua » (1935), et plus encore dans ce roman-ci, il s'est confronté à un problème stylistique crucial pour lui : trouver une langue "naturelle" dans laquelle ses personnages indigènes (à l'époque monolingues kechwas exclusifs) pourraient s'exprimer en espagnol (car dans ses romans en castillan, ce serait tout de même trop lourd de faire constamment de la "V.O. sous-titrée" !), et sans que les dialogues sonnent faux. Problème qu'il a résolu de façon originale et pertinente par l'emploi d'une sorte de "langage inventé", assez inouï : sur une base lexicale fondamentalement espagnole, il a greffé le rythme syntaxique et l'ordonnancement du kechwa. Ce qui donne son style si particulier et reconnaissable, si profondément typique et savoureux qu'on se croirait dans les banlieues andines des gros bourgs de l'intérieur, ou au coeur d'un « ayllu » (quartier ou communauté indigène). Mais qu'on se rassure : cette trouvaille stylistique n'altère en rien la parfaite lisibilité du récit, avec ses suspenses, ses rebondissements, sa colère blanche contenue qui sourd au détour d'une phrase ou d'une réplique méprisante d'un notable ou d'une autorité envers l'Indien.
« Yawar fiesta » pose enfin, dès 1941, le problème de l'expropriation inique des Indiens des hauts plateaux, couverte par le gouvernement de Lima et par les autorités locales tout acquis aux intérêts des notables, et des diverses exactions qu'ont subies les habitants des communautés indigènes de Puquio, dans la province de Lucanas (département d'Ayacucho), symboles du Pérou entier. Mais dans cette oeuvre, l'auteur rompt avec quelques-unes des conventions du roman indigéniste traditionnel, en soulignant la dignité de l'autochtone qui a su préserver ses coutumes ancestrales malgré le mépris dans lequel les tiennent les classes dominantes et les pouvoirs publics. Ce triomphalisme est en soi plutôt inhabituel selon les canons indigénistes, généralement plus misérabilistes, et donne à comprendre le monde andin comme un corps soudé, régi par ses propres lois, affronté uniment au modèle occidentalisé dominant sur la côte du Pérou. C'est peut-être en ce sens, et en ce sens seulement, que le terme d' « utopie » qu'emploie Vargas Llosa pour stigmatiser la position d'Arguedas trouve une certaine justification.
On l'a vu, cette dualité culturelle que José María Arguedas met en scène à la fois dans son style et dans son récit, il l'a vécue dans sa chair, au plus intime de son identité. Elle s'est peu à peu transformée en déchirement et en conscience douloureuse à cause des injustices des classes dominantes envers les Indiens qui ont perduré jusqu'à nos jours. de plus, on l'a vu dans sa biographie, Arguedas vivait un conflit profond entre son amour pour la culture indigène, qu'il souhaitait "intacte", et son désir d'aider l'Indien à sortir de sa misère (et donc forcément, d'une manière ou d'une autre, être obligé de s'acculturer), une distorsion intenable entre nostalgie traditionnaliste et adhésion au progressisme socialiste. Ces contradictions ne sont pas pour rien dans la dépression qui a abouti à son suicide en 1969, à l'âge de 58 ans, malgré sa réussite personnelle et sa reconnaissance sociale, littéraire et politique (il mena à bien aux ministères de l'Éducation puis de la Culture des missions importantes couronnées de succès et assez unanimement saluées, et il fut un universitaire et un directeur de musée très apprécié).
Cette tragédie exprime les déchirures et les clivages de la société péruvienne, laquelle n'a toujours pas surmonté, en fait, le bouleversement et le désastre que fut le génocide physique (par la maltraitance, la surexploitation et le choc biologique des grandes épidémies), économique (avec le pillage des ressources et la déstructuration sociale) et culturel des civilisations amérindiennes précolombiennes, lors de la conquête espagnole. Plus qu'une "réconciliation", Arguedas prône la reconnaissance de la valeur de ces cultures amérindiennes et leur intégration plénière au sentiment et au patrimoine national, assorties des nécessaires mesures de justice sociale envers les populations autochtones. Ce mouvement, amorcé par les idées d'Arguedas qui ont infusé la société péruvienne et même l'ensemble de l'Amérique du Sud, a déjà commencé, mais il est loin d'être achevé.
Sans cette fin tragique et prématurée, avec une oeuvre extraordinaire et qui aurait pu se poursuivre, nul doute que José María Arguedas, par l'originalité et la pertinence de son style, la justesse bien informée de ses descriptions, l'ampleur et la générosité de sa vision tant humaniste que "néo-indigéniste", et l'exemplarité de sa conscience universelle, eût naturellement trouvé sa place au sein du prestigieux collège des six grands écrivains nobélisés de l'aire latino-américaine, à savoir, dans l'ordre chronologique: Gabriela Mistral (Chili, 1945), Miguel-Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chili, 1971), Gabriel García Márquez (Colombie, 1982), Octavio Paz (Mexique, 1990), et Mario Vargas Llosa, son compatriote et admirateur péruvien, Nobel en 2010.
Vous pourrez lire aussi ici des commentaires critiques sur les oeuvres d'Arguedas que j'ai empruntés à une thèse (de Martine Rens), au chapitre "citations", à chaque page du site consacrée à ces livres.
■ Helgé, alias lglaviano. Ecrit en partie à l'aide des informations trouvées sur le site suivant (en espagnol) : «Biografías y vidas», http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arguedas.htm
(1)- « Wakawak'ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak'raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(2)- « Charango kirkincho » : adorable petit luth indien généralement à 5 doubles cordes, au son charmant, puissant et cristallin, clair et acidulé, dont la caisse est faite dans une carapace du petit tatou velu des Andes (et aujourd'hui en bois car le tatou kirkincho est protégé). Issu de la vihuela espagnole ou peut-être de la mandoline.
(3)- « El Arpa andina » : petite harpe indienne, qui peut se jouer assis ou debout en ambulatoire portée sur l'épaule afin d'accompagner les « dansak' » ou « danzantes de tijeras », les danseurs de la danse des ciseaux.
(4)- Grandes flûtes des Andes : soit les « toyos », sikus ou flûtes de Pan géantes ultra graves au son caverneux et percussif, ou encore la « machu kena » ou « ocona » : grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, au son très chaud velouté et rond, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
Lien : http://www.biografiasyvidas...
Oui, c'est un chef d'oeuvre! On peut dire que la description qui est faite ici dans la présentation (résumé) du livre par "Scarbo" est particulièrement juste : il y a une vraie dimension épique dans l'affrontement, que met en scène ce récit, entre les populations autochtones amérindiennes et le groupe des notables (colons et grands propriétaires blancs, les "mistis"), entre la sierra indienne et la côte créole et "blanche", affrontement qui rejoue à sa façon le grand traumatisme et le choc civilisationnel que fut la "conquista", par une poignée d'aventuriers espagnols, du grand empire inca au XVIe siècle.
L'observation précise des faits, des coutumes et des peuples est extraordinaire et révèle l'ethno-anthropologue savant que fut aussi Arguedas, ainsi que l'enfant sensible et émerveillé qui découvrit très jeune ces modes de vie et traditions autochtones, puis à l'adolescence avec son père (voir le roman suivant, en partie autobiographique, « Les fleuves profonds »). Auparavant, orphelin de mère très tôt, à deux ans, et son père s'étant remarié, souvent absent (il était avocat itinérant), sa marâtre et sa fratrie du côté de sa belle-mère l'obligeaient à vivre avec les serviteurs indiens. C'est auprès d'eux qu'il découvre la culture et la langue quechua (qu'on écrit kechwa dans la langue). En 1921, à l'âge de dix ans, il s'échappe de la tyrannie de sa belle famille avec son frère Aristide. Ils se sont réfugiés dans une communauté indigène de la Hacienda Viseca, où ils vécurent deux ans en contact étroit avec les Indiens, parlant exclusivement leur langue, apprenant et vivant leurs coutumes… Jusqu'à ce que, en 1923, les recueille leur père, qui les emmena dans son itinérance à travers les villages et les villes de la sierra, permettant ainsi au jeune José María de parfaire sa connaissance du monde andin, pour finalement s'établir en Abancay, la capitale du département d'Apurímac (centre-sud du Pérou).
Comme romancier, figure phare de toute la mouvance indigéniste, et ayant contribué à la renouveler, José María Arguedas rejoint Ciro Alegría, son compatriote et contemporain, dans la tentative délibérée, complexe, et plus réussie que jamais d'envisager, de décrire "de l'intérieur" l'Indien des Andes, et dans le dessein de portraiturer le visage composite de la réalité péruvienne, de désigner précisément, sans faux-fuyants culpabilisés et sans illusion historique, la confluence de « tous les sangs mêlés » de son identité. Ceci est dû en bonne partie au fait qu'il est originaire de la sierra du centre-sud du Pérou (régions d'Ayacucho, Apurímac, et Cuzco, soit le coeur même du Tawantinsuyu, l'empire Inca), qui est toujours restée plus liée à la langue kechwa et à l'héritage pré-hispanique que la sierra du nord, celle de Ciro Alegría et de César Vallejo. Alors, dès le début de son écriture, Arguedas se place du point de vue de l'Indien et exprime sa vision à la fois réaliste, ancrée dans le quotidien, et imprégnée d'un "fantastique concret", parvenant à une intensité esthétique et une identification avec l'optique populaire sans équivalent dans la littérature hispano-américaine (si ce n'est peut-être, plus tard, dans les romans et nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, ou bien sûr du colombien García Márquez), dans une démarche qui se situe au sein des grands courants de celle-ci mais de façon vraiment originale, qui tient à la fois du « réalisme merveilleux » promu par le cubain Alejo Carpentier et du « réalisme magique » d'un García Márquez (dans «Cent ans de solitude», «…Histoire de la candide Eréndira…», «Les funérailles de la Grande Mémé» ou «Chronique d'une mort annoncée», cette dernière très proche dans sa fatalité tragique et cosmique d'un autre roman d'Arguedas : «Diamants et silex»).
De fait, les récits d'Arguedas des années 1935-1954, en particulier le charmant conte «Warma Kuyay» (dans le recueil «Agua»), et ce vigoureux roman-ci de «Yawar fiesta», témoignent de ce sentir-être-entre-deux-mondes d'Arguedas : blanc de naissance (il était issu d'une famille riche d'"hacendados", les "établis" par l'empereur Charles Quint en récompense des conquêtes et dons faits à la couronne), mais Indien de coeur. Parfaitement bilingue, il a d'abord appris le kechwa et nourri son enfance de culture andine (musique, chants, danses, cosmogonies, récits fondateurs, croyances) plus que de culture occidentale, qu'il a fini par connaître solidement tant dans sa jeunesse étudiante (il a fait une licence de littérature, puis plus tard un doctorat d'ethno-anthropologie) que dans sa maturité, mais en la "transculturant" notablement : en effet, il a "quechuisé" l'idiome espagnol et subverti l'écriture romanesque bourgeoise moderne avec des éléments empruntés à la tradition orale (y compris des chants, même aux moments-clés de la narration) et à la pensée mythique (chamanisme, danse rituelle "des ciseaux": la « danza de tijeras » , amarus, etc.).
Publié en 1941 et, dans une nouvelle version en 1958, Yawar Fiesta raconte les mouvements et conflits qui agitent un gros bourg des Andes péruviennes quand les autorités de Lima interdisent la traditionnelle corrida locale, indienne, donnée rituellement tous les ans à l'occasion de la fête nationale, pendant laquelle les habitants des villages affrontent dans les rues et sur la place centrale les taureaux. Or cette année la corrida s'annonçait mémorable avec la venue espérée du taureau le plus puissant et sauvage de la région, véritable mythe vivant, un vrai totem : le “Misitu”. le gouvernement central ordonne que la dite corrida sauvage soit remplacée par une corrida moins féroce et dangereuse, "civilisée", de type espagnol, et menée par des toreros professionnels dans une arène fermée entourée de tribune. le titre original du roman, bilingue, mi-kechwa (Yawar : le sang) /mi-espagnol (la fiesta : la fête, et donc, littéralement «la fête sanglante»), indique le thème plus général, caractéristique de toute l'oeuvre d'Arguedas, de la coexistence et du contraste entre les Indiens, dont on célèbre la dignité et les traditions, la détermination unitaire malgré la joute aux rivalités simulées, et les blancs, maîtres des lieux, qui résistent aux nouvelles dispositions (contraires à des traditions qu'eux aussi ressentent comme leur appartenant en propre, comme une particularité locale qu'ils ont intégrée à leur identité), mais qui ne se risquent pas à s'opposer au sous-préfet, représentant l'autorité gouvernementale, et incarnant la "civilisation" hispanique occidentale dominante à laquelle ils souhaitent se rattacher : les voilà pris en flagrant délit de conflit identitaire, mais honteux et culpabilisé, et donc complètement intériorisé.
Le roman se terminera par le triomphe du peuple indien ; les toreros indigènes feront irruption dans l'arène, remplaçant le torero espagnol intimidé puis terrifié. Avec «Les fleuves profonds», «Yawar fiesta» est sans conteste le meilleur roman d'Arguedas. Il nous offre un tableau haut en couleur de la vie sociale complexe du Haut-Plateau andin, où l'aspect ethnique s'entrecroise avec des facteurs socioéconomiques et culturels d'une richesse et d'une subtilité infinies. L'écrivain péruvien réussit à témoigner encore ici de toute la sensibilité indienne, et en particulier dans la langue il transmet une certaine musicalité de type choral, laquelle dans «Yawar fiesta» se coule dans le son omniprésent des instruments autochtones [Wakawak'ras(1), charango(2), harpe andine(3), grandes flûtes des hauts-plateaux(4)], vrais motifs structurant en leitmotiv le roman dans son ensemble.
Car la langue d'Arguedas est riche et poétique, musicale, au souffle puissant ; elle aussi trahit une féconde dualité linguistique entre le castillan et le kechwa (la langue vernaculaire des Indiens des Andes et des anciens Incas), son récit est parsemé de "quechuismes" dont la lecture est facilitée par les notes du traducteur en cours de texte, et le glossaire complet à la fin (qui n'est pas si long en fait : Arguedas a choisi les mots et les concepts les plus importants, les plus fréquemment employés par les Indiens, et les plus révélateurs de leur vision du monde). Quechuismes dont on prend facilement l'habitude, si bien que très vite, on n'a plus besoin de consulter le glossaire (sauf exception, alors le traducteur vient à notre secours et propose une note en cours de récit). Mais, au-delà de ce vocabulaire "métissé" ou en fusion (comme on parle de « musique-fusion »), depuis son premier roman « Agua » (1935), et plus encore dans ce roman-ci, il s'est confronté à un problème stylistique crucial pour lui : trouver une langue "naturelle" dans laquelle ses personnages indigènes (à l'époque monolingues kechwas exclusifs) pourraient s'exprimer en espagnol (car dans ses romans en castillan, ce serait tout de même trop lourd de faire constamment de la "V.O. sous-titrée" !), et sans que les dialogues sonnent faux. Problème qu'il a résolu de façon originale et pertinente par l'emploi d'une sorte de "langage inventé", assez inouï : sur une base lexicale fondamentalement espagnole, il a greffé le rythme syntaxique et l'ordonnancement du kechwa. Ce qui donne son style si particulier et reconnaissable, si profondément typique et savoureux qu'on se croirait dans les banlieues andines des gros bourgs de l'intérieur, ou au coeur d'un « ayllu » (quartier ou communauté indigène). Mais qu'on se rassure : cette trouvaille stylistique n'altère en rien la parfaite lisibilité du récit, avec ses suspenses, ses rebondissements, sa colère blanche contenue qui sourd au détour d'une phrase ou d'une réplique méprisante d'un notable ou d'une autorité envers l'Indien.
« Yawar fiesta » pose enfin, dès 1941, le problème de l'expropriation inique des Indiens des hauts plateaux, couverte par le gouvernement de Lima et par les autorités locales tout acquis aux intérêts des notables, et des diverses exactions qu'ont subies les habitants des communautés indigènes de Puquio, dans la province de Lucanas (département d'Ayacucho), symboles du Pérou entier. Mais dans cette oeuvre, l'auteur rompt avec quelques-unes des conventions du roman indigéniste traditionnel, en soulignant la dignité de l'autochtone qui a su préserver ses coutumes ancestrales malgré le mépris dans lequel les tiennent les classes dominantes et les pouvoirs publics. Ce triomphalisme est en soi plutôt inhabituel selon les canons indigénistes, généralement plus misérabilistes, et donne à comprendre le monde andin comme un corps soudé, régi par ses propres lois, affronté uniment au modèle occidentalisé dominant sur la côte du Pérou. C'est peut-être en ce sens, et en ce sens seulement, que le terme d' « utopie » qu'emploie Vargas Llosa pour stigmatiser la position d'Arguedas trouve une certaine justification.
On l'a vu, cette dualité culturelle que José María Arguedas met en scène à la fois dans son style et dans son récit, il l'a vécue dans sa chair, au plus intime de son identité. Elle s'est peu à peu transformée en déchirement et en conscience douloureuse à cause des injustices des classes dominantes envers les Indiens qui ont perduré jusqu'à nos jours. de plus, on l'a vu dans sa biographie, Arguedas vivait un conflit profond entre son amour pour la culture indigène, qu'il souhaitait "intacte", et son désir d'aider l'Indien à sortir de sa misère (et donc forcément, d'une manière ou d'une autre, être obligé de s'acculturer), une distorsion intenable entre nostalgie traditionnaliste et adhésion au progressisme socialiste. Ces contradictions ne sont pas pour rien dans la dépression qui a abouti à son suicide en 1969, à l'âge de 58 ans, malgré sa réussite personnelle et sa reconnaissance sociale, littéraire et politique (il mena à bien aux ministères de l'Éducation puis de la Culture des missions importantes couronnées de succès et assez unanimement saluées, et il fut un universitaire et un directeur de musée très apprécié).
Cette tragédie exprime les déchirures et les clivages de la société péruvienne, laquelle n'a toujours pas surmonté, en fait, le bouleversement et le désastre que fut le génocide physique (par la maltraitance, la surexploitation et le choc biologique des grandes épidémies), économique (avec le pillage des ressources et la déstructuration sociale) et culturel des civilisations amérindiennes précolombiennes, lors de la conquête espagnole. Plus qu'une "réconciliation", Arguedas prône la reconnaissance de la valeur de ces cultures amérindiennes et leur intégration plénière au sentiment et au patrimoine national, assorties des nécessaires mesures de justice sociale envers les populations autochtones. Ce mouvement, amorcé par les idées d'Arguedas qui ont infusé la société péruvienne et même l'ensemble de l'Amérique du Sud, a déjà commencé, mais il est loin d'être achevé.
Sans cette fin tragique et prématurée, avec une oeuvre extraordinaire et qui aurait pu se poursuivre, nul doute que José María Arguedas, par l'originalité et la pertinence de son style, la justesse bien informée de ses descriptions, l'ampleur et la générosité de sa vision tant humaniste que "néo-indigéniste", et l'exemplarité de sa conscience universelle, eût naturellement trouvé sa place au sein du prestigieux collège des six grands écrivains nobélisés de l'aire latino-américaine, à savoir, dans l'ordre chronologique: Gabriela Mistral (Chili, 1945), Miguel-Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chili, 1971), Gabriel García Márquez (Colombie, 1982), Octavio Paz (Mexique, 1990), et Mario Vargas Llosa, son compatriote et admirateur péruvien, Nobel en 2010.
Vous pourrez lire aussi ici des commentaires critiques sur les oeuvres d'Arguedas que j'ai empruntés à une thèse (de Martine Rens), au chapitre "citations", à chaque page du site consacrée à ces livres.
■ Helgé, alias lglaviano. Ecrit en partie à l'aide des informations trouvées sur le site suivant (en espagnol) : «Biografías y vidas», http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arguedas.htm
(1)- « Wakawak'ras » (ou encore : Wajrapuko) : sorte de cor au son puissant et guerrier, fait de cornes de taureau creusées et emboîtées les unes dans les autres. Il accompagne le « wak'raykuy » ou chant des coups de corne, et le « turupukllay » la musique qui accompagne les corridas.
(2)- « Charango kirkincho » : adorable petit luth indien généralement à 5 doubles cordes, au son charmant, puissant et cristallin, clair et acidulé, dont la caisse est faite dans une carapace du petit tatou velu des Andes (et aujourd'hui en bois car le tatou kirkincho est protégé). Issu de la vihuela espagnole ou peut-être de la mandoline.
(3)- « El Arpa andina » : petite harpe indienne, qui peut se jouer assis ou debout en ambulatoire portée sur l'épaule afin d'accompagner les « dansak' » ou « danzantes de tijeras », les danseurs de la danse des ciseaux.
(4)- Grandes flûtes des Andes : soit les « toyos », sikus ou flûtes de Pan géantes ultra graves au son caverneux et percussif, ou encore la « machu kena » ou « ocona » : grande kena (flûte droite à encoche) des hauts plateaux, de 80 à 90 cms, à la voix profonde et grave, au son très chaud velouté et rond, des départements de Puno et Ayacucho au Pérou, qui se joue seule en expression individuelle à la différence des pusipías, lichiwayus, chokelas, autres grandes kenas qui se jouent en troupe, pour une expression communautaire.
Lien : http://www.biografiasyvidas...