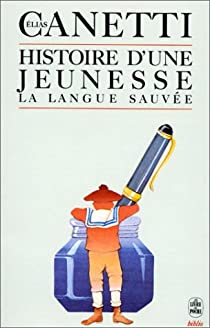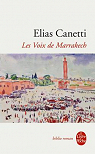Citations sur La langue sauvée (40)
1919 - à Zurich - il a 14 ans
J'étais attentif à elle (sa maman) autant qu'elle l'était de moi ; quand on est si proche d'une personne, on finit par avoir un sens infaillible des émotions qui la parcourent.
J'étais attentif à elle (sa maman) autant qu'elle l'était de moi ; quand on est si proche d'une personne, on finit par avoir un sens infaillible des émotions qui la parcourent.
Maladie de sa mère, hospitalisée en préventorium, courtisée par un médecin.
Il voulut poser sa main sur ma tête, sans doute pour me féliciter encore mais par le geste cette fois. Je lui échappai en me baissant très vite et il eut l'air légèrement interloqué. "Un fier petit bonhomme ma chère ! Ne se laisse toucher que par sa maman!" Le mot "toucher" m'est resté présent à l'esprit ; il me détermina à haïr cet homme, à le haïr du fond du cœur. Il ne fit plus un geste dans ma direction mais chercha à me désarmer par la flatterie. Et il devait continuer sur ce mode en y mettant autant d'entêtement que d'invention et sans lésiner sur les cadeaux longuement mûris grâce auxquels il escomptait briser ma résistance. Mais comment aurait-il pu imaginer que la volonté d'un enfant à peine âgé de onze ans était égale, voire supérieure à la sienne ?
C'est qu'il faisait une cour très empressée à ma mère ; il avait conçu, disait-il (mais on ne devait me rapporter ses paroles que bien plus tard) une vive inclination à son endroit, la plus vive inclination de sa vie. Il était prêt à divorcer pour elle. Il voulait se charger des trois enfants, aider ma mère à les élever. Tous trois pourraient étudier à l'université de Vienne ; pour ce qui était de l'aîné, de toute façon il deviendrait médecin et, s'il en avait envie, il pourrait s'occuper du préventorium plus tard. Ma mère se fermait à moi : elle se gardait bien de tout me dire sachant que cela m'aurait anéanti. J'avais l'impression qu'elle restait trop longtemps, qu'il ne voulait plus la laisser partir. "Tu es complètement guérie" lui disais-je à chacune de mes visites. "Rentre donc à la maison, je te soignerai". Elle souriait. Je parlais comme un grand, à la fois comme un homme et comme un médecin qui savait exactement ce qu'il y avait lieu de faire. J'aurai voulu la prendre à bras-le-corps et la porter dehors. "Une nuit, je viendrai te voler" lui dis-je.
Il voulut poser sa main sur ma tête, sans doute pour me féliciter encore mais par le geste cette fois. Je lui échappai en me baissant très vite et il eut l'air légèrement interloqué. "Un fier petit bonhomme ma chère ! Ne se laisse toucher que par sa maman!" Le mot "toucher" m'est resté présent à l'esprit ; il me détermina à haïr cet homme, à le haïr du fond du cœur. Il ne fit plus un geste dans ma direction mais chercha à me désarmer par la flatterie. Et il devait continuer sur ce mode en y mettant autant d'entêtement que d'invention et sans lésiner sur les cadeaux longuement mûris grâce auxquels il escomptait briser ma résistance. Mais comment aurait-il pu imaginer que la volonté d'un enfant à peine âgé de onze ans était égale, voire supérieure à la sienne ?
C'est qu'il faisait une cour très empressée à ma mère ; il avait conçu, disait-il (mais on ne devait me rapporter ses paroles que bien plus tard) une vive inclination à son endroit, la plus vive inclination de sa vie. Il était prêt à divorcer pour elle. Il voulait se charger des trois enfants, aider ma mère à les élever. Tous trois pourraient étudier à l'université de Vienne ; pour ce qui était de l'aîné, de toute façon il deviendrait médecin et, s'il en avait envie, il pourrait s'occuper du préventorium plus tard. Ma mère se fermait à moi : elle se gardait bien de tout me dire sachant que cela m'aurait anéanti. J'avais l'impression qu'elle restait trop longtemps, qu'il ne voulait plus la laisser partir. "Tu es complètement guérie" lui disais-je à chacune de mes visites. "Rentre donc à la maison, je te soignerai". Elle souriait. Je parlais comme un grand, à la fois comme un homme et comme un médecin qui savait exactement ce qu'il y avait lieu de faire. J'aurai voulu la prendre à bras-le-corps et la porter dehors. "Une nuit, je viendrai te voler" lui dis-je.
Elle (la maman) entreprit de lire avec moi Schiller en allemand et Shakespeare en anglais.
Elle revenait ainsi à ses anciennes amours, au théâtre, cultivant en même temps le souvenir de mon père avec qui elle avait tant parlé de ces choses autrefois. Elle s'efforçait de ne pas m'influencer. Elle voulait savoir, après chaque scène, comment je l'avais comprise, et c'était toujours moi qui parlais le premier, elle n'intervenait qu'après coup. Parfois, il se faisait tard, elle oubliait l'heure, nous continuions à lire : elle s'enthousiasmait pour quelque chose et je savais alors que la lecture ne se terminerait pas de sitôt. Cela dépendait aussi un peu de moi. Plus mes réactions étaient sensées et mon commentaire éloquent, plus l'expérience passée remontait avec force en elle. Quand elle s'enthousiasmait pour l'une ou l'autre de ces choses auxquelles elle était si profondément attachées, je savais que la veillée était faite pour durer : l'heure à laquelle je me coucherais n'avait alors plus aucune importance ; elle ne pouvait pas davantage se passer de moi que moi d'elle, elle me parlait comme à un adulte, faisait l'éloge de tel acteur dans tel rôle, critiquait éventuellement tel autre qui l'avait déçue, encore que ce dernier cas ne se produisît que rarement. Elle parlait de préférence de ce qui lui avait plu d'emblée, sans réserve ni restriction. Les ailes de son nez frémissaient au-dessus des narines largement ouvertes, ce n'était plus moi que voyaient ses grands yeux gris, ce n'était plus à moi qu'elle s'adressait. Quand elle était la proie de ce genre d'émotions, je sentais bien qu'elle parlait à mon père et peut-être m'identifiais-je alors effectivement à lui sans même m'en apercevoir.
Elle revenait ainsi à ses anciennes amours, au théâtre, cultivant en même temps le souvenir de mon père avec qui elle avait tant parlé de ces choses autrefois. Elle s'efforçait de ne pas m'influencer. Elle voulait savoir, après chaque scène, comment je l'avais comprise, et c'était toujours moi qui parlais le premier, elle n'intervenait qu'après coup. Parfois, il se faisait tard, elle oubliait l'heure, nous continuions à lire : elle s'enthousiasmait pour quelque chose et je savais alors que la lecture ne se terminerait pas de sitôt. Cela dépendait aussi un peu de moi. Plus mes réactions étaient sensées et mon commentaire éloquent, plus l'expérience passée remontait avec force en elle. Quand elle s'enthousiasmait pour l'une ou l'autre de ces choses auxquelles elle était si profondément attachées, je savais que la veillée était faite pour durer : l'heure à laquelle je me coucherais n'avait alors plus aucune importance ; elle ne pouvait pas davantage se passer de moi que moi d'elle, elle me parlait comme à un adulte, faisait l'éloge de tel acteur dans tel rôle, critiquait éventuellement tel autre qui l'avait déçue, encore que ce dernier cas ne se produisît que rarement. Elle parlait de préférence de ce qui lui avait plu d'emblée, sans réserve ni restriction. Les ailes de son nez frémissaient au-dessus des narines largement ouvertes, ce n'était plus moi que voyaient ses grands yeux gris, ce n'était plus à moi qu'elle s'adressait. Quand elle était la proie de ce genre d'émotions, je sentais bien qu'elle parlait à mon père et peut-être m'identifiais-je alors effectivement à lui sans même m'en apercevoir.
Quand il rentrait de l'affaire, mon père se mettait aussitôt à parler avec ma mère. Ils s'aimaient beaucoup en ce temps-là, ils avaient une langue bien à eux, inconnue de moi, l'allemand, la langue qui les ramenait au temps heureux où ils étaient étudiants à Vienne. Ils parlaient de préférence du Burgtheater où ils avaient vu, avant même de se connaître, les mêmes pièces et les mêmes acteurs, et ils n'en finissaient plus alors d'évoquer leurs souvenirs. J'appris plus tard qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre au cours de semblables conversations et, alors qu'ils n'avaient pas réussi, séparément, à réaliser leur rêve de théâtre - tous deux auraient voulu devenir comédiens, - ils parvinrent ensemble à faire accepter l'idée d'un mariage qui suscitait de nombreuses résistances.
Issu de l'une des plus anciennes opulentes familles sépharades espagnoles de Bulgarie, grand-père Arditti s'opposait au mariage de sa fille cadette, sa préférée, avec le fils d'un parvenu d'Andrinople. Grand-père Canetti ne devait sa réussite qu'à lui-même. Pour un orphelin abusé qui tout jeune, s'était retrouvé dans la rue, livré à lui-même, il n'avait pas trop mal réussi : aux yeux de l'autre grand-père, il restait un comédien et un menteur. "Es mentiroso " - "C'est un menteur" lui avais je moi-même entendu dire, un jour que j'étais là, l'écoutant sans qu'il s'en doutât. De son côté, grand-père Canetti se plaçait au-dessus de l'orgueil de ces Arditti qui le prenaient de si haut avec lui. N'importe quelle jeune fille de bonne famille pouvait convenir à son fils et il estimait que c'était s'abaisser inutilement que de vouloir se marier précisément avec la fille Arditti!
page 38
Issu de l'une des plus anciennes opulentes familles sépharades espagnoles de Bulgarie, grand-père Arditti s'opposait au mariage de sa fille cadette, sa préférée, avec le fils d'un parvenu d'Andrinople. Grand-père Canetti ne devait sa réussite qu'à lui-même. Pour un orphelin abusé qui tout jeune, s'était retrouvé dans la rue, livré à lui-même, il n'avait pas trop mal réussi : aux yeux de l'autre grand-père, il restait un comédien et un menteur. "Es mentiroso " - "C'est un menteur" lui avais je moi-même entendu dire, un jour que j'étais là, l'écoutant sans qu'il s'en doutât. De son côté, grand-père Canetti se plaçait au-dessus de l'orgueil de ces Arditti qui le prenaient de si haut avec lui. N'importe quelle jeune fille de bonne famille pouvait convenir à son fils et il estimait que c'était s'abaisser inutilement que de vouloir se marier précisément avec la fille Arditti!
page 38
Elle (la mère de Canetti ) avait acquis la conviction que toutes les religions se valent . Elle pensait qu'il fallait se référer à ce qu'elles avaient en commun et régler sa conduite là-dessus . Des guerres sanglantes , impitoyables , avaient été menées au nom de telle ou telle religion , c'était une raison supplémentaire de s'en méfier . sans compter que la religion détournait l'homme de certaines graves questions qui restaient à résoudre . Elle était convaincue que les hommes étaient capables du pire ; la preuve irréfutable de la faillite de toutes les religions résidait , à ses yeux , dans le fait qu'elles n'avaient pa su faire obstacle à la guerre . Quand des ecclésiastiques de toutes les confessions allèrent jusqu'à bénir les armes avec lesquelles des hommes qui ne se connaissaient même pas s'entre-tueraient bientôt .
Orgueil familial
Roustchouk, sur le Danube inférieur, où je suis venu au monde, était une ville merveilleuse pour un enfant, et si je me bornais à la situer en Bulgarie, on s’en ferait à coup sûr une idée tout à fait incomplète : des gens d’origines diverses vivaient là et l’on pouvait entendre parler sept ou huit langues différentes dans la journée. Hormis les Bulgares, le plus souvent venus de la campagne, il y avait beaucoup de Turcs qui vivaient dans un quartier bien à eux, et, juste à côté, le quartier des sépharades espagnols, le nôtre. On rencontrait des Grecs, des Albanais, des Arméniens, des Tziganes. Les Roumains venaient de l’autre côté du Danube, ma nourrice était roumaine mais je ne m’en souviens pas. Il y avait aussi des Russes, peu nombreux il est vrai.
Enfant, je n’avais pas une vision d’ensemble de cette multiplicité mais j’en ressentais constamment les effets. Certains personnages sont restés gravés dans ma mémoire uniquement parce qu’ils appartenaient à des ethnies particulières, se distinguant des autres par leur tenue vestimentaire. Parmi les domestiques qui travaillèrent à la maison pendant ces six années, il y eut une fois un Tcherkesse et, plus tard, un Arménien. La meilleure amie de ma mère était une Russe nommée Olga. Une fois par semaine, des Tziganes s’installaient dans notre cour ; toute une tribu, me semblait-il, tellement ils étaient nombreux, mais il sera encore question, ultérieurement, des terreurs qu’ils m’inspirèrent.
Comme ville portuaire sur le Danube, Roustchouk avait eu une certaine importance dans le passé. Le port avait attiré des gens de partout et il était constamment question du Danube. On parlait des années où le Danube était gelé ; des traversées qu’on faisait en traîneau, sur la glace, pénétrant en territoire roumain ; des loups affamés talonnant les chevaux attelés aux traîneaux.
Les loups sont les premiers animaux sauvages dont j’ai entendu parler. Dans les contes que me faisaient les jeunes paysannes bulgares, il était souvent question de loups-garous et mon père me fit terriblement peur, une nuit, en se montrant à moi avec un masque de loup sur le visage.
Je n’arriverai sans doute pas à évoquer d’une manière satisfaisante les riches couleurs de ces premières années à Roustchouk, les passions et les terreurs dont elles furent traversées. Rien de ce que je vivrai plus tard qui ne se fût déjà produit, sous une forme ou sous une autre, à Roustchouk, en ce temps-là. L’Europe, là, c’était le reste du monde. Quand quelqu’un remontait le Danube vers Vienne, on disait : il va en Europe ; l’Europe commençait là où finissait autrefois l’Empire ottoman. La plupart des sépharades espagnols avaient gardé la nationalité turque. Il est vrai qu’ils n’avaient jamais eu à souffrir des Turcs, ce qui n’était pas le cas des Slaves chrétiens des Balkans. Nombre d’entre eux étaient des commerçants aisés, le nouveau régime bulgare était bien disposé à leur égard et Ferdinand, le roi qui régna longtemps, passait pour un ami des Juifs.
La position des sépharades espagnols était un peu spéciale. C’étaient des Juifs croyants, donc très attachés à la communauté. Mais si cette dernière était présente, quoique sans ostentation, au centre de l’existence de chacun, il n’en reste pas moins vrai qu’ils se prenaient pour des Juifs d’une espèce particulière, ce qui était en rapport direct avec une longue tradition espagnole. L’espagnol qu’ils parlaient entre eux était pratiquement le même que celui qu’ils parlaient, des siècles auparavant, quand on les avait chassés de la péninsule. Quelques mots turcs avaient été incorporés à cette langue mais cela restait des mots turcs, reconnaissables comme tels, et l’on disposait d’ailleurs presque toujours du mot espagnol correspondant. Les premières chansons enfantines que j’entendis me furent chantes en espagnol, j’ai été bercé par ces anciennes « romances » ibériques, mais ce qui m’a le plus marqué, ce qui ne pouvait manquer d’impressionner profondément l’enfant, c’est, si je puis dire, une certaine mentalité espagnole. Les autres juifs, on les regardait de haut, avec un sentiment de naïve supériorité. Un mot invariablement chargé de mépris était le mot « Tudesco », désignant un Juif allemand ou un Ashkénaze. Il eût été impensable d’épouser une « Tudesca » et je ne crois pas qu’aucune exception n’ait jamais été faite à cette règle, parmi les nombreuses familles dont j’ai entendu parler à Roustchouk, pendant toutes ces années. Je n’avais pas six ans que mon grand-père, soucieux de l’avenir, me mettait déjà en garde contre une telle mésalliance. Mais cette discrimination générale n’était pas la seule. A l’intérieur même de la communauté des sépharades espagnols, une place à part était faite aux bonnes familles, c’est-à-dire à celles qui étaient riches depuis longtemps. Es de buena familia, il est de bonne famille, c’était à peu près ce qu’il y avait de plus flatteur à dire de quelqu’un. Combien de fois, et jusqu’à satiété, n’ai-je entendu ma mère répéter cela. Quand elle rêvait tout haut du Burgtheater et qu’on lisait Shakespeare ensemble et, bien plus tard encore, quand elle ne jurait que par Strindberg, devenu entretemps son auteur de prédilection, jamais elle ne se gêna pour affirmer qu’elle sortait d’une bonne famille, qu’il n’y en avait point de meilleure. Littéralement nourrie des littératures des différentes langues de culture qu’elle maîtrisait, elle ne trouvait nullement contradictoire ce désir d’universalité et l’orgueil familial dont elle était si intimement pénétrée. […]
Roustchouk, sur le Danube inférieur, où je suis venu au monde, était une ville merveilleuse pour un enfant, et si je me bornais à la situer en Bulgarie, on s’en ferait à coup sûr une idée tout à fait incomplète : des gens d’origines diverses vivaient là et l’on pouvait entendre parler sept ou huit langues différentes dans la journée. Hormis les Bulgares, le plus souvent venus de la campagne, il y avait beaucoup de Turcs qui vivaient dans un quartier bien à eux, et, juste à côté, le quartier des sépharades espagnols, le nôtre. On rencontrait des Grecs, des Albanais, des Arméniens, des Tziganes. Les Roumains venaient de l’autre côté du Danube, ma nourrice était roumaine mais je ne m’en souviens pas. Il y avait aussi des Russes, peu nombreux il est vrai.
Enfant, je n’avais pas une vision d’ensemble de cette multiplicité mais j’en ressentais constamment les effets. Certains personnages sont restés gravés dans ma mémoire uniquement parce qu’ils appartenaient à des ethnies particulières, se distinguant des autres par leur tenue vestimentaire. Parmi les domestiques qui travaillèrent à la maison pendant ces six années, il y eut une fois un Tcherkesse et, plus tard, un Arménien. La meilleure amie de ma mère était une Russe nommée Olga. Une fois par semaine, des Tziganes s’installaient dans notre cour ; toute une tribu, me semblait-il, tellement ils étaient nombreux, mais il sera encore question, ultérieurement, des terreurs qu’ils m’inspirèrent.
Comme ville portuaire sur le Danube, Roustchouk avait eu une certaine importance dans le passé. Le port avait attiré des gens de partout et il était constamment question du Danube. On parlait des années où le Danube était gelé ; des traversées qu’on faisait en traîneau, sur la glace, pénétrant en territoire roumain ; des loups affamés talonnant les chevaux attelés aux traîneaux.
Les loups sont les premiers animaux sauvages dont j’ai entendu parler. Dans les contes que me faisaient les jeunes paysannes bulgares, il était souvent question de loups-garous et mon père me fit terriblement peur, une nuit, en se montrant à moi avec un masque de loup sur le visage.
Je n’arriverai sans doute pas à évoquer d’une manière satisfaisante les riches couleurs de ces premières années à Roustchouk, les passions et les terreurs dont elles furent traversées. Rien de ce que je vivrai plus tard qui ne se fût déjà produit, sous une forme ou sous une autre, à Roustchouk, en ce temps-là. L’Europe, là, c’était le reste du monde. Quand quelqu’un remontait le Danube vers Vienne, on disait : il va en Europe ; l’Europe commençait là où finissait autrefois l’Empire ottoman. La plupart des sépharades espagnols avaient gardé la nationalité turque. Il est vrai qu’ils n’avaient jamais eu à souffrir des Turcs, ce qui n’était pas le cas des Slaves chrétiens des Balkans. Nombre d’entre eux étaient des commerçants aisés, le nouveau régime bulgare était bien disposé à leur égard et Ferdinand, le roi qui régna longtemps, passait pour un ami des Juifs.
La position des sépharades espagnols était un peu spéciale. C’étaient des Juifs croyants, donc très attachés à la communauté. Mais si cette dernière était présente, quoique sans ostentation, au centre de l’existence de chacun, il n’en reste pas moins vrai qu’ils se prenaient pour des Juifs d’une espèce particulière, ce qui était en rapport direct avec une longue tradition espagnole. L’espagnol qu’ils parlaient entre eux était pratiquement le même que celui qu’ils parlaient, des siècles auparavant, quand on les avait chassés de la péninsule. Quelques mots turcs avaient été incorporés à cette langue mais cela restait des mots turcs, reconnaissables comme tels, et l’on disposait d’ailleurs presque toujours du mot espagnol correspondant. Les premières chansons enfantines que j’entendis me furent chantes en espagnol, j’ai été bercé par ces anciennes « romances » ibériques, mais ce qui m’a le plus marqué, ce qui ne pouvait manquer d’impressionner profondément l’enfant, c’est, si je puis dire, une certaine mentalité espagnole. Les autres juifs, on les regardait de haut, avec un sentiment de naïve supériorité. Un mot invariablement chargé de mépris était le mot « Tudesco », désignant un Juif allemand ou un Ashkénaze. Il eût été impensable d’épouser une « Tudesca » et je ne crois pas qu’aucune exception n’ait jamais été faite à cette règle, parmi les nombreuses familles dont j’ai entendu parler à Roustchouk, pendant toutes ces années. Je n’avais pas six ans que mon grand-père, soucieux de l’avenir, me mettait déjà en garde contre une telle mésalliance. Mais cette discrimination générale n’était pas la seule. A l’intérieur même de la communauté des sépharades espagnols, une place à part était faite aux bonnes familles, c’est-à-dire à celles qui étaient riches depuis longtemps. Es de buena familia, il est de bonne famille, c’était à peu près ce qu’il y avait de plus flatteur à dire de quelqu’un. Combien de fois, et jusqu’à satiété, n’ai-je entendu ma mère répéter cela. Quand elle rêvait tout haut du Burgtheater et qu’on lisait Shakespeare ensemble et, bien plus tard encore, quand elle ne jurait que par Strindberg, devenu entretemps son auteur de prédilection, jamais elle ne se gêna pour affirmer qu’elle sortait d’une bonne famille, qu’il n’y en avait point de meilleure. Littéralement nourrie des littératures des différentes langues de culture qu’elle maîtrisait, elle ne trouvait nullement contradictoire ce désir d’universalité et l’orgueil familial dont elle était si intimement pénétrée. […]
Mon premier souvenir
Mon souvenir le plus ancien est baigné de rouge. Je sors par une porte, sur le bras d’une jeune fille, le sol devant moi est rouge, à gauche d’une descente d’escalier, rouge également. En face de nous, à la même hauteur, une porte s’ouvre, laissant passer un homme qui avance à ma rencontre en me souriant gentiment. Arrivé tout près de moi, il s’arrête et me dit : « Fais voir ta langue ! » Je tire la langue, il fourre la main dans sa poche, en sort un canif, l’ouvre et porte la lame presque contre ma langue. Il dit : « Maintenant, on va lui couper la langue. » Moi, je n’ose pas rentrer ma langue et le voilà qui arrive tout près avec son canif, la lame ne va pas tarder à toucher la langue. Au dernier moment, il retire sa main et dit : « Non, pas aujourd’hui, demain. » Il referme le canif et le remet dans sa poche.
Par cette porte, nous pénétrons chaque matin dans le vestibule rouge, la porte d’en face s’ouvre, et l’homme souriant paraît. Je sais ce qu’il va dire et j’attends qu’il m’ordonne de tirer la langue. Je sais qu’il finira par me la couper et j’ai de plus en plus peur. La journée commence ainsi et cela se reproduit fréquemment.
Je n’en parle pas sur le moment, beaucoup plus tard seulement j’interroge ma mère à ce sujet. A la couleur rouge elle reconnaît la pension de Karlsruhe où elle a passé l’été 1907 avec mon père et moi. Pour s’occuper du petit garçon de deux ans, ils ont ramené de Bulgarie une bonne d’enfant, elle-même âgée de quinze ans à peine. Elle a l’habitude de sortir de bon matin portant l’enfant sur son bras ; elle ne parle que le bulgare mais se débrouille parfaitement dans ce Karlsbad plein d’animation et rentre toujours à l’heure prévue avec l’enfant. Une fois, on la surprend avec un jeune homme inconnu, dans la rue, elle prétend ne rien savoir de lui, une rencontre tout à fait fortuite. Quelques semaines plus tard, on s’aperçoit que le jeune homme occupe la chambre juste en face de la nôtre, de l’autre côté du vestibule. La jeune fille va parfois le retrouver discrètement, en pleine nuit. Les parents se sentent responsables d’elle et la renvoient aussitôt en Bulgarie.
Tous deux, la jeune fille et le jeune homme, quittaient la maison de bon matin, c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, c’est ainsi que tout aura commencé. La menace du couteau a fait son effet, l’enfant s’est tu pendant dix ans.
Mon souvenir le plus ancien est baigné de rouge. Je sors par une porte, sur le bras d’une jeune fille, le sol devant moi est rouge, à gauche d’une descente d’escalier, rouge également. En face de nous, à la même hauteur, une porte s’ouvre, laissant passer un homme qui avance à ma rencontre en me souriant gentiment. Arrivé tout près de moi, il s’arrête et me dit : « Fais voir ta langue ! » Je tire la langue, il fourre la main dans sa poche, en sort un canif, l’ouvre et porte la lame presque contre ma langue. Il dit : « Maintenant, on va lui couper la langue. » Moi, je n’ose pas rentrer ma langue et le voilà qui arrive tout près avec son canif, la lame ne va pas tarder à toucher la langue. Au dernier moment, il retire sa main et dit : « Non, pas aujourd’hui, demain. » Il referme le canif et le remet dans sa poche.
Par cette porte, nous pénétrons chaque matin dans le vestibule rouge, la porte d’en face s’ouvre, et l’homme souriant paraît. Je sais ce qu’il va dire et j’attends qu’il m’ordonne de tirer la langue. Je sais qu’il finira par me la couper et j’ai de plus en plus peur. La journée commence ainsi et cela se reproduit fréquemment.
Je n’en parle pas sur le moment, beaucoup plus tard seulement j’interroge ma mère à ce sujet. A la couleur rouge elle reconnaît la pension de Karlsruhe où elle a passé l’été 1907 avec mon père et moi. Pour s’occuper du petit garçon de deux ans, ils ont ramené de Bulgarie une bonne d’enfant, elle-même âgée de quinze ans à peine. Elle a l’habitude de sortir de bon matin portant l’enfant sur son bras ; elle ne parle que le bulgare mais se débrouille parfaitement dans ce Karlsbad plein d’animation et rentre toujours à l’heure prévue avec l’enfant. Une fois, on la surprend avec un jeune homme inconnu, dans la rue, elle prétend ne rien savoir de lui, une rencontre tout à fait fortuite. Quelques semaines plus tard, on s’aperçoit que le jeune homme occupe la chambre juste en face de la nôtre, de l’autre côté du vestibule. La jeune fille va parfois le retrouver discrètement, en pleine nuit. Les parents se sentent responsables d’elle et la renvoient aussitôt en Bulgarie.
Tous deux, la jeune fille et le jeune homme, quittaient la maison de bon matin, c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, c’est ainsi que tout aura commencé. La menace du couteau a fait son effet, l’enfant s’est tu pendant dix ans.
Fort heureusement, il est des expériences rares et même uniques qui vous marquent d'autant plus profondément qu'elles ne se renouvellent pas.
...mon père lisait journellement le Neue freie Presse, et c'était un grand moment quand il dépliait son journal. Il n'avait plus d'yeux pour moi une fois qu'il avait commencé à lire, je savais qu'il ne me répondrait en aucun cas...Je cherchais à savoir ce que le journal pouvait bien avoir de si attirant; au début, je pensais que c'était son odeur ; quand j'étais seul et que personne ne me voyait, je grimpais sur la chaise et flairais avidement le journal. Ensuite seulement , je m'aperçus que la tête de mon père ne cessait de pivoter tout le long du journal; je fis de même derrière son dos, tandis que je jouais par terre, donc sans même avoir sous les yeux le journal qu'il tenait à deux mains sur la table. Un visiteur entra une fois à l'improviste et appela mon père qui se retourna et me surprit lisant un journal imaginaire.
Un peu plus tard, complètement calmé, il me dit : "Tu ne vaux pas la peine que je me donne à t'enseigner la loi. Tu l'apprendras donc à tes dépens, par l'expérience. Tu ne mérites pas mieux."
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Elias Canetti (22)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1721 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1721 lecteurs ont répondu