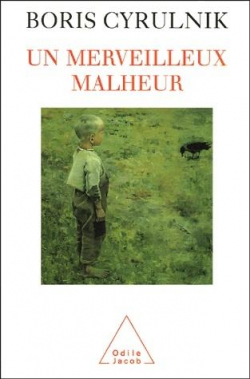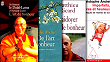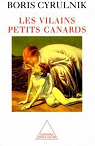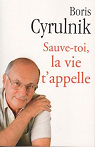Citations sur Un merveilleux malheur (102)
Aimer I'histoire de la vie de l'autre, c'est accepter une relation intime par récit ou livre interposé. A l'inverse, ceux qui sont gênés par l'aveu, et éprouvent une sensation d'impudeur (« Il se met à nu ») témoignent d'une intention de n'établir leurs relations que par les circuits sociaux convenables. Ils se protègent d'une rencontre intime avec l'auteur derrière la convention des stéréotypes sociaux. « Je » n'existe que par le « on ». Quand le moi est fragile, le nous sert de prothèse. Ce cadre identitaire est très agréable, car il permet la communion en adorant la même idole et en récitant les mêmes litanies. Mais l'individu n'a le droit de s'exprimer qu'en tant que membre de cette communauté. Le sentiment d'appartenance est délicieux mais il mène à l'amputation de l'individu et au mépris de ceux qui adorent d'autres idoles et récitent d'autres slogans.
Les troubles de I'affectivité persistent longtemps puisque les enfants veulent séduire ceux qui les maltraitent et maltraitent ceux qui les séduisent. Mais l'idéalisation et l'intellectualisation se mettent en place très tôt et protègent les enfants. Paradoxalement, quand on les sépare de leurs parents maltraitants, on accentue leur idéalisation. Ils se mettent alors à rêver des parents parfaits qu'ils auraient tant voulu connaître.
Les chercheurs ont eut deux surprises.
La première fut de comprendre que ceux qui avaient eu l'enfance la plus dure (parmi ces privilégiés) furent ceux qui avaient connu la vie adulte la plus épanouie, probablement parce qu'à l'âge de 18 ans, ils avaient été contraints par leurs petites épreuves de mettre en place des défenses positives. Alors que ceux qui avaient connu une enfance protégée avaient moins su affronter les épreuves de la vie.
La seconde surprise fut de constater que les mécanismes de défense le plus souvent retrouvés chez les adultes épanouis étaient les mêmes que ceux que l'on pouvait noter dans une population d'enfants résilients maltraités :
-La sublimation, quand la force de vivre est orientée vers des activités socialement valorisées, comme les activités artistiques, intellectuelles ou morales, Cette vitalité, aimantée par la société, permet aux blessés de l'âme, petits et grands, d'éviter le refoulement et de s'exprimer en entier, pour le plus grand bonheur de tous.
- Le contrôle des affects est associé à la sublimation : ni colère, ni désespoir, ni rumination, ni passages à l'acte brutaux, pour satisfaire les besoins immédiats. Une douce gestion du temps, une aptitude à retarder la réalisation des désirs et à les transformer, afin de les rendre acceptables. L'altruisme a été un trait caractéristique de cette population. Le dévouement à autrui permet d'échapper au conflit intérieur et permet de se faire aimer grâce au bonheur qu'on donne. Le retour est énorme, Cest une bonne affaire. L'humour a également été une défense précieuse. La représentation de l'événement traumatisant, destiné aux autres, permet de prendre de la distance, de moins se laisser entamer par l'épreuve et même d'en retirer un petit bénéfice de comédien.
Finalement, une population d'enfants maltraités donne à peu près vingt-cing pour cent de dépressions récidivantes au cours de l'existence. Ce chiffre énorme correspond au pourcentage de dépressions dans la population témoin et même dans la population privilégiée.
Alors? Il n'y aurait pas de différence entre la maltraitance et la bientraitance? Si l'on ne faisait parler que les chiffres, on risquerait d'arriver à une telle interprétation. Le seul moyen d'expliquer ce paradoxe, c'est d'apprendre à raisonner en termes de résilience. À chaque étape de l'histoire de l'enfant existe une possibilité de réparation ou d'aggravation.
La première fut de comprendre que ceux qui avaient eu l'enfance la plus dure (parmi ces privilégiés) furent ceux qui avaient connu la vie adulte la plus épanouie, probablement parce qu'à l'âge de 18 ans, ils avaient été contraints par leurs petites épreuves de mettre en place des défenses positives. Alors que ceux qui avaient connu une enfance protégée avaient moins su affronter les épreuves de la vie.
La seconde surprise fut de constater que les mécanismes de défense le plus souvent retrouvés chez les adultes épanouis étaient les mêmes que ceux que l'on pouvait noter dans une population d'enfants résilients maltraités :
-La sublimation, quand la force de vivre est orientée vers des activités socialement valorisées, comme les activités artistiques, intellectuelles ou morales, Cette vitalité, aimantée par la société, permet aux blessés de l'âme, petits et grands, d'éviter le refoulement et de s'exprimer en entier, pour le plus grand bonheur de tous.
- Le contrôle des affects est associé à la sublimation : ni colère, ni désespoir, ni rumination, ni passages à l'acte brutaux, pour satisfaire les besoins immédiats. Une douce gestion du temps, une aptitude à retarder la réalisation des désirs et à les transformer, afin de les rendre acceptables. L'altruisme a été un trait caractéristique de cette population. Le dévouement à autrui permet d'échapper au conflit intérieur et permet de se faire aimer grâce au bonheur qu'on donne. Le retour est énorme, Cest une bonne affaire. L'humour a également été une défense précieuse. La représentation de l'événement traumatisant, destiné aux autres, permet de prendre de la distance, de moins se laisser entamer par l'épreuve et même d'en retirer un petit bénéfice de comédien.
Finalement, une population d'enfants maltraités donne à peu près vingt-cing pour cent de dépressions récidivantes au cours de l'existence. Ce chiffre énorme correspond au pourcentage de dépressions dans la population témoin et même dans la population privilégiée.
Alors? Il n'y aurait pas de différence entre la maltraitance et la bientraitance? Si l'on ne faisait parler que les chiffres, on risquerait d'arriver à une telle interprétation. Le seul moyen d'expliquer ce paradoxe, c'est d'apprendre à raisonner en termes de résilience. À chaque étape de l'histoire de l'enfant existe une possibilité de réparation ou d'aggravation.
Le moyen le plus efficace et finalement assez rapide de les resocialiser, c'est la métamorphose du traumatisme. Dès l'instant où l'on peut parler du traumatisme, le dessiner, le mettre en scène ou le penser, on maitrise l'émotion qui nous débordait ou nous glaçait, au moment du choc. C'est dans la représentation de la tragédie qu'on remanie le sentiment provoqué par le fracas.
Le sentiment de soi devient une sorte de prémice d'identité, comme une image de soi plantée dans l'enfant par le regard de l'autre : « Je suis celui que l'autre regarde avec un dégoût horrifié, parce qu'il sait que je suis né d'un viol... Dans son regard je suis pestiféré. » L'effet façonnant de l'autre dure ce que dure la mémoire : il a des effets à long terme tant que la mémoire permet des performances durables, mais plus la personnalité se construit, plus le regard de l'autre ne provoque que des émotions brèves.
[...] Pour un enfant qui ne sait pas encore qui il est, ni ce qu'il vaut, ce regard possède le pouvoir d'imprégner un découragement en lui. Alors que pour l'adulte historisé, le même comportement provoque une brève émotion de condescendance enjouée : "Il n'a rien compris, ma vie a démontré le contraire"
Cette violence chronique, ces indices comportementaux qui ne font pas événement et ne sont pas historisables, possèdent probablement un effet dévastateur sur une personnalité en cours de développement, plus durable qu'un traumatisme aigu qui, lui, est plus facile à raconter.
[...] Pour un enfant qui ne sait pas encore qui il est, ni ce qu'il vaut, ce regard possède le pouvoir d'imprégner un découragement en lui. Alors que pour l'adulte historisé, le même comportement provoque une brève émotion de condescendance enjouée : "Il n'a rien compris, ma vie a démontré le contraire"
Cette violence chronique, ces indices comportementaux qui ne font pas événement et ne sont pas historisables, possèdent probablement un effet dévastateur sur une personnalité en cours de développement, plus durable qu'un traumatisme aigu qui, lui, est plus facile à raconter.
Par ailleurs, les études sur les migrants nous ont appris que lorsqu'il n'y a pas de structures affectives et sociales autour d'un jeune, l'intensité de son désir n'est pas canalisée. Or, quand une forte énergie n'est pas utilisée, elle se transforme en violence qui explose à la moindre occasion. Comme pour les migrants, les orphelins, dont la structure familiale ou sociale a été brisée, peuvent devenir créateurs si on leur donne un lieu de parole, autant qu'ils peuvent devenir délinquants quand leur énergie ne trouve aucun lieu d'expression.
On aime les victimes tant qu'elles sont misérables parce que, en les aidant, on se sent tellement bon. Mais quand les martyrs se transforment en héros, quand ils accèdent au pouvoir, ils deviennent suspects, car il est contre nature qu'une proie se métamorphose en prédateur.
Et puis, les survivants sont porteurs de mauvaises nouvelles. Ils nous fatiguent avec leur malheur. Raconter son inceste à table, c'est d'un très mauvais goût. Raconter sa déportation, pour nous culpabiliser? Ou nous faire pleurer ? Ou revendiquer une pension supplémentaire?
Enfin les survivants sont immoraux quand la vie leur sourit après la mort de leurs proches. Dans une culture de la mélancolie, la fête est toujours sale. Il y a quelque chose de honteux à être heureux quand nos parents sont en train de mourir. Or, c'est ce qui se passe pour les enfants résilients qui refusent de couler avec veux qu'ils aiment.
Et puis, les survivants sont porteurs de mauvaises nouvelles. Ils nous fatiguent avec leur malheur. Raconter son inceste à table, c'est d'un très mauvais goût. Raconter sa déportation, pour nous culpabiliser? Ou nous faire pleurer ? Ou revendiquer une pension supplémentaire?
Enfin les survivants sont immoraux quand la vie leur sourit après la mort de leurs proches. Dans une culture de la mélancolie, la fête est toujours sale. Il y a quelque chose de honteux à être heureux quand nos parents sont en train de mourir. Or, c'est ce qui se passe pour les enfants résilients qui refusent de couler avec veux qu'ils aiment.
Les survivants se sentent coupables, ce qui explique leurs fréquents comportements d'expiation. Vu de l'extérieur, on parle de « générosité » ou « d'austérité ». En fait, l'oblation qui consiste à donner à nos propres dépens est une bonne affaire puisqu'elle permet de se déculpabiliser. En se dépouillant pour les autres, on se sent moins criminel, on a moins tué nos parents et on devient alors celui par qui le bonheur arrive. Ce comportement qui nous ruine change le sentiment de soi et transforme un coupable en généreux donateur.
Toute mise à l'épreuve intime prend un effet ordalique : si je triomphe encore, si le jugement de Dieu m'accorde la victoire, si je surmonte l'épreuve des éléments naturels, de l'eau et du feu, si je domine la faim, le froid et l'hostilité sociale, je me fournirai la preuve que jai le droit de vivre malgré ma culpabilité. Mais ce combat se déroule sur le fil du rasoir. Si par malheur j'échoue, je confirmerai qu'on avait bien raison de vouloir me tuer.
Le biculturalisme n'est pas la solution la plus facile puisqu'il exige l'apprentissage de deux mondes mentaux. II semble pourtant plus humain et plus riche. Le stress d'acculturation s'estompe quand on est entouré. Cette sécurisation sert de camp de base pour explorer et apprendre la culture d'accueil. Les Mexicains bilingues du sud des États-Unis manifestent presque trois fois moins de problèmes médicaux que ceux qui ne parlent pas l'anglais. Les Coréens canadiens les plus marginalisés et les plus stressés sont ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Quand les parents ne parlent que le langage de leurs origines et que les enfants n'apprennent que celui du pays d'accueil, ce déchirement linguistique entraîne un clivage familial où chaque génération ne comprend pas l'autre, ce qui est très injuste car les parents, presque toujours, ne veulent pas apprendre la langue de leurs origines aux enfants afin qu'ils s'assimilent plus rapidement.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Boris Cyrulnik (75)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres de Cyrulnik
Un merveilleux...
jour
malheur
problème
sentiment
10 questions
47 lecteurs ont répondu
Thème :
Boris CyrulnikCréer un quiz sur ce livre47 lecteurs ont répondu