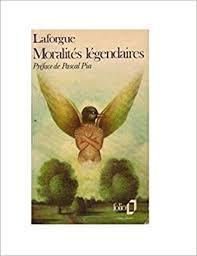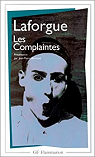Dans "Persée et Andromède", la dernière de ces moralités, Persée n'est plus qu'un "vilain héros d'opéra-comique" et Andromède finit même par regretter le monstre qui veillait sur elle sur une île désolée et que Persée vient de tuer dans un combat mythologique qui tourne à la parodie . Jules Laforgue prend donc beaucoup de libertés avec des personnages devenus légendaires : Hamlet, Lohengrin, Salomé, Pan, Persée et Andromède. Jules Laforgue les ridiculise souvent, les transforme selon une fantaisie débordante, mais peut-être qu'au bout de ce traitement il les rend plus véritables également, exprimant davantage ce qu'est notre condition. "L'angoisse métaphysique et le besoin d'amour, voilà, en vérité, les thèmes essentiels des Moralités légendaires." Poésie, ironie, tendresse, désespoir, mélancolie... le poète nous entraîne dans un véritable tourbillon.
« A-t-il fallu qu'il adorât la Beauté (…) pour l'insulter avec tant de soin, pour s'ingénier, comme il le fait, tout le long de son livre, à en dénaturer les formules ! »
Cette réflexion de Léon Bloy sur Lautréamont m'est revenue au moment de songer à un autre poète français né à Montevideo. Je veux parler de Jules Laforgue, dont la démarche dans ces Moralités Légendaires me paraît comparable à celle que Bloy prête à son aîné dans Les chants de Maldoror. En effet, avec ce recueil, Laforgue s'évertue à défigurer les héros des chefs d'oeuvres d'antan : Hamlet, Persée et Andromède, Elsa et Lohengrin, Pan, Salomé, Saint Jean-Baptiste… ils perdent tous la tête, afin que notre poète leur substitue les traits de son visage facétieux.
L'image que ces personnages donnaient autrefois de l'amour et de la mort est ici raillée, parodiée, désacralisée, massacrée, « massacrilégée », pour reprendre le néologisme de la belle Elsa, qui aimerait bien se voir infliger ce sort par un Lohengrin regrettant, au pied d'un lit conjugal luxuriant, les hauteurs métaphysiques dont son cygne l'a fait descendre ! À l'inverse, Hamlet cherche en vain à échapper à l'attrait morbide des symboles évoquant Ophélie et sa tombe, sans que le cynisme et sa nouvelle amante ne lui soient d'aucun secours.
En somme, l'amour ne s'accomplit pas facilement : ce bel idéal est ankylosé par des symboles et des discours volontairement grotesques, qui oblitèrent la rencontre entre l'homme et la femme. La nouvelle sur Salomé pousse ce procédé à son paroxysme, car l'héroïne et Iokanaan ne communiquent pas, tandis que la danse iconique de Salomé se retrouve transposée dans la seule narration, qui fait perdre la voix au saint et entraîne le lecteur dans un ahurissant grand-huit d'exotisme baroque effréné, au rythme de loopings syntaxiques et de mots rares s'étageant jusqu'à des hauteurs lexicales suffocantes. En guise d'apogée, Salomé étouffe à son tour la parole du narrateur pour achever le pauvre lecteur d'une logorrhée crypto-érotico-bouddhiste pleine de fumisterie, où Laforgue n'est pas loin d'asphyxier sa propre philosophie.
Car oui, même la beauté de son oeuvre d'écrivain et de sa vie, Laforgue ne la respecte pas. Au point de se moquer inconsciemment de son avenir dans la plus courte histoire, le miracle des roses, où un amant suicidé envoie maladroitement des pétales rouges sang recouvrir la poitrine d'une phtisique, lui offrant le faux espoir d'une guérison. L'oeuvre de Laforgue est-elle semblable à ces pétales de roses pouvant encore faire croire à sa vie, même après que la maladie l'eût emporté à 27 ans ?
Un sort d'autant plus triste que la seule moralité où l'amour parvient à s'accomplir est la toute dernière, que Laforgue composa pendant sa brève existence d'homme marié : répugnée par la pseudo-beauté surfaite et hypocrite de Persée, Andromède s'abandonne au grotesque, au monstrueux, pour pousser cette logique jusqu'au bout et la faire éclater, retrouvant une forme originelle, une vérité simple et enfouie qui unifie le Tout : les mythes et les hommes. "Tout est dans tout", c'est la proto-moralité que Pan ne cesse de répéter comme un refrain, mis en musique par sa flûte pour lui redonner les "influx de vigueur et de tendresse réelle" chers à Rimbaud, car l'Adieu à la beauté peut permettre de mieux revenir à elle.
Cette réflexion de Léon Bloy sur Lautréamont m'est revenue au moment de songer à un autre poète français né à Montevideo. Je veux parler de Jules Laforgue, dont la démarche dans ces Moralités Légendaires me paraît comparable à celle que Bloy prête à son aîné dans Les chants de Maldoror. En effet, avec ce recueil, Laforgue s'évertue à défigurer les héros des chefs d'oeuvres d'antan : Hamlet, Persée et Andromède, Elsa et Lohengrin, Pan, Salomé, Saint Jean-Baptiste… ils perdent tous la tête, afin que notre poète leur substitue les traits de son visage facétieux.
L'image que ces personnages donnaient autrefois de l'amour et de la mort est ici raillée, parodiée, désacralisée, massacrée, « massacrilégée », pour reprendre le néologisme de la belle Elsa, qui aimerait bien se voir infliger ce sort par un Lohengrin regrettant, au pied d'un lit conjugal luxuriant, les hauteurs métaphysiques dont son cygne l'a fait descendre ! À l'inverse, Hamlet cherche en vain à échapper à l'attrait morbide des symboles évoquant Ophélie et sa tombe, sans que le cynisme et sa nouvelle amante ne lui soient d'aucun secours.
En somme, l'amour ne s'accomplit pas facilement : ce bel idéal est ankylosé par des symboles et des discours volontairement grotesques, qui oblitèrent la rencontre entre l'homme et la femme. La nouvelle sur Salomé pousse ce procédé à son paroxysme, car l'héroïne et Iokanaan ne communiquent pas, tandis que la danse iconique de Salomé se retrouve transposée dans la seule narration, qui fait perdre la voix au saint et entraîne le lecteur dans un ahurissant grand-huit d'exotisme baroque effréné, au rythme de loopings syntaxiques et de mots rares s'étageant jusqu'à des hauteurs lexicales suffocantes. En guise d'apogée, Salomé étouffe à son tour la parole du narrateur pour achever le pauvre lecteur d'une logorrhée crypto-érotico-bouddhiste pleine de fumisterie, où Laforgue n'est pas loin d'asphyxier sa propre philosophie.
Car oui, même la beauté de son oeuvre d'écrivain et de sa vie, Laforgue ne la respecte pas. Au point de se moquer inconsciemment de son avenir dans la plus courte histoire, le miracle des roses, où un amant suicidé envoie maladroitement des pétales rouges sang recouvrir la poitrine d'une phtisique, lui offrant le faux espoir d'une guérison. L'oeuvre de Laforgue est-elle semblable à ces pétales de roses pouvant encore faire croire à sa vie, même après que la maladie l'eût emporté à 27 ans ?
Un sort d'autant plus triste que la seule moralité où l'amour parvient à s'accomplir est la toute dernière, que Laforgue composa pendant sa brève existence d'homme marié : répugnée par la pseudo-beauté surfaite et hypocrite de Persée, Andromède s'abandonne au grotesque, au monstrueux, pour pousser cette logique jusqu'au bout et la faire éclater, retrouvant une forme originelle, une vérité simple et enfouie qui unifie le Tout : les mythes et les hommes. "Tout est dans tout", c'est la proto-moralité que Pan ne cesse de répéter comme un refrain, mis en musique par sa flûte pour lui redonner les "influx de vigueur et de tendresse réelle" chers à Rimbaud, car l'Adieu à la beauté peut permettre de mieux revenir à elle.
Oh! l'insoutenable légèreté de cette moralité légendaire! C'est Salomé à l'opéra -comique.
Laforgue aurait d'abord imaginé "la petite vocératrice jaune à pois funèbres" donnant sa langue -celle du Baptiste, cela va sans dire...- au chat!...
Moralités Légendaires est composé de six textes courts, des "nouvelles qui ne sont ni du Villiers ni du Maupassant"selon le mot de l'auteur, presque autant de variations (très) libres autour de grands mythes occidentaux. de Salomé à Hamlet, Laforgue jongle avec d'immenses figures sans se départir un instant de sa désinvolture et de son ironie. En effet, ces fables qui paraissent pourtant bien insouciantes sont toutes traversées d'une ironie et d'un humour assez grinçants : cascades d'anachronismes, ridicules divers, décalages de ton habilement ménagés, l'auteur ne lésine pas sur les moyens. A l'époque où Laforgue écrit, la mode est à la parodie et les artistes se plaisent à maltraiter la mythologie ; sa démarche n'est donc pas vraiment novatrice. Mais il a une façon de le faire tout à fait plaisante : ces fables sont en effet imprégnées de légèreté et de poésie. D'une certaine mélancolie mais chez notre poète exclamatif, elle est toujours discrète, présente mais toujours à demi-mots, se cachant habilement derrière les rires. Ces illustres personnages resemblent à de grandes marionnettes un peu débiles, et on est amené à sourire de leur présomption, de leurs échecs, de leur faiblesse : Laforgue alors riait de lui-même, en prêtant à ses pantins des aspirations, des goûts et des jugements qui lui sont propres. Funambulesque. C'est au final un singulier objet littéraire que ces Moralités Légendaires qui, sous couvert de n'importe quoi, permettent d'entrer dans cet univers particulier aux divinités lunaires et aux clowns grimaçants, suscitant au final de vraies questions, entre deux invraisemblances. Une bien belle découverte !
Lien : http://carnets-plume.blogspo..
Lien : http://carnets-plume.blogspo..
Laforgue revisite avec ce livre des mythes et récits bien connus (Hamlet, Salomé...) avec un humour noir, tournant au ridicule les héros de ses récits.
C'est une lecture difficile, avec un style particulier mais très bien écrit. J'y ai pris beaucoup de plaisir, même s'il y a des passages que j'ai dû relire plusieurs fois afin de les comprendre vraiment.
C'est un classique à lire si on connait les récits dont il s'inspire, et si on aime les parodies !
C'est une lecture difficile, avec un style particulier mais très bien écrit. J'y ai pris beaucoup de plaisir, même s'il y a des passages que j'ai dû relire plusieurs fois afin de les comprendre vraiment.
C'est un classique à lire si on connait les récits dont il s'inspire, et si on aime les parodies !
Un recueil de morales sympathiques quoique aujourd'hui on connaisse très bien ces dernières. La plume, fortement descriptive, n'est pas désagréable. Je le recommande à petite dose.
Plus d'infos sur ma chronique :)
Lien : http://la-riviere-des-mots.b..
Plus d'infos sur ma chronique :)
Lien : http://la-riviere-des-mots.b..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jules Laforgue (22)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1231 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1231 lecteurs ont répondu