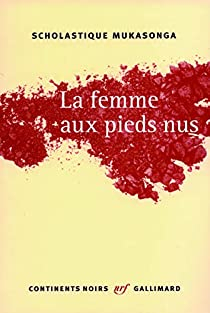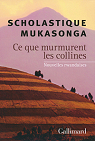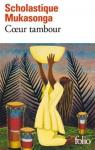Une mère met tout en oeuvre pour sauver ses enfants des horreurs de la guerre et des exactions au Rwanda. L'auteur décrit des traditions menacées de disparaître, ainsi que tout un peuple.
Mukasonga rend hommage à toutes les victimes, femmes, mères, hommes et enfants, du génocide subi par les Tutsi au Rwanda. A travers le portrait de sa mère, l'auteur recueille diverses traditions et savoirs du peuple tutsi. L'hommage à la mère devient universel, et devient aussi un hommage à un peuple décimé.
Avec une déférence extraordinaire, Scholastique Mukasonga rend hommage à sa mère. Pas de pathos, un style simple et élégant, précis. Hommage, transmission d'un savoir, mais aussi hymne à la vie, ce petit livre, très simple en apparence, est tout ça. Il ne faut pas s'y tromper : c'est un très grand livre. Mukasonga partage avec le lecteur l'histoire de son peuple, et c'est un honneur pour le lecteur de pouvoir lire ceci. Un très très beau livre !
Mukasonga rend hommage à toutes les victimes, femmes, mères, hommes et enfants, du génocide subi par les Tutsi au Rwanda. A travers le portrait de sa mère, l'auteur recueille diverses traditions et savoirs du peuple tutsi. L'hommage à la mère devient universel, et devient aussi un hommage à un peuple décimé.
Avec une déférence extraordinaire, Scholastique Mukasonga rend hommage à sa mère. Pas de pathos, un style simple et élégant, précis. Hommage, transmission d'un savoir, mais aussi hymne à la vie, ce petit livre, très simple en apparence, est tout ça. Il ne faut pas s'y tromper : c'est un très grand livre. Mukasonga partage avec le lecteur l'histoire de son peuple, et c'est un honneur pour le lecteur de pouvoir lire ceci. Un très très beau livre !
Un très beau texte de l'auteur sur sa mère à qui elle offre un linceul de ses mots. Une très belle peinture du Rwanda d'avant le génocide et des peurs déjà à l'oeuvre...
Happant. Prenant. Bouleversant. Un livre que j'ai dévoré.
Scholastique Mukasonga nous emmène loin de France, à la rencontre du Rwanda, à la découverte d'une culture à cent mille lieues de la nôtre dans un contexte complètement différent. Elle raconte les champs de sorgho, l'enfance tendre et belle, les nombreux frères et soeurs, les coutumes, le quotidien de son peuple. Et plus encore, elle raconte sa mère, Stefania. Une femme de courage, une lionne dont la principale obsession est d'assurer la survie de ses enfants dans un monde qui ne veut pas d'eux. Car c'est la guerre entre les Hutus et les Tutsis. Ou plutôt, c'est le massacre des Tutsis depuis que les Hutus ont pris le pouvoir. le danger est partout. Ils sont déportés, battus, leurs maisons sont saccagées, leurs femmes violées, leurs enfants tués, leur culture menacée... Toute leur vie est organisée autour de la survie. À tout instant, les enfants doivent être capables de se cacher pour réussir plus tard à franchir la frontière du Burundi – dans le meilleur des cas.
Scholastique Mukasonga raconte son évolution au sein de cet univers à la fois hostile et chaleureux, dans l'ombre d'une mère qu'elle aime et admire – à raison ! Une mère qui la protège, une mère qui est un modèle de dévouement pour sa famille. On ne peut s'empêcher d'admirer la force et le caractère de cette femme si particulière et si extraordinaire.
L'histoire décrit le quotidien de la famille au travers de petites anecdotes qui nous montrent à quel point la culture de ce peuple, ses habitudes, ses croyances sont différentes des nôtres. Certaines choses sont tellement inenvisageables pour nous qu'on se demande parfois si on vit sur la même planète !
Leur quotidien est rempli de surnaturel, ils vivent en permanence avec leurs contes et leurs légendes. Parfois merveilleuses, celles-ci sonnent aussi comme des excuses pour cacher une réalité bien difficile à avouer. Pour eux, un foetus peut très bien se mettre à vagabonder dans le corps de sa mère, mais cela l'empêche de se développer et retarde l'accouchement. Durant son enfance, Scholastique a ainsi connu un homme qui a attendu l'enfant dont sa femme prétendait être enceinte pendant cinq ans. Cinq ans ! Moui. Ils sont bien naïfs, les maris.
Une autre croyance que j'ai trouvé très belle, c'est celle des larmes de la lune, qui tombent parfois sur le ricin, un arbre particulier
J'aime cette ambiance entre réel et magie. Pour les Rwandais, tout est prétexte à maléfice ou enchantement. On dirait encore un monde d'enfant.
Je recommande ce livre à TOUT LE MONDE. Ne serait-ce que pour avoir connaissance de ce génocide qui a lieu au Rwanda. Mais aussi pour pouvoir découvrir la plume de Scholastique Mukasonga, entraînante, enivrante, enchanteresse.
Scholastique Mukasonga nous emmène loin de France, à la rencontre du Rwanda, à la découverte d'une culture à cent mille lieues de la nôtre dans un contexte complètement différent. Elle raconte les champs de sorgho, l'enfance tendre et belle, les nombreux frères et soeurs, les coutumes, le quotidien de son peuple. Et plus encore, elle raconte sa mère, Stefania. Une femme de courage, une lionne dont la principale obsession est d'assurer la survie de ses enfants dans un monde qui ne veut pas d'eux. Car c'est la guerre entre les Hutus et les Tutsis. Ou plutôt, c'est le massacre des Tutsis depuis que les Hutus ont pris le pouvoir. le danger est partout. Ils sont déportés, battus, leurs maisons sont saccagées, leurs femmes violées, leurs enfants tués, leur culture menacée... Toute leur vie est organisée autour de la survie. À tout instant, les enfants doivent être capables de se cacher pour réussir plus tard à franchir la frontière du Burundi – dans le meilleur des cas.
Scholastique Mukasonga raconte son évolution au sein de cet univers à la fois hostile et chaleureux, dans l'ombre d'une mère qu'elle aime et admire – à raison ! Une mère qui la protège, une mère qui est un modèle de dévouement pour sa famille. On ne peut s'empêcher d'admirer la force et le caractère de cette femme si particulière et si extraordinaire.
L'histoire décrit le quotidien de la famille au travers de petites anecdotes qui nous montrent à quel point la culture de ce peuple, ses habitudes, ses croyances sont différentes des nôtres. Certaines choses sont tellement inenvisageables pour nous qu'on se demande parfois si on vit sur la même planète !
Leur quotidien est rempli de surnaturel, ils vivent en permanence avec leurs contes et leurs légendes. Parfois merveilleuses, celles-ci sonnent aussi comme des excuses pour cacher une réalité bien difficile à avouer. Pour eux, un foetus peut très bien se mettre à vagabonder dans le corps de sa mère, mais cela l'empêche de se développer et retarde l'accouchement. Durant son enfance, Scholastique a ainsi connu un homme qui a attendu l'enfant dont sa femme prétendait être enceinte pendant cinq ans. Cinq ans ! Moui. Ils sont bien naïfs, les maris.
Une autre croyance que j'ai trouvé très belle, c'est celle des larmes de la lune, qui tombent parfois sur le ricin, un arbre particulier
J'aime cette ambiance entre réel et magie. Pour les Rwandais, tout est prétexte à maléfice ou enchantement. On dirait encore un monde d'enfant.
Je recommande ce livre à TOUT LE MONDE. Ne serait-ce que pour avoir connaissance de ce génocide qui a lieu au Rwanda. Mais aussi pour pouvoir découvrir la plume de Scholastique Mukasonga, entraînante, enivrante, enchanteresse.
dès la deuxième page, ce bouquin a réussi à me tirer des larmes d'émotions, et après un récit captivant qui nous plonge dans la vie quotidienne et les traditions du Rwanda et bien je referme ce livre avec de l'eau dans les yeux. Merci Scholastique pour ce beau témoignage.
« Maman, je n’étais pas là pour recouvrir ton corps et je n’ai plus que des mots – des mots d’une langue que tu ne comprenais pas – pour accomplir ce que tu avais demandé. »
C’est pour parer d’un linceul sa mère que Scholastique Mukasonga a écrit ce livre. Un linceul de mot pour lui rendre hommage, à elle ainsi qu’à toutes les autres mères ; les Mères Courage, les Mères Bienveillantes, celles qui ont donné la vie, leur vie, jusqu’à en mourir pour sauver leurs enfants. Car l’auteur est rwandaise et Stefania sa mère, comme des milliers d’autres tutsis, a péri dans la folie génocidaire de 1994. Elle a relaté cette expérience dans son premier livre, Inyenzi ou les Cafards. Dans La femme aux pieds nus, l’écrivain dresse un portrait des réfugiés tutsis au Bugesera, cette province du Rwanda où arrivèrent tant de déplacés, dont ses parents. Elle passe en revue les thèmes du quotidien. A quoi ressemblent les maisons ? Comment se nourrit-on ? Quelles traditions se perpétuent ? Quelles sont celles qui se perdent ? Quelle est la place des hommes, des femmes, des enfants au sein de la famille, du village, de la société ? Toutes ces questions auxquelles elle répond nous apprennent beaucoup. Même certains détails qui paraissent insignifiants au premier abord, deviennent sous sa plume des découvertes d’un monde inconnu. Le chapitre consacré au sorgho par exemple, est passionnant. On y découvre toute la variété des utilisations, sa symbolique, sa place dans l’imaginaire collectif. « Le sorgho, c’était le roi de nos champs ».
Mais au-delà du propos sur le quotidien, c’est bien sûr un témoignage pour les femmes, pour dire toute le courage dont elles ont fait preuve pour surmonter les difficultés. A l’image de Stefania, qui prévoit sans cesse de nouvelles cachettes pour ses enfants en cas d’attaque, ou de Gaudenciana, qui garde ses sept fils auprès d’elle de peur qu’ils ne se fassent tuer. Finalement, on parle assez peu des hommes, hormis quelques figures comme celle du père et des frères de l’auteur. Les hommes ne sont-ils pas ceux qui ont porté la mort…? Certaines scènes sont lumineuses, malgré l’horreur qui se préfigure; comme celle des vermifuges naturels utilisés pour les bambins malades. On se surprend à sourire malgré ce que l’on sait de l’après.
Ce texte pudique et fier est un témoignage de ce qui ne sera plus. Si une certaine mélancolie vous étreint en le refermant, c’est la preuve que, grâce aux mots, nous pouvons faire revivre ceux dont la voix s’est éteinte à jamais. Il est du rôle des survivants de nous la faire entendre.
http://manouselivre.com/la-femme-aux-pieds-nus/
Lien : http://manouselivre.com
C’est pour parer d’un linceul sa mère que Scholastique Mukasonga a écrit ce livre. Un linceul de mot pour lui rendre hommage, à elle ainsi qu’à toutes les autres mères ; les Mères Courage, les Mères Bienveillantes, celles qui ont donné la vie, leur vie, jusqu’à en mourir pour sauver leurs enfants. Car l’auteur est rwandaise et Stefania sa mère, comme des milliers d’autres tutsis, a péri dans la folie génocidaire de 1994. Elle a relaté cette expérience dans son premier livre, Inyenzi ou les Cafards. Dans La femme aux pieds nus, l’écrivain dresse un portrait des réfugiés tutsis au Bugesera, cette province du Rwanda où arrivèrent tant de déplacés, dont ses parents. Elle passe en revue les thèmes du quotidien. A quoi ressemblent les maisons ? Comment se nourrit-on ? Quelles traditions se perpétuent ? Quelles sont celles qui se perdent ? Quelle est la place des hommes, des femmes, des enfants au sein de la famille, du village, de la société ? Toutes ces questions auxquelles elle répond nous apprennent beaucoup. Même certains détails qui paraissent insignifiants au premier abord, deviennent sous sa plume des découvertes d’un monde inconnu. Le chapitre consacré au sorgho par exemple, est passionnant. On y découvre toute la variété des utilisations, sa symbolique, sa place dans l’imaginaire collectif. « Le sorgho, c’était le roi de nos champs ».
Mais au-delà du propos sur le quotidien, c’est bien sûr un témoignage pour les femmes, pour dire toute le courage dont elles ont fait preuve pour surmonter les difficultés. A l’image de Stefania, qui prévoit sans cesse de nouvelles cachettes pour ses enfants en cas d’attaque, ou de Gaudenciana, qui garde ses sept fils auprès d’elle de peur qu’ils ne se fassent tuer. Finalement, on parle assez peu des hommes, hormis quelques figures comme celle du père et des frères de l’auteur. Les hommes ne sont-ils pas ceux qui ont porté la mort…? Certaines scènes sont lumineuses, malgré l’horreur qui se préfigure; comme celle des vermifuges naturels utilisés pour les bambins malades. On se surprend à sourire malgré ce que l’on sait de l’après.
Ce texte pudique et fier est un témoignage de ce qui ne sera plus. Si une certaine mélancolie vous étreint en le refermant, c’est la preuve que, grâce aux mots, nous pouvons faire revivre ceux dont la voix s’est éteinte à jamais. Il est du rôle des survivants de nous la faire entendre.
http://manouselivre.com/la-femme-aux-pieds-nus/
Lien : http://manouselivre.com
Elle écrit très bien Scholastique Mukasonga; d'origine rwandaise, tutsi, elle nous raconte ici sa mère, Stefania, la femme aux pieds nus et la vie qu'avait sa famille dans les années avant le grand massacre. Les tutsi avaient déjà été déportés dans une région inhospitalière, le Bugesera, où ils survivaient; dans leurs baraquements, des soldats surgissaient régulièrement pour saccager le peu qu'ils avaient. Mais ce livre veut se consacrer à la mère, à l'énergie qu'elle déploie pour essayer de sauver ses enfants, essayer de leur apprendre à fuir et à se cacher; une mère qui jour et nuit guette les bruits de bottes sur la piste. Et c'est l'occasion de parler de la vie quotidienne, très bouleversée bien sûr, mais une vie que Stefania veut la plus belle possible pour ses enfants; il faut savoir lire les signes, comme les pleurs de la lune, faire les choses comme on les a toujours faites. Elles passent leur vie à travailler dur ces femmes rwandaises; ce sont elles qui cultivent les champs souvent avec un bébé dans le dos, confectionnent les médications, élèvent les enfants. Il y a dans ce récit beaucoup d'anecdotes, de petits souvenirs d'enfance souvent amusants et poignants aussi: la place du pain, la grande affaire du mariage, les contes ... Stefania a été, parmi d'autres, une mère bienveillante, bienfaisante, qui nourrissait, protégeait, conseillait, consolait, une gardienne de vie.
Lien : http://www.les2bouquineuses...
Lien : http://www.les2bouquineuses...
Dans ce livre, Scholastique Mukasonga rend hommage à sa mère, courageuse et exceptionnelle.
C'est un témoignage très fort sur la vie des Tutsis déportés après avoir tout perdu, toujours à la merci de militaires agressifs.
le courage de Stéfania, la mère de Scholastique, est exceptionnel pour protéger ses enfants, rebâtir un lieu protecteur, cultiver la terre, soigner avec les plantes, organiser les mariages, transmettre leur histoire...
Ce livre émouvant est un beau témoignage sur ce village avant la génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Scholastique Mukasonga a reçu pour ce livre le prix Seligmann 2008 "contre le racisme, l'injustice et l'intolérance".
Un livre à garder comme un témoignage précieux que je conseille à tous de lire!!
C'est un témoignage très fort sur la vie des Tutsis déportés après avoir tout perdu, toujours à la merci de militaires agressifs.
le courage de Stéfania, la mère de Scholastique, est exceptionnel pour protéger ses enfants, rebâtir un lieu protecteur, cultiver la terre, soigner avec les plantes, organiser les mariages, transmettre leur histoire...
Ce livre émouvant est un beau témoignage sur ce village avant la génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Scholastique Mukasonga a reçu pour ce livre le prix Seligmann 2008 "contre le racisme, l'injustice et l'intolérance".
Un livre à garder comme un témoignage précieux que je conseille à tous de lire!!
Peut-on parler de roman ? Il faudrait écouter Scholastique Mukasonga pour en savoir plus. Mais sans avoir lu aucun commentaire, aucune interview ou autres critiques savantes, je range sans trop me tromper ce texte dans le récit. Un récit bouleversant par sa sobriété, par sa simplicité, par le minimalisme du style qu'emploie la romancière tutsi dans ce texte qui nous parle du génocide de son peuple au Rwanda et d'un devoir de mémoire à l'égard d'une mère disparue, massacrée par ce qui constitue l'une des horreurs absolues du siècle dernier, le génocide des tutsi et de certains modérés hutu au Rwanda.
Source photo - Gallimard Continents noirs
Scholastique Mukasonga introduit dès son prologue la dimension mémorielle de son projet.
Maman, je n'étais pas là pour recouvrir ton corps et je n'ai plus que des mots - des mots d'une langue que tu ne comprenais - pour accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur la page du cahier, tissent et retissent le linceul de ton corps absent.
page 13 - édition Gallimard, Collection Folio
Par les moyens et le talent qu'elle possède, Scholastique Mukasonga constitue une forme de sépulture par les mots pour sa mère Stéfania. Cependant, et bien qu'ayant dressé le contexte de sa narration, elle se détourne de la folie des événements pour dresser le portrait d'une communauté, celle des déportés tutsis de Nyamata.
En effet, à l'orée des indépendances, les premières vagues de violence ébranlent le Rwanda, entre tutsis et hutus. Et dans ces périodes troubles, des tutsis vont être déplacés vers la région inhospitalière du Bugesera (p.15), après que pour beaucoup, leur cheptel de bovins ait été détruit.
Tout cela, le lecteur le découvre au fur et à mesure que les conditions d'existence dans ce Rwanda rural se révèlent pour cette communauté qui se serre les coudes. En tentant une interprétation rapide de la chronologie par recoupement des faits, la période décrite couvre les années 60 et 70. Stefania est une entremetteuse. Une marieuse. Une personnalité très forte. Une mère courage. Son mari, Antoine, catholique pratiquant, est plus effacé sous la plume de Scholastique, la dernière de leurs trois filles.
L'atmosphère est à la fois pesante et légère. Tant que l'on reste dans le cercle familial, le voisinage immédiat, dans cette communauté, la description du mode de vie est une source réelle d'informations. Mukasonga fait un véritable travail d'anthropologue ou ethnologue, en faisant revivre tous les rites de ce groupe de personnes : mariage, solidarité, voisinage, éducation, etc. Cela est décrit avec une minutie étonnante qui enrichit le texte et en même temps qui terrifie le lecteur. Qui connait la fin de l'histoire.
Ce que Scholastique Mukasonga souligne de manière subliminale, c'est que cette communauté de Nyamata a vécu avec une épée de Damoclès depuis les indépendances, oppressée par le régime militaire. Les racines du mal sont lointaines.
On peut toutefois oser poser la question suivante : Dans sa posture clivante, totalement légitime vu le terrible destin de sa famille, est-ce qu'une reconstruction est seulement envisageable ? Il est peut-être trop tôt pour poser la question. Voir indécent. Mais, le texte porte une charge beaucoup plus lourde et largement moins distanciée que les romans que j'ai pu lire sur ce sujet. de Monemembo. de Tadjo. de Diop. Même de Gatoré, rwandais lui aussi.
Au coeur des ténèbres et de l'omerta, Scholastique Mukasonga est une voix magnifique qu'il faut entendre pour que plus jamais cela ne se reproduise. Ce serait là le plus beau linceul à la mémoire des morts de Nyamata, en 1994.
Lien : http://gangoueus.blogspot.fr..
Hommage rendu à sa mère et à toutes les mères courage.
A lire, aussi pour apprendre/connaître les us et coutumes d'un pays.
A lire, aussi pour apprendre/connaître les us et coutumes d'un pays.
Avril 1994, c'est le génocide des tutsis du Rwanda. Scholastique Mukasonga exilée en France avant le drame y a survécu mais 37 membres de sa famille seront massacrés dont sa mère Stéfania, la femme aux pieds nus. Au Rwanda une tradition veut que les enfants d'une défunte recouvrent son corps d'un pagne car personne ne doit voir le corps d'une mère ; c'est parce qu'elle n'a jamais pu recouvrir sa mère que Scholastique Mukasonga va écrire ce livre comme un pagne que l'on déploie. Pour honorer la mémoire de ces mères courages, c'est la vie qui est choisie dans ce récit. La description de la vie d'avant, pour faire revivre le rythme des saisons et des coutumes : la récolte du sorgho, la construction des cases, les magnifiques coiffures appelés imasunzu (dont je vous conseille d'aller voir les photos sur Internet) … c'est aussi un quotidien de peur car bien avant le drame les tutsis sont stigmatisés, ils sont les bêtes nuisibles, les cafards. Les signes de l'extermination à venir sont là, le mépris, la terreur, les viols, les meurtres sporadiques, les cases saccagés, les bêtes et les enclos brûlés, l'absence de justice. Au travers de ce récit, Scholastique décrit l'amour infini des mères pour leurs enfants, ces femmes inépuisables qui tentent coûte que coûte, malgré l'exil, la crainte de mourir, l'absence de projets possibles de maintenir vivantes les coutumes. Une vie faite de courage et de solidarité.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Femme, femme, femme.
palamede
21 livres

Le Rwanda, 20 ans après
Bibalice
10 livres

Auteures africaines
Majuscaux
25 livres
Autres livres de Scholastique Mukasonga (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'homme au tabouret d'or !
Qui est Katabolonga ?
Le fils du roi Tsongor
Le frère du roi Tsongor
Le père du roi Tsongor
Le cousin du roi Tsongor
Le porteur du tabouret d'or
L'oncle du roi Tsongor
Le petit-fils du roi Tsongor
15 questions
594 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, afrique
, fantastique
, apparitionsCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu