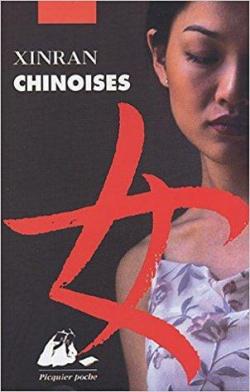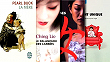Citations sur Chinoises (146)
Au cours d’une visite que j’ai rendue à mes parents un week-end, j’ai
confié à ma mère que j’avais beaucoup de mal à faire la différence entre un
mariage de raison et la prison. Ma mère m’a répliqué d’un ton léger : « Et
combien de gens en Chine font un mariage d’amour ? » Quand je lui ai
demandé pourquoi elle disait cela, elle a trouvé un prétexte pour quitter la
pièce. Je savais que ma mère écoutait mon émission presque tous les jours,
mais nous ne parlions que rarement de nos sentiments personnels. Toute ma
vie, j’avais attendu qu’elle me prenne dans ses bras : elle ne m’a pas une
seule fois serrée contre elle ou embrassée, même enfant ; adulte, la réserve
traditionnelle chinoise nous a interdit toute démonstration d’affection.
Entre 1945 et 1985 (quand se déplacer dans le pays est redevenu possible),
beaucoup de familles étaient éclatées. Nous n’avons pas échappé à la règle
et j’ai passé très peu de temps auprès de mes parents. Je voulais en savoir
plus sur ma mère, sur la femme qui m’avait donné la vie et avait suscité en
moi d’innombrables questions sur les femmes. Mon assurance grandissante
de journaliste m’a aidée à reconstituer des parties de son histoire.
Ma mère est issue d’une grande famille capitaliste de Nankin, une ville
débordante d’activité mais tranquille et harmonieuse, très différente de la
Pékin politique, de la Shanghai commerçante et de la bruyante Guangzhou.
Sun Yatsen, le fondateur de la Chine moderne, a choisi d’être enterré à
Nankin et le Guomindang y a établi, à un moment de son histoire, sa
capitale.
Située sur les rives du Yangtse au sud-est de la Chine, près de l’imposante
montagne de Zijinshan, la ville comporte des lacs et des espaces verts. Elle
est traversée par des boulevards ombragés, bordés d’arbres, dans toutes les
directions, et l’ancienneté des palais et des murs d’enceinte autant que la
modernité des bâtiments le long de la rivière attestent de la richesse de son
héritage culturel. Les Chinois disent que les hommes sont façonnés par
l’eau et la terre qui les entourent ; d’après ce que je connais de la famille de
ma mère, je pense que c’est vrai.
La famille de ma mère possédait autrefois des biens immobiliers
considérables à Nankin ; tout ce qui se trouvait au sud d’une ligne
s’étendant de la porte ouest de la ville jusqu’au centre à trois kilomètres de
là vers l’est leur appartenait. Mon grand-père maternel était à la tête de
l’industrie du chanvre dans trois provinces – Jiangsu, Zhejiang et Anhui –
ainsi que d’un certain nombre d’autres usines. Dans la prospère Chine du
Sud, l’acheminement par voie d’eau était le moyen de transport privilégié.
Mon grand-père commercialisait toutes sortes de choses, des toiles
goudronnées pour les bateaux de guerre aux câbles pour les ancres des
petits bateaux de pêche.
C’était un entrepreneur et un directeur des plus compétents, même s’il
n’avait pas beaucoup étudié. Néanmoins, il comprenait l’importance de
l’éducation et de la culture ; il avait envoyé ses sept enfants dans les
meilleures écoles, et fondé lui-même une école à Nankin. Même si à cette
époque on s’accordait à répéter que « le manque de talent chez une femme
est une vertu », ses filles ont bénéficié de la plus complète des éducations.
De mes oncles et tantes, je tiens que dans la maison de mon grand-père, les
règles de conduite étaient d’une sévérité extrême. Pendant les repas, si
quelqu’un laissait échapper un bruit en mangeant, ou que sa main gauche
s’écartait un tant soit peu du bol de riz, ou qu’une autre règle était enfreinte,
mon grand-père posait ses baguettes et quittait la table. Personne n’avait le
droit de continuer à manger après son départ ; ils devaient attendre le
prochain repas pour assouvir leur faim.
Quand le nouveau régime est venu au pouvoir en 1949, mon grand-père a
été obligé de céder ses biens au gouvernement pour protéger sa famille.
Peut-être par désir de se rebeller contre la sévérité de leur éducation, ses
enfants se sont tous engagés activement dans les mouvements
révolutionnaires du Parti communiste, et ont combattu des capitalistes
comme leur père.
Mon grand-père a cédé une partie de ses biens immobiliers au
gouvernement à trois reprises – en 1950, 1959 et 1963 – mais ces sacrifices
n’ont pas suffi à le mettre à l’abri. Au début de la Révolution culturelle, il a
été désigné à la vindicte publique parce qu’il s’était attiré les éloges de deux
des ennemis mortels de Mao Zedong. Le premier était Chiang Kai-shek, qui
avait mentionné mon grand-père en termes élogieux parce qu’il avait
travaillé à développer l’industrie nationale face à l’agression japonaise. Le
second était un ancien camarade de Mao, Liu Shaoqi, qui avait félicité mon
grand-père pour avoir donné une grande partie de ses biens au pays. Chiang
Kai-shek avait dû fuir la Chine et se réfugier à Taiwan, et Liu avait été
incarcéré après être tombé en défaveur.
Mon grand-père avait déjà plus de soixante-dix ans quand il a été
emprisonné. Il a survécu à cette épreuve avec une force de caractère
surprenante. Les gardes rouges crachaient ou se mouchaient dans la
nourriture grossière et le thé clair qu’ils apportaient aux prisonniers. Un
vieillard qui partageait la même cellule que lui est mort de chagrin, de
colère et de honte de se voir traiter ainsi, mais mon grand-père a gardé le
sourire. Il enlevait la morve et les crachats, et mangeait tout ce qui était
mangeable. Les gardes rouges en sont venus à l’admirer et ont même fini
par lui apporter une nourriture un peu meilleure que celle des autres.
Quand mon grand-père est sorti de prison à la fin de la Révolution
culturelle, un de ses codétenus l’a invité à partager un repas de canard au
sel, une spécialité de Nankin, pour fêter l’événement. Quand on a déposé le
mets délicat sur la table, l’ami de mon grand-père s’est effondré, foudroyé
par une hémorragie cérébrale provoquée par l’excès d’émotion.
Mon grand-père n’a montré ni joie d’avoir recouvré la liberté ni tristesse
en apprenant la mort de ses amis et la perte de sa famille et de ses biens ; il
semblait que ses sentiments avaient été anesthésiés pour toujours. Ce n’est
que quand il m’a permis de lire son journal intime au cours d’un séjour que
j’ai fait en Chine en mars 2000, que j’ai compris qu’il n’avait jamais cessé
de ressentir les vicissitudes des époques qu’il avait traversées. Son
expérience et sa compréhension de la vie l’avaient rendu inapte à
s’exprimer par le canal futile de la parole, mais même si l’émotion dans ses
journaux n’est jamais patente, ses sentiments les plus intimes y sont
consignés.
Ma mère était devenue membre de la Ligue de la jeunesse communiste à
l’âge de quatorze ans, et elle était entrée dans l’armée et le Parti à seize.
Avant cela, sa réussite scolaire et ses talents de chanteuse et de danseuse lui
avaient valu à Nankin une modeste réputation. Dans l’armée, elle avait
continué à se distinguer. Elle était première de sa promotion, première aux
examens, et l’une des meilleures candidates dans les concours militaires
nationaux. Brillante et belle, plus d’un cadre du Parti et de l’armée la
courtisait et rivalisait pour une danse pendant les bals. Des années plus tard,
ma mère m’a avoué qu’elle se sentait alors comme une Cendrillon à qui la
pantoufle de vair de la révolution convenait parfaitement, et que ce rôle
comblait tous ses rêves. Emportée par cette vague de succès, elle ne se
doutait pas que son milieu familial reviendrait la pourchasser.
Au début des années 1950, l’armée a commencé sa première purge interne
de type stalinien. Ma mère a été mise sur la « liste noire » des descendants
capitalistes et exclue du cercle enchanteur des révolutionnaires de premier
ordre. Elle a dû travailler dans une usine militaire où, en collaboration avec
des experts d’Allemagne de l’Est, elle a mis au point une nouvelle machine-
outil pour fabriquer de l’équipement militaire. Sur la photo de groupe qui
commémore cette réalisation, on a dit à ma mère qu’elle ne pouvait pas
rester au premier rang à cause de son milieu familial, et on l’a reléguée
derrière.
Pendant le conflit sino-soviétique, elle est devenue une cible de choix. Ses
origines capitalistes justifiaient qu’on mette à l’épreuve sa fidélité au Parti.
Vers la fin de la Révolution culturelle, elle a dirigé une petite équipe
technique qui a conçu un outil qui permettait d’améliorer notablement
l’efficacité de rendement. Toutefois, on ne l’a pas autorisée à s’en attribuer
le mérite. On lui a refusé le titre de chef de projet parce qu’on jugeait
impossible que quelqu’un avec son passé puisse être loyal envers le Parti.
Pendant plus de trente ans, ma mère s’est battue pour avoir droit au même
traitement et à la même reconnaissance que ses collègues de même grade,
mais sans succès. Rien ne pouvait changer le fait qu’elle était fille d’un
capitaliste.
Un ami de la famille m’a dit un jour que la meilleure preuve de la force de
caractère de ma mère a été sa décision d’épouser mon père. Quand ils se
sont mariés, mon père était un enseignant très respecté dans une académie
militaire ; il avait eu ma mère pour élève, et nombreuses étaient ses
étudiantes qui l’admiraient. Ma mère ne manquait pas de partis parmi les
enseignants, mais elle a choisi mon père, qui n’était pas beau, mais qui était
le plus brillant de tous. Ses collègues pensaient qu’elle ne l’avait pas
épousée par amour, mais pour prouver sa valeur.
L’intelligence de mon père semblait, en vérité, justifier le choix de ma
mère ; quand elle parlait de lui, elle disait toujours qu’il était terriblement
intelligent ; c’était un expert de dimension nationale en mécanique et en
informatique, et il parlait plusieurs langues étrangères. Elle ne l’a jamais
décrit comme un bon mari ou un bon père. Pour mon frère et moi, il n’était
pas facile de réconcilier l’opinion qu’elle avait de notre père avec cet
homme à l’esprit confus que nou
confié à ma mère que j’avais beaucoup de mal à faire la différence entre un
mariage de raison et la prison. Ma mère m’a répliqué d’un ton léger : « Et
combien de gens en Chine font un mariage d’amour ? » Quand je lui ai
demandé pourquoi elle disait cela, elle a trouvé un prétexte pour quitter la
pièce. Je savais que ma mère écoutait mon émission presque tous les jours,
mais nous ne parlions que rarement de nos sentiments personnels. Toute ma
vie, j’avais attendu qu’elle me prenne dans ses bras : elle ne m’a pas une
seule fois serrée contre elle ou embrassée, même enfant ; adulte, la réserve
traditionnelle chinoise nous a interdit toute démonstration d’affection.
Entre 1945 et 1985 (quand se déplacer dans le pays est redevenu possible),
beaucoup de familles étaient éclatées. Nous n’avons pas échappé à la règle
et j’ai passé très peu de temps auprès de mes parents. Je voulais en savoir
plus sur ma mère, sur la femme qui m’avait donné la vie et avait suscité en
moi d’innombrables questions sur les femmes. Mon assurance grandissante
de journaliste m’a aidée à reconstituer des parties de son histoire.
Ma mère est issue d’une grande famille capitaliste de Nankin, une ville
débordante d’activité mais tranquille et harmonieuse, très différente de la
Pékin politique, de la Shanghai commerçante et de la bruyante Guangzhou.
Sun Yatsen, le fondateur de la Chine moderne, a choisi d’être enterré à
Nankin et le Guomindang y a établi, à un moment de son histoire, sa
capitale.
Située sur les rives du Yangtse au sud-est de la Chine, près de l’imposante
montagne de Zijinshan, la ville comporte des lacs et des espaces verts. Elle
est traversée par des boulevards ombragés, bordés d’arbres, dans toutes les
directions, et l’ancienneté des palais et des murs d’enceinte autant que la
modernité des bâtiments le long de la rivière attestent de la richesse de son
héritage culturel. Les Chinois disent que les hommes sont façonnés par
l’eau et la terre qui les entourent ; d’après ce que je connais de la famille de
ma mère, je pense que c’est vrai.
La famille de ma mère possédait autrefois des biens immobiliers
considérables à Nankin ; tout ce qui se trouvait au sud d’une ligne
s’étendant de la porte ouest de la ville jusqu’au centre à trois kilomètres de
là vers l’est leur appartenait. Mon grand-père maternel était à la tête de
l’industrie du chanvre dans trois provinces – Jiangsu, Zhejiang et Anhui –
ainsi que d’un certain nombre d’autres usines. Dans la prospère Chine du
Sud, l’acheminement par voie d’eau était le moyen de transport privilégié.
Mon grand-père commercialisait toutes sortes de choses, des toiles
goudronnées pour les bateaux de guerre aux câbles pour les ancres des
petits bateaux de pêche.
C’était un entrepreneur et un directeur des plus compétents, même s’il
n’avait pas beaucoup étudié. Néanmoins, il comprenait l’importance de
l’éducation et de la culture ; il avait envoyé ses sept enfants dans les
meilleures écoles, et fondé lui-même une école à Nankin. Même si à cette
époque on s’accordait à répéter que « le manque de talent chez une femme
est une vertu », ses filles ont bénéficié de la plus complète des éducations.
De mes oncles et tantes, je tiens que dans la maison de mon grand-père, les
règles de conduite étaient d’une sévérité extrême. Pendant les repas, si
quelqu’un laissait échapper un bruit en mangeant, ou que sa main gauche
s’écartait un tant soit peu du bol de riz, ou qu’une autre règle était enfreinte,
mon grand-père posait ses baguettes et quittait la table. Personne n’avait le
droit de continuer à manger après son départ ; ils devaient attendre le
prochain repas pour assouvir leur faim.
Quand le nouveau régime est venu au pouvoir en 1949, mon grand-père a
été obligé de céder ses biens au gouvernement pour protéger sa famille.
Peut-être par désir de se rebeller contre la sévérité de leur éducation, ses
enfants se sont tous engagés activement dans les mouvements
révolutionnaires du Parti communiste, et ont combattu des capitalistes
comme leur père.
Mon grand-père a cédé une partie de ses biens immobiliers au
gouvernement à trois reprises – en 1950, 1959 et 1963 – mais ces sacrifices
n’ont pas suffi à le mettre à l’abri. Au début de la Révolution culturelle, il a
été désigné à la vindicte publique parce qu’il s’était attiré les éloges de deux
des ennemis mortels de Mao Zedong. Le premier était Chiang Kai-shek, qui
avait mentionné mon grand-père en termes élogieux parce qu’il avait
travaillé à développer l’industrie nationale face à l’agression japonaise. Le
second était un ancien camarade de Mao, Liu Shaoqi, qui avait félicité mon
grand-père pour avoir donné une grande partie de ses biens au pays. Chiang
Kai-shek avait dû fuir la Chine et se réfugier à Taiwan, et Liu avait été
incarcéré après être tombé en défaveur.
Mon grand-père avait déjà plus de soixante-dix ans quand il a été
emprisonné. Il a survécu à cette épreuve avec une force de caractère
surprenante. Les gardes rouges crachaient ou se mouchaient dans la
nourriture grossière et le thé clair qu’ils apportaient aux prisonniers. Un
vieillard qui partageait la même cellule que lui est mort de chagrin, de
colère et de honte de se voir traiter ainsi, mais mon grand-père a gardé le
sourire. Il enlevait la morve et les crachats, et mangeait tout ce qui était
mangeable. Les gardes rouges en sont venus à l’admirer et ont même fini
par lui apporter une nourriture un peu meilleure que celle des autres.
Quand mon grand-père est sorti de prison à la fin de la Révolution
culturelle, un de ses codétenus l’a invité à partager un repas de canard au
sel, une spécialité de Nankin, pour fêter l’événement. Quand on a déposé le
mets délicat sur la table, l’ami de mon grand-père s’est effondré, foudroyé
par une hémorragie cérébrale provoquée par l’excès d’émotion.
Mon grand-père n’a montré ni joie d’avoir recouvré la liberté ni tristesse
en apprenant la mort de ses amis et la perte de sa famille et de ses biens ; il
semblait que ses sentiments avaient été anesthésiés pour toujours. Ce n’est
que quand il m’a permis de lire son journal intime au cours d’un séjour que
j’ai fait en Chine en mars 2000, que j’ai compris qu’il n’avait jamais cessé
de ressentir les vicissitudes des époques qu’il avait traversées. Son
expérience et sa compréhension de la vie l’avaient rendu inapte à
s’exprimer par le canal futile de la parole, mais même si l’émotion dans ses
journaux n’est jamais patente, ses sentiments les plus intimes y sont
consignés.
Ma mère était devenue membre de la Ligue de la jeunesse communiste à
l’âge de quatorze ans, et elle était entrée dans l’armée et le Parti à seize.
Avant cela, sa réussite scolaire et ses talents de chanteuse et de danseuse lui
avaient valu à Nankin une modeste réputation. Dans l’armée, elle avait
continué à se distinguer. Elle était première de sa promotion, première aux
examens, et l’une des meilleures candidates dans les concours militaires
nationaux. Brillante et belle, plus d’un cadre du Parti et de l’armée la
courtisait et rivalisait pour une danse pendant les bals. Des années plus tard,
ma mère m’a avoué qu’elle se sentait alors comme une Cendrillon à qui la
pantoufle de vair de la révolution convenait parfaitement, et que ce rôle
comblait tous ses rêves. Emportée par cette vague de succès, elle ne se
doutait pas que son milieu familial reviendrait la pourchasser.
Au début des années 1950, l’armée a commencé sa première purge interne
de type stalinien. Ma mère a été mise sur la « liste noire » des descendants
capitalistes et exclue du cercle enchanteur des révolutionnaires de premier
ordre. Elle a dû travailler dans une usine militaire où, en collaboration avec
des experts d’Allemagne de l’Est, elle a mis au point une nouvelle machine-
outil pour fabriquer de l’équipement militaire. Sur la photo de groupe qui
commémore cette réalisation, on a dit à ma mère qu’elle ne pouvait pas
rester au premier rang à cause de son milieu familial, et on l’a reléguée
derrière.
Pendant le conflit sino-soviétique, elle est devenue une cible de choix. Ses
origines capitalistes justifiaient qu’on mette à l’épreuve sa fidélité au Parti.
Vers la fin de la Révolution culturelle, elle a dirigé une petite équipe
technique qui a conçu un outil qui permettait d’améliorer notablement
l’efficacité de rendement. Toutefois, on ne l’a pas autorisée à s’en attribuer
le mérite. On lui a refusé le titre de chef de projet parce qu’on jugeait
impossible que quelqu’un avec son passé puisse être loyal envers le Parti.
Pendant plus de trente ans, ma mère s’est battue pour avoir droit au même
traitement et à la même reconnaissance que ses collègues de même grade,
mais sans succès. Rien ne pouvait changer le fait qu’elle était fille d’un
capitaliste.
Un ami de la famille m’a dit un jour que la meilleure preuve de la force de
caractère de ma mère a été sa décision d’épouser mon père. Quand ils se
sont mariés, mon père était un enseignant très respecté dans une académie
militaire ; il avait eu ma mère pour élève, et nombreuses étaient ses
étudiantes qui l’admiraient. Ma mère ne manquait pas de partis parmi les
enseignants, mais elle a choisi mon père, qui n’était pas beau, mais qui était
le plus brillant de tous. Ses collègues pensaient qu’elle ne l’avait pas
épousée par amour, mais pour prouver sa valeur.
L’intelligence de mon père semblait, en vérité, justifier le choix de ma
mère ; quand elle parlait de lui, elle disait toujours qu’il était terriblement
intelligent ; c’était un expert de dimension nationale en mécanique et en
informatique, et il parlait plusieurs langues étrangères. Elle ne l’a jamais
décrit comme un bon mari ou un bon père. Pour mon frère et moi, il n’était
pas facile de réconcilier l’opinion qu’elle avait de notre père avec cet
homme à l’esprit confus que nou
Un soir, j’étais sur le point de conclure mon émission avec un peu de
musique douce – ce que je faisais habituellement pendant les dix dernières
minutes – quand j’ai pris un dernier appel :
— Xinran, bonsoir, j’appelle de Ma’anshan. Merci pour votre émission.
Elle me donne beaucoup à réfléchir et me réconforte, moi et beaucoup
d’autres femmes. Aujourd’hui, j’aimerais vous demander ce que vous
pensez de l’homosexualité. Pourquoi tant de gens rejettent-ils les
homosexuels ? Pourquoi la Chine considère-t-elle l’homosexualité comme
un délit ? Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que les homosexuels
ont les mêmes droits et sont confrontés aux mêmes choix dans la vie que
tout le monde ?…
Alors que l’interlocutrice continuait à déverser son flot de questions, j’ai
senti une sueur froide m’envahir. L’homosexualité était un sujet tabou selon
le code des médias ; je me suis demandé, affolée, pourquoi la contrôleuse
n’avait pas coupé l’appel.
Impossible de me dérober : des milliers de gens attendaient ma réponse et
je ne pouvais pas dire que c’était un sujet considéré comme interdit. Ni que
le temps nous manquait : il restait encore quinze bonnes minutes avant la
fin de l’émission. J’ai augmenté le volume de la musique tout en cherchant
frénétiquement dans mes souvenirs de lectures sur l’homosexualité une
façon d’aborder le sujet de façon diplomatique. La femme venait de poser
une question pertinente, qui devait traîner dans l’esprit des auditeurs :
— L’homosexualité a son histoire propre, de la Rome antique à l’Occident
et des dynasties Tang et Song en Chine jusqu’à nos jours. Il y a des
arguments philosophiques qui établissent que tout ce qui existe a une raison
d’être, alors pourquoi considère-t-on en Chine que l’homosexualité est une
aberration ?
A ce moment-là, j’ai aperçu à travers l’écran de verre la contrôleuse qui
décrochait le téléphone intérieur. Elle a blêmi et coupé immédiatement
l’appel au beau milieu d’une phrase, alors que c’était strictement interdit.
Quelques instants plus tard, le directeur du service est entré en trombe dans
la pièce de contrôle et m’a dit dans l’interphone : « Soyez prudente,
Xinran ! »
J’ai laissé la musique pendant une minute de plus avant d’ouvrir le micro.
— Bonsoir, amis de la radio, vous écoutez Mots sur la brise nocturne.
Mon nom est Xinran, et je débats en direct avec vous du monde des
femmes. De dix à douze tous les soirs, vous pouvez vous mettre à l’écoute
de la vie des femmes, des battements de leurs cœurs et écouter leurs
histoires.
Je faisais de mon mieux pour gagner du temps tout en mettant de l’ordre
dans mes pensées.
— Nous venons de recevoir l’appel d’une auditrice qui en sait long sur la
société et l’histoire, et compatit aux expériences d’un groupe de femmes qui
ont un style de vie non conventionnel.
« Pour autant que je sache, l’homosexualité n’est pas, comme le dit notre
auditrice, un produit spécifique de la société contemporaine ; on en trouve
mention dans l’histoire occidentale et orientale. On raconte que pendant les
guerres de conquête de la Rome antique, les chefs allaient jusqu’à
encourager leurs soldats à pratiquer l’homosexualité. Cependant, il
s’agissait peut-être à l’époque plus d’une question d’utilité que d’une
véritable approbation. Les relations homosexuelles aidaient les soldats à
supporter la guerre et l’éloignement de leurs familles. Par un retournement
cruel, les attachements sentimentaux formés entre les soldats leur
insufflaient une énergie accrue pour venger leurs amants morts ou blessés.
« En Chine, l’homosexualité n’a pas été pratiquée que sous les Tang et les
Song ; on en trouve déjà mention sous la dynastie Wei. Les relations que
nous en possédons proviennent toutes de la cour impériale. Mais
l’homosexualité n’a jamais dominé aucune société – peut-être parce que
l’humanité a un besoin naturel de l’amour entre hommes et femmes pour
procréer. Comme les hommes avisés et les sages de la Chine classique l’ont
dit : “Tout concourt à trouver sa place, et le sort décide.”
« Nous sommes tous d’accord pour dire que chacun a le droit de choisir
son style de vie, et le droit d’exprimer ses besoins sexuels. Toutefois,
l’humanité est en perpétuel changement. Chaque pays, ethnie et région
avance du mieux qu’il peut vers une humanité future, en quête d’un système
parfait. Personne ne peut cependant prononcer de conclusion définitive sur
les bienfaits et les méfaits de cette quête, et en attendant d’avoir atteint cette
perfection, nous avons besoin de conseils pour nous guider. Nous avons
aussi besoin de tolérance et de compréhension.
« Je ne pense pas que l’hérédité seule puisse expliquer l’homosexualité, et
je ne crois pas non plus qu’on puisse tenir l’environnement familial pour
seul responsable. La curiosité est une explication encore moins crédible. Je
crois que ses sources sont multiples et variées. Nous faisons tous des
expériences différentes dans la vie, et nous faisons des choix similaires mais
différents. Reconnaître la différence veut dire que nous ne devrions pas
nous attendre à ce que les autres partagent nos opinions sur
l’homosexualité, car de telles espérances peuvent entraîner des préjugés
d’une autre sorte.
« A nos amis homosexuels qui ont souffert de préjugés, j’aimerais
demander pardon de la part des gens irréfléchis qu’ils ont pu rencontrer.
Nous avons tous besoin de compréhension dans ce monde.
J’ai monté le volume de la musique, fermé le micro et inspiré
profondément. Tout à coup je me suis rendu compte que, dans la pièce de
contrôle de l’autre côté de la séparation de verre, s’étaient rassemblés tous
les cadres supérieurs de la station. Le patron de la radio et le directeur de la
programmation se sont précipités dans mon studio, m’ont saisi les mains et
les ont secouées vigoureusement.
— Merci, merci, Xinran ! Vous vous en êtes très très bien sortie !
Les paumes du grand patron étaient moites.
— Vous nous avez sauvé la peau ! a bredouillé le directeur de la
programmation, les mains tremblantes.
— Assez bavardé, allons dîner ! On mettra ça sur le compte du bureau, a
dit le Vieux Wu, le directeur administratif.
J’étais confondue par tant d’attentions.
Par la suite, j’ai compris ce qui était arrivé. La contrôleuse m’a dit que,
l’esprit occupé par le résultat des examens d’entrée de son fils à
l’université, elle n’avait pas prêté attention à l’appel avant que le directeur
de service paniqué ne lui téléphone. Le Vieux Wu écoutait l’émission chez
lui, comme il le faisait tous les jours. En comprenant que l’émission
avançait en terrain miné, il avait immédiatement appelé le directeur de la
programmation, qui avait en hâte appelé le patron de la radio : être
conscient de la situation et ne pas le signaler aurait constitué une erreur plus
grave encore. Ils s’étaient tous rendus au studio aussi vite qu’ils avaient pu,
en écoutant mon émission en route. Quand ils étaient arrivés dans la pièce
de contrôle, la crise s’était résolue d’elle-même.
musique douce – ce que je faisais habituellement pendant les dix dernières
minutes – quand j’ai pris un dernier appel :
— Xinran, bonsoir, j’appelle de Ma’anshan. Merci pour votre émission.
Elle me donne beaucoup à réfléchir et me réconforte, moi et beaucoup
d’autres femmes. Aujourd’hui, j’aimerais vous demander ce que vous
pensez de l’homosexualité. Pourquoi tant de gens rejettent-ils les
homosexuels ? Pourquoi la Chine considère-t-elle l’homosexualité comme
un délit ? Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que les homosexuels
ont les mêmes droits et sont confrontés aux mêmes choix dans la vie que
tout le monde ?…
Alors que l’interlocutrice continuait à déverser son flot de questions, j’ai
senti une sueur froide m’envahir. L’homosexualité était un sujet tabou selon
le code des médias ; je me suis demandé, affolée, pourquoi la contrôleuse
n’avait pas coupé l’appel.
Impossible de me dérober : des milliers de gens attendaient ma réponse et
je ne pouvais pas dire que c’était un sujet considéré comme interdit. Ni que
le temps nous manquait : il restait encore quinze bonnes minutes avant la
fin de l’émission. J’ai augmenté le volume de la musique tout en cherchant
frénétiquement dans mes souvenirs de lectures sur l’homosexualité une
façon d’aborder le sujet de façon diplomatique. La femme venait de poser
une question pertinente, qui devait traîner dans l’esprit des auditeurs :
— L’homosexualité a son histoire propre, de la Rome antique à l’Occident
et des dynasties Tang et Song en Chine jusqu’à nos jours. Il y a des
arguments philosophiques qui établissent que tout ce qui existe a une raison
d’être, alors pourquoi considère-t-on en Chine que l’homosexualité est une
aberration ?
A ce moment-là, j’ai aperçu à travers l’écran de verre la contrôleuse qui
décrochait le téléphone intérieur. Elle a blêmi et coupé immédiatement
l’appel au beau milieu d’une phrase, alors que c’était strictement interdit.
Quelques instants plus tard, le directeur du service est entré en trombe dans
la pièce de contrôle et m’a dit dans l’interphone : « Soyez prudente,
Xinran ! »
J’ai laissé la musique pendant une minute de plus avant d’ouvrir le micro.
— Bonsoir, amis de la radio, vous écoutez Mots sur la brise nocturne.
Mon nom est Xinran, et je débats en direct avec vous du monde des
femmes. De dix à douze tous les soirs, vous pouvez vous mettre à l’écoute
de la vie des femmes, des battements de leurs cœurs et écouter leurs
histoires.
Je faisais de mon mieux pour gagner du temps tout en mettant de l’ordre
dans mes pensées.
— Nous venons de recevoir l’appel d’une auditrice qui en sait long sur la
société et l’histoire, et compatit aux expériences d’un groupe de femmes qui
ont un style de vie non conventionnel.
« Pour autant que je sache, l’homosexualité n’est pas, comme le dit notre
auditrice, un produit spécifique de la société contemporaine ; on en trouve
mention dans l’histoire occidentale et orientale. On raconte que pendant les
guerres de conquête de la Rome antique, les chefs allaient jusqu’à
encourager leurs soldats à pratiquer l’homosexualité. Cependant, il
s’agissait peut-être à l’époque plus d’une question d’utilité que d’une
véritable approbation. Les relations homosexuelles aidaient les soldats à
supporter la guerre et l’éloignement de leurs familles. Par un retournement
cruel, les attachements sentimentaux formés entre les soldats leur
insufflaient une énergie accrue pour venger leurs amants morts ou blessés.
« En Chine, l’homosexualité n’a pas été pratiquée que sous les Tang et les
Song ; on en trouve déjà mention sous la dynastie Wei. Les relations que
nous en possédons proviennent toutes de la cour impériale. Mais
l’homosexualité n’a jamais dominé aucune société – peut-être parce que
l’humanité a un besoin naturel de l’amour entre hommes et femmes pour
procréer. Comme les hommes avisés et les sages de la Chine classique l’ont
dit : “Tout concourt à trouver sa place, et le sort décide.”
« Nous sommes tous d’accord pour dire que chacun a le droit de choisir
son style de vie, et le droit d’exprimer ses besoins sexuels. Toutefois,
l’humanité est en perpétuel changement. Chaque pays, ethnie et région
avance du mieux qu’il peut vers une humanité future, en quête d’un système
parfait. Personne ne peut cependant prononcer de conclusion définitive sur
les bienfaits et les méfaits de cette quête, et en attendant d’avoir atteint cette
perfection, nous avons besoin de conseils pour nous guider. Nous avons
aussi besoin de tolérance et de compréhension.
« Je ne pense pas que l’hérédité seule puisse expliquer l’homosexualité, et
je ne crois pas non plus qu’on puisse tenir l’environnement familial pour
seul responsable. La curiosité est une explication encore moins crédible. Je
crois que ses sources sont multiples et variées. Nous faisons tous des
expériences différentes dans la vie, et nous faisons des choix similaires mais
différents. Reconnaître la différence veut dire que nous ne devrions pas
nous attendre à ce que les autres partagent nos opinions sur
l’homosexualité, car de telles espérances peuvent entraîner des préjugés
d’une autre sorte.
« A nos amis homosexuels qui ont souffert de préjugés, j’aimerais
demander pardon de la part des gens irréfléchis qu’ils ont pu rencontrer.
Nous avons tous besoin de compréhension dans ce monde.
J’ai monté le volume de la musique, fermé le micro et inspiré
profondément. Tout à coup je me suis rendu compte que, dans la pièce de
contrôle de l’autre côté de la séparation de verre, s’étaient rassemblés tous
les cadres supérieurs de la station. Le patron de la radio et le directeur de la
programmation se sont précipités dans mon studio, m’ont saisi les mains et
les ont secouées vigoureusement.
— Merci, merci, Xinran ! Vous vous en êtes très très bien sortie !
Les paumes du grand patron étaient moites.
— Vous nous avez sauvé la peau ! a bredouillé le directeur de la
programmation, les mains tremblantes.
— Assez bavardé, allons dîner ! On mettra ça sur le compte du bureau, a
dit le Vieux Wu, le directeur administratif.
J’étais confondue par tant d’attentions.
Par la suite, j’ai compris ce qui était arrivé. La contrôleuse m’a dit que,
l’esprit occupé par le résultat des examens d’entrée de son fils à
l’université, elle n’avait pas prêté attention à l’appel avant que le directeur
de service paniqué ne lui téléphone. Le Vieux Wu écoutait l’émission chez
lui, comme il le faisait tous les jours. En comprenant que l’émission
avançait en terrain miné, il avait immédiatement appelé le directeur de la
programmation, qui avait en hâte appelé le patron de la radio : être
conscient de la situation et ne pas le signaler aurait constitué une erreur plus
grave encore. Ils s’étaient tous rendus au studio aussi vite qu’ils avaient pu,
en écoutant mon émission en route. Quand ils étaient arrivés dans la pièce
de contrôle, la crise s’était résolue d’elle-même.
Mes collègues disaient : « Les journalistes deviennent de plus en plus
circonspects avec le temps. » A mesure que je gagnais une certaine
expérience du fonctionnement de la radiodiffusion et essayais de repousser
les limites imposées à mon émission, je commençais à entrevoir ce qu’ils
entendaient par là. A tout moment, un journaliste pouvait commettre une
erreur mettant sa carrière, si ce n’est sa liberté, en danger. Nous vivions
dans un monde régi par un ensemble minutieusement contingenté de règles,
et si on les enfreignait, cela pouvait entraîner de graves conséquences. La
première fois que j’ai présenté une émission de radio, mon directeur avait
l’air si nerveux que je pensais qu’il allait s’évanouir. Ce n’est que plus tard,
quand je suis devenue chef de service moi-même, que j’ai découvert
comment, en accord avec les règles de radiodiffusion chinoises, quand un
bulletin était coupé ne fût-ce que trente secondes, le nom de la personne en
charge de l’équipe faisait le tour du pays – une action disciplinaire qui
pouvait sérieusement affecter les promotions futures. Les erreurs les plus
infimes pouvaient se traduire par une réduction de la prime mensuelle (qui
était bien plus élevée que le salaire) ; les erreurs graves menaient souvent à
une régression à un échelon inférieur, si ce n’est au renvoi pur et simple.
Deux ou trois fois par semaine, les journalistes de la radio devaient assister
à un cours d’études politiques. Les séances développaient les vues de Deng
Xiaoping sur l’ouverture de la Chine et les théories de Jiang Zemin
concernant l’économie. Les principes et l’importance politique des
informations nous étaient inculqués encore et encore, et aucune séance ne
s’achevait sans quelque condamnation de collègues pour des transgressions
variées : ne pas avoir annoncé les noms des chefs dans le bon ordre
hiérarchique, avoir échoué à restituer les fondements de la propagande du
Parti dans un commentaire, avoir manqué de respect envers ses aînés, ne
pas avoir mis le Parti au courant d’une liaison amoureuse, s’être comporté
avec « indécence » ; tout cela et d’autres manquements de ce genre étaient
mis au ban public. Pendant ces sessions, j’avais le sentiment que la Chine
était encore aux prises avec la Révolution culturelle : la politique régulait
encore tous les aspects de la vie quotidienne ; certains groupes de gens
étaient soumis à la censure et aux jugements, ce qui donnait aux autres le
sentiment d’accomplir quelque chose.
Je trouvais très difficile de me souvenir de toutes ces informations
politiques, mais j’étais sûre de retenir le précepte le plus important : « Le
Parti est seul juge. » Le temps est venu où ma propre compréhension de ce
principe a été mise à l’épreuve.
circonspects avec le temps. » A mesure que je gagnais une certaine
expérience du fonctionnement de la radiodiffusion et essayais de repousser
les limites imposées à mon émission, je commençais à entrevoir ce qu’ils
entendaient par là. A tout moment, un journaliste pouvait commettre une
erreur mettant sa carrière, si ce n’est sa liberté, en danger. Nous vivions
dans un monde régi par un ensemble minutieusement contingenté de règles,
et si on les enfreignait, cela pouvait entraîner de graves conséquences. La
première fois que j’ai présenté une émission de radio, mon directeur avait
l’air si nerveux que je pensais qu’il allait s’évanouir. Ce n’est que plus tard,
quand je suis devenue chef de service moi-même, que j’ai découvert
comment, en accord avec les règles de radiodiffusion chinoises, quand un
bulletin était coupé ne fût-ce que trente secondes, le nom de la personne en
charge de l’équipe faisait le tour du pays – une action disciplinaire qui
pouvait sérieusement affecter les promotions futures. Les erreurs les plus
infimes pouvaient se traduire par une réduction de la prime mensuelle (qui
était bien plus élevée que le salaire) ; les erreurs graves menaient souvent à
une régression à un échelon inférieur, si ce n’est au renvoi pur et simple.
Deux ou trois fois par semaine, les journalistes de la radio devaient assister
à un cours d’études politiques. Les séances développaient les vues de Deng
Xiaoping sur l’ouverture de la Chine et les théories de Jiang Zemin
concernant l’économie. Les principes et l’importance politique des
informations nous étaient inculqués encore et encore, et aucune séance ne
s’achevait sans quelque condamnation de collègues pour des transgressions
variées : ne pas avoir annoncé les noms des chefs dans le bon ordre
hiérarchique, avoir échoué à restituer les fondements de la propagande du
Parti dans un commentaire, avoir manqué de respect envers ses aînés, ne
pas avoir mis le Parti au courant d’une liaison amoureuse, s’être comporté
avec « indécence » ; tout cela et d’autres manquements de ce genre étaient
mis au ban public. Pendant ces sessions, j’avais le sentiment que la Chine
était encore aux prises avec la Révolution culturelle : la politique régulait
encore tous les aspects de la vie quotidienne ; certains groupes de gens
étaient soumis à la censure et aux jugements, ce qui donnait aux autres le
sentiment d’accomplir quelque chose.
Je trouvais très difficile de me souvenir de toutes ces informations
politiques, mais j’étais sûre de retenir le précepte le plus important : « Le
Parti est seul juge. » Le temps est venu où ma propre compréhension de ce
principe a été mise à l’épreuve.
Pendant les quelques années qui ont suivi, je me suis entretenue avec un
certain nombre de femmes sur leurs croyances, et ces entretiens ont
confirmé l’opinion qu’elles étaient vraiment capables de croire à tout un
éventail de religions en même temps. A Zhengzhou, j’ai rencontré une
cadre à la retraite qui réussissait à concilier sa dévotion au Parti
communiste avec une foi intense dans un Fangxiang gong (un Qigong des
odeurs et des parfums) – un genre de Qigong où l’idée est d’amener le
maître à émettre un parfum qui vous permette d’inhaler sa bonté et de
donner de la force à votre corps. Avant cela, elle croyait dans des exercices
pour garder la forme et des remèdes aux plantes. Quand je lui ai demandé si
elle croyait au bouddhisme, elle m’a dit de ne pas parler trop fort mais a
reconnu que, oui, elle y croyait. Les personnes âgées de sa famille avaient
toujours dit qu’il valait mieux croire à tout plutôt que de ne croire à rien.
Elle m’a aussi raconté qu’elle croyait en Jésus qui était le père Noël et
venait chez vous vous aider à la fin de l’année. Comme je m’étonnais que
Jésus et le père Noël soient une seule et même personne, elle a répliqué que
j’étais trop jeune pour comprendre et m’a demandé de ne pas diffuser notre
conversation :
— On dit : « A la maison, croyez en vos propres dieux et faites ce que
vous voulez ; au-dehors, croyez au Parti et surveillez vos actes. » Mais je ne
voudrais pas qu’on apprenne ce que je viens de vous dire. Je ne veux pas
que les gens me fassent subir de mauvais traitements maintenant que je suis
vieille.
— N’ayez crainte, je n’en parlerai à personne, l’ai-je rassurée.
Elle a pris un air dubitatif.
— C’est ce que vous dites, mais par les temps qui courent, à qui se fier ?
certain nombre de femmes sur leurs croyances, et ces entretiens ont
confirmé l’opinion qu’elles étaient vraiment capables de croire à tout un
éventail de religions en même temps. A Zhengzhou, j’ai rencontré une
cadre à la retraite qui réussissait à concilier sa dévotion au Parti
communiste avec une foi intense dans un Fangxiang gong (un Qigong des
odeurs et des parfums) – un genre de Qigong où l’idée est d’amener le
maître à émettre un parfum qui vous permette d’inhaler sa bonté et de
donner de la force à votre corps. Avant cela, elle croyait dans des exercices
pour garder la forme et des remèdes aux plantes. Quand je lui ai demandé si
elle croyait au bouddhisme, elle m’a dit de ne pas parler trop fort mais a
reconnu que, oui, elle y croyait. Les personnes âgées de sa famille avaient
toujours dit qu’il valait mieux croire à tout plutôt que de ne croire à rien.
Elle m’a aussi raconté qu’elle croyait en Jésus qui était le père Noël et
venait chez vous vous aider à la fin de l’année. Comme je m’étonnais que
Jésus et le père Noël soient une seule et même personne, elle a répliqué que
j’étais trop jeune pour comprendre et m’a demandé de ne pas diffuser notre
conversation :
— On dit : « A la maison, croyez en vos propres dieux et faites ce que
vous voulez ; au-dehors, croyez au Parti et surveillez vos actes. » Mais je ne
voudrais pas qu’on apprenne ce que je viens de vous dire. Je ne veux pas
que les gens me fassent subir de mauvais traitements maintenant que je suis
vieille.
— N’ayez crainte, je n’en parlerai à personne, l’ai-je rassurée.
Elle a pris un air dubitatif.
— C’est ce que vous dites, mais par les temps qui courent, à qui se fier ?
Je n’avais pas oublié les trois questions de l’étudiante Jin Shuai : De quelle
philosophie se réclament les femmes ? Que signifie le mot « bonheur » pour
une femme ? Et qu’est-ce qui fait d’une femme une femme « bien » ? Au fil
de mes enquêtes pour mes émissions, j’essayais d’y répondre.
Je pensais qu’il serait intéressant de demander à mes collègues plus âgés et
plus expérimentés, le Grand Li et le Vieux Chen, leurs opinions sur les
philosophies qui sous-tendaient la vie des femmes. Il va de soi qu’à une
époque où la foi dans le Parti venait toujours en premier, il me fallait faire
attention à la façon dont je poserais cette question.
— Bien sûr, les femmes croient dans le Parti avant toute chose,
commençai-je, mais n’ont-elles pas d’autres croyances ?
Le Vieux Chen accepta avec empressement de débattre de ce sujet.
— Les Chinoises ont une tournure d’esprit religieuse, déclara-t-il, mais il
semble qu’elles puissent croire en plusieurs religions à la fois. Les femmes
qui croient aux exercices physiques et spirituels du Qigong changent
constamment de type de Qigong et de maître : leurs dieux vont et viennent.
On ne peut pas leur en tenir rigueur : les difficultés de la vie les poussent à
chercher une façon de s’en sortir. Comme le président Mao l’a dit : « La
pauvreté fait naître un désir de changement. » Maintenant nous croyons en
Mao Zedong et au communisme, mais avant on croyait au Ciel, à
l’Empereur Céleste, au Bouddha, à Jésus et Mahomet. En dépit de notre
longue histoire, nous n’avons pas de foi indigène. Les empereurs et les
dirigeants étaient considérés comme des divinités, mais ils changeaient tout
le temps et les gens ont pris l’habitude d’adorer différents dieux. Comme on
dit : « Pour cent personnes, cent croyances différentes. » En fait, on pourrait
dire qu’on ne croit vraiment en rien. Les femmes sont beaucoup plus
pragmatiques que les hommes, aussi elles ont tendance à mettre tous les
atouts dans leur manche. Et comme elles ne voient pas bien quel est le dieu
qui a le plus de pouvoir ou l’esprit qui est le plus utile, elles croient en tous,
juste pour mettre toutes les chances de leur côté.
Je savais que ce qu’il disait était vrai, mais je me demandais comment les
gens réussissaient à concilier les doctrines antagonistes des différentes
religions. Le Vieux Chen sembla deviner mes pensées.
— Je crois que presque toutes les femmes comprennent ce qu’est la
religion. La plupart essaient seulement de faire comme les autres, de peur
d’être mal vues.
Le Grand Li était d’accord avec le Vieux Chen. Il souligna le fait que,
surtout depuis qu’on avait institué la liberté religieuse en 1983, un foyer
pouvait avoir plusieurs autels consacrés à des dieux différents. La plupart
des gens qui priaient le faisaient pour demander la fortune ou d’autres
bénéfices. Il me parla de ses voisins : un des grands-parents était bouddhiste
et l’autre taoïste, et ils se disputaient constamment. Loin des bâtons
d’encens, la petite-fille chrétienne avait édifié une croix ; les grands-parents
le lui reprochaient sans cesse, en disant qu’elle serait la cause de leur mort
précoce. La mère de la fille croyait en une forme de Qigong et le père
croyait au dieu de la Richesse. Eux aussi étaient tout le temps en train de se
chamailler : la femme disait que l’avidité de l’homme portait atteinte à sa
spiritualité, et l’homme accusait les mauvaises influences de la femme de
faire du tort à sa fortune. Le peu d’argent que possédait cette famille était
dépensé en rituels religieux ou en images saintes, mais ils n’en étaient pas
plus riches ni plus heureux pour autant.
Le Grand Li me parla aussi d’une femme chef d’entreprise de ses
connaissances qui avait la réputation d’être très religieuse. Dans ses
discours publics, elle faisait l’éloge du Parti communiste, unique espoir de
la Chine ; une fois redescendue du podium, elle prêchait le bouddhisme,
disait aux gens qu’ils seraient récompensés dans leur prochaine vie en
fonction de leurs actes dans celle-ci. Quand le vent tournait, elle se faisait
l’avocate d’un certain type de Qigong miraculeux. Quelqu’un de son unité
de travail m’a dit qu’elle épinglait un badge du Parti communiste sur son
manteau, une image du Bouddha sur sa petite culotte et un portrait du
Grand Maître Zhang de la secte Zangmigong sur son soutien-gorge.
En voyant mon regard incrédule, le Grand Li m’a assuré que le nom de
cette femme était souvent mentionné dans les journaux. Elle était élue
« Travailleuse modèle » tous les ans, et avait été choisie comme membre
extraordinaire du Parti plusieurs fois.
— Ce genre de religiosité ne doit pas être trop du goût du Parti, ai-je dit
d’un ton légèrement irrévérencieux.
Le Vieux Chen a tapoté la table et déclaré, l’air sévère :
— Xinran, faites attention à ce que vous dites. Ce genre de propos pourrait
vous coûter votre tête.
— Devons-nous encore avoir peur ?
— Ne soyez pas si naïve ! Dans les années cinquante, le Parti a lancé un
appel pour que « cent fleurs s’épanouissent et rivalisent entre elles ». Que
s’est-il passé ? Ceux qui ont répondu à l’appel ont tous été emprisonnés ou
envoyés dans des villages perdus dans les montagnes. Certains n’avaient
fait qu’exprimer leurs pensées dans leur journal intime, et ils ont dû pour
cela supporter les dénonciations publiques et la prison.
Le Vieux Chen était un homme bon. Il m’a mise en garde :
— Vous ne devriez pas trop parler de foi et de religion. Vous n’allez vous
attirer que des ennuis.
philosophie se réclament les femmes ? Que signifie le mot « bonheur » pour
une femme ? Et qu’est-ce qui fait d’une femme une femme « bien » ? Au fil
de mes enquêtes pour mes émissions, j’essayais d’y répondre.
Je pensais qu’il serait intéressant de demander à mes collègues plus âgés et
plus expérimentés, le Grand Li et le Vieux Chen, leurs opinions sur les
philosophies qui sous-tendaient la vie des femmes. Il va de soi qu’à une
époque où la foi dans le Parti venait toujours en premier, il me fallait faire
attention à la façon dont je poserais cette question.
— Bien sûr, les femmes croient dans le Parti avant toute chose,
commençai-je, mais n’ont-elles pas d’autres croyances ?
Le Vieux Chen accepta avec empressement de débattre de ce sujet.
— Les Chinoises ont une tournure d’esprit religieuse, déclara-t-il, mais il
semble qu’elles puissent croire en plusieurs religions à la fois. Les femmes
qui croient aux exercices physiques et spirituels du Qigong changent
constamment de type de Qigong et de maître : leurs dieux vont et viennent.
On ne peut pas leur en tenir rigueur : les difficultés de la vie les poussent à
chercher une façon de s’en sortir. Comme le président Mao l’a dit : « La
pauvreté fait naître un désir de changement. » Maintenant nous croyons en
Mao Zedong et au communisme, mais avant on croyait au Ciel, à
l’Empereur Céleste, au Bouddha, à Jésus et Mahomet. En dépit de notre
longue histoire, nous n’avons pas de foi indigène. Les empereurs et les
dirigeants étaient considérés comme des divinités, mais ils changeaient tout
le temps et les gens ont pris l’habitude d’adorer différents dieux. Comme on
dit : « Pour cent personnes, cent croyances différentes. » En fait, on pourrait
dire qu’on ne croit vraiment en rien. Les femmes sont beaucoup plus
pragmatiques que les hommes, aussi elles ont tendance à mettre tous les
atouts dans leur manche. Et comme elles ne voient pas bien quel est le dieu
qui a le plus de pouvoir ou l’esprit qui est le plus utile, elles croient en tous,
juste pour mettre toutes les chances de leur côté.
Je savais que ce qu’il disait était vrai, mais je me demandais comment les
gens réussissaient à concilier les doctrines antagonistes des différentes
religions. Le Vieux Chen sembla deviner mes pensées.
— Je crois que presque toutes les femmes comprennent ce qu’est la
religion. La plupart essaient seulement de faire comme les autres, de peur
d’être mal vues.
Le Grand Li était d’accord avec le Vieux Chen. Il souligna le fait que,
surtout depuis qu’on avait institué la liberté religieuse en 1983, un foyer
pouvait avoir plusieurs autels consacrés à des dieux différents. La plupart
des gens qui priaient le faisaient pour demander la fortune ou d’autres
bénéfices. Il me parla de ses voisins : un des grands-parents était bouddhiste
et l’autre taoïste, et ils se disputaient constamment. Loin des bâtons
d’encens, la petite-fille chrétienne avait édifié une croix ; les grands-parents
le lui reprochaient sans cesse, en disant qu’elle serait la cause de leur mort
précoce. La mère de la fille croyait en une forme de Qigong et le père
croyait au dieu de la Richesse. Eux aussi étaient tout le temps en train de se
chamailler : la femme disait que l’avidité de l’homme portait atteinte à sa
spiritualité, et l’homme accusait les mauvaises influences de la femme de
faire du tort à sa fortune. Le peu d’argent que possédait cette famille était
dépensé en rituels religieux ou en images saintes, mais ils n’en étaient pas
plus riches ni plus heureux pour autant.
Le Grand Li me parla aussi d’une femme chef d’entreprise de ses
connaissances qui avait la réputation d’être très religieuse. Dans ses
discours publics, elle faisait l’éloge du Parti communiste, unique espoir de
la Chine ; une fois redescendue du podium, elle prêchait le bouddhisme,
disait aux gens qu’ils seraient récompensés dans leur prochaine vie en
fonction de leurs actes dans celle-ci. Quand le vent tournait, elle se faisait
l’avocate d’un certain type de Qigong miraculeux. Quelqu’un de son unité
de travail m’a dit qu’elle épinglait un badge du Parti communiste sur son
manteau, une image du Bouddha sur sa petite culotte et un portrait du
Grand Maître Zhang de la secte Zangmigong sur son soutien-gorge.
En voyant mon regard incrédule, le Grand Li m’a assuré que le nom de
cette femme était souvent mentionné dans les journaux. Elle était élue
« Travailleuse modèle » tous les ans, et avait été choisie comme membre
extraordinaire du Parti plusieurs fois.
— Ce genre de religiosité ne doit pas être trop du goût du Parti, ai-je dit
d’un ton légèrement irrévérencieux.
Le Vieux Chen a tapoté la table et déclaré, l’air sévère :
— Xinran, faites attention à ce que vous dites. Ce genre de propos pourrait
vous coûter votre tête.
— Devons-nous encore avoir peur ?
— Ne soyez pas si naïve ! Dans les années cinquante, le Parti a lancé un
appel pour que « cent fleurs s’épanouissent et rivalisent entre elles ». Que
s’est-il passé ? Ceux qui ont répondu à l’appel ont tous été emprisonnés ou
envoyés dans des villages perdus dans les montagnes. Certains n’avaient
fait qu’exprimer leurs pensées dans leur journal intime, et ils ont dû pour
cela supporter les dénonciations publiques et la prison.
Le Vieux Chen était un homme bon. Il m’a mise en garde :
— Vous ne devriez pas trop parler de foi et de religion. Vous n’allez vous
attirer que des ennuis.
— Quelqu’un a crié à Xiao Ping : « Il est cinq heures trente du matin, on
va venir te porter secours bientôt ! » Il voulait la réconforter, l’aider à tenir.
Mais les secondes, les minutes et les heures passaient, et les secours ne
venaient pas.
— Parce qu’il a fallu du temps aux gens avant de découvrir ce qui s’était
passé, ai-je dit en me souvenant que cela avait pris longtemps avant qu’un
bulletin de nouvelles nous parvienne.
Mme Yang a hoché la tête.
— Quelle sorte de pays était-ce donc en 1976 ? Une grande cité gisait en
ruine, trois cent mille personnes étaient mortes, et personne ne le savait. La
Chine était un pays arriéré ! Je crois que si nous avions été un peu plus
évolués, on aurait pu épargner la vie de beaucoup de gens. Xiao Ping aurait
survécu.
va venir te porter secours bientôt ! » Il voulait la réconforter, l’aider à tenir.
Mais les secondes, les minutes et les heures passaient, et les secours ne
venaient pas.
— Parce qu’il a fallu du temps aux gens avant de découvrir ce qui s’était
passé, ai-je dit en me souvenant que cela avait pris longtemps avant qu’un
bulletin de nouvelles nous parvienne.
Mme Yang a hoché la tête.
— Quelle sorte de pays était-ce donc en 1976 ? Une grande cité gisait en
ruine, trois cent mille personnes étaient mortes, et personne ne le savait. La
Chine était un pays arriéré ! Je crois que si nous avions été un peu plus
évolués, on aurait pu épargner la vie de beaucoup de gens. Xiao Ping aurait
survécu.
Les parents ainsi que les beaux-parents de Xiao Yao étaient là, et la
chambre était remplie de cadeaux. Xiao Yao semblait heureuse et
étonnamment reposée après l’épreuve de l’accouchement. Avoir mis au
monde un garçon était une des raisons de cette aura de bien-être, ai-je pensé
alors.
Depuis d’innombrables générations, on accorde foi à cette maxime : « Il y
a trente-six vertus, mais rester sans héritier est une malédiction qui les
abolit toutes. » Une femme qui a donné naissance à un fils est irréprochable.
Quand Xiao Yao était venue pour accoucher, elle avait dû partager une
salle avec sept autres femmes. Elle avait demandé plusieurs fois à son mari
de lui procurer une chambre individuelle, mais il avait refusé. En apprenant
qu’elle avait eu un fils, son mari s’était immédiatement débrouillé pour
accéder à son désir.
chambre était remplie de cadeaux. Xiao Yao semblait heureuse et
étonnamment reposée après l’épreuve de l’accouchement. Avoir mis au
monde un garçon était une des raisons de cette aura de bien-être, ai-je pensé
alors.
Depuis d’innombrables générations, on accorde foi à cette maxime : « Il y
a trente-six vertus, mais rester sans héritier est une malédiction qui les
abolit toutes. » Une femme qui a donné naissance à un fils est irréprochable.
Quand Xiao Yao était venue pour accoucher, elle avait dû partager une
salle avec sept autres femmes. Elle avait demandé plusieurs fois à son mari
de lui procurer une chambre individuelle, mais il avait refusé. En apprenant
qu’elle avait eu un fils, son mari s’était immédiatement débrouillé pour
accéder à son désir.
Le Nouvel An était passé et la fête du Printemps approchait. C’est la fête
la plus importante de l’année pour les Chinois, et l’occasion pour beaucoup
de renforcer leurs relations commerciales. Tous les ans, les responsables des
médias tirent tout le parti possible des festivités. Quelles que soient leurs
fonctions, ils reçoivent des montagnes de cadeaux et des douzaines
d’invitations à des galas et des dîners. Je n’étais encore qu’une humble
présentatrice, sans aucun pouvoir officiel, mais des gens riches et influents
cherchaient à faire ma connaissance à cause de la popularité de mon
émission. L’attention qu’ils me portaient n’était pas une reconnaissance de
ma réussite, c’est au nombre de mes auditeurs que je la devais. Tous les
responsables en Chine connaissent ce vieil aphorisme transmis de
génération en génération depuis les Tang : « L’eau porte le bateau, elle peut
aussi le faire chavirer. » Les gens simples comme mes auditeurs étaient
l’eau, et les officiels le bateau.
la plus importante de l’année pour les Chinois, et l’occasion pour beaucoup
de renforcer leurs relations commerciales. Tous les ans, les responsables des
médias tirent tout le parti possible des festivités. Quelles que soient leurs
fonctions, ils reçoivent des montagnes de cadeaux et des douzaines
d’invitations à des galas et des dîners. Je n’étais encore qu’une humble
présentatrice, sans aucun pouvoir officiel, mais des gens riches et influents
cherchaient à faire ma connaissance à cause de la popularité de mon
émission. L’attention qu’ils me portaient n’était pas une reconnaissance de
ma réussite, c’est au nombre de mes auditeurs que je la devais. Tous les
responsables en Chine connaissent ce vieil aphorisme transmis de
génération en génération depuis les Tang : « L’eau porte le bateau, elle peut
aussi le faire chavirer. » Les gens simples comme mes auditeurs étaient
l’eau, et les officiels le bateau.
Jeune homme, le mari de la Chiffonnière avait étudié à Moscou pendant
trois ans, et était entré en politique peu de temps après son retour. Cela avait
coïncidé avec les terribles événements du Grand Bond en avant. Sous l’œil
attentif du Parti, qui tirait les ficelles et échafaudait des plans pour lui, il
avait épousé la Chiffonnière. Alors que toute la famille se réjouissait de la
naissance d’un second enfant, son mari était mort subitement d’une crise
cardiaque. Vers la fin de l’année suivante, le plus jeune de ses enfants était
mort de la scarlatine. La douleur de la perte de son mari et de son enfant
avait enlevé à la Chiffonnière toute envie de continuer à vivre, au point
qu’un jour, elle avait emmené l’enfant qui lui restait sur la rive du Yangtse
avec l’intention de rejoindre son mari et son bébé dans l’autre monde.
Au bord du Yangtse, elle s’apprêtait à dire adieu à la vie lorsque son fils
lui avait demandé d’un air innocent : « On va rejoindre papa ? »
La Chiffonnière avait été choquée : comment un enfant de cinq ans
pouvait-il savoir ce qu’elle cachait en son cœur ? Elle avait demandé à son
fils : « A ton avis ? »
Il avait répondu d’une voix forte : « Bien sûr que nous allons voir papa !
Mais je n’ai pas apporté ma petite voiture pour lui montrer ! »
Elle avait éclaté en sanglots et n’avait pas posé à son fils d’autre question.
Il savait ce qu’elle ressentait. Il comprenait que son père n’était plus de ce
monde, mais comme tous les jeunes enfants, il n’avait pas une conscience
claire de la différence entre la vie et la mort. Ses larmes avaient ranimé ses
sentiments maternels et son sens du devoir. Elle avait pleuré, l’enfant dans
ses bras, et avait laissé le bruit du fleuve la laver de sa faiblesse et lui
redonner courage. Puis elle avait ramassé le billet d’adieu qu’elle avait écrit
et était rentrée chez elle avec son fils.
Il lui avait demandé : « Alors, on va pas voir papa ? »
Elle avait répondu : « Papa est trop loin, et tu es trop petit pour aller là-bas.
Maman va t’aider à grandir, et tu pourras emporter plus de choses, et des
plus belles quand tu iras le rejoindre. »
Après cette scène, la Chiffonnière avait fait tout son possible pour donner
à son fils ce qu’il y avait de mieux. Elle disait qu’il s’était très bien
débrouillé.
trois ans, et était entré en politique peu de temps après son retour. Cela avait
coïncidé avec les terribles événements du Grand Bond en avant. Sous l’œil
attentif du Parti, qui tirait les ficelles et échafaudait des plans pour lui, il
avait épousé la Chiffonnière. Alors que toute la famille se réjouissait de la
naissance d’un second enfant, son mari était mort subitement d’une crise
cardiaque. Vers la fin de l’année suivante, le plus jeune de ses enfants était
mort de la scarlatine. La douleur de la perte de son mari et de son enfant
avait enlevé à la Chiffonnière toute envie de continuer à vivre, au point
qu’un jour, elle avait emmené l’enfant qui lui restait sur la rive du Yangtse
avec l’intention de rejoindre son mari et son bébé dans l’autre monde.
Au bord du Yangtse, elle s’apprêtait à dire adieu à la vie lorsque son fils
lui avait demandé d’un air innocent : « On va rejoindre papa ? »
La Chiffonnière avait été choquée : comment un enfant de cinq ans
pouvait-il savoir ce qu’elle cachait en son cœur ? Elle avait demandé à son
fils : « A ton avis ? »
Il avait répondu d’une voix forte : « Bien sûr que nous allons voir papa !
Mais je n’ai pas apporté ma petite voiture pour lui montrer ! »
Elle avait éclaté en sanglots et n’avait pas posé à son fils d’autre question.
Il savait ce qu’elle ressentait. Il comprenait que son père n’était plus de ce
monde, mais comme tous les jeunes enfants, il n’avait pas une conscience
claire de la différence entre la vie et la mort. Ses larmes avaient ranimé ses
sentiments maternels et son sens du devoir. Elle avait pleuré, l’enfant dans
ses bras, et avait laissé le bruit du fleuve la laver de sa faiblesse et lui
redonner courage. Puis elle avait ramassé le billet d’adieu qu’elle avait écrit
et était rentrée chez elle avec son fils.
Il lui avait demandé : « Alors, on va pas voir papa ? »
Elle avait répondu : « Papa est trop loin, et tu es trop petit pour aller là-bas.
Maman va t’aider à grandir, et tu pourras emporter plus de choses, et des
plus belles quand tu iras le rejoindre. »
Après cette scène, la Chiffonnière avait fait tout son possible pour donner
à son fils ce qu’il y avait de mieux. Elle disait qu’il s’était très bien
débrouillé.
Elle m’a livré son histoire par bribes. Elle ne s’est pas attardée sur les
causes ou les conséquences, et j’avais l’impression qu’elle n’était pas
encore tout à fait décidée à me révéler les épreuves qu’elle avait connues.
Ses mots n’ont fait qu’ouvrir un peu la boîte où elle s’était enfermée, mais
n’ont pas levé le voile de son visage.
causes ou les conséquences, et j’avais l’impression qu’elle n’était pas
encore tout à fait décidée à me révéler les épreuves qu’elle avait connues.
Ses mots n’ont fait qu’ouvrir un peu la boîte où elle s’était enfermée, mais
n’ont pas levé le voile de son visage.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Xinran (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
132 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre132 lecteurs ont répondu