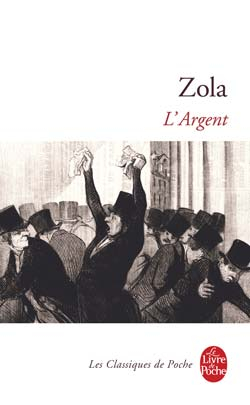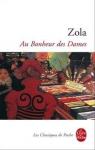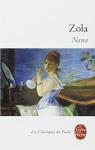Mai 1864. Saccard s'attable alors que le soleil réchauffe la place de la Bourse où l'omnibus de la Bastille fait un arrêt, où les fiacres s'enfilent les uns derrière les autres. Saccard, c'est Aristide Rougon que nous avons déjà rencontré. À cinquante ans, après avoir bien goûté à la richesse grâce à la spéculation immobilière pour remodeler le tout Paris, il tente de se remettre de sa dégringolade finale qui clôturait La Curée. Sa soif de triompher n'est pas encore éteinte et lui dessèche encore le gosier. Dans ce restaurant, les habitués de la Bourse, spéculateurs, remisiers, coulissiers, échangent avant l'ouverture de celle-ci et semblent battre froid à Saccard qui couve avec détermination le rêve de sa seconde ascension pour conquérir Paris.
Son appétit de fortune est intact, il veut tenter « le grand coup », une affaire échafaudée dans sa cervelle avide d'or, de millions et de pouvoir. Car déjà, avant la fin du Second Empire, l'argent, et ceux qui en jouent fébrilement à la Bourse, détiennent et activent les ficelles du pouvoir.
Vu de loin, des fourmis, silhouettes noires grouillantes sur les marches de l'édifice financier est une des images pleines d'évocation qui font tout l'enchantement des lectures zoliennes. Donc, pour avoir Paris et même le monde entier sous ses pieds, il suffit de contrôler toutes ces fourmis et prendre la place du tout puissant Gundermann, banquier roi, et qui, de par sa position, renferme ici toute la haine à venir du juif.
Voilà donc le grand projet de Saccard : créer une banque, la Banque universelle pour aller à l'assaut du monde. Finie la spéculation immobilière, place au jeu de la Bourse !
On se doute bien que l'ambition colossale de Saccard ne s'embarrassera pas des lois, ni ne s'inquiètera du frein de la morale pour apaiser sa fièvre.
Les magouilles financières ne datent pas d'hier, et celles d'aujourd'hui sont exactement similaires à celles décriées par Zola. Trouvons les fonds, faisons monter, par tous les moyens, le cours de l'action et fixons-nous un plafond dont l'unique objectif n'est pas de l'atteindre mais de le dépasser.
En périphérie des hausses, baisses, ordres d'achats fermes ou à terme, des titres qui virevoltent jusqu'à étourdissement, des cours qui s'accélèrent, élèvent puis précipitent les acquéreurs, Zola nous sert quelques personnages bien accommodés selon le rôle qu'il leur octroie. Il y a l'énorme Méchain, débordante de graisse, trimbalant son sac de cuir gonflé de valeurs déclassées de compagnies moribondes. L'image caricaturale du corbeau de la finance, avec son acolyte Busch, charognard chassant les débiteurs afin de recouvrer les créances non honorées.
Mais il y aussi une femme désirant redonner aux pauvres les millions acquis salement par son défunt mari et puis Mme Caroline, dont le désir de réveiller l'Orient enflamme les yeux de Saccard, imprimant sur ses rétines les milliards à la clé de ce développement.
En amour, en affaires, les infidélités courent et l'argent les talonne. Est-il maudit, pourri ou admirable ? N'a-t-il pas, à lui seul, la force d'améliorer de tristes conditions ? L'opinion de Caroline oscille et nous montre toute la complexité de ce questionnement.
Malgré la multiplicité des personnages, Zola se focalise sur cette puissance financière et laisse peu de répit au lecteur profane, oubliant ses habituelles envolées descriptives des alentours qui m'ont cruellement manqué dans cet opus des Rougon-Macquart. Les termes boursiers, heureusement repris dans un lexique pour éclairer faiblement mon ignorance en la matière, sont très, très présents et Zola en use et en abuse en les ramenant sur la scène moult et moult fois. Il n'en reste pas moins que je me sens toujours bien dans l'écriture de Zola, dans sa façon d'aller au fond des choses avec richesse et éclat.
Son appétit de fortune est intact, il veut tenter « le grand coup », une affaire échafaudée dans sa cervelle avide d'or, de millions et de pouvoir. Car déjà, avant la fin du Second Empire, l'argent, et ceux qui en jouent fébrilement à la Bourse, détiennent et activent les ficelles du pouvoir.
Vu de loin, des fourmis, silhouettes noires grouillantes sur les marches de l'édifice financier est une des images pleines d'évocation qui font tout l'enchantement des lectures zoliennes. Donc, pour avoir Paris et même le monde entier sous ses pieds, il suffit de contrôler toutes ces fourmis et prendre la place du tout puissant Gundermann, banquier roi, et qui, de par sa position, renferme ici toute la haine à venir du juif.
Voilà donc le grand projet de Saccard : créer une banque, la Banque universelle pour aller à l'assaut du monde. Finie la spéculation immobilière, place au jeu de la Bourse !
On se doute bien que l'ambition colossale de Saccard ne s'embarrassera pas des lois, ni ne s'inquiètera du frein de la morale pour apaiser sa fièvre.
Les magouilles financières ne datent pas d'hier, et celles d'aujourd'hui sont exactement similaires à celles décriées par Zola. Trouvons les fonds, faisons monter, par tous les moyens, le cours de l'action et fixons-nous un plafond dont l'unique objectif n'est pas de l'atteindre mais de le dépasser.
En périphérie des hausses, baisses, ordres d'achats fermes ou à terme, des titres qui virevoltent jusqu'à étourdissement, des cours qui s'accélèrent, élèvent puis précipitent les acquéreurs, Zola nous sert quelques personnages bien accommodés selon le rôle qu'il leur octroie. Il y a l'énorme Méchain, débordante de graisse, trimbalant son sac de cuir gonflé de valeurs déclassées de compagnies moribondes. L'image caricaturale du corbeau de la finance, avec son acolyte Busch, charognard chassant les débiteurs afin de recouvrer les créances non honorées.
Mais il y aussi une femme désirant redonner aux pauvres les millions acquis salement par son défunt mari et puis Mme Caroline, dont le désir de réveiller l'Orient enflamme les yeux de Saccard, imprimant sur ses rétines les milliards à la clé de ce développement.
En amour, en affaires, les infidélités courent et l'argent les talonne. Est-il maudit, pourri ou admirable ? N'a-t-il pas, à lui seul, la force d'améliorer de tristes conditions ? L'opinion de Caroline oscille et nous montre toute la complexité de ce questionnement.
Malgré la multiplicité des personnages, Zola se focalise sur cette puissance financière et laisse peu de répit au lecteur profane, oubliant ses habituelles envolées descriptives des alentours qui m'ont cruellement manqué dans cet opus des Rougon-Macquart. Les termes boursiers, heureusement repris dans un lexique pour éclairer faiblement mon ignorance en la matière, sont très, très présents et Zola en use et en abuse en les ramenant sur la scène moult et moult fois. Il n'en reste pas moins que je me sens toujours bien dans l'écriture de Zola, dans sa façon d'aller au fond des choses avec richesse et éclat.
L'argent c'est avant tout l'histoire des égos et de l'ambition qui écrase les sentiments profonds. L'égo pour Saccard, convaincu qu'il pourra retrouver la bonne Fortune via ses projets en Orient et prêt à toute la démesure pour arriver à ses fins. L'écrasement des sentiments, c'est justement le reniement de l'égo en cédant aux passions qui sont étrangères, en étant attiré comme les phalènes par la puissance de la lumière qu'on sait pourtant éphémère. Mme Caroline, son frère Hamelin, Busch, Delcambre, la baronne Sandorff, la comtesse Beauvilliers et sa fille sont les personnages centraux de ce grand roman ou l'adjuvant Gundermann se fait la cible d'un antisémitisme qui dégouline de façon toujours terriblement contemporaine.
"L'argent", dix-huitième volet des Rougon-Macquart, nous emmène dans le monde de la finance, où nous retrouvons Aristide Saccard, toujours aussi détestable. Dans "La curée", on avait déjà eu un avant-goût de cet être extravagant, qui n'a pas hésité à sacrifier sa famille pour arriver à ses fins. Dans "L'argent", il va beaucoup plus loin, lui qui se veut « le maître du monde », voulant anéantir « cette sale race juive », démontrer que lui aussi a cette « construction particulière de la cervelle, les mêmes aptitudes que la race juive ». D'une ambition à toute épreuve, il voit grand, trop sans aucun doute, en veut toujours plus alors que les millions de francs poussent comme une mauvaise herbe. Il veut la prospérité, la richesse, la reconnaissance, la célébrité. Et il les aura... avant de connaître la faillite et la ruine, sans oublier d'entraîner tout son petit monde avec lui (n'est pas Aristide Saccard qui veut !).
Pour la construction de son histoire, Émile Zola a suivi point par point le Krash de l'Union Générale (1881-1882), à l'issue duquel le banquier Bontoux, ruiné, a été condamné à cinq ans de prison. Mais ici, on ne parle pas de l'Union Générale, mais de la Banque Universelle. On ne parle pas des Rothschild, mais de Gundermann (banquier juif, ennemi juré de Saccard). Et évidemment, on ne parle pas non plus d'Eugène Bontoux, mais bel et bien d'Aristide Saccard. Il y est, comme le titre de cet ouvrage l'indique, uniquement question d'argent : tout se joue sur la place de la Bourse de Paris et tout tourne autour d'elle et des ambitions extravagantes de Saccard.
On baigne donc, tout au long de notre lecture, dans un milieu que je n'ai pas du tout trouvé attirant. Comme à son habitude, Zola connaît son sujet et nous le décrit superbement, toujours de manière très réaliste. Mais il a fallu que je m'accroche pour ne pas me perdre, même si l'auteur se répète souvent. Car il nous parle de spéculations, d'actions et de cotes boursières, de placements, de primes, d'intérêts, de liquidations, de crédits, de reports/déports, de transactions et de dividendes. Les nombreux personnages sont tour à tour banquiers, courtiers, agents de change, remisiers, commis, haussiers/baissiers, coulissiers, receveurs, coteurs, spéculateurs, liquidateurs, actionnaires, etc. de quoi se mélanger les pinceaux... Et je ne parle pas de toutes les magouilles, de l'achat de la presse et des politiques, tout comme de cette haine récurrente envers les Juifs.
Il est clair que je n'ai sans aucun doute pas tout compris à ce "jeu de la Bourse", passe-temps pour les uns, véritable addiction pour les autres. Ce milieu, dans lequel on achète et vend des actions avec facilité quand on a des milliers de francs plein les poches, met en avant des personnages abjects pour la plupart. Et pourtant, même si ce tome ne figurera pas dans mes préférés de la série, j'ai une nouvelle fois apprécié ma lecture.
"Plus on gagne d'argent, plus on en redemande" : c'est ce que Zola tient à démontrer dans son roman par le biais de ses personnages spéculateurs et/ou profiteurs, qui sont pour la plupart écoeurants. Pas la peine de préciser que je les ai détestés et qu'il me tardait les voir touchés par la faillite (oh que je suis méchante !)... Et pourtant, quelques-uns sortent du lot (comme Mme Caroline et son frère, la princesse Orvieda, ou encore M. Dejoie), et sans être attachants, on espère pour eux une fin moins dramatique (mais c'est mal connaître l'auteur...). Je constate que Saccard s'en sort bien, encore une fois, et c'est quelque peu enrageant...
La lecture fut donc un peu compliquée, à cause de tous ces termes spécifiques et le grand nombre de personnages. Mais j'ai finalement appris beaucoup, et l'auteur se répète souvent, nous permettant de mieux intégrer les différents procédés financiers. J'ai aimé suivre le déroulé des événements, les différentes étapes qui ont conduit d'abord à la prospérité et au succès, pour se terminer dans la faillite, pourtant prévisible dès le départ.
Pour la construction de son histoire, Émile Zola a suivi point par point le Krash de l'Union Générale (1881-1882), à l'issue duquel le banquier Bontoux, ruiné, a été condamné à cinq ans de prison. Mais ici, on ne parle pas de l'Union Générale, mais de la Banque Universelle. On ne parle pas des Rothschild, mais de Gundermann (banquier juif, ennemi juré de Saccard). Et évidemment, on ne parle pas non plus d'Eugène Bontoux, mais bel et bien d'Aristide Saccard. Il y est, comme le titre de cet ouvrage l'indique, uniquement question d'argent : tout se joue sur la place de la Bourse de Paris et tout tourne autour d'elle et des ambitions extravagantes de Saccard.
On baigne donc, tout au long de notre lecture, dans un milieu que je n'ai pas du tout trouvé attirant. Comme à son habitude, Zola connaît son sujet et nous le décrit superbement, toujours de manière très réaliste. Mais il a fallu que je m'accroche pour ne pas me perdre, même si l'auteur se répète souvent. Car il nous parle de spéculations, d'actions et de cotes boursières, de placements, de primes, d'intérêts, de liquidations, de crédits, de reports/déports, de transactions et de dividendes. Les nombreux personnages sont tour à tour banquiers, courtiers, agents de change, remisiers, commis, haussiers/baissiers, coulissiers, receveurs, coteurs, spéculateurs, liquidateurs, actionnaires, etc. de quoi se mélanger les pinceaux... Et je ne parle pas de toutes les magouilles, de l'achat de la presse et des politiques, tout comme de cette haine récurrente envers les Juifs.
Il est clair que je n'ai sans aucun doute pas tout compris à ce "jeu de la Bourse", passe-temps pour les uns, véritable addiction pour les autres. Ce milieu, dans lequel on achète et vend des actions avec facilité quand on a des milliers de francs plein les poches, met en avant des personnages abjects pour la plupart. Et pourtant, même si ce tome ne figurera pas dans mes préférés de la série, j'ai une nouvelle fois apprécié ma lecture.
"Plus on gagne d'argent, plus on en redemande" : c'est ce que Zola tient à démontrer dans son roman par le biais de ses personnages spéculateurs et/ou profiteurs, qui sont pour la plupart écoeurants. Pas la peine de préciser que je les ai détestés et qu'il me tardait les voir touchés par la faillite (oh que je suis méchante !)... Et pourtant, quelques-uns sortent du lot (comme Mme Caroline et son frère, la princesse Orvieda, ou encore M. Dejoie), et sans être attachants, on espère pour eux une fin moins dramatique (mais c'est mal connaître l'auteur...). Je constate que Saccard s'en sort bien, encore une fois, et c'est quelque peu enrageant...
La lecture fut donc un peu compliquée, à cause de tous ces termes spécifiques et le grand nombre de personnages. Mais j'ai finalement appris beaucoup, et l'auteur se répète souvent, nous permettant de mieux intégrer les différents procédés financiers. J'ai aimé suivre le déroulé des événements, les différentes étapes qui ont conduit d'abord à la prospérité et au succès, pour se terminer dans la faillite, pourtant prévisible dès le départ.
Le titre expose le sujet : ici, on va parler de pognon, d'oseille, de pèze, de flouze, de grisbi… pas tellement des picaillons, des piécettes ou de la mitraille qui traînent (quand il y en a) au fond du porte-monnaie de Gervaise, mais de la richesse, des actions, des placements et des opérations financières qui font la raison de vivre de certains « hommes d'affaires ». On va parler d'argent au sens général du terme : celui qui combiné au sexe et au pouvoir, tient les rênes du monde.
Zola a déjà abordé ce thème dans plusieurs romans : dans « La Curée », le dénommé Saccard (déjà lui) nous démontrait comment on bâtit une fortune. Dans « Au bonheur des dames », Octave Mouret nous expliquait une des façons de la faire fructifier. Et la plupart des autres romans, inversement, nous égrenaient les mille et une façons de s'en passer.
« L'Argent » nous place au coeur du sujet : la Bourse est le temple de ce nouveau dieu, et Saccard est son grand-prêtre. Saccard, vous vous en souvenez, c'est Aristide Rougon, le frère d'Eugène, le ministre ; comme beaucoup de personnages de la série (surtout dans ce milieu), il n'est pas d'une moralité exemplaire, il a autant de scrupules que moi j'ai de billets de 200 euros (et même 100, d'ailleurs), il multiplie les bonnes conquêtes et les mauvais coups, bref, un seigneur.
Son nouveau truc, c'est de créer une nouvelle banque, la Banque Universelle (rien que ça, mais ça situe l'ampleur du projet), destinée à financer des investissements au Proche-Orient. (Oui, en 1864, le Proche-Orient était déjà attractif). Notre ami Saccard, déjà rompu dans toutes les manigances financières, nage là-dedans comme un poisson dans l'eau. Il a pourtant fort à faire avec des concurrents aussi requins que lui, comme le banquier Gutterman, l'affairiste Busch, ou des aventurières du tapis vert comme la baronne Sandorff, Les femmes, ce n'est pas un problème, tôt ou tard elles finissent dans son lit, au grand dam de sa maîtresse du moment, Caroline. Tous les coups sont permis, y compris ceux qui touchent à la vie privée (quelle époque ! ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait des choses comme ça !) Saccard triomphe, mais plus dure sera la chute…
Saccard tient le premier rôle dans cette pièce plutôt noire que rose. Mais en fait le héros du roman, c'est l'argent : c'est lui qui est à l'origine de tout, et qui commande à la manoeuvre. Zola, a accumulé pour ce livre plus de documentation que pour ses autres romans (et ce n'est pas peu dire). Il s'est inspiré de tous les scandales financiers de son époque, et particulièrement du krach du Comptoir National d'Escompte de Paris, en 1889, et plus encore celui de l'Union Générale dix ans plus tôt (1881-1882). Tous les mécanismes boursiers sont décryptés, même et surtout les plus illégaux (comme aujourd'hui, le délai d'initié faisait alors florès). L'argent est donc au centre du roman : la Bourse devient comme le Voreux de « Germinal » une espèce de Moloch qui réclame des victimes. du reste tout n'est pas négatif, Zola montre aussi le bon côté des investissements, pour un bien-être de la population, et un accroissement général des fortunes (même s'il est réservé à des particuliers), il place même un discours socialisant dans la bouche de militants marxistes (utopie, quand tu nous tiens…)
Un roman très technique donc, mais dont les personnages, particulièrement bien dessinés, font un drame bourgeois où, comme souvent chez Zola, la vie privée se mêle à la vie publique, suivant une courbe montante puis descendante, culminant en apogée à la corbeille et finissant en catastrophe. Pas pour tout le monde d'ailleurs : les mauvaises herbes repoussent toujours (nous en avons des exemples tous les jours dans nos soi-disant procès politiques) …
Zola a déjà abordé ce thème dans plusieurs romans : dans « La Curée », le dénommé Saccard (déjà lui) nous démontrait comment on bâtit une fortune. Dans « Au bonheur des dames », Octave Mouret nous expliquait une des façons de la faire fructifier. Et la plupart des autres romans, inversement, nous égrenaient les mille et une façons de s'en passer.
« L'Argent » nous place au coeur du sujet : la Bourse est le temple de ce nouveau dieu, et Saccard est son grand-prêtre. Saccard, vous vous en souvenez, c'est Aristide Rougon, le frère d'Eugène, le ministre ; comme beaucoup de personnages de la série (surtout dans ce milieu), il n'est pas d'une moralité exemplaire, il a autant de scrupules que moi j'ai de billets de 200 euros (et même 100, d'ailleurs), il multiplie les bonnes conquêtes et les mauvais coups, bref, un seigneur.
Son nouveau truc, c'est de créer une nouvelle banque, la Banque Universelle (rien que ça, mais ça situe l'ampleur du projet), destinée à financer des investissements au Proche-Orient. (Oui, en 1864, le Proche-Orient était déjà attractif). Notre ami Saccard, déjà rompu dans toutes les manigances financières, nage là-dedans comme un poisson dans l'eau. Il a pourtant fort à faire avec des concurrents aussi requins que lui, comme le banquier Gutterman, l'affairiste Busch, ou des aventurières du tapis vert comme la baronne Sandorff, Les femmes, ce n'est pas un problème, tôt ou tard elles finissent dans son lit, au grand dam de sa maîtresse du moment, Caroline. Tous les coups sont permis, y compris ceux qui touchent à la vie privée (quelle époque ! ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait des choses comme ça !) Saccard triomphe, mais plus dure sera la chute…
Saccard tient le premier rôle dans cette pièce plutôt noire que rose. Mais en fait le héros du roman, c'est l'argent : c'est lui qui est à l'origine de tout, et qui commande à la manoeuvre. Zola, a accumulé pour ce livre plus de documentation que pour ses autres romans (et ce n'est pas peu dire). Il s'est inspiré de tous les scandales financiers de son époque, et particulièrement du krach du Comptoir National d'Escompte de Paris, en 1889, et plus encore celui de l'Union Générale dix ans plus tôt (1881-1882). Tous les mécanismes boursiers sont décryptés, même et surtout les plus illégaux (comme aujourd'hui, le délai d'initié faisait alors florès). L'argent est donc au centre du roman : la Bourse devient comme le Voreux de « Germinal » une espèce de Moloch qui réclame des victimes. du reste tout n'est pas négatif, Zola montre aussi le bon côté des investissements, pour un bien-être de la population, et un accroissement général des fortunes (même s'il est réservé à des particuliers), il place même un discours socialisant dans la bouche de militants marxistes (utopie, quand tu nous tiens…)
Un roman très technique donc, mais dont les personnages, particulièrement bien dessinés, font un drame bourgeois où, comme souvent chez Zola, la vie privée se mêle à la vie publique, suivant une courbe montante puis descendante, culminant en apogée à la corbeille et finissant en catastrophe. Pas pour tout le monde d'ailleurs : les mauvaises herbes repoussent toujours (nous en avons des exemples tous les jours dans nos soi-disant procès politiques) …
L'ouvrage représente vraiment un travail monumental pour décrire si minutieusement le monde de la finance sous l'Empire de Napoléon III. C'est fait de façon vivante et crédible, le talent de Zola est évident, on croirait y être… La montée mirobolante des cours de l'action de la “Banque Universelle”, son frémissement d'incertitude puis sa chute sont prévisibles mais très prenants.
Les personnages principaux sont décrits avec force et finesse à la fois. Beaucoup ont plusieurs facettes ce qui les rend d'autant plus intéressants. L'antisémitisme des financiers catholiques apparaît parfois, quelques allusions par ci par là, cela est décrit aussi avec beaucoup de réalisme et on comprend vite que Zola, tout en ne faisant que l'esquisser, ne le partage pas.
Cela dit, je me sens plus impressionné par l'oeuvre que conquis. Il y a un nombre excessif (à mon goût) de personnages secondaires et ce, dès le début, ce qui rend le livre de prime abord très touffu et rébarbatif. Même si cela se résout ensuite, le cynisme de la plupart des personnages ou leur côté antipathique font que je ne me sens aucune envie de lire un autre roman de Zola à la suite ou même dans peu de temps.
Tiens, un Bernard Clavel pour changer, ça ferait du bien pour s'aérer les méninges !
Les personnages principaux sont décrits avec force et finesse à la fois. Beaucoup ont plusieurs facettes ce qui les rend d'autant plus intéressants. L'antisémitisme des financiers catholiques apparaît parfois, quelques allusions par ci par là, cela est décrit aussi avec beaucoup de réalisme et on comprend vite que Zola, tout en ne faisant que l'esquisser, ne le partage pas.
Cela dit, je me sens plus impressionné par l'oeuvre que conquis. Il y a un nombre excessif (à mon goût) de personnages secondaires et ce, dès le début, ce qui rend le livre de prime abord très touffu et rébarbatif. Même si cela se résout ensuite, le cynisme de la plupart des personnages ou leur côté antipathique font que je ne me sens aucune envie de lire un autre roman de Zola à la suite ou même dans peu de temps.
Tiens, un Bernard Clavel pour changer, ça ferait du bien pour s'aérer les méninges !
Dans ce roman plus que jamais Zola bluffe par sa capacité à saisir différentes psychologies en peu de mots. Son thème du jour, l'Argent, lui donne de la matière car sur sept ou huit Rougon Macquart lus, c'est celui qui comporte le plus de personnages. Comme s'il avait voulu traverser une bonne fois pour toute le mille feuilles social et nous en montrer les couches par une multitude de portraits. Les Français et l'Argent.
Evidemment c'est le protagoniste Saccard notre Loup de wall street sur Seine qui reste emblématique, j'ai apprécié son ambivalence morale plus subtile que les jugements fréquents que porte Zola sur ses personnages. Son énergie, sa trajectoire son besoin de réussite donnent beaucoup à penser sur ce genre d'Homme.
Je n'ai presque que des bonnes choses à dire et pourtant ce tome m'a moins plu que d'autres. Zola exclut toute tension narrative en annonçant très en avance la fin de son roman et ce sujet de la bourse semble être si visité dans d'autres oeuvres contemporaines que j'ai été un poil ennuyé.
Evidemment c'est le protagoniste Saccard notre Loup de wall street sur Seine qui reste emblématique, j'ai apprécié son ambivalence morale plus subtile que les jugements fréquents que porte Zola sur ses personnages. Son énergie, sa trajectoire son besoin de réussite donnent beaucoup à penser sur ce genre d'Homme.
Je n'ai presque que des bonnes choses à dire et pourtant ce tome m'a moins plu que d'autres. Zola exclut toute tension narrative en annonçant très en avance la fin de son roman et ce sujet de la bourse semble être si visité dans d'autres oeuvres contemporaines que j'ai été un poil ennuyé.
Non, trop c'est trop. Illisible, mortel d'ennui, ça tombe des mains, on n'en ferait pas cadeau à son pire ennemi. du blabla financier, mondanités, magouilles de boursicoteurs, escroqueries et copinages, vagues commentaires politiques.. Money, money, money
Dans ce roman, nous retrouvons Aristide Saccard, le mauvais garçon de la lignée des Macquart, qui avait changé de nom, déjà pour raison de mauvaise réputation, dans « La Curée ».
Il lance la création de la « Banque Universelle », devant financer des projets au Moyen Orient. Il attire autant d'actionnaires qu'il peut, petits et gros, en faisant miroiter le fait qu'il va « donner Jérusalem » au Pape.
S'en suit un montée vertigineuse de la valeur de l'action. Certains, parmi les premiers acheteurs commencent à s'inquiéter de cette situation irréaliste, et à se dire qu'il vaudrait mieux vendre, afin d'assurer le bénéfice. Mais, s'ils lui demandent conseil, Saccard les persuade de ne pas vendre et, au contraire, de continuer à acheter s'il le peuvent, afin de le soutenir, ne pas le laisser tomber.
Car il faut résister à l'offensive des « baissiers », menés par le banquier juif Gundermann. On se demande comment ils font pour vendre encore « de l'Universelle », alors que l'action continue à monter.
Mais à plusieurs reprise, Zola nous explique qu'il y a des agents doubles, qui achète officiellement et font revendre par des hommes de paille, ou le contraire.
Madame Caroline est une femme qui n'a pas eu d'enfant et vit avec son frère. Ce frère est ingénieur et supervise l'un de ces grands travaux financés par la Banque Universelle.
Saccard fait la connaissance de Madame Caroline et l'aide à financer ses maisons pour les enfants, dont elle s'occupe, Il la convainc d'acheter des actions de la Banque Universelle, en lui faisant miroiter des gains colossaux, car cette montée ne fait que commencer.
Parallèlement, s'établit, entre Saccard et Madame Caroline, une liaison, amoureuse ou assimilée. Puis, Madame Caroline découvre qu'elle n'est pas la seule. Après une crise de jalousie, qui va passer, elle se remet toujours à flot, contente de la vie, et lui pardonne.
Au fur et à mesure que l'action monte, son frère, avec qui elle correspond, lui conseille de vendre, avec de plus en plus d'insistance. Saccard la dissuade en disant qu'elle ne va pas le laisser tomber alors qu'il est en pleine ascension, et menacé par les « baissiers », ce serait une trahison.
Mais elle vend tout de même, progressivement, en cachette de Saccard, et sur les conseils de son frère. Lorsque l'action atteint son sommet et commence à s'effondrer, elle a vendu ses dernières actions au prix le plus fort.
Ce sera la seule qui ne perdra pas tout, lorsque l'action va s'effondrer de plus de trois mille francs à quelques centaines.
Cette catastrophe entraîne avec elle des centaines d'épargnants qui perdent ainsi leurs économies ou leur héritage, et sont ruinés.
Saccard aussi, est ruiné, mais il en l'habitude, « toujours sans le sous et dépensant des fortunes », des autres, évidemment.
Suite à une action en justice d'un des épargnants ruinés, Saccard et le frère de Madame Caroline sont arrêtés pour escroquerie, le deuxième pour complicité ou en tant qu'associé.
Madame Caroline va voir son frère en prison, mais pas Saccard, qu'elle considère comme responsable de tout ce désastre.
Mais ils font appel, et Saccard profite de la libération provisoire pour aller en Hollande se lancer dans quelqu'autre affaire...
Lien : https://perso.cm63.fr/node/419
Il lance la création de la « Banque Universelle », devant financer des projets au Moyen Orient. Il attire autant d'actionnaires qu'il peut, petits et gros, en faisant miroiter le fait qu'il va « donner Jérusalem » au Pape.
S'en suit un montée vertigineuse de la valeur de l'action. Certains, parmi les premiers acheteurs commencent à s'inquiéter de cette situation irréaliste, et à se dire qu'il vaudrait mieux vendre, afin d'assurer le bénéfice. Mais, s'ils lui demandent conseil, Saccard les persuade de ne pas vendre et, au contraire, de continuer à acheter s'il le peuvent, afin de le soutenir, ne pas le laisser tomber.
Car il faut résister à l'offensive des « baissiers », menés par le banquier juif Gundermann. On se demande comment ils font pour vendre encore « de l'Universelle », alors que l'action continue à monter.
Mais à plusieurs reprise, Zola nous explique qu'il y a des agents doubles, qui achète officiellement et font revendre par des hommes de paille, ou le contraire.
Madame Caroline est une femme qui n'a pas eu d'enfant et vit avec son frère. Ce frère est ingénieur et supervise l'un de ces grands travaux financés par la Banque Universelle.
Saccard fait la connaissance de Madame Caroline et l'aide à financer ses maisons pour les enfants, dont elle s'occupe, Il la convainc d'acheter des actions de la Banque Universelle, en lui faisant miroiter des gains colossaux, car cette montée ne fait que commencer.
Parallèlement, s'établit, entre Saccard et Madame Caroline, une liaison, amoureuse ou assimilée. Puis, Madame Caroline découvre qu'elle n'est pas la seule. Après une crise de jalousie, qui va passer, elle se remet toujours à flot, contente de la vie, et lui pardonne.
Au fur et à mesure que l'action monte, son frère, avec qui elle correspond, lui conseille de vendre, avec de plus en plus d'insistance. Saccard la dissuade en disant qu'elle ne va pas le laisser tomber alors qu'il est en pleine ascension, et menacé par les « baissiers », ce serait une trahison.
Mais elle vend tout de même, progressivement, en cachette de Saccard, et sur les conseils de son frère. Lorsque l'action atteint son sommet et commence à s'effondrer, elle a vendu ses dernières actions au prix le plus fort.
Ce sera la seule qui ne perdra pas tout, lorsque l'action va s'effondrer de plus de trois mille francs à quelques centaines.
Cette catastrophe entraîne avec elle des centaines d'épargnants qui perdent ainsi leurs économies ou leur héritage, et sont ruinés.
Saccard aussi, est ruiné, mais il en l'habitude, « toujours sans le sous et dépensant des fortunes », des autres, évidemment.
Suite à une action en justice d'un des épargnants ruinés, Saccard et le frère de Madame Caroline sont arrêtés pour escroquerie, le deuxième pour complicité ou en tant qu'associé.
Madame Caroline va voir son frère en prison, mais pas Saccard, qu'elle considère comme responsable de tout ce désastre.
Mais ils font appel, et Saccard profite de la libération provisoire pour aller en Hollande se lancer dans quelqu'autre affaire...
Lien : https://perso.cm63.fr/node/419
On retrouve dans ce dix-huitième volume des Rougon-Macquart le personnage d'Aristide Saccard que nous avions déjà suivi dans « La Curée », au début de la saga.
Toujours obnubilé par l'argent, Saccard joue avec le feu et avec l'argent des autres dans des aventures financières qui ne peuvent que mal finir.
Émile Zola nous propose ainsi un portrait acide de la Bourse et de ses opérations douteuses, la spéculation cynique et folle, et la folie de tous ceux qui la pratiquent.
Si « La Curée » était le roman de la prospérité, de la croissance, des grands projets et de l'optimisme, celui-ci est son pendant, comme le revers de la médaille. Après les années de gloire et de prospérité du Second Empire, le pessimisme est de mise. La chute approche. La guerre contre la Prusse semble inévitable. Et avec elle, « La Débâcle » qui fera l'objet du prochain roman du cycle.
Toujours obnubilé par l'argent, Saccard joue avec le feu et avec l'argent des autres dans des aventures financières qui ne peuvent que mal finir.
Émile Zola nous propose ainsi un portrait acide de la Bourse et de ses opérations douteuses, la spéculation cynique et folle, et la folie de tous ceux qui la pratiquent.
Si « La Curée » était le roman de la prospérité, de la croissance, des grands projets et de l'optimisme, celui-ci est son pendant, comme le revers de la médaille. Après les années de gloire et de prospérité du Second Empire, le pessimisme est de mise. La chute approche. La guerre contre la Prusse semble inévitable. Et avec elle, « La Débâcle » qui fera l'objet du prochain roman du cycle.
Près de 10 ans après ma première lecture je me suis replongée dans cette page romanesque consacrée aux gloires et déboires des spéculateurs du 2nd Empire. Il faut avoir un peu de temps pour se plonger dans l'écriture de Zola qui est parfois un peu laborieuse et demande d'être, à mon sens, suivie sans trop de distractions extérieures. En vacances c'est mieux !
Une fois immergée dans le flux descriptif et narratif, quel plaisir de se sentir découvrir tout un monde qui se construit au fil des pages, au gré des péripéties et des états d'âme des personnages et des impressions fortes produites par les descriptions. Celle du Palais Brongniart, palais de la Bourse, m'a particulièrement marquée.
Le roman se structure par cercle concentrique autour de ce bâtiment, à la fois symbole et catalyseur du capitalisme financier et de ses ambivalences. Saccard, ruiné, tourne, fasciné autour du bâtiment, permettant au lecteur de découvrir (un peu fastidieusement) tout le petit peuple et les grands personnages qui font la spéculation de la place parisienne, et feront l'intrigue du roman.
Finalement, son héros parvenu de nouveau à régner en maître dans ce temple de l'argent, Zola nous entraîne dans un chapitre incroyable au coeur de la séance qui verra exploser la bulle spéculative autour de l'Universelle. L'art du romancier s'exprimer alors à son paroxysme, dans la géniale restitution de l'ambiance électrique, des bruits, des mouvements de foule, de ces deux heures de folie qui marquent le basculement du destin de bien des personnages.
Un chapitre vraiment marquant et étrange pour qui connaît aujourd'hui les colonnes du Palais Brongniart, vidé de son activité boursière, réduit à être un centre de conférences et divers bureaux.
Le personnage le plus intéressant du roman est probablement Mme Caroline, située à la convergence de toutes les intrigues et au sein de l'ambivalence du capitalisme boursier et de la finance. Cette femme de tête mais non dépourvue de coeur, rationnelle mais emportée par sa grande humanité, est l'interprète des réflexions de l'auteur sur son sujet, et il lui donnera le dernier mot, qui n'est pas sans espoir.
Un autre aspect culturel du roman m'a marquée, celui de l'utilisation par Saccard du concept de la "chrétienté" et d'une forme de guerre des civilisation pour gagner à sa cause spéculative les catholiques et les esprits sensibles au prestige romain. Cette forme de guerre implicite mais sous jacente entre un modèle "chrétien" et "juif", alimentée plus par les préjugés antisémites des personnages que par une réelle conviction chrétienne, évoque les débats actuels mis en scène par l'extrême droite sur le choc entre chrétienté et islam.
Que ce soit en matière de manipulation idéologique ou de déconnexion entre la finance et l'économie réelle, la lecture de Zola nous montre donc qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil !
Une fois immergée dans le flux descriptif et narratif, quel plaisir de se sentir découvrir tout un monde qui se construit au fil des pages, au gré des péripéties et des états d'âme des personnages et des impressions fortes produites par les descriptions. Celle du Palais Brongniart, palais de la Bourse, m'a particulièrement marquée.
Le roman se structure par cercle concentrique autour de ce bâtiment, à la fois symbole et catalyseur du capitalisme financier et de ses ambivalences. Saccard, ruiné, tourne, fasciné autour du bâtiment, permettant au lecteur de découvrir (un peu fastidieusement) tout le petit peuple et les grands personnages qui font la spéculation de la place parisienne, et feront l'intrigue du roman.
Finalement, son héros parvenu de nouveau à régner en maître dans ce temple de l'argent, Zola nous entraîne dans un chapitre incroyable au coeur de la séance qui verra exploser la bulle spéculative autour de l'Universelle. L'art du romancier s'exprimer alors à son paroxysme, dans la géniale restitution de l'ambiance électrique, des bruits, des mouvements de foule, de ces deux heures de folie qui marquent le basculement du destin de bien des personnages.
Un chapitre vraiment marquant et étrange pour qui connaît aujourd'hui les colonnes du Palais Brongniart, vidé de son activité boursière, réduit à être un centre de conférences et divers bureaux.
Le personnage le plus intéressant du roman est probablement Mme Caroline, située à la convergence de toutes les intrigues et au sein de l'ambivalence du capitalisme boursier et de la finance. Cette femme de tête mais non dépourvue de coeur, rationnelle mais emportée par sa grande humanité, est l'interprète des réflexions de l'auteur sur son sujet, et il lui donnera le dernier mot, qui n'est pas sans espoir.
Un autre aspect culturel du roman m'a marquée, celui de l'utilisation par Saccard du concept de la "chrétienté" et d'une forme de guerre des civilisation pour gagner à sa cause spéculative les catholiques et les esprits sensibles au prestige romain. Cette forme de guerre implicite mais sous jacente entre un modèle "chrétien" et "juif", alimentée plus par les préjugés antisémites des personnages que par une réelle conviction chrétienne, évoque les débats actuels mis en scène par l'extrême droite sur le choc entre chrétienté et islam.
Que ce soit en matière de manipulation idéologique ou de déconnexion entre la finance et l'économie réelle, la lecture de Zola nous montre donc qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (295)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
594 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu