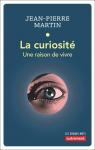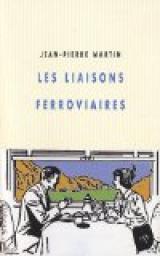Critiques de Jean-Pierre Martin (53)
Nous avons un point de vue intéressant sur la curiosité et l'histoire de ce point de caractère. A quel point sommes-nous curieux ? Est-ce bien ou mal ? Petit à petit, sans nous en rendre compte, on perds tout intérêt pour ce qui nous entoure, tout devient routinier et monotone. J'aimerais pouvoir revenir aux premiers instants, aux moments où j'ai vu quelque chose pour la première fois. Mais j'essaye de prendre conscience des choses afin de m'en souvenir, et je m'émerveille chaque jour de ce qui m'entoure !
Quand il attendait aux premiers rangs, dans une évidence trop manifeste, Louis-Ferdinand Céline, Paul Léautaud ou Thomas Bernhard, certes pris en compte ici, le lecteur apprend davantage (dans le désordre alphabétique) de Louis Aragon, Aristote, Antonin Artaud, Georges Bataille, Charles Baudelaire, Cicéron, Pierre Drieu La Rochelle, Gustave Flaubert, Jean Genet, Victor Hugo, Henri Michaux, Richard Millet, Friedrich Nietzsche, Paul Nizan, Ambroise Paré, Charles Péguy, Arthur Rimbaud, Jean-Paul Sartre, Germaine Tillion, Jules Vallès, Théophile de Viau, Michel Vinaver, et de beaucoup d’autres, plus ou moins évoqués ou cités dans cette passionnante promenade traversant de multiples époques et espaces linguistiques ou géographiques.
Ce recueil d’études consacré à ce dont Jean Genet, qui savait de quoi il parlait, fait l’éloge, «l’extraordinaire pouvoir de la colère», s’ouvre sur un brillant avant-propos de Jean-Pierre Martin dont on apprécie la vivacité quasi primesautière du style, postulant que la colère des écrivains qui n’ont pas «mis le couvercle sur la bouilloire» (portraits de Michaux et Nizan en «colériques congénitaux») leur vient de l’enfance et qu’il s’agit peut-être là de l’enfance de la littérature, même si l’on se réjouit plus loin de la souriante remarque de Jean-François Louette: «Les jeunes gens en colère ? Allons donc : voyez plutôt du côté des vieillards.»
Jamais les contributions de ce livre qui se lit avec un plaisir passionné – pour qui se passionne pour la littérature, s’entend, et même si peu féru de philosophie – ne s’enlisent dans quelque jargonneux délire d’analyse ou de didactisme «universitaire» quand elles se trouvent toutes signées d’enseignants des plus solides facultés. Au contraire, elles fournissent une foultitude d’informations et d’observations clairement énoncées et souvent mal connues, qui ne laissent d’intéresser, voire d’étonner.
Érudition n’est pas ennui. Cependant, presque toujours employée péjorativement, l’épithète universitaire «suscite aujourd’hui une réaction d’inappétence» reconnaît, un rien autocritique, Claude Burgelin, lequel enseigna la littérature française à Lyon 2, dans le texte qui ferme judicieusement ce volume; ici défendus et illustrés, même si égratignés, ses pairs savent aussi – dont acte – écrire mieux, beaucoup mieux et captivant (reprenons ses mots) qu’une prose de second rang, pesante, empesée, raide, une langue de bois marquée par la lourdeur et le verbiage, sans inattendu, ni… colère.
À l’opposé de la mélancolie romantique, la colère littéraire («furor poeticus» des anciens, «pensée poétique de la colère» de Artaud, de Michaux) concentre – citons à nouveau Genet, ce «grand furieux» (Martine Boyer-Weinmann) –, un «extraordinaire pouvoir de création verbale» puisque «l’écriture doit être capable de faire hurler le papier» (Jacques Neefs). Colère qu’il faut certes savoir, avec Aristote, distinguer de l’indignation. Colère qui, dépassée et féconde, se convertit en roman, en poème… (Martine Boyer-Weidmann) pour produire quelque chose de plus grand qu’elle-même. Ainsi de Baudelaire, cité entre cent, affirmant que «la colère m’a fait faire un bon livre sur la Belgique» – on notera que l’auteur de Amœnitates belgicae ne dit pas «contre les Belges»…
Un ouvrage riche, neuf, substantiel et nécessaire, auquel revenir.
On voudra souligner, pour finir, compliment que ne méritent pas tous les éditeurs, «petits» ou «micros», «gros» ou «grands», que le soin, particulièrement typographique et, oui, orthographique, que Cécile Defaut apporte à la fabrication de ses livres est non pas courant sinon «normal», mais rare, très rare, et digne d’éloges appuyés.
Sous la direction de Martine Boyer-Weinmann et Jean-Pierre Martin. Textes de Daniel Bougnoux, Martine Boyer-Weinmann, Catherine Brun, Claude Burgelin, Belinda Cannone, Dominique Carlat, Bruno Chaouat, Jean-Michel Delacomptée, Jean-François Louette, Jean-Pierre Martin, William Marx, Hélène Merlin-Kajman, Jacques Neefs.
Critique parue dans, "Encres de Loire" n° 49 page 20, automne 2009
Lien : http://www.paysdelaloire.fr/..
Ce recueil d’études consacré à ce dont Jean Genet, qui savait de quoi il parlait, fait l’éloge, «l’extraordinaire pouvoir de la colère», s’ouvre sur un brillant avant-propos de Jean-Pierre Martin dont on apprécie la vivacité quasi primesautière du style, postulant que la colère des écrivains qui n’ont pas «mis le couvercle sur la bouilloire» (portraits de Michaux et Nizan en «colériques congénitaux») leur vient de l’enfance et qu’il s’agit peut-être là de l’enfance de la littérature, même si l’on se réjouit plus loin de la souriante remarque de Jean-François Louette: «Les jeunes gens en colère ? Allons donc : voyez plutôt du côté des vieillards.»
Jamais les contributions de ce livre qui se lit avec un plaisir passionné – pour qui se passionne pour la littérature, s’entend, et même si peu féru de philosophie – ne s’enlisent dans quelque jargonneux délire d’analyse ou de didactisme «universitaire» quand elles se trouvent toutes signées d’enseignants des plus solides facultés. Au contraire, elles fournissent une foultitude d’informations et d’observations clairement énoncées et souvent mal connues, qui ne laissent d’intéresser, voire d’étonner.
Érudition n’est pas ennui. Cependant, presque toujours employée péjorativement, l’épithète universitaire «suscite aujourd’hui une réaction d’inappétence» reconnaît, un rien autocritique, Claude Burgelin, lequel enseigna la littérature française à Lyon 2, dans le texte qui ferme judicieusement ce volume; ici défendus et illustrés, même si égratignés, ses pairs savent aussi – dont acte – écrire mieux, beaucoup mieux et captivant (reprenons ses mots) qu’une prose de second rang, pesante, empesée, raide, une langue de bois marquée par la lourdeur et le verbiage, sans inattendu, ni… colère.
À l’opposé de la mélancolie romantique, la colère littéraire («furor poeticus» des anciens, «pensée poétique de la colère» de Artaud, de Michaux) concentre – citons à nouveau Genet, ce «grand furieux» (Martine Boyer-Weinmann) –, un «extraordinaire pouvoir de création verbale» puisque «l’écriture doit être capable de faire hurler le papier» (Jacques Neefs). Colère qu’il faut certes savoir, avec Aristote, distinguer de l’indignation. Colère qui, dépassée et féconde, se convertit en roman, en poème… (Martine Boyer-Weidmann) pour produire quelque chose de plus grand qu’elle-même. Ainsi de Baudelaire, cité entre cent, affirmant que «la colère m’a fait faire un bon livre sur la Belgique» – on notera que l’auteur de Amœnitates belgicae ne dit pas «contre les Belges»…
Un ouvrage riche, neuf, substantiel et nécessaire, auquel revenir.
On voudra souligner, pour finir, compliment que ne méritent pas tous les éditeurs, «petits» ou «micros», «gros» ou «grands», que le soin, particulièrement typographique et, oui, orthographique, que Cécile Defaut apporte à la fabrication de ses livres est non pas courant sinon «normal», mais rare, très rare, et digne d’éloges appuyés.
Sous la direction de Martine Boyer-Weinmann et Jean-Pierre Martin. Textes de Daniel Bougnoux, Martine Boyer-Weinmann, Catherine Brun, Claude Burgelin, Belinda Cannone, Dominique Carlat, Bruno Chaouat, Jean-Michel Delacomptée, Jean-François Louette, Jean-Pierre Martin, William Marx, Hélène Merlin-Kajman, Jacques Neefs.
Critique parue dans, "Encres de Loire" n° 49 page 20, automne 2009
Lien : http://www.paysdelaloire.fr/..
Constance, la fille de Sandor a sombré dans une psychose profonde. C'est tout un monde qui s'écroule, toute une cellule familiale qui explose. Son médecin l'arrête et Sandor se met à errer dans les rues de Lyon, croisant des fous à chaque pâté de maisons, chaque quai de métro, chaque zinc de bar… Il les attire ou est-ce lui qui est attiré par ces fous?
Sandor va se plonger dans la littérature sur la folie, il cherche à comprendre, peut changer le cours des choses, sauver ce qui est à sauver et aimer ce qui tient encore la route: ces trois fils qui se construisent tant bien que mal dans leur vie d'adultes, sa femme qu'il ne désespère pas de reconquérir.
Mais Constance l'obsède. "Oublie Constance!" lui dit un jour son médecin. Comment oublie-t-on son enfant?
Ce roman est absolument splendide. Qui n'a pas un jour souffert devant le désespoir de son enfant aura peut-être du mal à en saisir toute la force. Il raconte le parcours d'un père, d'un parent, meurtri par la non-mort de son enfant, celui qui sombre dans la maladie mentale, pour qui les chances de guérison sont quasi nulles.
Les qualités littéraires de Jean-Pierre Martin sont indiscutables et son personnage est d'une crédibilité bouleversante. Sa douleur est palpable, mais l'espoir qu'il insuffle par les décisions qu'il prend, le regard qu'il porte sur tous ces fous, son amour de père, sa résilience et son humanité, font de ce roman un beau roman, au sens le plus noble du terme, de ces romans que l'on referme trop vite.
Pourquoi n'en parle-t-on pas plus?
Lien : https://carpentersracontent...
Sandor va se plonger dans la littérature sur la folie, il cherche à comprendre, peut changer le cours des choses, sauver ce qui est à sauver et aimer ce qui tient encore la route: ces trois fils qui se construisent tant bien que mal dans leur vie d'adultes, sa femme qu'il ne désespère pas de reconquérir.
Mais Constance l'obsède. "Oublie Constance!" lui dit un jour son médecin. Comment oublie-t-on son enfant?
Ce roman est absolument splendide. Qui n'a pas un jour souffert devant le désespoir de son enfant aura peut-être du mal à en saisir toute la force. Il raconte le parcours d'un père, d'un parent, meurtri par la non-mort de son enfant, celui qui sombre dans la maladie mentale, pour qui les chances de guérison sont quasi nulles.
Les qualités littéraires de Jean-Pierre Martin sont indiscutables et son personnage est d'une crédibilité bouleversante. Sa douleur est palpable, mais l'espoir qu'il insuffle par les décisions qu'il prend, le regard qu'il porte sur tous ces fous, son amour de père, sa résilience et son humanité, font de ce roman un beau roman, au sens le plus noble du terme, de ces romans que l'on referme trop vite.
Pourquoi n'en parle-t-on pas plus?
Lien : https://carpentersracontent...
J'aime bien les romans originaux et celui là l'est assurément par le parti pris. En effet, écrire sur la folie, la schizophrénie, la dépression etc est un acte littéraire difficile qu'il faut savoir manier sans tomber dans le style... clinique !
Ici, sans être aussi emballée que @dis_moi_10_phrases, j'ai trouvé que c'était réussi !
Notre personnage, Sandor Novick, est en arrêt maladie, pris de mélancolie pré-dépression suite à la mort de son père. Sandor est un empathique profond, d'ailleurs il l'est tellement qu'il attire tous les fous errants des villes, on se confie à lui, on partage ses névroses, sa folie car Sandor sait écouter et plus que tout il comprend. Il a pris au 1er degré la maxime d'Ossip Maudelstram, poète russe, qui a écrit "Le fou, c'est d'abord celui qui est sans interlocuteur."
Mais Sandor est aussi le père de Constance, atteint de schizophrènie paranoïde, qui lui bouffe l'espace, les nuits, les repas de famille, la tête, la vie. Alors, il cherche, Sandor dans la folie des autres de quoi s'arrimer à celle de sa fille, dans les conférences sur le sujet. Et puis la folie est partout, dans les livres, la musique, au cinéma alors difficile d'avoir le moral, de tenir bon, d'espérer pour ses autres enfants que ça ira, que Ysé, son ex lui reviendra.
Et pour, non pas "lacher prise", mais "prendre ses distances", il s'échappe à la campagne mais là bas aussi d'autres fous l'attendent. Et enfin après une installation laborieuse dans une ferme restée dans son jus, je l'ai senti sereint mais comme Robert Walser, qu'il cite "Je ne suis pas ici pour écrire, je suis ici pour être fou !"
Ici, sans être aussi emballée que @dis_moi_10_phrases, j'ai trouvé que c'était réussi !
Notre personnage, Sandor Novick, est en arrêt maladie, pris de mélancolie pré-dépression suite à la mort de son père. Sandor est un empathique profond, d'ailleurs il l'est tellement qu'il attire tous les fous errants des villes, on se confie à lui, on partage ses névroses, sa folie car Sandor sait écouter et plus que tout il comprend. Il a pris au 1er degré la maxime d'Ossip Maudelstram, poète russe, qui a écrit "Le fou, c'est d'abord celui qui est sans interlocuteur."
Mais Sandor est aussi le père de Constance, atteint de schizophrènie paranoïde, qui lui bouffe l'espace, les nuits, les repas de famille, la tête, la vie. Alors, il cherche, Sandor dans la folie des autres de quoi s'arrimer à celle de sa fille, dans les conférences sur le sujet. Et puis la folie est partout, dans les livres, la musique, au cinéma alors difficile d'avoir le moral, de tenir bon, d'espérer pour ses autres enfants que ça ira, que Ysé, son ex lui reviendra.
Et pour, non pas "lacher prise", mais "prendre ses distances", il s'échappe à la campagne mais là bas aussi d'autres fous l'attendent. Et enfin après une installation laborieuse dans une ferme restée dans son jus, je l'ai senti sereint mais comme Robert Walser, qu'il cite "Je ne suis pas ici pour écrire, je suis ici pour être fou !"
Sensible au témoignage de la souffrance d'un père dont la fille est atteinte d'une schizophrénie grave. D'un point de vue littéraire,j'aime la poésie de ces descriptions des fous,les corps errants dans la ville,les bouleversants,les exilés de l'intérieur,les allumés de toute sorte, celui qui est sans interlocuteur.Par ailleurs le narrateur a une part d'humanité,de souffrance et d'humour qui est très touchante.A noter les pages 119 et 120 renvoient à de nombreux ouvrages littéraires sur la folie,des références .
J'ai lu ce livre dans le cadre du "prix Goncourt Belgique". Avec plusieurs élèves de mon université, nous lisons les sélections du Goncourt et élisons notre favori que nous allons devoir aller défendre devant d'autres élèves d'autres universités.
J'ai trouvé ce livre intriguant. L'écriture est peu familière, assez atypique pour un roman. Elle est principalement composée de phrases courtes (Sujet+Verbe+Complément) mais contient également de temps en temps des phrases très longues qui semblent assez inappropriées par rapport au reste. Quand on voit le titre, ça n'a rien d'étonnant mais ce n'est pas dans mes habitudes de lectures cela m'a donc assez surprise... Le roman nous parle de fous et est écrit de manière folle d'une certaine manière. On a l'impression d'être dans la tête d'une personne et d'assister directement à ses pensées sans filtre et de sauter d'une pensée à une autre sans réelle cohérence, c'est assez perturbant. Malheureusement, ce roman était également très court et je n'ai donc pas particulièrement aimé. C'est vrai que j'ai l'habitude des briques dans lesquelles on a tout le temps de s'attacher aux personnages et ici, ce fût loin d'être le cas. Je n'ai pas aimé les personnages secondaires mais je n'ai pas non plus aimé Sandor, le personnage principal qui n'était pas assez attachant, ni assez cohérent pour moi. Le livre et l'histoire en elle-même m'ont quant à eux beaucoup fait réfléchir. Mais je n'ai pas aimé la forme. Même si le fond m'a semblé des plus intéressant, la forme m'a empêcher de plonger complètement dans ce roman. Je suis donc sortie de ce roman avec une impression de manque, d'être passée à côté de quelque chose.
Lien : https://librospersomnia.blog..
J'ai trouvé ce livre intriguant. L'écriture est peu familière, assez atypique pour un roman. Elle est principalement composée de phrases courtes (Sujet+Verbe+Complément) mais contient également de temps en temps des phrases très longues qui semblent assez inappropriées par rapport au reste. Quand on voit le titre, ça n'a rien d'étonnant mais ce n'est pas dans mes habitudes de lectures cela m'a donc assez surprise... Le roman nous parle de fous et est écrit de manière folle d'une certaine manière. On a l'impression d'être dans la tête d'une personne et d'assister directement à ses pensées sans filtre et de sauter d'une pensée à une autre sans réelle cohérence, c'est assez perturbant. Malheureusement, ce roman était également très court et je n'ai donc pas particulièrement aimé. C'est vrai que j'ai l'habitude des briques dans lesquelles on a tout le temps de s'attacher aux personnages et ici, ce fût loin d'être le cas. Je n'ai pas aimé les personnages secondaires mais je n'ai pas non plus aimé Sandor, le personnage principal qui n'était pas assez attachant, ni assez cohérent pour moi. Le livre et l'histoire en elle-même m'ont quant à eux beaucoup fait réfléchir. Mais je n'ai pas aimé la forme. Même si le fond m'a semblé des plus intéressant, la forme m'a empêcher de plonger complètement dans ce roman. Je suis donc sortie de ce roman avec une impression de manque, d'être passée à côté de quelque chose.
Lien : https://librospersomnia.blog..
Histoire et civilisation des États-Unis : Textes et documents commentés du XVIIe siècle à nos jours
Jean-Pierre Martin
Jean-Pierre Martin
74 textes importants qui jalonnent l'histoire politique, économique, militaire et sociale des Etats-Unis.
Lu à parution mais demeure le souvenir d'une lecture jubilatoire car relevant d'une fine observation du "peuple migrateur" et ce, lors de chacun de mes voyages ferroviaires très, très réguliers.
Par ailleurs, il est à souligner que l'auteur n'est pas à l'origine auteur de "littérature" mais que ses spécialités rendent ses observations de la gent humaine voyageuse très humoristiques et brillantes d'intelligence.
Par ailleurs, il est à souligner que l'auteur n'est pas à l'origine auteur de "littérature" mais que ses spécialités rendent ses observations de la gent humaine voyageuse très humoristiques et brillantes d'intelligence.
Le titre sonne comme une injonction. A l’adresse de soi-même ? A l’adresse du lecteur ? A l’adresse d’une génération guettée par l’oubli historique ? Sans doute aux trois, pourrait-on avancer. Tant celui qui écrit et relate deux mois de détention, en 1970, invite tout un chacun à une réflexion qui de loin excède la circonstance initiale
Le 20 mai 1970 un jeune homme de 22 ans est cueilli par la police dans l’hôtel où il se cache. Cela se passe à Saint-Nazaire. Etudiant en philosophie, qui avec 1968 avait pensé venue l’heure de la révolution, il a quitté la fac pour rejoindre le lieu où se joue l’avenir de la société : le monde de l’industrie avec la classe ouvrière comme fer de lance des luttes transformatrices. Jean-Pierre Martin, c’est de lui qu’il s’agit, était un militant de la « Gauche prolétarienne », un mouvement maoïste qui se présentait comme une organisation de « nouveaux partisans » face à la société bourgeoise comme à un parti communiste accusé d’avoir collaboré avec celle-ci et « trahi » sa mission émancipatrice. Ainsi que pas mal d’autres de sa génération il avait donc lâché ses études, au grand dam de ses parents, pour « se jeter dans le monde. » Le plus célèbre de ces jeunes dissidents fut Pierre Overney, tué par un vigile de Renault en février 1972. Le pedigree d’activiste de Jean-Pierre Martin lui avait fermé les portes des Chantiers de l’Atlantique (« tu étais signalé et fiché »). Celui-ci avait ensuite travaillé chez Sud Aviation avant que les Renseignements Généraux n’alertent l’entreprise (« tu es viré au bout de quelques mois »). Mais cela n’avait pas arrêté son activité militante. Il faut dire que l’époque était aux distributions quotidiennes de tracts aux portes des usines, aux collages d’affiches, à la peinture de slogans sur les murs. C’est ainsi qu’il avait distribué un tract justifiant l’attaque au cocktail Molotov de la direction des Chantiers de l’Atlantique. En ce début des années 1970 les accidents du travail s’y étaient en effet multipliés. Pour les autorités le seul délit constitué, c’était ce tract faisant l’apologie d’un « crime d’incendie volontaire. »
Si le contexte politique apparaît ici essentiel, il ne constitue cependant pas ce qu’on pourrait désigner comme le centre névralgique du récit. Dès son arrestation le jeune militant non seulement avait été incarcéré, mais mis à l’isolement au mitard. Dans la France de Georges Pompidou et de son ministre de l’intérieur Raymond Marcellin on ne relâchait pas la pression sur ce qu’on appellerait aujourd’hui une ultragauche, qui de son côté ne reculait pas devant la violence. Dès son entrée dans les 5m2 d’une cellule infecte, sorte de cul de basse fosse de la seconde moitié du 20ème siècle d’où suintait une « humidité archaïque », Jean-Pierre Martin s’était trouvé confronté à une nouvelle urgence : survivre dans un environnement hostile, face au mutisme réglementaire des gardiens, à la solitude de la courte promenade quotidienne, à l’absence de tout contact, à l’interdiction de toute information, et, last but not least, à la désespérante vision d’un minuscule rectangle de ciel. Celui qui se qualifie de « prolo d’adoption », ne se retrouve plus alors que face à lui-même. La problématique change. Si le politique n’est évidemment pas évacué, il cède la première place à des questions à la fois plus concrètes et plus existentielles. L’hygiène, les repas, les vêtements, la compagnie de l’araignée baptisée Hélène -le détenu a des lettres-, qui tisse sa toile au-dessus de lui (« Ma compagne d’isolement, Ma danseuse immobile, Ma funambule prostrée »), la consolation du chant des mésanges comme chez Rosa Luxembourg emprisonnée à Wronke, la journée rythmée par le passage de gardiens croqués d’un mot à la Daumier (« Bouille écarlate, Poisson froid… »), la « visiteuse » en dame de charité, mais aussi la rupture avec les parents, la timide approche des femmes… Entre journal intime et introspection, le récit des 61 jours de taulard à « Saint Naz » se présente tel un retour sur soi, une sortie des limites, pour ne pas dire des étroitesses, de la communauté militante.
Quand à la même époque une Annie Ernaux par ses études s’arrachait à son milieu et accédait à un statut nouveau, en une manière de « trahison » de sa classe sociale, Jean-Pierre Martin, s’il faisait le chemin exactement inverse, se retrouvait dans une situation identique de « trahison » : ses parents avaient visé pour lui « l’ascension sociale, l’arrachement à leurs origines modestes » et il avait « chuté vers le monde d’en bas », l’usine. A mesure que défilaient les longues journées au mitard, quelque chose se mettait donc en route chez lui, qui tenait de la reconquête de soi sans pour autant abjurer son engagement. Il pouvait également observer comment lentement son image auprès des gardiens changeait. Comme si de chaque côté se produisait un gain d’humanité. Celui qui nous donne à lire ce bouleversant et très lucide récit à la première personne s’adresse à celui qu’il fut, dans un tutoiement qui dit l’évidente proximité en même temps que s’y mêle la perceptible ironie d’un recul critique. Il relevait dans son activisme « un certain goût du tragique » : le récit de Jean-Pierre Martin s’élargit aujourd’hui à une bien plus vaste dimension. Humaine, tout simplement.
Lien : https://jclebrun.eu/blog/
Le 20 mai 1970 un jeune homme de 22 ans est cueilli par la police dans l’hôtel où il se cache. Cela se passe à Saint-Nazaire. Etudiant en philosophie, qui avec 1968 avait pensé venue l’heure de la révolution, il a quitté la fac pour rejoindre le lieu où se joue l’avenir de la société : le monde de l’industrie avec la classe ouvrière comme fer de lance des luttes transformatrices. Jean-Pierre Martin, c’est de lui qu’il s’agit, était un militant de la « Gauche prolétarienne », un mouvement maoïste qui se présentait comme une organisation de « nouveaux partisans » face à la société bourgeoise comme à un parti communiste accusé d’avoir collaboré avec celle-ci et « trahi » sa mission émancipatrice. Ainsi que pas mal d’autres de sa génération il avait donc lâché ses études, au grand dam de ses parents, pour « se jeter dans le monde. » Le plus célèbre de ces jeunes dissidents fut Pierre Overney, tué par un vigile de Renault en février 1972. Le pedigree d’activiste de Jean-Pierre Martin lui avait fermé les portes des Chantiers de l’Atlantique (« tu étais signalé et fiché »). Celui-ci avait ensuite travaillé chez Sud Aviation avant que les Renseignements Généraux n’alertent l’entreprise (« tu es viré au bout de quelques mois »). Mais cela n’avait pas arrêté son activité militante. Il faut dire que l’époque était aux distributions quotidiennes de tracts aux portes des usines, aux collages d’affiches, à la peinture de slogans sur les murs. C’est ainsi qu’il avait distribué un tract justifiant l’attaque au cocktail Molotov de la direction des Chantiers de l’Atlantique. En ce début des années 1970 les accidents du travail s’y étaient en effet multipliés. Pour les autorités le seul délit constitué, c’était ce tract faisant l’apologie d’un « crime d’incendie volontaire. »
Si le contexte politique apparaît ici essentiel, il ne constitue cependant pas ce qu’on pourrait désigner comme le centre névralgique du récit. Dès son arrestation le jeune militant non seulement avait été incarcéré, mais mis à l’isolement au mitard. Dans la France de Georges Pompidou et de son ministre de l’intérieur Raymond Marcellin on ne relâchait pas la pression sur ce qu’on appellerait aujourd’hui une ultragauche, qui de son côté ne reculait pas devant la violence. Dès son entrée dans les 5m2 d’une cellule infecte, sorte de cul de basse fosse de la seconde moitié du 20ème siècle d’où suintait une « humidité archaïque », Jean-Pierre Martin s’était trouvé confronté à une nouvelle urgence : survivre dans un environnement hostile, face au mutisme réglementaire des gardiens, à la solitude de la courte promenade quotidienne, à l’absence de tout contact, à l’interdiction de toute information, et, last but not least, à la désespérante vision d’un minuscule rectangle de ciel. Celui qui se qualifie de « prolo d’adoption », ne se retrouve plus alors que face à lui-même. La problématique change. Si le politique n’est évidemment pas évacué, il cède la première place à des questions à la fois plus concrètes et plus existentielles. L’hygiène, les repas, les vêtements, la compagnie de l’araignée baptisée Hélène -le détenu a des lettres-, qui tisse sa toile au-dessus de lui (« Ma compagne d’isolement, Ma danseuse immobile, Ma funambule prostrée »), la consolation du chant des mésanges comme chez Rosa Luxembourg emprisonnée à Wronke, la journée rythmée par le passage de gardiens croqués d’un mot à la Daumier (« Bouille écarlate, Poisson froid… »), la « visiteuse » en dame de charité, mais aussi la rupture avec les parents, la timide approche des femmes… Entre journal intime et introspection, le récit des 61 jours de taulard à « Saint Naz » se présente tel un retour sur soi, une sortie des limites, pour ne pas dire des étroitesses, de la communauté militante.
Quand à la même époque une Annie Ernaux par ses études s’arrachait à son milieu et accédait à un statut nouveau, en une manière de « trahison » de sa classe sociale, Jean-Pierre Martin, s’il faisait le chemin exactement inverse, se retrouvait dans une situation identique de « trahison » : ses parents avaient visé pour lui « l’ascension sociale, l’arrachement à leurs origines modestes » et il avait « chuté vers le monde d’en bas », l’usine. A mesure que défilaient les longues journées au mitard, quelque chose se mettait donc en route chez lui, qui tenait de la reconquête de soi sans pour autant abjurer son engagement. Il pouvait également observer comment lentement son image auprès des gardiens changeait. Comme si de chaque côté se produisait un gain d’humanité. Celui qui nous donne à lire ce bouleversant et très lucide récit à la première personne s’adresse à celui qu’il fut, dans un tutoiement qui dit l’évidente proximité en même temps que s’y mêle la perceptible ironie d’un recul critique. Il relevait dans son activisme « un certain goût du tragique » : le récit de Jean-Pierre Martin s’élargit aujourd’hui à une bien plus vaste dimension. Humaine, tout simplement.
Lien : https://jclebrun.eu/blog/
Jean-Pierre Martin, « Mes fous » 154 pages
Père de quatre enfants, dont un enfant reconnu autiste asperger et une fille schizophrène, Sandor se sépare de son épouse. Fatigué, il prend un arrêt de travail afin de se reposer. Pour s’éloigner aussi de ceux qu’il ne supporte plus : « les masques, les simagrées (…) Les petits hommes qui se prennent pour quelqu'un. Les surimportants qui pontifient ».
Et tandis qu’il se promène en ville, il constate que son empathie semble attirer les gens différents. Aussi s’interroge-t-il : "Est-ce que j'attire les fous, ou bien est-ce moi qui cherche leur compagnie ?" / Je marche infatigablement, interminablement, sans but, dans les rues, sur les quais, dans les parcs. Quelques humains, des ultrasensibles, perçoivent de l'intérieur mes ondes. Il arrive qu'une rencontre de hasard m'entraîne dans son maelström. Sylvain a bien raison de me dire que je souffre d'un excès d'empathie. C'est vrai que j'ai tendance à voir la folie partout, à débusquer sa menace, chez moi ou chez les autres, à travers des signes légers : une parole exagérément volubile, l'hystérie d'un geste, le mutisme glaçant d'un poisson froid, la logorrhée d'un monologuiste. Les fous et les demi-fous me magnétisent. A moins que ce soit le contraire. Je ne peux pas détourner mon regard. Je suis prêt à les suivre tel un privé qui aurait renoncé à la filature et adopté la méthode directe.
Il se jette sur toutes les lectures qui concernent les différentes formes de folie, évoque ces « corps errants » qui se confient à lui : « Quelquefois, par solidarité, j'ai envie de hurler avec eux, de harponner les autres, tous les autres si indifférents, si pressés, si blindés de normalité. »
Un ouvrage intéressant, sensible, parfois drôle, mais aussi désespérant face à la souffrance de ceux qui sont ignorés. Et une écriture ciselée.
Père de quatre enfants, dont un enfant reconnu autiste asperger et une fille schizophrène, Sandor se sépare de son épouse. Fatigué, il prend un arrêt de travail afin de se reposer. Pour s’éloigner aussi de ceux qu’il ne supporte plus : « les masques, les simagrées (…) Les petits hommes qui se prennent pour quelqu'un. Les surimportants qui pontifient ».
Et tandis qu’il se promène en ville, il constate que son empathie semble attirer les gens différents. Aussi s’interroge-t-il : "Est-ce que j'attire les fous, ou bien est-ce moi qui cherche leur compagnie ?" / Je marche infatigablement, interminablement, sans but, dans les rues, sur les quais, dans les parcs. Quelques humains, des ultrasensibles, perçoivent de l'intérieur mes ondes. Il arrive qu'une rencontre de hasard m'entraîne dans son maelström. Sylvain a bien raison de me dire que je souffre d'un excès d'empathie. C'est vrai que j'ai tendance à voir la folie partout, à débusquer sa menace, chez moi ou chez les autres, à travers des signes légers : une parole exagérément volubile, l'hystérie d'un geste, le mutisme glaçant d'un poisson froid, la logorrhée d'un monologuiste. Les fous et les demi-fous me magnétisent. A moins que ce soit le contraire. Je ne peux pas détourner mon regard. Je suis prêt à les suivre tel un privé qui aurait renoncé à la filature et adopté la méthode directe.
Il se jette sur toutes les lectures qui concernent les différentes formes de folie, évoque ces « corps errants » qui se confient à lui : « Quelquefois, par solidarité, j'ai envie de hurler avec eux, de harponner les autres, tous les autres si indifférents, si pressés, si blindés de normalité. »
Un ouvrage intéressant, sensible, parfois drôle, mais aussi désespérant face à la souffrance de ceux qui sont ignorés. Et une écriture ciselée.
Sandor souffre ou du moins est atteint d’un « excès d’empathie ». Il capte et reconnaît les personnes qu’il croise dans les rues de Lyon et qui lui semble en décalage avec le monde extérieur. Il répère les « fous » et revient les fréquenter ensuite au détour de ses déambulations, en revenant tailler le bout de gras avec eux par exemple. Sandor déambule car il est en arrêt de travail et il a le temps d’exercer ce drôle de passe-temps. Il est aussi un fin observateur de sa famille proche. Une famille que l’on pourrait qualifier de dysfonctionnelle et qui ne se trouve pas bien loin des « fous » que Sandor côtoie.
Avec « Mes fous », l’auteur écrit un très beau livre sur les nuances qui existent entre le normal et le pathologique. Il relève à travers les points de vue de son personnage Sandor, un point de vue plus global. Celui que porte la société sur la folie, sur la psychiatrie et sur ces personnages en marge. Des personnages qu’on laisse de côté, qui ne mérite plus notre attention. Des « corps errants » pour reprendre la très belle expression de l’auteur.
Sans être dénué d’empathie et avec un ton très juste, Jean-Pierre Martin invite les lectrices et les lecteurs à une réflexion sur la question. Sandor développe sa pensée au fil du récit et ce n’est jamais manichéen bien au contraire. Le personnage principal est touché par ces marginaux et à la lecture de ce livre nous aussi.
« J’ai aussi une fibre ethnographique. J’aurais volontiers pratiqué l’observation participante ».
« C’est vrai que j’ai tendance à voir la folie partout, à débusquer sa menace, chez moi ou chez les autres, à travers des signes légers : une parole exagérément volubile, l’hystérie d’un geste, le mutisme glaçant d’un poisson froid, la logorrhée d’un monologuiste. Les fous et les demi-fous me magnétisent. À moins que ce ne soit le contraire. Je ne peux pas détourner mon regard. Je suis prêt à les suivre tel un privé qui aurait renoncé à la filature et adopté la méthode directe.
Fou n’est pas le mot, même si je le prononce avec affection. Je préfère dire : corps errants. Je les appelle ainsi pour tenter de leur rendre un peu de leur noblesse. »
« Est-ce que j’attire les fous, ou bien est-ce que c’est moi qui cherche leur compagnie ? Quelquefois j’aimerais échapper à cette manie qui est la mienne, décider de ne plus prêter attention. Mais les corps errants saisissent comme personne les fragilités alentour. »
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
Avec « Mes fous », l’auteur écrit un très beau livre sur les nuances qui existent entre le normal et le pathologique. Il relève à travers les points de vue de son personnage Sandor, un point de vue plus global. Celui que porte la société sur la folie, sur la psychiatrie et sur ces personnages en marge. Des personnages qu’on laisse de côté, qui ne mérite plus notre attention. Des « corps errants » pour reprendre la très belle expression de l’auteur.
Sans être dénué d’empathie et avec un ton très juste, Jean-Pierre Martin invite les lectrices et les lecteurs à une réflexion sur la question. Sandor développe sa pensée au fil du récit et ce n’est jamais manichéen bien au contraire. Le personnage principal est touché par ces marginaux et à la lecture de ce livre nous aussi.
« J’ai aussi une fibre ethnographique. J’aurais volontiers pratiqué l’observation participante ».
« C’est vrai que j’ai tendance à voir la folie partout, à débusquer sa menace, chez moi ou chez les autres, à travers des signes légers : une parole exagérément volubile, l’hystérie d’un geste, le mutisme glaçant d’un poisson froid, la logorrhée d’un monologuiste. Les fous et les demi-fous me magnétisent. À moins que ce ne soit le contraire. Je ne peux pas détourner mon regard. Je suis prêt à les suivre tel un privé qui aurait renoncé à la filature et adopté la méthode directe.
Fou n’est pas le mot, même si je le prononce avec affection. Je préfère dire : corps errants. Je les appelle ainsi pour tenter de leur rendre un peu de leur noblesse. »
« Est-ce que j’attire les fous, ou bien est-ce que c’est moi qui cherche leur compagnie ? Quelquefois j’aimerais échapper à cette manie qui est la mienne, décider de ne plus prêter attention. Mais les corps errants saisissent comme personne les fragilités alentour. »
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
Ce livre est jubilatoire: non, la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, même si certains philosophes antiques et l'Eglise la vilipendaient. Jean-Pierre Martin la considère au contraire comme une qualité, une ouverture, un élan vivifiant permettant de sortir de sa monotonie. Sans la curiosité, pas de grandes découvertes, pas de progrès scientifiques, pas de débats d'idée et pas de lectures et pas d'amour. C'est un livre intéressant et très stimulant.
Un auteur lyonnais sur la liste du Goncourt (depuis pas retenu sur la dernière) - on y découvre les quais de Lyon même si c'est surtout la folie de sa fille Constance (la dernière de ses quatre enfants) qui est le sujet du livre. Mention particulière au chapitre 3 qui se déroule en Haute-Loire, c'est le plus réussi
Une histoire à huit clos dans un TGV, le train de l'amour à grande vitesse !
Drôle et plein de finesse.
Drôle et plein de finesse.
Sur un étal de libraire, un livre à la couverture bleu nuit, un bandeau rouge où est inscrite en grandes lettres blanches cette phrase, surtout cette phrase : « Quand je me mets à penser, je ne m'en sors plus ». Je découvre le titre : « Queneau Losophe ».
Ah bon ! Evidemment je connais le Queneau des poèmes, le Queneau des chansons, le Queneau de « Zazie » et de l'époustouflant « Exercices de Style ». Il m'a souvent bousculée (linguistiquement – phonétiquement parlant), il m'a fait rire et j'ai aimé les jeux de sons, les phrases déchiquetées, les interrogations provoquées, etc. ... Comme ... tout le monde !
Voilà que je rencontre, grâce à cette citation, un autre auteur : Jean-Pierre Martin, le « meilleur lecteur » de Queneau, un des fondateurs de la losophie et c'est avec délectation que je me suis plongée dans ce livre.
La collection s'intitule « L'un et l'autre ». Je laisse chanter ces mots en moi. Je ressens le fil, je vois le miroir. Deux visages se superposent : respect, projection, amour (« l'amour n'a pas d'objet »), défense posthume, superposition, idéalisation, dépassement.
Cette biographie à deux têtes nous apprend qui fut l'un, qui est l'autre.
Queneau plus loin que le Queneau original, bousculant, humour en bout de plume que l'on enseigne aux potaches, un Queneau mélancolique, aux connaissances livresques écrasantes, humain remuant dont la losophie empêche la pensée de tourner-z-en rond, de répéter, de se scléroser, de « pensoter », de se systématiser, de s'envoler dans les arcanes philosophiques hermétiques connues, d'oublier le quotidien, la rue, ses acteurs et de rire.
Jean-Pierre Martin nous entraîne dans les romans moins connus du grand public et donne surtout envie de lire « Les Derniers Jours » et ainsi découvrir le héros Vincent Tuquedenne (Queneau).
L'auteur livre des extraits de la correspondance qu'il a entretenue avec Queneau, des échanges d'une richesse et d'une compréhension mutuelle telle que la « dernière mélancolie » de Raymond Queneau en fut illuminée : être compris parfois mieux que par lui-même.
Cette admiration est dévorante et je comprends l'auteur qui eut besoin de recul pour retrouver l'innocence de la lecture. L'identification est parfois dérangeante mais a permis cette compréhension unique dont nous pouvons partager la lecture dans ce livre aux multiples facettes.
Comprendre intensément un auteur, pénétrer profondément derrière le miroir qui constitue tout être n'est donné qu'à celui qui s'y trouve, s'y retrouve et aime. C'est l'empreinte que laissera ce livre qui contribue à la connaissance d'une pensée, celle de la losophie.
Ah bon ! Evidemment je connais le Queneau des poèmes, le Queneau des chansons, le Queneau de « Zazie » et de l'époustouflant « Exercices de Style ». Il m'a souvent bousculée (linguistiquement – phonétiquement parlant), il m'a fait rire et j'ai aimé les jeux de sons, les phrases déchiquetées, les interrogations provoquées, etc. ... Comme ... tout le monde !
Voilà que je rencontre, grâce à cette citation, un autre auteur : Jean-Pierre Martin, le « meilleur lecteur » de Queneau, un des fondateurs de la losophie et c'est avec délectation que je me suis plongée dans ce livre.
La collection s'intitule « L'un et l'autre ». Je laisse chanter ces mots en moi. Je ressens le fil, je vois le miroir. Deux visages se superposent : respect, projection, amour (« l'amour n'a pas d'objet »), défense posthume, superposition, idéalisation, dépassement.
Cette biographie à deux têtes nous apprend qui fut l'un, qui est l'autre.
Queneau plus loin que le Queneau original, bousculant, humour en bout de plume que l'on enseigne aux potaches, un Queneau mélancolique, aux connaissances livresques écrasantes, humain remuant dont la losophie empêche la pensée de tourner-z-en rond, de répéter, de se scléroser, de « pensoter », de se systématiser, de s'envoler dans les arcanes philosophiques hermétiques connues, d'oublier le quotidien, la rue, ses acteurs et de rire.
Jean-Pierre Martin nous entraîne dans les romans moins connus du grand public et donne surtout envie de lire « Les Derniers Jours » et ainsi découvrir le héros Vincent Tuquedenne (Queneau).
L'auteur livre des extraits de la correspondance qu'il a entretenue avec Queneau, des échanges d'une richesse et d'une compréhension mutuelle telle que la « dernière mélancolie » de Raymond Queneau en fut illuminée : être compris parfois mieux que par lui-même.
Cette admiration est dévorante et je comprends l'auteur qui eut besoin de recul pour retrouver l'innocence de la lecture. L'identification est parfois dérangeante mais a permis cette compréhension unique dont nous pouvons partager la lecture dans ce livre aux multiples facettes.
Comprendre intensément un auteur, pénétrer profondément derrière le miroir qui constitue tout être n'est donné qu'à celui qui s'y trouve, s'y retrouve et aime. C'est l'empreinte que laissera ce livre qui contribue à la connaissance d'une pensée, celle de la losophie.
Critique de Baptiste Morizot pour le Magazine Littéraire
Dans Les Écrivains face à la doxa, les protagonistes sont plutôt les lecteurs face à la doxa scolaire. La doxa est «l'ensemble des idées dominantes qui contribuent à former la religion d'une nation». Ce livre est une thérapie pour une maladie bien spécifique : «la doxa littéraire, produit dérivé de l'enseignement», ou le marasme dans lequel semble se mouvoir l'enseignement scolaire et universitaire de la littérature. Il s'agit d'un drame sociologiquement restreint, mais qui pourrait s'étendre aux lecteurs de demain.
L'enseignement littéraire apparaît ici comme automatisé par une série d'habitudes mortifères, qui consistent à empêcher l'expérience intime et intense de lecture d'un livre, pour lui substituer des modes d'analyse programmés, produisant de la répétition. Parmi ces dogmes et opinions reçues, la «doxa techniciste» transforme la littérature en ingénierie des tropes, où la lecture consiste en un rangement minutieux des organes du texte selon les catégories des formalismes les plus abstrus. Connaître la littérature, c'est alors connaître les outils pour la disséquer vive, et non plus les livres eux-mêmes. La doxa du secret, quant à elle, interdit toute incursion dans la biographie d'un auteur pour donner un éclairage à son oeuvre. Cette doxa à la mode postule l'autonomie pure du texte, et la mort de l'auteur. Sur ce point le débat est houleux : Jean-Pierre Martin s'oppose ici à une théorie qui ne manque pas d'adeptes, et qui reste pertinente pour résoudre certains problèmes, comme celui qui est posé par le psychologisme d'un Sainte-Beuve prétendant expliquer toute l'oeuvre par la psyché de l'auteur. Néanmoins, Jean-Pierre Martin montre bien que le débat est faussé par une radicalisation des positions en présence. Les lectures biographiques peuvent être pertinentes, à condition de ne pas prétendre réduire l'oeuvre, mais l'éclairer.
Si ces critiques semblent éclairantes, le point qui reste en débat est celui de leur extension : à qui s'adressent-elles ? Si l'hypothèse sociologique de l'auteur est juste, elles ne s'appliquent pas qu'à l'enseignement universitaire et scolaire de la littérature, mais aussi à vous et moi, à l'honnête homme, qui croit être libre de lire des romans comme il l'entend, quand c'est la doxa qui lit à travers lui. Cette hypothèse aujourd'hui un peu catastrophiste pourrait être un risque pour demain : les honnêtes hommes de demain étant les élèves d'aujourd'hui, le danger est que leur rapport à la littérature soit vicié par les programmes éducatifs. La thérapie que propose Jean-Pierre Martin revient au mot de Hölderlin : «Là où est le danger croît aussi ce qui sauve.» Car les écrivains continuent à écrire, et les lecteurs à les lire, de sorte qu'ils réactivent ensemble ce mode authentique de lecture qu'est l'expérience intime, sans trop de médiation théorique, sans nécessité immédiate de professer une opinion, et sans explication de texte à rendre. Pour une fois, le bon sens semble être une solution.
Dans Les Écrivains face à la doxa, les protagonistes sont plutôt les lecteurs face à la doxa scolaire. La doxa est «l'ensemble des idées dominantes qui contribuent à former la religion d'une nation». Ce livre est une thérapie pour une maladie bien spécifique : «la doxa littéraire, produit dérivé de l'enseignement», ou le marasme dans lequel semble se mouvoir l'enseignement scolaire et universitaire de la littérature. Il s'agit d'un drame sociologiquement restreint, mais qui pourrait s'étendre aux lecteurs de demain.
L'enseignement littéraire apparaît ici comme automatisé par une série d'habitudes mortifères, qui consistent à empêcher l'expérience intime et intense de lecture d'un livre, pour lui substituer des modes d'analyse programmés, produisant de la répétition. Parmi ces dogmes et opinions reçues, la «doxa techniciste» transforme la littérature en ingénierie des tropes, où la lecture consiste en un rangement minutieux des organes du texte selon les catégories des formalismes les plus abstrus. Connaître la littérature, c'est alors connaître les outils pour la disséquer vive, et non plus les livres eux-mêmes. La doxa du secret, quant à elle, interdit toute incursion dans la biographie d'un auteur pour donner un éclairage à son oeuvre. Cette doxa à la mode postule l'autonomie pure du texte, et la mort de l'auteur. Sur ce point le débat est houleux : Jean-Pierre Martin s'oppose ici à une théorie qui ne manque pas d'adeptes, et qui reste pertinente pour résoudre certains problèmes, comme celui qui est posé par le psychologisme d'un Sainte-Beuve prétendant expliquer toute l'oeuvre par la psyché de l'auteur. Néanmoins, Jean-Pierre Martin montre bien que le débat est faussé par une radicalisation des positions en présence. Les lectures biographiques peuvent être pertinentes, à condition de ne pas prétendre réduire l'oeuvre, mais l'éclairer.
Si ces critiques semblent éclairantes, le point qui reste en débat est celui de leur extension : à qui s'adressent-elles ? Si l'hypothèse sociologique de l'auteur est juste, elles ne s'appliquent pas qu'à l'enseignement universitaire et scolaire de la littérature, mais aussi à vous et moi, à l'honnête homme, qui croit être libre de lire des romans comme il l'entend, quand c'est la doxa qui lit à travers lui. Cette hypothèse aujourd'hui un peu catastrophiste pourrait être un risque pour demain : les honnêtes hommes de demain étant les élèves d'aujourd'hui, le danger est que leur rapport à la littérature soit vicié par les programmes éducatifs. La thérapie que propose Jean-Pierre Martin revient au mot de Hölderlin : «Là où est le danger croît aussi ce qui sauve.» Car les écrivains continuent à écrire, et les lecteurs à les lire, de sorte qu'ils réactivent ensemble ce mode authentique de lecture qu'est l'expérience intime, sans trop de médiation théorique, sans nécessité immédiate de professer une opinion, et sans explication de texte à rendre. Pour une fois, le bon sens semble être une solution.
Critique de Philippe Roland pour le Magazine Littéraire
On savait que Raymond Queneau avait été surréaliste, pataphysicien, oulipien ; on sait désormais qu'il fut aussi et surtout «losophe». C'est en soutenant un mémoire de maîtrise au parloir de la prison de Saint-Nazaire que Jean-Pierre Martin expose sa découverte : «pour tous les êtres désemparés qui ne trouvaient satisfaction dans aucun secteur repérable et délimité de l'art ou de la pensée», un espoir existe, la losophie, c'est-à-dire une manière à la fois grave et drolatique de se moquer de la philosophie sans jamais cesser d'être philosophe, une «forme de sagesse qui, n'étant ni tout à fait de la littérature ni tout à fait de la philosophie, jouissait du meilleur des deux». Or qui mieux que Queneau a su incarner cette discipline nouvelle ? Jean-Pierre Martin décide alors d'écrire à celui qui est l'un de ses écrivains fétiches, qu'il lit et relit avec délice depuis sa prime jeunesse, et l'auteur de Zazie dans le métro lui répond : ainsi commence une correspondance qui durera jusqu'à la mort de Queneau, et même après - correspondance dont il importe peu finalement de savoir si elle est vraie ou fausse.
Ce texte est un exercice d'admiration et de gratitude : en lisant les ouvrages de Queneau, Jean-Pierre Martin a appris à se détacher du «tout-politique», de l'esprit de système, des discours péremptoires, de l'emphase du Poète inspiré, il a appris «à tenir bon dans la voie du gai désespoir», à rire d'un rire libérateur, à se méfier de tout ce qui embrigade et fige le langage et la pensée. Il y a décelé une oeuvre aussi novatrice que celles d'un Joyce ou d'un Céline, reconnue comme telle par la pointe de l'avant-garde littéraire du XXe siècle - qu'il s'agisse des amis Leiris ou Duras, ou encore de Barthes, de Blanchot, de Calvino ou de Robbe-Grillet. Dans ce cas, s'interroge-t-on, pourquoi un écrivain aussi génial a-t-il été à ce point sous-estimé ? Parce qu'il est amusant et pudique, alors qu'il est de bon ton qu'un grantécrivain soit sombre et dévoile de lourds secrets ; parce qu'il s'est tenu à l'écart des modes esthétiques et des engagements politiques ; parce qu'il se présentait comme un humble artisan disciple de Boileau et qu'il conserve de sa Normandie natale un côté taiseux et effacé, un provincialisme qui ne cadrait pas avec le monde des Lettres. Et même si on a peu à peu pris conscience de son importance - La Pléiade, notamment, est passée par là -, il reste encore assez méconnu. Mais Queneau losophe est au moins autant un portrait de Queneau qu'un autoportrait de Jean-Pierre Martin : un jeu de miroirs plus ou moins déformants est ici mis en place, si bien que l'auteur ressemble parfois plus à Queneau que Queneau lui-même (à moins que ce ne soit l'inverse), qu'on ne sait pas toujours très bien si telle phrase est écrite par l'un ou par l'autre, et qu'ils s'éloignent amicalement l'un de l'autre d'une pirouette au moment précis où on croit les saisir et les confondre tous deux. À la fois biographie, autobiographie, traité (phi)losophique et critique littéraire, Queneau losophe est un kekchose jubilatoire et émouvant, une irrésistible invitation à lire et à relire Queneau - ainsi qu'un art de la lecture, ou comment une oeuvre littéraire peut métamorphoser son lecteur, à tel point que le lecteur devient l'auteur de l'oeuvre qui a changé sa vie.
On savait que Raymond Queneau avait été surréaliste, pataphysicien, oulipien ; on sait désormais qu'il fut aussi et surtout «losophe». C'est en soutenant un mémoire de maîtrise au parloir de la prison de Saint-Nazaire que Jean-Pierre Martin expose sa découverte : «pour tous les êtres désemparés qui ne trouvaient satisfaction dans aucun secteur repérable et délimité de l'art ou de la pensée», un espoir existe, la losophie, c'est-à-dire une manière à la fois grave et drolatique de se moquer de la philosophie sans jamais cesser d'être philosophe, une «forme de sagesse qui, n'étant ni tout à fait de la littérature ni tout à fait de la philosophie, jouissait du meilleur des deux». Or qui mieux que Queneau a su incarner cette discipline nouvelle ? Jean-Pierre Martin décide alors d'écrire à celui qui est l'un de ses écrivains fétiches, qu'il lit et relit avec délice depuis sa prime jeunesse, et l'auteur de Zazie dans le métro lui répond : ainsi commence une correspondance qui durera jusqu'à la mort de Queneau, et même après - correspondance dont il importe peu finalement de savoir si elle est vraie ou fausse.
Ce texte est un exercice d'admiration et de gratitude : en lisant les ouvrages de Queneau, Jean-Pierre Martin a appris à se détacher du «tout-politique», de l'esprit de système, des discours péremptoires, de l'emphase du Poète inspiré, il a appris «à tenir bon dans la voie du gai désespoir», à rire d'un rire libérateur, à se méfier de tout ce qui embrigade et fige le langage et la pensée. Il y a décelé une oeuvre aussi novatrice que celles d'un Joyce ou d'un Céline, reconnue comme telle par la pointe de l'avant-garde littéraire du XXe siècle - qu'il s'agisse des amis Leiris ou Duras, ou encore de Barthes, de Blanchot, de Calvino ou de Robbe-Grillet. Dans ce cas, s'interroge-t-on, pourquoi un écrivain aussi génial a-t-il été à ce point sous-estimé ? Parce qu'il est amusant et pudique, alors qu'il est de bon ton qu'un grantécrivain soit sombre et dévoile de lourds secrets ; parce qu'il s'est tenu à l'écart des modes esthétiques et des engagements politiques ; parce qu'il se présentait comme un humble artisan disciple de Boileau et qu'il conserve de sa Normandie natale un côté taiseux et effacé, un provincialisme qui ne cadrait pas avec le monde des Lettres. Et même si on a peu à peu pris conscience de son importance - La Pléiade, notamment, est passée par là -, il reste encore assez méconnu. Mais Queneau losophe est au moins autant un portrait de Queneau qu'un autoportrait de Jean-Pierre Martin : un jeu de miroirs plus ou moins déformants est ici mis en place, si bien que l'auteur ressemble parfois plus à Queneau que Queneau lui-même (à moins que ce ne soit l'inverse), qu'on ne sait pas toujours très bien si telle phrase est écrite par l'un ou par l'autre, et qu'ils s'éloignent amicalement l'un de l'autre d'une pirouette au moment précis où on croit les saisir et les confondre tous deux. À la fois biographie, autobiographie, traité (phi)losophique et critique littéraire, Queneau losophe est un kekchose jubilatoire et émouvant, une irrésistible invitation à lire et à relire Queneau - ainsi qu'un art de la lecture, ou comment une oeuvre littéraire peut métamorphoser son lecteur, à tel point que le lecteur devient l'auteur de l'oeuvre qui a changé sa vie.
Tout à la fois témoignage sur les conditions en détention, sur la solitude de l'enfermement et les moyens d'y échapper par la pensée, galerie de portraits de ceux qui peuplent la prison, des deux côtés des grilles, manifeste d'un homme dont la révolte gronde toujours, et portrait d'une époque, ce court livre est un trésor d'humanité, à l'instar de Mes fous, publié en 2020 aux éditions de L'Olivier.
Lien : https://www.francetvinfo.fr/..
Lien : https://www.francetvinfo.fr/..
Jean-Pierre Martin a été incarcéré dans la maison d'arrêt de Saint-Nazaire en 1970 pendant 61 jours. 61 jours au mitard et sur lesquels il revient dans son dernier texte, "N'oublie rien". Alors qu'il a 22 ans et qu'il travaille à l'usine, il est arrêté pour "apologie du crime d'incendie volontaire". Une tournure floue qui cache en réalité une contestation collective à laquelle il prend part suite aux nombreux accidents du travail sur les chantiers de l'Atlantique. L'auteur s'engage à plusieurs reprises durant cette période pour lutter contre l'injustice notamment celle liée aux accidents du travail. Il arrête ses études et travaille à l'usine avant son arrestation. Jean-Pierre Martin restitue une expérience carcérale marquante. C'est aussi tout le contexte d'une époque qui défile sous les yeux du lecteur. L'auteur s'attarde à la fois sur son vécu personnel et en même temps comment il s'inscrit dans cette lutte collective à Saint-Nazaire. Un texte plein d'émotion et très bien écrit.
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
Lien : https://lesmafieuses.wordpre..
L'écrivain et essayiste revient sur ses deux mois de détention, en 1970, alors qu'il militait à la Gauche prolétarienne : un apprentissage décisif.
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean-Pierre Martin
Lecteurs de Jean-Pierre Martin (230)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le pays des contes
Alex et Conner sont......
les petits-enfants de la Bonne fée
les enfants de Cendrillon et du prince Charmant
les chiens de Rouge
13 questions
38 lecteurs ont répondu
Thème : Le pays des contes, tome 1 : Le sortilège perdu de
Chris ColferCréer un quiz sur cet auteur38 lecteurs ont répondu