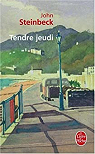Critiques de John Steinbeck (2472)
Je vais volontairement tâcher de ne rien déflorer du délice de cet ouvrage époustouflant, atroce et tellement, TELLEMENT fort, afin que ceux qui désirent s'en repaître sans connaître l'histoire au préalable puisse tout de même avoir quelques indices.
Voici un pur bijou, du très grand Steinbeck. J'ai rarement lu un livre aussi petit qui me frappe aussi fort et aussi durablement (il n'y aurait peut-être que Montserrat d'Emmanuel Roblès ou On Achève Bien Les Chevaux d'Horace McCoy à concourir dans cette incroyable catégorie). Où donc John Steinbeck est-il allé chercher une pareille histoire (qu'il n'est pas usurpé d'appeler une histoire d'amour sous ses apparences tout autres) ? Probablement du côté d'Edith Wharton est de son étonnant Ethan Frome, mais ça c'est juste mon intuition.
Quoi qu'il en soit, l'auteur nous sert des dialogues impeccables, un scénario parfait, simple, efficace, un style lumineux, un fil qui se tend tout au long du récit jusqu'à vous éclater au visage. Si vous restez insensibles, allez d'urgence consulter un cardiologue car il y a vraisemblablement un problème de ce côté là !
Je voudrais seulement offrir deux comparaisons pour les deux protagonistes principaux, l'une pour George, l'autre pour Lennie.
George, l'ouvrier agricole modèle, pas naïf, les pieds sur terre, qu'il ne faut pas trop chercher mais qui est une bonne pâte dans le fond, me fait beaucoup penser à Jean dans La Terre d'Émile Zola. La Jacqueline de Zola a aussi son pendant dans ce livre.
D'autre part, ceux qui ont lu L'Homme Sans Qualités de Robert Musil trouveront peut-être une ressemblance frappante entre ce Lennie et le personnage de Moosbrugger au chapitre 18 de cet autre monument littéraire qui date lui aussi des années 1930.
C'est un caractère récurrent chez Steinbeck de choisir un protagoniste souffrant d'une difformité physique ou mentale comme une sorte de Quasimodo moderne (voir La Grande Vallée, Les Pâturages du Ciel pour les difformités physiques, À l'est d'Éden pour les mentales).
Bonne lecture et surtout, j'aimerais souffrir d'amnésie pour revivre le plaisir que j'ai eu à lire ce livre pour la première fois, néanmoins, ce n'est là que mon tout petit avis parmi une kyrielle d'autres, c'est-à-dire, bien peu de chose.
P. S. : On sait que John Steinbeck s'est inspiré du poème en dialecte écossais de Robert Burns de 1785 intitulé « To a mouse » pour choisir le titre de son œuvre et que le passage suivant décrit à merveille ce qui s'y passe :
« The best-laid schemes of mice and men
Go oft awry,
And leave us nothing but grief and pain,
For promised joy ! »
La symbolique est partout très forte dans ce roman et j'aimerais simplement faire une toute petite remarque quant à l'utilisation de la souris. Ici, malheureusement, on perd beaucoup à la traduction. Dans le titre original " Of Mice and Men ", l'utilisation de deux substantifs proches à l'oreille et ayant un pluriel particulier (ce qui n'est pas si fréquent en anglais) rapproche inévitablement, comme dans le poème de Burns, l'Homme en général de la Souris. Dans le déroulement de l'action, le parallèle entre l'un des personnages, broyé par Lenny et la souris me semble assez transparent.
De même, la fuite continue de George et Lenny, au départ, n'est sans doute pas très différente de la fuite des rongeurs face à leurs bourreaux humains. Si bien que la question qu'il convient de se poser est : Qui sont les bourreaux de George et Lenny ? Mais voilà, c'est tout le roman, cette question, et c'est pour ça qu'il est vraiment grandiose.
Voici un pur bijou, du très grand Steinbeck. J'ai rarement lu un livre aussi petit qui me frappe aussi fort et aussi durablement (il n'y aurait peut-être que Montserrat d'Emmanuel Roblès ou On Achève Bien Les Chevaux d'Horace McCoy à concourir dans cette incroyable catégorie). Où donc John Steinbeck est-il allé chercher une pareille histoire (qu'il n'est pas usurpé d'appeler une histoire d'amour sous ses apparences tout autres) ? Probablement du côté d'Edith Wharton est de son étonnant Ethan Frome, mais ça c'est juste mon intuition.
Quoi qu'il en soit, l'auteur nous sert des dialogues impeccables, un scénario parfait, simple, efficace, un style lumineux, un fil qui se tend tout au long du récit jusqu'à vous éclater au visage. Si vous restez insensibles, allez d'urgence consulter un cardiologue car il y a vraisemblablement un problème de ce côté là !
Je voudrais seulement offrir deux comparaisons pour les deux protagonistes principaux, l'une pour George, l'autre pour Lennie.
George, l'ouvrier agricole modèle, pas naïf, les pieds sur terre, qu'il ne faut pas trop chercher mais qui est une bonne pâte dans le fond, me fait beaucoup penser à Jean dans La Terre d'Émile Zola. La Jacqueline de Zola a aussi son pendant dans ce livre.
D'autre part, ceux qui ont lu L'Homme Sans Qualités de Robert Musil trouveront peut-être une ressemblance frappante entre ce Lennie et le personnage de Moosbrugger au chapitre 18 de cet autre monument littéraire qui date lui aussi des années 1930.
C'est un caractère récurrent chez Steinbeck de choisir un protagoniste souffrant d'une difformité physique ou mentale comme une sorte de Quasimodo moderne (voir La Grande Vallée, Les Pâturages du Ciel pour les difformités physiques, À l'est d'Éden pour les mentales).
Bonne lecture et surtout, j'aimerais souffrir d'amnésie pour revivre le plaisir que j'ai eu à lire ce livre pour la première fois, néanmoins, ce n'est là que mon tout petit avis parmi une kyrielle d'autres, c'est-à-dire, bien peu de chose.
P. S. : On sait que John Steinbeck s'est inspiré du poème en dialecte écossais de Robert Burns de 1785 intitulé « To a mouse » pour choisir le titre de son œuvre et que le passage suivant décrit à merveille ce qui s'y passe :
« The best-laid schemes of mice and men
Go oft awry,
And leave us nothing but grief and pain,
For promised joy ! »
La symbolique est partout très forte dans ce roman et j'aimerais simplement faire une toute petite remarque quant à l'utilisation de la souris. Ici, malheureusement, on perd beaucoup à la traduction. Dans le titre original " Of Mice and Men ", l'utilisation de deux substantifs proches à l'oreille et ayant un pluriel particulier (ce qui n'est pas si fréquent en anglais) rapproche inévitablement, comme dans le poème de Burns, l'Homme en général de la Souris. Dans le déroulement de l'action, le parallèle entre l'un des personnages, broyé par Lenny et la souris me semble assez transparent.
De même, la fuite continue de George et Lenny, au départ, n'est sans doute pas très différente de la fuite des rongeurs face à leurs bourreaux humains. Si bien que la question qu'il convient de se poser est : Qui sont les bourreaux de George et Lenny ? Mais voilà, c'est tout le roman, cette question, et c'est pour ça qu'il est vraiment grandiose.
Juste un mot : SUBLIME !
Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de faire court car il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est : « Chapeau l'artiste ! »
Imaginez : Vous vivez de la terre en pleine période de crise (Dust Bowl + dépression post 1929* — voir le premier P.S. au bas de cette critique si vous souhaitez quelques informations sur le contexte) dans un sale Oklahoma qui refuse d'offrir de bonnes parcelles.
Vous êtes endetté auprès des banques au point de devoir quitter votre terre pour honorer vos créances (je vous conseille à ce propos, si vous ne le connaissez déjà, L'Argent Dette sur Dailymotion ou Youtube). Où allez vous ?
Là où tout le monde vous dit que c'est mieux ; la Californie, l'Eldorado en quelque sorte (pour mémoire, voir L'or de Blaise Cendrars).
Ouais ! La Californie... et toutes les misères qui vont avec et que vous pouvez vous figurer (du garagiste véreux, aux super propriétaires, toujours prêts à faire travailler à l'oeil une main-d'oeuvre en souffrance).
Ce livre dépasse de loin les frontières des États américains, c'est une allégorie de l'immigration en général. Les Africains, Sud-Américains, Asiatiques qui arrivent péniblement au fond d'un container, sur un radeau ou par quelque autre moyen sommaire et dangereux en Europe ou dans n'importe quelle autre terre soi-disant "promise" doivent vivre à peu près la même chose que les Joad des années 30 aux États-unis.
La magie de Steinbeck, c'est une écriture juste, basée sur un chapitre d'ordre général directement suivi par la mise en situation pour les infortunés Joad. du zéro faute littéraire, un monument de littérature, probablement le plus grand roman du XXème siècle et il s'est même permis le luxe de laisser poindre "le vin de l'espoir" derrière "les raisins de la colère".
Chapeau l'artiste ! même si ça commence à faire beaucoup de fois que je l'écris, ce ne sera jamais de trop, du moins c'est mon minuscule avis, qui se balance comme une feuille roussie désespérément accrochée au rameau dans un matin gris de novembre, autant dire, pas grand-chose.
P.S. 1 : le phénomène du Dust Bowl — littéralement le « bassin de poussière » — est un phénomène à la fois climatique et anthropique d'une ampleur exceptionnelle qui toucha plusieurs états des États-Unis durant environ une décennie, de 1932 à 1941, dont le coeur se situait, principalement, sur une zone équivalant à peu près à la moitié de la France métropolitaine.
(Les principaux états touchés furent l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado et le Kansas, même si bien d'autres états furent eux aussi touchés plus ponctuellement au cours de la période, comme le Nebraska, les Dakota du Nord et du Sud, le Wyoming ou encore l'Iowa, par exemple, ce qui représente au total une superficie comprise entre deux et quatre fois la France métropolitaine, en fonction des épisodes tempétueux considérés, notamment, le pire d'entre eux, survenu le 14 avril 1935.)
Il s'agit d'une très vaste zone de plaine située directement à l'est des montagnes Rocheuses. Historiquement, la végétation qui s'y maintenait était de la prairie, dans laquelle paissaient d'immenses troupeaux de bisons. L'absence naturelle d'arbres dans toute cette zone aurait pu ou aurait dû retenir davantage l'attention des nouveaux agriculteurs venus s'installer sur ces terres à la fin du XIX et au début du XXè s.
Labourer ces terres, retirer les plantes herbacées qui maintenaient le sol fut, dans un premier temps — c'est-à-dire des années 1900 à 1930 —, relativement sans conséquence sur la productivité agricole, de sorte que de nombreux agriculteurs pauvres, désireux de devenir propriétaires investirent sur cette zone, notamment dans les années 1920 où les prix des denrées agricoles étaient élevés après la Première guerre mondiale, et le travail de la terre, rendu plus aisé par la mécanisation.
Cependant, une zone semi-aride, puisque c'est ce qu'elle est, reste une zone semi-aride ; et en tant que zone semi-aride, elle est sujette aux épisodes de sécheresse. Jusque là, rien à dire, rien qui ne soit autre que naturel, même si l'intensité et la durée de ladite sécheresse furent exceptionnelles. En revanche, ce qui n'est pas naturel, c'est que le vent quasi permanent qui arrive des montagnes Rocheuses rencontre d'immenses zones de terre dénudées.
Et là, ce furent des millions, des milliards de tonnes de poussière qui furent arrachées aux sols et mis en suspension dans l'air. Voilà qui est entièrement imputable aux hommes et aux techniques productivistes de l'époque.
Ajoutons à cela le prix des denrées agricoles qui s'effondrèrent du fait même du crach boursier d'octobre 1929, une crise économique qui s'installa pour longtemps, doublée d'une crise climatique d'une longueur, d'une intensité et d'une fréquence hors du commun, jamais vue ni avant ni après en ces lieux et, durant presque dix ans, des récoltes quasi nulles.
Il faut imaginer des coups de tabac à répétition soulevant d'inimaginables nuages de poussière noirs et opaques, hauts comme des montagnes, sur des distances de parfois 300 km, capables d'occulter toute lumière en plein midi, capables d'accumuler suffisamment de sable pour faire disparaître votre maison en une fois sous une dune monumentale, capables de vous abraser les jambes si vous êtes dehors les jambes nues, capables de vous faire avaler tellement de poussière que vos poumons s'en trouvent emplis et que vous pouvez en succomber.
Ajoutons à cela de larges abus de la part des secteurs bancaires et fonciers, et l'on comprend mieux pourquoi des millions de personnes furent d'un coup dépossédés de leur moyen de subsistance, écoeurés de leur lopin de terre, et, de ce fait, jetés sur les routes en quête d'un nouveau gagne-pain.
P.S. 2 : même si j'aime assez le film de John Ford de 1940 (donc un an seulement après la sortie du roman), c'est peu dire qu'il est très en-dessous du livre. Vu la densité et la longueur du roman, le réalisateur a choisi de se focaliser sur certains tableaux, il fait notamment l'ellipse de toute la descente aux enfers que constitue le trajet depuis l'Oklahoma jusqu'à la Californie, qui est, personnellement, ce que j'aime le mieux du livre (même s'il m'est difficile de prétendre qu'il existe des endroits que j'aime moins dans ce livre car j'aime absolument tout). Ce film vaut surtout pour l'illustration très réaliste et contextuelle qu'il procure de l'oeuvre de Steinbeck.
N.B. : ce livre est évidemment à l'origine du superbe titre de Bruce Springsteen : The Ghost Of Tom Joad.
Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de faire court car il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est : « Chapeau l'artiste ! »
Imaginez : Vous vivez de la terre en pleine période de crise (Dust Bowl + dépression post 1929* — voir le premier P.S. au bas de cette critique si vous souhaitez quelques informations sur le contexte) dans un sale Oklahoma qui refuse d'offrir de bonnes parcelles.
Vous êtes endetté auprès des banques au point de devoir quitter votre terre pour honorer vos créances (je vous conseille à ce propos, si vous ne le connaissez déjà, L'Argent Dette sur Dailymotion ou Youtube). Où allez vous ?
Là où tout le monde vous dit que c'est mieux ; la Californie, l'Eldorado en quelque sorte (pour mémoire, voir L'or de Blaise Cendrars).
Ouais ! La Californie... et toutes les misères qui vont avec et que vous pouvez vous figurer (du garagiste véreux, aux super propriétaires, toujours prêts à faire travailler à l'oeil une main-d'oeuvre en souffrance).
Ce livre dépasse de loin les frontières des États américains, c'est une allégorie de l'immigration en général. Les Africains, Sud-Américains, Asiatiques qui arrivent péniblement au fond d'un container, sur un radeau ou par quelque autre moyen sommaire et dangereux en Europe ou dans n'importe quelle autre terre soi-disant "promise" doivent vivre à peu près la même chose que les Joad des années 30 aux États-unis.
La magie de Steinbeck, c'est une écriture juste, basée sur un chapitre d'ordre général directement suivi par la mise en situation pour les infortunés Joad. du zéro faute littéraire, un monument de littérature, probablement le plus grand roman du XXème siècle et il s'est même permis le luxe de laisser poindre "le vin de l'espoir" derrière "les raisins de la colère".
Chapeau l'artiste ! même si ça commence à faire beaucoup de fois que je l'écris, ce ne sera jamais de trop, du moins c'est mon minuscule avis, qui se balance comme une feuille roussie désespérément accrochée au rameau dans un matin gris de novembre, autant dire, pas grand-chose.
P.S. 1 : le phénomène du Dust Bowl — littéralement le « bassin de poussière » — est un phénomène à la fois climatique et anthropique d'une ampleur exceptionnelle qui toucha plusieurs états des États-Unis durant environ une décennie, de 1932 à 1941, dont le coeur se situait, principalement, sur une zone équivalant à peu près à la moitié de la France métropolitaine.
(Les principaux états touchés furent l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado et le Kansas, même si bien d'autres états furent eux aussi touchés plus ponctuellement au cours de la période, comme le Nebraska, les Dakota du Nord et du Sud, le Wyoming ou encore l'Iowa, par exemple, ce qui représente au total une superficie comprise entre deux et quatre fois la France métropolitaine, en fonction des épisodes tempétueux considérés, notamment, le pire d'entre eux, survenu le 14 avril 1935.)
Il s'agit d'une très vaste zone de plaine située directement à l'est des montagnes Rocheuses. Historiquement, la végétation qui s'y maintenait était de la prairie, dans laquelle paissaient d'immenses troupeaux de bisons. L'absence naturelle d'arbres dans toute cette zone aurait pu ou aurait dû retenir davantage l'attention des nouveaux agriculteurs venus s'installer sur ces terres à la fin du XIX et au début du XXè s.
Labourer ces terres, retirer les plantes herbacées qui maintenaient le sol fut, dans un premier temps — c'est-à-dire des années 1900 à 1930 —, relativement sans conséquence sur la productivité agricole, de sorte que de nombreux agriculteurs pauvres, désireux de devenir propriétaires investirent sur cette zone, notamment dans les années 1920 où les prix des denrées agricoles étaient élevés après la Première guerre mondiale, et le travail de la terre, rendu plus aisé par la mécanisation.
Cependant, une zone semi-aride, puisque c'est ce qu'elle est, reste une zone semi-aride ; et en tant que zone semi-aride, elle est sujette aux épisodes de sécheresse. Jusque là, rien à dire, rien qui ne soit autre que naturel, même si l'intensité et la durée de ladite sécheresse furent exceptionnelles. En revanche, ce qui n'est pas naturel, c'est que le vent quasi permanent qui arrive des montagnes Rocheuses rencontre d'immenses zones de terre dénudées.
Et là, ce furent des millions, des milliards de tonnes de poussière qui furent arrachées aux sols et mis en suspension dans l'air. Voilà qui est entièrement imputable aux hommes et aux techniques productivistes de l'époque.
Ajoutons à cela le prix des denrées agricoles qui s'effondrèrent du fait même du crach boursier d'octobre 1929, une crise économique qui s'installa pour longtemps, doublée d'une crise climatique d'une longueur, d'une intensité et d'une fréquence hors du commun, jamais vue ni avant ni après en ces lieux et, durant presque dix ans, des récoltes quasi nulles.
Il faut imaginer des coups de tabac à répétition soulevant d'inimaginables nuages de poussière noirs et opaques, hauts comme des montagnes, sur des distances de parfois 300 km, capables d'occulter toute lumière en plein midi, capables d'accumuler suffisamment de sable pour faire disparaître votre maison en une fois sous une dune monumentale, capables de vous abraser les jambes si vous êtes dehors les jambes nues, capables de vous faire avaler tellement de poussière que vos poumons s'en trouvent emplis et que vous pouvez en succomber.
Ajoutons à cela de larges abus de la part des secteurs bancaires et fonciers, et l'on comprend mieux pourquoi des millions de personnes furent d'un coup dépossédés de leur moyen de subsistance, écoeurés de leur lopin de terre, et, de ce fait, jetés sur les routes en quête d'un nouveau gagne-pain.
P.S. 2 : même si j'aime assez le film de John Ford de 1940 (donc un an seulement après la sortie du roman), c'est peu dire qu'il est très en-dessous du livre. Vu la densité et la longueur du roman, le réalisateur a choisi de se focaliser sur certains tableaux, il fait notamment l'ellipse de toute la descente aux enfers que constitue le trajet depuis l'Oklahoma jusqu'à la Californie, qui est, personnellement, ce que j'aime le mieux du livre (même s'il m'est difficile de prétendre qu'il existe des endroits que j'aime moins dans ce livre car j'aime absolument tout). Ce film vaut surtout pour l'illustration très réaliste et contextuelle qu'il procure de l'oeuvre de Steinbeck.
N.B. : ce livre est évidemment à l'origine du superbe titre de Bruce Springsteen : The Ghost Of Tom Joad.
Ils rêvent d'un lopin de terre, d'une petite ferme à eux, d'être libres et rentiers. Mais avant, ce qui attend Lennie et George c'est un boulot mal payé d'ouvriers agricoles dans un ranch de Californie.
Un travail indispensable qui se révèle un péril permanent pour Lennie, un géant naïf et impulsif. Un danger que rien ne peut éloigner, pas même les mises en garde de son ami George, dont la bienveillance envers lui, même si elle s'exprime brutalement, est touchante. L'auteur en empathie avec ses héros terriblement humains nous prépare à un drame. La tension est palpable, on se surprend à souhaiter vraiment que Lennie écoute son ami et ne se mette pas dans de sales draps.
A travers un univers qu'il connait pour y avoir travaillé, celui des travailleurs agricoles, John Steinbeck dénonce la politique et le système économique qui ont conduit à la Grande Dépression. Cette oeuvre naturaliste exceptionnelle — véritable plaidoyer contre le racisme, la ségrégation, le rejet du handicap —, digne d'un drame antique, est un regard critique essentiel sur une Amérique qui, engendrant un monde d'exclus, a déçu.
Un travail indispensable qui se révèle un péril permanent pour Lennie, un géant naïf et impulsif. Un danger que rien ne peut éloigner, pas même les mises en garde de son ami George, dont la bienveillance envers lui, même si elle s'exprime brutalement, est touchante. L'auteur en empathie avec ses héros terriblement humains nous prépare à un drame. La tension est palpable, on se surprend à souhaiter vraiment que Lennie écoute son ami et ne se mette pas dans de sales draps.
A travers un univers qu'il connait pour y avoir travaillé, celui des travailleurs agricoles, John Steinbeck dénonce la politique et le système économique qui ont conduit à la Grande Dépression. Cette oeuvre naturaliste exceptionnelle — véritable plaidoyer contre le racisme, la ségrégation, le rejet du handicap —, digne d'un drame antique, est un regard critique essentiel sur une Amérique qui, engendrant un monde d'exclus, a déçu.
Les très grands livres ne sont pas forcément les plus alambiqués, labyrinthiques ou interminables.
Les très grands livres, tel Des souris et des hommes, offrent la beauté et la simplicité d'un simple chemin de campagne ou d'une photo en noir et blanc aux bords dentelés (et de bien d'autres belles choses aussi).
Les deux protagonistes principaux, ce sont Lenny et Georges qui vont par les fermes louer leurs bras et dépenser leur sueur. Eux, sont deux hommes simples et ils ont un rêve commun qui est déjà un projet.
La tragédie, sublime sous le ciel des immenses espaces d' Amérique du nord, est en marche...
Les très grands livres, tel Des souris et des hommes, offrent la beauté et la simplicité d'un simple chemin de campagne ou d'une photo en noir et blanc aux bords dentelés (et de bien d'autres belles choses aussi).
Les deux protagonistes principaux, ce sont Lenny et Georges qui vont par les fermes louer leurs bras et dépenser leur sueur. Eux, sont deux hommes simples et ils ont un rêve commun qui est déjà un projet.
La tragédie, sublime sous le ciel des immenses espaces d' Amérique du nord, est en marche...
La lecture est un refuge intime, un tableau géant, une fenêtre vers l'esprit. Lorsqu'on entame un roman comme A l'est d'Eden l'on éprouve cet indéfinissable bonheur de tourner les pages et de s'émerveiller.
Le canevas est à priori simple, mais le dispositif narratif rend le récit passionnant. John Steinbeck aime raconter des histoires qui se déplient lentement, cherchant au fond de l'encrier la singularité des êtres et des choses. Il possède un sens saisissant du détail et la subtilité de poser en filigrane les questions de morale, portant un regard affûté sur son pays et sur son époque.
La trame se déroule autour de la question du Bien et du Mal. Des notions religieuses, mais aussi philosophiques et humanistes viennent appuyer le récit, notamment la question du libre arbitre.
A l'est d'Eden est une formidable saga historique qui retrace le passage du siècle et le tournant de la révolution industrielle.
Intimiste, lumineux, juste saupoudré d'ironie, ce bijou étaye des sentiments universels : la joie, la peine, le courage, la peur, le péché, l'innocence.
Tragique, comme toutes les belles histoires, ce récit plein de références et de symbolisme célèbre la vie, l'importance de se battre pour la vie et contre nos mauvais penchants.
Avec ce roman à la fois juste et enlevé, John Steinbeck prouve une fois de plus son talent de portraitiste affûté des solitudes modernes. Il drague et fouille les eaux noires des âmes.
Entre chronique sociale et mélancolie, A l'est d'Eden est un roman aussi brillant que salutaire, intemporel et contemporain, de ces romans qui vous touchent au coeur et restent marqué au fer rouge dans la mémoire.
Le canevas est à priori simple, mais le dispositif narratif rend le récit passionnant. John Steinbeck aime raconter des histoires qui se déplient lentement, cherchant au fond de l'encrier la singularité des êtres et des choses. Il possède un sens saisissant du détail et la subtilité de poser en filigrane les questions de morale, portant un regard affûté sur son pays et sur son époque.
La trame se déroule autour de la question du Bien et du Mal. Des notions religieuses, mais aussi philosophiques et humanistes viennent appuyer le récit, notamment la question du libre arbitre.
A l'est d'Eden est une formidable saga historique qui retrace le passage du siècle et le tournant de la révolution industrielle.
Intimiste, lumineux, juste saupoudré d'ironie, ce bijou étaye des sentiments universels : la joie, la peine, le courage, la peur, le péché, l'innocence.
Tragique, comme toutes les belles histoires, ce récit plein de références et de symbolisme célèbre la vie, l'importance de se battre pour la vie et contre nos mauvais penchants.
Avec ce roman à la fois juste et enlevé, John Steinbeck prouve une fois de plus son talent de portraitiste affûté des solitudes modernes. Il drague et fouille les eaux noires des âmes.
Entre chronique sociale et mélancolie, A l'est d'Eden est un roman aussi brillant que salutaire, intemporel et contemporain, de ces romans qui vous touchent au coeur et restent marqué au fer rouge dans la mémoire.
Dans les années trente, en Californie comme ailleurs, le machinisme était encore balbutiant si bien que les exploitations agricoles avaient recours à une multitude de journaliers qui de l'aube au crépuscule s'échinaient à la tâche.
La Grande Dépression a jeté sur les routes quantité de pauvre hères qui, le baluchon sur l'épaule, sillonnent la campagne en quête de travail.
George et Lennie sont de ceux-là. Ils viennent d'être embauchés dans un ranch situé au sud de la petite ville de Soledad, entre San Francisco et Los Angeles.
Encore jeunes, ils forment un bien curieux tandem : George est futé mais paraît assez frêle alors que Lennie est simplet mais d'un gabarit impressionnant. Une amitié indéfectible unit ces deux êtres d'allure et de tempérament si dissemblables. Chaque jour ils entretiennent le rêve de posséder en commun un petit lopin de terre, d'élever des animaux, de fréquenter qui bon leur semble, de vivre comme des rentiers…
Ce court roman est d'une saisissante dramaturgie. Assez vite le lecteur pressent le danger qui guette George et Lennie et aimerait voir les deux amis quitter au plus vite ce nouvel employeur au fils bagarreur et à la bru trop aguichante.
Lorsqu'il publie “Des souris et des hommes” en 1937, à seulement 35 ans, John Steinbeck est sans doute loin d'imaginer marquer de son empreinte l'histoire de la littérature. Quatre vingts ans plus tard les lecteurs continuent de plébisciter ce roman de l'amitié et de l'altérité dont la concision tutoie la perfection.
La Grande Dépression a jeté sur les routes quantité de pauvre hères qui, le baluchon sur l'épaule, sillonnent la campagne en quête de travail.
George et Lennie sont de ceux-là. Ils viennent d'être embauchés dans un ranch situé au sud de la petite ville de Soledad, entre San Francisco et Los Angeles.
Encore jeunes, ils forment un bien curieux tandem : George est futé mais paraît assez frêle alors que Lennie est simplet mais d'un gabarit impressionnant. Une amitié indéfectible unit ces deux êtres d'allure et de tempérament si dissemblables. Chaque jour ils entretiennent le rêve de posséder en commun un petit lopin de terre, d'élever des animaux, de fréquenter qui bon leur semble, de vivre comme des rentiers…
Ce court roman est d'une saisissante dramaturgie. Assez vite le lecteur pressent le danger qui guette George et Lennie et aimerait voir les deux amis quitter au plus vite ce nouvel employeur au fils bagarreur et à la bru trop aguichante.
Lorsqu'il publie “Des souris et des hommes” en 1937, à seulement 35 ans, John Steinbeck est sans doute loin d'imaginer marquer de son empreinte l'histoire de la littérature. Quatre vingts ans plus tard les lecteurs continuent de plébisciter ce roman de l'amitié et de l'altérité dont la concision tutoie la perfection.
Il y a d'abord le sentiment d'échec, la culpabilité, le regard sur ce qu'on a perdu, puis le départ. Départ vers une autre vie, une vie meilleure, la promesse d'un eldorado. On se retourne alors une dernière fois vers la terre qui nous a vus naître. le voyage interminable, les premiers morts, la faim, le froid… Mais on y croit toujours parce qu'on a vu les tracts qui promettaient un travail avec un bon salaire. Même si une petite voix nous dit que ce n'est pas normal tous ces gens qui partent dans la même direction. Chacun avec ses rêves dans la tête, tient bon. Puis l'arrivée, la descente aux enfers, la faim, le froid. Pas de maison, peu de travail et le salaire qui ne permet pas de manger à sa faim. Des morts, encore des morts. La cruelle vision des gens du nouveau pays qui ne nous acceptent pas mais qui ont besoin de nous pour le travail. L'inacceptable réalité et l'impossible retour. Alors notre mère qui a toujours tout accepté sans broncher va devenir la citadelle de la famille motivant les uns, câlinant les autres. Mais rien n'y fait, la misère est à nos portes, la désillusion, encore la mort… L'acceptation puis la colère.
Un récit bouleversant mais terriblement réaliste. Une prose sublime sur la crise de 1929 aux Etats- Unis qui me rappelle insidieusement la crise de notre monde moderne. Une chose n'a pas changée, les banques ont toujours le pouvoir ! Un roman à lire ou à relire, c'est grandiose. A prescrire à tous les intolérants de la Terre.
Un récit bouleversant mais terriblement réaliste. Une prose sublime sur la crise de 1929 aux Etats- Unis qui me rappelle insidieusement la crise de notre monde moderne. Une chose n'a pas changée, les banques ont toujours le pouvoir ! Un roman à lire ou à relire, c'est grandiose. A prescrire à tous les intolérants de la Terre.
La littérature de John Steinbeck fut qualifiée de « literature of social commitment », à juste titre. En plus du réalisme, il y a le grotesque aussi, mais pas ironique. C'est impressionnant à quel point le romancier maîtrise le langage de tous les jours.
L'une des questions soulevées par le livre concerne la société précisément : est-elle dominée par la peur ? Quoi qu'il en soit, elle est hostile à Lennie et le message semble assez clair et très pessimiste : les rêves ne se réalisent jamais. Il n'en demeure pas moins qu'une certaine forme de fraternité peut exister, comme celle entre George et Lennie, et avec Slim, sorte de leader incontesté de la communauté des fermiers.
Enfin, un dernier mot sur le thème de l'innocence : Lennie a l'innocence et la naïveté d'un enfant, qui le conduisent au meurtre. Une autre question se pose donc : l'innocence existe-elle ?
Magistral, à lire sans plus attendre !
L'une des questions soulevées par le livre concerne la société précisément : est-elle dominée par la peur ? Quoi qu'il en soit, elle est hostile à Lennie et le message semble assez clair et très pessimiste : les rêves ne se réalisent jamais. Il n'en demeure pas moins qu'une certaine forme de fraternité peut exister, comme celle entre George et Lennie, et avec Slim, sorte de leader incontesté de la communauté des fermiers.
Enfin, un dernier mot sur le thème de l'innocence : Lennie a l'innocence et la naïveté d'un enfant, qui le conduisent au meurtre. Une autre question se pose donc : l'innocence existe-elle ?
Magistral, à lire sans plus attendre !
John Steinbeck est un affreux petit magicien auquel je vous déconseille de vous frotter jamais. En effet, il est bien capable de vous envoûter, l'animal, et vous n'en sortiriez plus, jusqu'à la fin des temps. Car il est comme ça, John Steinbeck, soyez-en sûrs, et l'on ne se méfie jamais suffisamment des enchanteurs de grands chemins de la littérature tels que lui.
En ce qui me concerne, à chaque fois que revient l'été et qu'un soleil étouffant m'accable (j'ai encore un peu de temps pour cette année), que je me traîne telle une limace exsangue avec pour seule idée fixe l'envie de me vautrer et de siroter quelque boisson, je repense invariablement à Tortilla Flat.
Mais faire la critique de Tortilla Flat est pour moi un exercice périlleux. Premièrement parce que je n'ai pas relu le livre récemment, et ce n'est que par l'entremise des « petites mains » ou logiciels de Babelio qui ont eu le désir et le loisir de supprimer ma critique au cours du dernier mois que je me retrouve à devoir la réécrire aujourd'hui avec pour seul matériau, des souvenirs flétris et des couleurs passées.
Alors certes, le livre est encore bien présent à mon esprit, mais je ne viens pas de le reposer donc, mon cerveau peut vraisemblablement en altérer certains traits et en sur-exprimer beaucoup d'autres. Vous me pardonnerez peut-être et remercierez les bons offices de Babelio pour moi.
Deuxièmement, Steinbeck est probablement l'un des auteurs, pour ne pas dire L'Auteur que je préfère, donc, pas facile, facile d'avoir l'air objective, n'est-ce pas ? Troisièmement, Tortilla flat est, de par son sujet et de par son traitement, très différent, ce me semble, du style « ordinaire » de l'auteur.
À la lecture de certains commentaires, je comprends mieux l'indignation de John Steinbeck et sa décision de ne jamais plus écrire sur les Paisanos de Monterey. Ses contemporains ont interprété son livre dans les années 1930 comme une moquerie en règle, voire, une certaine forme de mépris pour ces habitants dont le sang est à forte proportion amérindio-mexicaine et pour lesquels il nourrissait une réelle sympathie.
En effet, c'est avec beaucoup de tendresse et une bonne dose d'humour que Steinbeck dépeint ces drôles de drilles et certainement pas pour s'en moquer, un peu à la manière d'un Pagnol qui se fout gentiment des Marseillais mais qui nourrit un profond respect et un amour vrai de leur âme.
Pour être franche, je n'ai réellement compris ce que John Steinbeck avait voulu exprimer dans Tortilla flat que lorsque j'ai moi-même côtoyé des Amérindiens pendant une année. À la première lecture, j'en étais restée au cocasse, au côté décalé de ces gais lurons, dont l'essentiel du raisonnement tourne toujours plus ou moins autour d'un gallon de pinard.
Mais en vivant auprès des peuples amérindiens, à voir, en chair et en os, des gens qui sont tout sauf adaptés au système dominant, qui sont heureux quand ils peuvent se retrouver entre copains et se mettre une bonne cuite, qui n'ont aucune espèce de notion de ce que ça peut être que la rentabilité, l'intérêt, la prévoyance, les réserves, un travail fixe ou encore la ponctualité, mais qui jouissent, en revanche de nous, d'une forme d'insouciance continuelle, d'une joie de vivre dans le dénuement et d'une confraternité très enviable, j'ai vu plus clair dans le message de Steinbeck.
(Bien que, vous l'imaginez sans peine, même parmi de telles gens peuvent toujours se faire jour des querelles — d'ailleurs souvent pour les motifs les plus incompréhensibles de ce côté-ci de l'Atlantique.) Eh bien là, d'un coup, mes souvenirs de Tortilla flat ont refait surface, et je me suis dit : « Comme c'est juste ; comme il a su trouver la bonne façon d'en parler, avec humour, avec certains traits un peu caricaturés, mais dans l'ensemble si réalistes. »
Du coup, j'ai également compris ce choix de narration, si empreinte d'une certaine naïveté. Cela colle si bien au tempérament des Paisanos qu'un autre mode d'énonciation eût été moins bien approprié.
Il ne faut surtout pas chercher une histoire ou une morale à ce livre. Dites-vous simplement que l'auteur va vous parler de gens, qui, dans l'ensemble, ne réfléchissent pas comme vous et moi, qui considèrent qu'ils ont sauvé leur journée quand ils ont réussi à se gonfler la panse de victuailles (c'est bien), et de vin (c'est mieux).
Si par revers de fortune il n'y a que du vin, ils ne vont pas en faire une maladie, par contre, s'il n'y a ni victuailles ni vin, ils vont s'ingénier, faire fonctionner leurs bras, voire même leur cerveau pour combler cette lacune.
C'est une vie sans calcul, d'aucune sorte. Donc, lorsque le hasard d'un héritage fait de Danny un propriétaire, c'est tellement loin des préoccupations ordinaires du groupe de copains, c'est une telle révolution de leurs habitudes qu'on comprend que l'ordre ne reviendra qu'à partir du moment où Danny aura tout perdu et qu'il pourra retourner à ses rigolades et pochetronneries quotidiennes avec ses potes.
Pour illustrer cet état d'esprit, je vais prendre un exemple que j'ai réellement vécu avec des Amérindiens. Lorsqu'on vous donne par exemple rendez-vous « demain », cela peut signifier « dans une heure », « ce soir », « dans une semaine », « dans un mois », « jamais de la vie, tu peux toujours courir » voire, très, très, très exceptionnellement, « demain ».
Eh bien les Paisanos de Monterey c'est ça, c'est exactement ça ! L'esprit du quartier nommé " Tortilla Flat ", c'est ça ! Des gens qui n'ont pas du tout la même vision de la vie que la nôtre, cette vie que nous subissons plus que nous ne la vivons, où l'on déprime dès qu'on perd son emploi, où l'on a la bougeotte dès qu'on est trois jours sans aller travailler, où l'on court toute la journée (d'ailleurs pour pas grand-chose, bien souvent).
Bref, voilà ce que je peux vous dire de ce livre, c'est drôle et pathétique à la fois, c'est presque un témoignage ethnographique urbain sur une communauté et un quartier qui a dû bien changer à présent. C'est un drôle de document sur une façon de vivre probablement disparue de nos jours à Monterey, mais qui a existé du temps de Steinbeck, il n'y a pas de raison d'en douter, et que l'on peut encore rencontrer en voyage, deci-delà, auprès de populations, pas du tout « dans le système » et qui doivent bien rigoler à nous voir courir tout le temps. du moins c'est mon avis tortillé et plat, c'est-à-dire, pas grand-chose.
En ce qui me concerne, à chaque fois que revient l'été et qu'un soleil étouffant m'accable (j'ai encore un peu de temps pour cette année), que je me traîne telle une limace exsangue avec pour seule idée fixe l'envie de me vautrer et de siroter quelque boisson, je repense invariablement à Tortilla Flat.
Mais faire la critique de Tortilla Flat est pour moi un exercice périlleux. Premièrement parce que je n'ai pas relu le livre récemment, et ce n'est que par l'entremise des « petites mains » ou logiciels de Babelio qui ont eu le désir et le loisir de supprimer ma critique au cours du dernier mois que je me retrouve à devoir la réécrire aujourd'hui avec pour seul matériau, des souvenirs flétris et des couleurs passées.
Alors certes, le livre est encore bien présent à mon esprit, mais je ne viens pas de le reposer donc, mon cerveau peut vraisemblablement en altérer certains traits et en sur-exprimer beaucoup d'autres. Vous me pardonnerez peut-être et remercierez les bons offices de Babelio pour moi.
Deuxièmement, Steinbeck est probablement l'un des auteurs, pour ne pas dire L'Auteur que je préfère, donc, pas facile, facile d'avoir l'air objective, n'est-ce pas ? Troisièmement, Tortilla flat est, de par son sujet et de par son traitement, très différent, ce me semble, du style « ordinaire » de l'auteur.
À la lecture de certains commentaires, je comprends mieux l'indignation de John Steinbeck et sa décision de ne jamais plus écrire sur les Paisanos de Monterey. Ses contemporains ont interprété son livre dans les années 1930 comme une moquerie en règle, voire, une certaine forme de mépris pour ces habitants dont le sang est à forte proportion amérindio-mexicaine et pour lesquels il nourrissait une réelle sympathie.
En effet, c'est avec beaucoup de tendresse et une bonne dose d'humour que Steinbeck dépeint ces drôles de drilles et certainement pas pour s'en moquer, un peu à la manière d'un Pagnol qui se fout gentiment des Marseillais mais qui nourrit un profond respect et un amour vrai de leur âme.
Pour être franche, je n'ai réellement compris ce que John Steinbeck avait voulu exprimer dans Tortilla flat que lorsque j'ai moi-même côtoyé des Amérindiens pendant une année. À la première lecture, j'en étais restée au cocasse, au côté décalé de ces gais lurons, dont l'essentiel du raisonnement tourne toujours plus ou moins autour d'un gallon de pinard.
Mais en vivant auprès des peuples amérindiens, à voir, en chair et en os, des gens qui sont tout sauf adaptés au système dominant, qui sont heureux quand ils peuvent se retrouver entre copains et se mettre une bonne cuite, qui n'ont aucune espèce de notion de ce que ça peut être que la rentabilité, l'intérêt, la prévoyance, les réserves, un travail fixe ou encore la ponctualité, mais qui jouissent, en revanche de nous, d'une forme d'insouciance continuelle, d'une joie de vivre dans le dénuement et d'une confraternité très enviable, j'ai vu plus clair dans le message de Steinbeck.
(Bien que, vous l'imaginez sans peine, même parmi de telles gens peuvent toujours se faire jour des querelles — d'ailleurs souvent pour les motifs les plus incompréhensibles de ce côté-ci de l'Atlantique.) Eh bien là, d'un coup, mes souvenirs de Tortilla flat ont refait surface, et je me suis dit : « Comme c'est juste ; comme il a su trouver la bonne façon d'en parler, avec humour, avec certains traits un peu caricaturés, mais dans l'ensemble si réalistes. »
Du coup, j'ai également compris ce choix de narration, si empreinte d'une certaine naïveté. Cela colle si bien au tempérament des Paisanos qu'un autre mode d'énonciation eût été moins bien approprié.
Il ne faut surtout pas chercher une histoire ou une morale à ce livre. Dites-vous simplement que l'auteur va vous parler de gens, qui, dans l'ensemble, ne réfléchissent pas comme vous et moi, qui considèrent qu'ils ont sauvé leur journée quand ils ont réussi à se gonfler la panse de victuailles (c'est bien), et de vin (c'est mieux).
Si par revers de fortune il n'y a que du vin, ils ne vont pas en faire une maladie, par contre, s'il n'y a ni victuailles ni vin, ils vont s'ingénier, faire fonctionner leurs bras, voire même leur cerveau pour combler cette lacune.
C'est une vie sans calcul, d'aucune sorte. Donc, lorsque le hasard d'un héritage fait de Danny un propriétaire, c'est tellement loin des préoccupations ordinaires du groupe de copains, c'est une telle révolution de leurs habitudes qu'on comprend que l'ordre ne reviendra qu'à partir du moment où Danny aura tout perdu et qu'il pourra retourner à ses rigolades et pochetronneries quotidiennes avec ses potes.
Pour illustrer cet état d'esprit, je vais prendre un exemple que j'ai réellement vécu avec des Amérindiens. Lorsqu'on vous donne par exemple rendez-vous « demain », cela peut signifier « dans une heure », « ce soir », « dans une semaine », « dans un mois », « jamais de la vie, tu peux toujours courir » voire, très, très, très exceptionnellement, « demain ».
Eh bien les Paisanos de Monterey c'est ça, c'est exactement ça ! L'esprit du quartier nommé " Tortilla Flat ", c'est ça ! Des gens qui n'ont pas du tout la même vision de la vie que la nôtre, cette vie que nous subissons plus que nous ne la vivons, où l'on déprime dès qu'on perd son emploi, où l'on a la bougeotte dès qu'on est trois jours sans aller travailler, où l'on court toute la journée (d'ailleurs pour pas grand-chose, bien souvent).
Bref, voilà ce que je peux vous dire de ce livre, c'est drôle et pathétique à la fois, c'est presque un témoignage ethnographique urbain sur une communauté et un quartier qui a dû bien changer à présent. C'est un drôle de document sur une façon de vivre probablement disparue de nos jours à Monterey, mais qui a existé du temps de Steinbeck, il n'y a pas de raison d'en douter, et que l'on peut encore rencontrer en voyage, deci-delà, auprès de populations, pas du tout « dans le système » et qui doivent bien rigoler à nous voir courir tout le temps. du moins c'est mon avis tortillé et plat, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Doc est enfin de retour à Monterey, deux ans après avoir été démobilisé, mais la petite ville a bien changée après la guerre.
Le chômage s'est installé rue de la Sardine avec la fermeture des usines de conserverie suite à une pêche trop intensive des poissons due à l'effort de guerre.
Certains habitants sont morts, d'autres sont partis tel Lee Chong l'épicier qui vendit son magasin pour s'acheter un bateau et enfin réaliser son rêve ; voir des palmiers, rencontrer des Polynésiennes, tout en sillonnant les mers du Sud et en faisant du commerce.
A-t-il réussi ?
Il y a aussi Fauna, une forte personnalité, qui a repris l'Ours, une maison de tolérance, après le décès de sa soeur Dora.
Quand elle apprend l'arrivée de Doc la petite communauté est toute à la joie de le revoir, car sans lui la vie n'est plus aussi légère, mais elle déchante vite quand elle s'aperçoit qu'il n'est plus le même.
Boire un verre de bière glacé, parler avec un ami, ne lui procurent plus le même plaisir et même ses recherches menées dans son laboratoire sur les céphalopodes ne l'intéressent plus guère.
Il se sent vide et triste.
John Steinbeck nous raconte avec chaleur, humour et tendresse la vie de la rue de la Sardine peuplée de personnages attachants, un peu en dehors de la société mais solidaires, qui complotent avec l'aide de Fauna, pour retrouver le Doc qu'ils aiment "celui d'avant la guerre".
Oui mais est-ce aussi désintéressé ? car avec un Doc malheureux qui donc aller voir quand on a des ennuis ?
Du moins c'est ce que j'ai ressenti.
Peut-être un roman mineur dans l'oeuvre de Steinbeck mais j'éprouve toujours autant de plaisir en compagnie de son écriture.
Le chômage s'est installé rue de la Sardine avec la fermeture des usines de conserverie suite à une pêche trop intensive des poissons due à l'effort de guerre.
Certains habitants sont morts, d'autres sont partis tel Lee Chong l'épicier qui vendit son magasin pour s'acheter un bateau et enfin réaliser son rêve ; voir des palmiers, rencontrer des Polynésiennes, tout en sillonnant les mers du Sud et en faisant du commerce.
A-t-il réussi ?
Il y a aussi Fauna, une forte personnalité, qui a repris l'Ours, une maison de tolérance, après le décès de sa soeur Dora.
Quand elle apprend l'arrivée de Doc la petite communauté est toute à la joie de le revoir, car sans lui la vie n'est plus aussi légère, mais elle déchante vite quand elle s'aperçoit qu'il n'est plus le même.
Boire un verre de bière glacé, parler avec un ami, ne lui procurent plus le même plaisir et même ses recherches menées dans son laboratoire sur les céphalopodes ne l'intéressent plus guère.
Il se sent vide et triste.
John Steinbeck nous raconte avec chaleur, humour et tendresse la vie de la rue de la Sardine peuplée de personnages attachants, un peu en dehors de la société mais solidaires, qui complotent avec l'aide de Fauna, pour retrouver le Doc qu'ils aiment "celui d'avant la guerre".
Oui mais est-ce aussi désintéressé ? car avec un Doc malheureux qui donc aller voir quand on a des ennuis ?
Du moins c'est ce que j'ai ressenti.
Peut-être un roman mineur dans l'oeuvre de Steinbeck mais j'éprouve toujours autant de plaisir en compagnie de son écriture.
Éden, Dean, dong... Lire À l'est d'Éden et mourir...
Et bing ! Encore un chef-d'oeuvre signé Steinbeck. Pour ceux qui auraient vu le vieux film d'Elia Kazan avec James Dean, l'incipit du commentaire fera sens car vous savez que le grand James est mort peu de temps après. Sachez simplement que le livre comporte 4 parties et que le film ne traite que de la dernière. Ce n'est donc pas peu dire que le film, tout honnête qu'il puisse être, n'est qu'un très pâle reflet du livre.
Pour les amoureux de Steinbeck, sachez aussi que ce livre est partiellement autobiographique car les Hamilton ont réellement existé, Sam Hamilton étant le grand père maternel de l'auteur et tous les noms donnés dans cette famille sont réels. La scène du baptême de l'air, par exemple, concerne la mère de John Steinbeck.
Que dire de ce livre? le sujet semble en être le bien et le mal, mais dit comme cela, ça ne donne pas trop envie, il faut bien évidemment imaginer toute la subtilité de l'auteur, sa propre absence de manichéisme (pensez par exemple à "En un combat douteux"), la dentelle dans laquelle il travaille la profondeur de ses personnages, la caricature à but allégorique comme dans "La perle". Ici tout y est.
On suit donc tout d'abord le destin d'Adam Trask, fruit du premier mariage du rude Cyrus Trask, et de son frère puiné Charles D une seconde épouse. Les deux frères, si différents sont tels le yin et le yang. Adam semble aussi chétif et rêveur que Charles apparaît robuste et prosaïque.
Puis cheminant dans le destin et dans le temps, Adam Trask va se trouver une femme et suffisamment se brouiller avec Charles pour décider de migrer en Californie afin de se séparer de son frère. D'où le titre du livre qui est un clin d'oeil à la bible : "Caïn se retira de devant l'Éternel, et séjourna dans le pays de Nôd, à l'est d'Éden." L'épouse d'Adam, Kate, s'avère être passablement handicapée de toute sorte de commisération ou d'empathie pour son prochain. Pour faire simple on peut la qualifier, au bas mot, d'impitoyable.
Celle-ci va donner naissance à des jumeaux, Aaron et Caleb, aussi dissemblables que pouvaient l'être Adam et Charles. Je ne vous en dit pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture.
Sachez encore que tout au long du livre, l'auteur alterne des événements de la famille Trask avec ceux de la famille Hamilton jusqu'à ce que les deux principaux pivots de ces deux familles, Samuel Hamilton et Adam Trask interagissent entre eux. Les personnages secondaires, Sam Hamilton et surtout le chinois Lee sont particulièrement intéressants. Alors n'hésitez plus, lisez, délectez-vous et faites passer le message car la portée philosophique et parabolique de l'ouvrage valent vraiment le détour, du moins c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Et bing ! Encore un chef-d'oeuvre signé Steinbeck. Pour ceux qui auraient vu le vieux film d'Elia Kazan avec James Dean, l'incipit du commentaire fera sens car vous savez que le grand James est mort peu de temps après. Sachez simplement que le livre comporte 4 parties et que le film ne traite que de la dernière. Ce n'est donc pas peu dire que le film, tout honnête qu'il puisse être, n'est qu'un très pâle reflet du livre.
Pour les amoureux de Steinbeck, sachez aussi que ce livre est partiellement autobiographique car les Hamilton ont réellement existé, Sam Hamilton étant le grand père maternel de l'auteur et tous les noms donnés dans cette famille sont réels. La scène du baptême de l'air, par exemple, concerne la mère de John Steinbeck.
Que dire de ce livre? le sujet semble en être le bien et le mal, mais dit comme cela, ça ne donne pas trop envie, il faut bien évidemment imaginer toute la subtilité de l'auteur, sa propre absence de manichéisme (pensez par exemple à "En un combat douteux"), la dentelle dans laquelle il travaille la profondeur de ses personnages, la caricature à but allégorique comme dans "La perle". Ici tout y est.
On suit donc tout d'abord le destin d'Adam Trask, fruit du premier mariage du rude Cyrus Trask, et de son frère puiné Charles D une seconde épouse. Les deux frères, si différents sont tels le yin et le yang. Adam semble aussi chétif et rêveur que Charles apparaît robuste et prosaïque.
Puis cheminant dans le destin et dans le temps, Adam Trask va se trouver une femme et suffisamment se brouiller avec Charles pour décider de migrer en Californie afin de se séparer de son frère. D'où le titre du livre qui est un clin d'oeil à la bible : "Caïn se retira de devant l'Éternel, et séjourna dans le pays de Nôd, à l'est d'Éden." L'épouse d'Adam, Kate, s'avère être passablement handicapée de toute sorte de commisération ou d'empathie pour son prochain. Pour faire simple on peut la qualifier, au bas mot, d'impitoyable.
Celle-ci va donner naissance à des jumeaux, Aaron et Caleb, aussi dissemblables que pouvaient l'être Adam et Charles. Je ne vous en dit pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture.
Sachez encore que tout au long du livre, l'auteur alterne des événements de la famille Trask avec ceux de la famille Hamilton jusqu'à ce que les deux principaux pivots de ces deux familles, Samuel Hamilton et Adam Trask interagissent entre eux. Les personnages secondaires, Sam Hamilton et surtout le chinois Lee sont particulièrement intéressants. Alors n'hésitez plus, lisez, délectez-vous et faites passer le message car la portée philosophique et parabolique de l'ouvrage valent vraiment le détour, du moins c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Une lecture d'une intensité dramatique extraordinaire !
Je comprends en refermant ce livre les qualificatifs de chef d'oeuvre ou encore de monument de la littérature Américaine associés à cette oeuvre.
Ce roman a pour cadre la "Grande Dépression" des années 1930 aux États-Unis.
La famille Joad, métayers depuis plusieurs générations, se voit expulsée de sa ferme et se retrouve sans ressources.
Convaincus comme des dizaines de milliers d'entre eux qu'il est possible de refaire leur vie en Californie, les Joad vendent leurs maigres biens et quittent l'Oklahoma pour un long périple vers l'Eldorado dont ils rêvent.
La structure, la construction de ce roman est brillante en ce sens qu'un chapitre sur deux est documentaire et nous instruit chronologiquement de la situation économique et sociétale de l'époque.
Et dans un chapitre sur deux, nous suivons parallèlement la progression déterminée des Joad vers la Californie qui synthétise tous leurs espoirs, vaillants et durs au mal comme ils le sont, trouver du travail et refaire leur vie est une simple évidence.
Ce qui rend ce récit si poignant c'est qu'il s'agit d'une histoire qui a été vécue par une multitude d'Américains, c'était il y a 90 ans et c'était hier ou presque et surtout c'est vraiment arrivé.
Ce qui donne une telle force à ce roman c'est que l'on sait inconsciemment, dans ses tripes, que cela pourrait se reproduire tant les causes de cette misère sont toujours à l'oeuvre un peu partout dans le monde qui est le nôtre.
Ce qui sidère le lecteur, c'est l'implacable logique de cet engrenage qui broie l'humain et fait voler en éclats les principes les plus essentiels, notamment ici dans un pays qui "a de la religion", un paradoxe qui ne manque jamais de m'interpeler régulièrement car il semble que les leçons de l'histoire ne soient pas retenues ici comme ailleurs.
Ce qui est évident, c'est que ce récit nous instruit sur les méfaits du capitalisme et du profit à tout prix plus que n'importe quel documentaire ou étude car ce drame nous touche au plus profond.
Le ton est tellement juste, les émotions retranscrites tellement vraies, que j'ai vécu cette lecture avec beaucoup d'intensité, bien qu'écrit en 1939, le style est toujours d'actualité, puissant et sobre.
Pour conclure je dirais qu'il s'agit d'un classique que je suis heureux d'avoir lu !
Je comprends en refermant ce livre les qualificatifs de chef d'oeuvre ou encore de monument de la littérature Américaine associés à cette oeuvre.
Ce roman a pour cadre la "Grande Dépression" des années 1930 aux États-Unis.
La famille Joad, métayers depuis plusieurs générations, se voit expulsée de sa ferme et se retrouve sans ressources.
Convaincus comme des dizaines de milliers d'entre eux qu'il est possible de refaire leur vie en Californie, les Joad vendent leurs maigres biens et quittent l'Oklahoma pour un long périple vers l'Eldorado dont ils rêvent.
La structure, la construction de ce roman est brillante en ce sens qu'un chapitre sur deux est documentaire et nous instruit chronologiquement de la situation économique et sociétale de l'époque.
Et dans un chapitre sur deux, nous suivons parallèlement la progression déterminée des Joad vers la Californie qui synthétise tous leurs espoirs, vaillants et durs au mal comme ils le sont, trouver du travail et refaire leur vie est une simple évidence.
Ce qui rend ce récit si poignant c'est qu'il s'agit d'une histoire qui a été vécue par une multitude d'Américains, c'était il y a 90 ans et c'était hier ou presque et surtout c'est vraiment arrivé.
Ce qui donne une telle force à ce roman c'est que l'on sait inconsciemment, dans ses tripes, que cela pourrait se reproduire tant les causes de cette misère sont toujours à l'oeuvre un peu partout dans le monde qui est le nôtre.
Ce qui sidère le lecteur, c'est l'implacable logique de cet engrenage qui broie l'humain et fait voler en éclats les principes les plus essentiels, notamment ici dans un pays qui "a de la religion", un paradoxe qui ne manque jamais de m'interpeler régulièrement car il semble que les leçons de l'histoire ne soient pas retenues ici comme ailleurs.
Ce qui est évident, c'est que ce récit nous instruit sur les méfaits du capitalisme et du profit à tout prix plus que n'importe quel documentaire ou étude car ce drame nous touche au plus profond.
Le ton est tellement juste, les émotions retranscrites tellement vraies, que j'ai vécu cette lecture avec beaucoup d'intensité, bien qu'écrit en 1939, le style est toujours d'actualité, puissant et sobre.
Pour conclure je dirais qu'il s'agit d'un classique que je suis heureux d'avoir lu !
Steinbeck a dit qu’il ne méritait pas le prix Nobel de littérature qui lui a été attribué en 1962. Dans ce cas, à mon avis, beaucoup ne l’ont sans doute pas mérité. Quand bien même il n’aurait écrit que ce chef d’œuvre, il ferait partie des plus grands.
En tout cas ce titre est allé étoffer ma liste de livres pour une ile déserte ; celle ci changera sans doute au fil du temps mais il ne sera pas parmi les premiers à devoir céder sa place.
Dès les premières lignes, j’ai été époustouflée par la qualité de la prose de Steinbeck. J’avais lu il y a très longtemps Des souris et des hommes mais je n’ai pas souvenir qu’il m’avait autant remué. Moindre maturité sans doute.
La description de la terre, des cultures en train de mourir, le discours des agents de la banque et des propriétaires pour chasser les métayers. Comme celle des vendeurs de voitures d’occasion, des propriétaires de Californie, tout est vraiment très fort. L’évocation de toutes les difficultés auxquelles
les Okies doivent faire face, et qui n’en sont pas vraiment à leurs yeux puisque de toute façon ils ne peuvent faire autre chose qu’aller droit devant, est si réaliste, qu’on ressent la fatigue, la poussière, la volonté tendue jusqu’à la dureté.
Le drame des fermiers chassés de leurs fermes par le Dust Bowl et le rachat de leurs terres par les banques est vu à la fois à travers la famille Joad et quelques personnages qui partagent leurs destins quelques jours ou quelques semaines, mais aussi par la masse de tous les migrants, dans des chapitres où sans personnaliser les dialogues, Steinbeck fait revivre les scènes que tous ont connu face aux commerçants, aux propriétaires.
Tous ces pauvres savent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes : « Le seul genre de gouvernement qu’on ait qui s’appuie sur nous, c’est la marge de bénéfices. »
Le personnage de Man, cette femme forte, autour de laquelle la famille gravite comme les planètes autour de leur soleil, même si ce sont les hommes qui dirigent, au moins en principe, est particulièrement remarquable. Elle est avec l’un de ses fils, Tom, la charpente de la famille, les deux seuls à s’effacer toujours devant les besoins du groupe.
J’ai été à de nombreuses reprises frappée par la modernité du propos ou son intemporanéïté. C’était en Amérique du Nord dans la décennie 1930, mais cela aurait pu se passer n’importe où, n’importe quand. Quelques transpositions et le propos reste juste et d’actualité.
Une notion qui revient souvent c’est le changement que constituent pour les hommes de ne plus travailler eux-mêmes la terre, de ne plus la toucher que ce soit dans les grandes plaines où les tracteurs retournent la terre ou en Californie où les fermiers sont devenus des commerçants, qui ne la travaillent pas eux-mêmes et parfois ne la connaissent pas. Je ne connais pas le reste de l’œuvre de Steinbeck et je ne sais pas comment cela s’articule avec d’autres opinions, mais j’ai fort envie de le savoir.
Voilà un avis que je donne très rarement, c’est peut-être même la première fois, mais si vous ne l’avez jamais lu, courez chez votre libraire ou à défaut à la bibli la plus proche. Pour ma part, je suis allée me procurer un autre Steinbeck, et ce ne sera pas le dernier.
En tout cas ce titre est allé étoffer ma liste de livres pour une ile déserte ; celle ci changera sans doute au fil du temps mais il ne sera pas parmi les premiers à devoir céder sa place.
Dès les premières lignes, j’ai été époustouflée par la qualité de la prose de Steinbeck. J’avais lu il y a très longtemps Des souris et des hommes mais je n’ai pas souvenir qu’il m’avait autant remué. Moindre maturité sans doute.
La description de la terre, des cultures en train de mourir, le discours des agents de la banque et des propriétaires pour chasser les métayers. Comme celle des vendeurs de voitures d’occasion, des propriétaires de Californie, tout est vraiment très fort. L’évocation de toutes les difficultés auxquelles
les Okies doivent faire face, et qui n’en sont pas vraiment à leurs yeux puisque de toute façon ils ne peuvent faire autre chose qu’aller droit devant, est si réaliste, qu’on ressent la fatigue, la poussière, la volonté tendue jusqu’à la dureté.
Le drame des fermiers chassés de leurs fermes par le Dust Bowl et le rachat de leurs terres par les banques est vu à la fois à travers la famille Joad et quelques personnages qui partagent leurs destins quelques jours ou quelques semaines, mais aussi par la masse de tous les migrants, dans des chapitres où sans personnaliser les dialogues, Steinbeck fait revivre les scènes que tous ont connu face aux commerçants, aux propriétaires.
Tous ces pauvres savent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes : « Le seul genre de gouvernement qu’on ait qui s’appuie sur nous, c’est la marge de bénéfices. »
Le personnage de Man, cette femme forte, autour de laquelle la famille gravite comme les planètes autour de leur soleil, même si ce sont les hommes qui dirigent, au moins en principe, est particulièrement remarquable. Elle est avec l’un de ses fils, Tom, la charpente de la famille, les deux seuls à s’effacer toujours devant les besoins du groupe.
J’ai été à de nombreuses reprises frappée par la modernité du propos ou son intemporanéïté. C’était en Amérique du Nord dans la décennie 1930, mais cela aurait pu se passer n’importe où, n’importe quand. Quelques transpositions et le propos reste juste et d’actualité.
Une notion qui revient souvent c’est le changement que constituent pour les hommes de ne plus travailler eux-mêmes la terre, de ne plus la toucher que ce soit dans les grandes plaines où les tracteurs retournent la terre ou en Californie où les fermiers sont devenus des commerçants, qui ne la travaillent pas eux-mêmes et parfois ne la connaissent pas. Je ne connais pas le reste de l’œuvre de Steinbeck et je ne sais pas comment cela s’articule avec d’autres opinions, mais j’ai fort envie de le savoir.
Voilà un avis que je donne très rarement, c’est peut-être même la première fois, mais si vous ne l’avez jamais lu, courez chez votre libraire ou à défaut à la bibli la plus proche. Pour ma part, je suis allée me procurer un autre Steinbeck, et ce ne sera pas le dernier.
Un roman noir parmi les classiques
Mardi 19h16. Chatelet-Les Halles. Quatre pages encore à lire avant de refermer « Des souris et des hommes ». Troublé et pensif, au bord du quai en attendant le RER B, je vois surgir en contre-bas, devant moi, une souris chevauchant les rails à toute vitesse. S’agirait-il d’une coïncidence ou d’un clin d’œil de Lennie, le héros du roman de Steinbeck ? Mystère, mystère…
Comme je l’ai appris dans « L’assassin qui en moi »de Jim Thompson, la citation "Les projets les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas", extraite du poème de Robert Burns "To a Mouse" (1786), a inspiré le titre de ce roman à John Steinbeck.
Sous le titre original "Of Mice and Men", ce court roman fut publié en 1937 par le celèbre écrivain américain, suivi de son autre œuvre majeure "Les Raisins de la colère" en 1939.
Dans le roman « Des souris et des hommes », Steinbeck distille une histoire pasionnante à travers une relation d’amitié profonde et indéfectible entre deux hommes très différents : Georges Milton, petit chef et vif d’esprit, et Lennie Small, colosse légèrement attardé au visage informe et véritable force de la nature.
Partageant le même rêve de posséder un jour une petite propriété pour élever des lapins, les deux hommes vadrouillent de ferme en ferme pour économiser suffisamment pour se payer cette terre promise. Ils se baladent ainsi tranquillement à pied pour rejoindre un ranch de Californie afin de travailler comme saisonniers. Néanmoins, Lennie a la fâcheuse manie de vouloir caresser toutes les choses douces : du velours, de la soie, des souris, des chiots, … et même la peau ou les cheveux des femmes, ce qui lui a causé bien des ennuis dans son ancienne ferme.
Continuez donc la route en compagnie de nos deux amis inséparables Georges et Lennie jusqu’au ranch des Curley à Soledad pour connaitre le fin mot de l’histoire…
Dès le début du roman, j’ai découvert de fortes similitudes avec le magnifique roman de Charles Williams « La fille des collines » : une belle écriture dès qu’il s’agit de décrire les paysages et la vie animale entourant les protagonistes, des dialogues marquants pour des personnages vivant à la campagne, et enfin le plus important, l’attrait diabolique de la femme, objet et source de conflit permanent entre les hommes.
J’ai particulièrement apprécié le début plutôt lent et attendrissant entre nos deux héros et la seconde partie du roman très enlevée aboutissant au final magnifiquement écrit et émouvant.
En outre, un passage spécifique du livre a retenu mon attention ; il s’agit d’une conversation entre Lennie, Crooks, le palefrenier noir de la ferme et enfin Candy, un brave homme qui a perdu une main au travail. En quelques pages seulement, John Steinbeck réussit à symboliser l’exclusion des noirs, des handicapés et des malades mentaux à cette époque. Une mise à l’écart qui n’a pas les mêmes causes, par nature, mais qui a les mêmes effets. Un passage tout simplement magnifique digne d’un très grand auteur.
Pour conclure, il se dégage de ce roman une proximité littéraire forte avec des romans noirs comme « On achève bien les chevaux » d’Horace Mc Coy (que j’ai moins aimé mais dont l’idée originale est lumineuse) ou « La filles des collines » de Charles Williams (que j’ai adoré). Néanmoins, je constate que Steinbeck est lu par un large public et on l’affuble de roman classique alors que les autres sont considérés comme des romans noirs.
A mon humble avis, « Des souris et des hommes » dépeint aussi durement la condition humaine que dans les deux autres livres évoqués, ceci dans un format plus court. Dommage pour de nombreux lecteurs qui passent à côté d’œuvres incontournables et trop méconnues (américaines notamment).
Comme quoi, pour qu’un roman attire la lumière, il est préférable d’être noir parmi les classiques qu’être un classique parmi les noirs…
PS : je vous conseille évidemment de lire ou relire ce très court roman. Elaine Steinbeck évoquait son mari dans une lettre en parlant d'une « âme lourde mais essayant de voler ». Exactement à l’image de ce livre, une âme lourde mais essayant de voler…en direction d’un lopin de terre au milieu des lapins mangeant de la luzerne.
Mardi 19h16. Chatelet-Les Halles. Quatre pages encore à lire avant de refermer « Des souris et des hommes ». Troublé et pensif, au bord du quai en attendant le RER B, je vois surgir en contre-bas, devant moi, une souris chevauchant les rails à toute vitesse. S’agirait-il d’une coïncidence ou d’un clin d’œil de Lennie, le héros du roman de Steinbeck ? Mystère, mystère…
Comme je l’ai appris dans « L’assassin qui en moi »de Jim Thompson, la citation "Les projets les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas", extraite du poème de Robert Burns "To a Mouse" (1786), a inspiré le titre de ce roman à John Steinbeck.
Sous le titre original "Of Mice and Men", ce court roman fut publié en 1937 par le celèbre écrivain américain, suivi de son autre œuvre majeure "Les Raisins de la colère" en 1939.
Dans le roman « Des souris et des hommes », Steinbeck distille une histoire pasionnante à travers une relation d’amitié profonde et indéfectible entre deux hommes très différents : Georges Milton, petit chef et vif d’esprit, et Lennie Small, colosse légèrement attardé au visage informe et véritable force de la nature.
Partageant le même rêve de posséder un jour une petite propriété pour élever des lapins, les deux hommes vadrouillent de ferme en ferme pour économiser suffisamment pour se payer cette terre promise. Ils se baladent ainsi tranquillement à pied pour rejoindre un ranch de Californie afin de travailler comme saisonniers. Néanmoins, Lennie a la fâcheuse manie de vouloir caresser toutes les choses douces : du velours, de la soie, des souris, des chiots, … et même la peau ou les cheveux des femmes, ce qui lui a causé bien des ennuis dans son ancienne ferme.
Continuez donc la route en compagnie de nos deux amis inséparables Georges et Lennie jusqu’au ranch des Curley à Soledad pour connaitre le fin mot de l’histoire…
Dès le début du roman, j’ai découvert de fortes similitudes avec le magnifique roman de Charles Williams « La fille des collines » : une belle écriture dès qu’il s’agit de décrire les paysages et la vie animale entourant les protagonistes, des dialogues marquants pour des personnages vivant à la campagne, et enfin le plus important, l’attrait diabolique de la femme, objet et source de conflit permanent entre les hommes.
J’ai particulièrement apprécié le début plutôt lent et attendrissant entre nos deux héros et la seconde partie du roman très enlevée aboutissant au final magnifiquement écrit et émouvant.
En outre, un passage spécifique du livre a retenu mon attention ; il s’agit d’une conversation entre Lennie, Crooks, le palefrenier noir de la ferme et enfin Candy, un brave homme qui a perdu une main au travail. En quelques pages seulement, John Steinbeck réussit à symboliser l’exclusion des noirs, des handicapés et des malades mentaux à cette époque. Une mise à l’écart qui n’a pas les mêmes causes, par nature, mais qui a les mêmes effets. Un passage tout simplement magnifique digne d’un très grand auteur.
Pour conclure, il se dégage de ce roman une proximité littéraire forte avec des romans noirs comme « On achève bien les chevaux » d’Horace Mc Coy (que j’ai moins aimé mais dont l’idée originale est lumineuse) ou « La filles des collines » de Charles Williams (que j’ai adoré). Néanmoins, je constate que Steinbeck est lu par un large public et on l’affuble de roman classique alors que les autres sont considérés comme des romans noirs.
A mon humble avis, « Des souris et des hommes » dépeint aussi durement la condition humaine que dans les deux autres livres évoqués, ceci dans un format plus court. Dommage pour de nombreux lecteurs qui passent à côté d’œuvres incontournables et trop méconnues (américaines notamment).
Comme quoi, pour qu’un roman attire la lumière, il est préférable d’être noir parmi les classiques qu’être un classique parmi les noirs…
PS : je vous conseille évidemment de lire ou relire ce très court roman. Elaine Steinbeck évoquait son mari dans une lettre en parlant d'une « âme lourde mais essayant de voler ». Exactement à l’image de ce livre, une âme lourde mais essayant de voler…en direction d’un lopin de terre au milieu des lapins mangeant de la luzerne.
Pauvre John Steinbeck ! J'adore John Steinbeck : j'adore l'homme, l'écrivain, ses convictions, ses combats, lui qui était tellement engagé, tellement proche du peuple, tellement humain, tellement humaniste, tellement critique vis-à-vis des banques, des puissants et de l'absence générale de morale dans la vie moderne…
Eh bien oui, John Steinbeck, j'ai bien dit John Steinbeck s'est abaissé à pondre ceci. Alors certes, c'était une commande, certes le commanditaire de ladite commande n'était autre que le président des États-Unis en personne, à savoir Franklin D. Roosevelt, le père du New Deal, mais tout de même.
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ?! Rien moins qu'une bonne vieille propagande militaire visant à justifier la construction et l'emploi des pires machines de destruction massive jamais construites à l'époque. D'ailleurs, ce sont ces grandissimes bombardiers, dont l'auteur chante ici si bien les louanges, qui ont si brillamment et si efficacement rayé de la carte Hiroshima et Nagasaki en faisant un maximum de dégâts, de victimes civiles et d'anéantissement environnemental, trois ans seulement après la publication de ce machin.
« Bombes larguées ! » ont dû crier les membres d'équipage, ce qui, comme l'explique si bien l'auteur équivaut dans l'Air Force à dire « Mission accomplie ! ». Oui, accomplie, les p'tits gars, bien accomplie, même, les centaines de milliers de victimes vous en remercient !
John ! John ! Putain John ! Mon John à moi, mon John Des Souris et des hommes, mon John d'En un combat douteux, mon John des Raisins de la colère, mon John d'À l'est d'Eden, mon John de L'hiver de notre déplaisir, mon John de tout ce que j'avais lu de toi jusqu'à présent, pourquoi m'as-tu fait ça ????
Alors certes, certes, vers la fin de ta vie, tu t'es repenti, John. Il est même précisé en quatrième de couverture que tu as écrit sur tes vieux jours : « Nous faisions tous partie de l'effort de guerre. Nous avons marché avec lui, nous nous sommes faits ses complices. » Nul doute que ton dernier grand roman, L'Hiver de notre déplaisir, montre combien tu t'es désillusionné sur ta nation, sur tes dirigeants et sur la direction générale que prenait ton pays au début des années 1960.
Mais ce qu'il y a de terrible là-dedans, John, vois-tu, c'est que même dans cet exercice de propagande pro-boucherie, pro-destruction, pro-tuerie, tu restes l'immense écrivain que tu as toujours été. Le texte a des qualités didactiques et documentaires évidentes. Même cette grosse merde, tu la fais bien, avec coeur et talent. Tu arrives presque à nous émouvoir sur le destin et les aptitudes surprenantes de Bill, le gars qui se destine à envoyer des tonnes et des tonnes de bombes sur des êtres humains comme toi et moi. Le petit Al qui défonce si bien les cibles mobiles à la mitrailleuse, le brave Joe qui a quitté la ferme paternelle pour devenir pilote, sans oublier Allan qui est si méticuleux dans son job de navigateur, etc.
Tu arrives magistralement à convaincre la famille américaine moyenne de l'époque de laisser son fiston adoré s'engager dans l'Air Force. On sait bien qu'il a de fortes chances de n'en revenir jamais ; on sait bien que s'il en revient, il aura fait un sacré bon boulot, dont il pourra être bien fier. Il aura contribué à transformer en engrais suffisamment de chair humaine pour assurer le bonheur d'au moins quinze générations de vers de terre.
Comment as-tu pu te laisser aller à écrire ça, John ? On dirait une brochure publicitaire vantant les bienfaits — les bonheurs presque — d'une entrée en guerre ! Toi, si empathique, si humain, si lucide également sur les manoeuvres des puissants et des grandes entreprises de l'armement, comment as-tu pu te renier ainsi ? Comment as-tu pu t'émerveiller de la sorte sur ces monstrueux bombardiers ? N'en voir que les performances techniques ? N'admirer que les muscles, les réflexes, l'intuition ou l'esprit d'équipe des fantastiques opérateurs qui allaient oeuvrer dans ces machines de mort sans en mesurer les conséquences autres que : « Ce sera bien pour notre nation. »
Alors j'ai cherché, John, je te jure que j'ai bien cherché, John, et c'est un autre Américain qui m'a mise sur la voie. Ton compatriote en question, c'est le psychologue social Stanley Milgram. Celui-là même qui s'est rendu célèbre par l'expérience qui porte son nom à propos de la soumission à l'autorité. Il a montré sans contestation possible que tout un chacun pouvait devenir un bourreau, un tortionnaire, s'il en recevait l'ordre et s'il avait le sentiment, même diffus, qu'en faisant cela, il travaillait pour servir une « bonne » cause.
Stanley Milgram écrivit ceci : « La souffrance de la victime demeure abstraite et lointaine pour le sujet. Il sait, mais au niveau conceptuel seulement, qu'il inflige un traitement douloureux ; le fait est enregistré, mais non ressenti. C'est là un phénomène assez courant. L'aviateur qui lâche des bombes n'ignore sûrement pas qu'elles vont semer la souffrance et la mort, mais cette conscience est dépourvue d'affectivité et n'éveille en lui aucune réaction émotionnelle. »
Tu vois, John, il parle pour toi, là, le Stanley. Il dit que si tu as pu écrire ce machin-là, c'était parce que, consciemment ou inconsciemment, les victimes futures de tes magnifiques bombardiers seraient invariablement loin de toi et surtout frappées du sceau infâme de « l'ennemi ». Dans le cerveau des gens, il y a souvent des petites musiques de ce genre : « Il y a des victimes ? C'est vrai, mais ce sont que des ennemis, donc ça n'est pas grave. » (En ce moment, on aime bien nous faire accroire que nos armées ne butent que des terroristes, comme si « terroristes » et « gens » n'étaient pas la même marchandise, comme si, par nature, ces deux choses-là étaient remarquablement différentes.)
Imagine, John, si je m'amusais à envoyer des bombes aux gens sous prétexte que ce sont mes ennemis ! J'aurais déjà un sacré paquet de croix sur ma carlingue, car je te prie de me croire, au cours de ma vie, à dire toujours ce que je pensais, je m'en suis faits des ennemis, quinze à la douzaine, et pas plus loin que sur Babelio, il y en aurait des tas. En effet, sitôt qu'on affirme une opinion propre, non hypocrite, non consensuelle, qui ne soit pas bêtement repompée ou recrachée de je ne sais quel média dominant aux bottes des puissants ou un vulgaire lieu commun, on s'attire indéfectiblement des ennemis, et pas qu'un peu.
Mais je ne t'en veux pas, John, tu as semé sur le chemin de l'histoire littéraire des joyaux parmi les plus beaux et les plus grands qu'on puisse encore contempler. À côté de tous ces vibrants chefs-d'oeuvre, tu as fait, tu as dit, tu as écrit des conneries, comme tout le monde, et moi mieux que tout le monde. Je t'aime toujours autant, John, peut-être même plus encore qu'avant, car je sais à présent que tu n'es plus une machine à rédiger des chefs-d'oeuvre, mais un homme, au sens vrai du terme, au sens touchant du terme, un individu qui a des convictions et, de ce fait même, qui parfois se trompe et parfois lourdement. J'aime les hommes comme toi, John, et toi, en particulier, je t'aime énormément.
Pour le reste, je tiens à remercier Les Belles Lettres et Babelio pour l'envoi et la découverte de ce livre inédit en français jusqu'à présent. Désormais, je comprends un peu mieux pourquoi ce titre était resté inédit (sans vouloir offenser personne). D'ailleurs souvenez-vous bien que ce que j'exprime ici n'est que mon tout petit avis, vilain comme une bombe larguée et fort heureusement moins dangereux pour les vies humaines situées juste en-dessous, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose.
Eh bien oui, John Steinbeck, j'ai bien dit John Steinbeck s'est abaissé à pondre ceci. Alors certes, c'était une commande, certes le commanditaire de ladite commande n'était autre que le président des États-Unis en personne, à savoir Franklin D. Roosevelt, le père du New Deal, mais tout de même.
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ?! Rien moins qu'une bonne vieille propagande militaire visant à justifier la construction et l'emploi des pires machines de destruction massive jamais construites à l'époque. D'ailleurs, ce sont ces grandissimes bombardiers, dont l'auteur chante ici si bien les louanges, qui ont si brillamment et si efficacement rayé de la carte Hiroshima et Nagasaki en faisant un maximum de dégâts, de victimes civiles et d'anéantissement environnemental, trois ans seulement après la publication de ce machin.
« Bombes larguées ! » ont dû crier les membres d'équipage, ce qui, comme l'explique si bien l'auteur équivaut dans l'Air Force à dire « Mission accomplie ! ». Oui, accomplie, les p'tits gars, bien accomplie, même, les centaines de milliers de victimes vous en remercient !
John ! John ! Putain John ! Mon John à moi, mon John Des Souris et des hommes, mon John d'En un combat douteux, mon John des Raisins de la colère, mon John d'À l'est d'Eden, mon John de L'hiver de notre déplaisir, mon John de tout ce que j'avais lu de toi jusqu'à présent, pourquoi m'as-tu fait ça ????
Alors certes, certes, vers la fin de ta vie, tu t'es repenti, John. Il est même précisé en quatrième de couverture que tu as écrit sur tes vieux jours : « Nous faisions tous partie de l'effort de guerre. Nous avons marché avec lui, nous nous sommes faits ses complices. » Nul doute que ton dernier grand roman, L'Hiver de notre déplaisir, montre combien tu t'es désillusionné sur ta nation, sur tes dirigeants et sur la direction générale que prenait ton pays au début des années 1960.
Mais ce qu'il y a de terrible là-dedans, John, vois-tu, c'est que même dans cet exercice de propagande pro-boucherie, pro-destruction, pro-tuerie, tu restes l'immense écrivain que tu as toujours été. Le texte a des qualités didactiques et documentaires évidentes. Même cette grosse merde, tu la fais bien, avec coeur et talent. Tu arrives presque à nous émouvoir sur le destin et les aptitudes surprenantes de Bill, le gars qui se destine à envoyer des tonnes et des tonnes de bombes sur des êtres humains comme toi et moi. Le petit Al qui défonce si bien les cibles mobiles à la mitrailleuse, le brave Joe qui a quitté la ferme paternelle pour devenir pilote, sans oublier Allan qui est si méticuleux dans son job de navigateur, etc.
Tu arrives magistralement à convaincre la famille américaine moyenne de l'époque de laisser son fiston adoré s'engager dans l'Air Force. On sait bien qu'il a de fortes chances de n'en revenir jamais ; on sait bien que s'il en revient, il aura fait un sacré bon boulot, dont il pourra être bien fier. Il aura contribué à transformer en engrais suffisamment de chair humaine pour assurer le bonheur d'au moins quinze générations de vers de terre.
Comment as-tu pu te laisser aller à écrire ça, John ? On dirait une brochure publicitaire vantant les bienfaits — les bonheurs presque — d'une entrée en guerre ! Toi, si empathique, si humain, si lucide également sur les manoeuvres des puissants et des grandes entreprises de l'armement, comment as-tu pu te renier ainsi ? Comment as-tu pu t'émerveiller de la sorte sur ces monstrueux bombardiers ? N'en voir que les performances techniques ? N'admirer que les muscles, les réflexes, l'intuition ou l'esprit d'équipe des fantastiques opérateurs qui allaient oeuvrer dans ces machines de mort sans en mesurer les conséquences autres que : « Ce sera bien pour notre nation. »
Alors j'ai cherché, John, je te jure que j'ai bien cherché, John, et c'est un autre Américain qui m'a mise sur la voie. Ton compatriote en question, c'est le psychologue social Stanley Milgram. Celui-là même qui s'est rendu célèbre par l'expérience qui porte son nom à propos de la soumission à l'autorité. Il a montré sans contestation possible que tout un chacun pouvait devenir un bourreau, un tortionnaire, s'il en recevait l'ordre et s'il avait le sentiment, même diffus, qu'en faisant cela, il travaillait pour servir une « bonne » cause.
Stanley Milgram écrivit ceci : « La souffrance de la victime demeure abstraite et lointaine pour le sujet. Il sait, mais au niveau conceptuel seulement, qu'il inflige un traitement douloureux ; le fait est enregistré, mais non ressenti. C'est là un phénomène assez courant. L'aviateur qui lâche des bombes n'ignore sûrement pas qu'elles vont semer la souffrance et la mort, mais cette conscience est dépourvue d'affectivité et n'éveille en lui aucune réaction émotionnelle. »
Tu vois, John, il parle pour toi, là, le Stanley. Il dit que si tu as pu écrire ce machin-là, c'était parce que, consciemment ou inconsciemment, les victimes futures de tes magnifiques bombardiers seraient invariablement loin de toi et surtout frappées du sceau infâme de « l'ennemi ». Dans le cerveau des gens, il y a souvent des petites musiques de ce genre : « Il y a des victimes ? C'est vrai, mais ce sont que des ennemis, donc ça n'est pas grave. » (En ce moment, on aime bien nous faire accroire que nos armées ne butent que des terroristes, comme si « terroristes » et « gens » n'étaient pas la même marchandise, comme si, par nature, ces deux choses-là étaient remarquablement différentes.)
Imagine, John, si je m'amusais à envoyer des bombes aux gens sous prétexte que ce sont mes ennemis ! J'aurais déjà un sacré paquet de croix sur ma carlingue, car je te prie de me croire, au cours de ma vie, à dire toujours ce que je pensais, je m'en suis faits des ennemis, quinze à la douzaine, et pas plus loin que sur Babelio, il y en aurait des tas. En effet, sitôt qu'on affirme une opinion propre, non hypocrite, non consensuelle, qui ne soit pas bêtement repompée ou recrachée de je ne sais quel média dominant aux bottes des puissants ou un vulgaire lieu commun, on s'attire indéfectiblement des ennemis, et pas qu'un peu.
Mais je ne t'en veux pas, John, tu as semé sur le chemin de l'histoire littéraire des joyaux parmi les plus beaux et les plus grands qu'on puisse encore contempler. À côté de tous ces vibrants chefs-d'oeuvre, tu as fait, tu as dit, tu as écrit des conneries, comme tout le monde, et moi mieux que tout le monde. Je t'aime toujours autant, John, peut-être même plus encore qu'avant, car je sais à présent que tu n'es plus une machine à rédiger des chefs-d'oeuvre, mais un homme, au sens vrai du terme, au sens touchant du terme, un individu qui a des convictions et, de ce fait même, qui parfois se trompe et parfois lourdement. J'aime les hommes comme toi, John, et toi, en particulier, je t'aime énormément.
Pour le reste, je tiens à remercier Les Belles Lettres et Babelio pour l'envoi et la découverte de ce livre inédit en français jusqu'à présent. Désormais, je comprends un peu mieux pourquoi ce titre était resté inédit (sans vouloir offenser personne). D'ailleurs souvenez-vous bien que ce que j'exprime ici n'est que mon tout petit avis, vilain comme une bombe larguée et fort heureusement moins dangereux pour les vies humaines situées juste en-dessous, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose.
Une Saison Amère, c'est le titre imbécile de la traduction extraordinairement médiocre d'un livre pourtant sublime. Aussi comprendrez vous que mes seulement quatre étoiles se réfèrent à la piètre qualité de cette traduction car, en soi, l'oeuvre de Steinbeck en vaut, cinq, six, sept voire huit.
" Une Saison Amère ", quel titre débile ! L'original est un vers du Richard III de Shakespeare totalement effacé dans cette traduction. Mais il n'y a pas que le titre ; Anouk Neuhoff a tout gâché dans cette traduction du style de Steinbeck.
Il existe pourtant une vraie traduction de ce dernier roman de John Steinbeck mais qui ne circule plus que sur le marché de l'occasion et qui était l'oeuvre du traducteur Jean Rosenthal (le traducteur, notamment, de Ken Follett). En somme, si vous en avez l'occasion, évitez à tout prix cette traduction minable et jetez-vous sur l'autre qui s'intitule " L'Hiver de Notre Déplaisir ", qui colle parfaitement à l'original " The Winter Of Our Discontent ".
Outre ce problème de traduction, c'est un chef d'oeuvre de plus à mettre au compte de l'épicier Steinbeck, qui, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore.
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York ;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
En somme, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans cette traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année. Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison qui vient de voir finir l'hiver, car, tout bien pesé, il ne représente pas grand-chose.
" Une Saison Amère ", quel titre débile ! L'original est un vers du Richard III de Shakespeare totalement effacé dans cette traduction. Mais il n'y a pas que le titre ; Anouk Neuhoff a tout gâché dans cette traduction du style de Steinbeck.
Il existe pourtant une vraie traduction de ce dernier roman de John Steinbeck mais qui ne circule plus que sur le marché de l'occasion et qui était l'oeuvre du traducteur Jean Rosenthal (le traducteur, notamment, de Ken Follett). En somme, si vous en avez l'occasion, évitez à tout prix cette traduction minable et jetez-vous sur l'autre qui s'intitule " L'Hiver de Notre Déplaisir ", qui colle parfaitement à l'original " The Winter Of Our Discontent ".
Outre ce problème de traduction, c'est un chef d'oeuvre de plus à mettre au compte de l'épicier Steinbeck, qui, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore.
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York ;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
En somme, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans cette traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année. Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison qui vient de voir finir l'hiver, car, tout bien pesé, il ne représente pas grand-chose.
Les chemins de la littérature permettent d'accéder à des petits coins de paradis, jardins merveilleux où chacun peut croquer comme bon lui semble des moments de douce félicité. Ainsi les grands classiques, porteurs de messages intemporels, sont-ils là pour tout à la fois divertir et éclairer.
Brillerait-il “À l'est d'Eden” un soleil enchanteur, comparable à celui rencontré dernièrement dans d'autres romans de John Steinbeck ?
Au coeur de la Californie, la vallée de la Salinas est une région fertile pour peu qu'il pleuve suffisamment durant le printemps. En ce 19ème siècle finissant, la plupart des fermiers vivent correctement de leur labeur. Les Hamilton n'ont pas la chance de posséder les meilleures terres mais l'intelligence inventive de Samuel et son altruisme compensent ce handicap. Avec sa femme Liza et leurs neuf enfants, ils forment une famille au sein de laquelle il fait bon vivre.
Nouvellement installé, son voisin Adam Trask est lui aussi un homme bon. Il est loin de posséder la fibre paysanne mais l'héritage paternel l'a mis jusqu'à la fin de ses jours à l'abri du besoin. Il vient d'engager un domestique chinois, un homme plus très jeune pétri d'humanisme et de sagesse.
Avec des personnages masculins, plus avenants les uns que les autres, “À l'est d'Éden” aurait-il le profil d'un roman à l'eau de rose ? C'est sans compter sur la personnalité étrange de Cathy Trask, la ravissante épouse d'Adam enceinte de plusieurs mois. Le regard inhabité de cet être démoniaque laisse transparaître un esprit schizophrène incapable de supporter la moindre contrariété.
Magnifique allégorie du Livre de la Genèse selon lequel toute la misère du monde découle du péché originel, “À l'est d'Éden” met en exergue une lutte à mort entre le bien et le mal.
Le titre de ce chef-d'oeuvre est lui aussi d'inspiration biblique et résume à merveille le jeune parcours de vie des jumeaux du couple Trask, Caleb et Aaron, abandonnés par leur mère à leur naissance et aussi dissemblables que l'étaient naguère Caïn et Abel.
Publié en 1952 après une longue période de gestation, ce long roman est peut-être le plus abouti et le plus fascinant du grand écrivain américain. Comme souvent chez Steinbeck le happy end est particulièrement réussi : la vie continue malgré tout...
Brillerait-il “À l'est d'Eden” un soleil enchanteur, comparable à celui rencontré dernièrement dans d'autres romans de John Steinbeck ?
Au coeur de la Californie, la vallée de la Salinas est une région fertile pour peu qu'il pleuve suffisamment durant le printemps. En ce 19ème siècle finissant, la plupart des fermiers vivent correctement de leur labeur. Les Hamilton n'ont pas la chance de posséder les meilleures terres mais l'intelligence inventive de Samuel et son altruisme compensent ce handicap. Avec sa femme Liza et leurs neuf enfants, ils forment une famille au sein de laquelle il fait bon vivre.
Nouvellement installé, son voisin Adam Trask est lui aussi un homme bon. Il est loin de posséder la fibre paysanne mais l'héritage paternel l'a mis jusqu'à la fin de ses jours à l'abri du besoin. Il vient d'engager un domestique chinois, un homme plus très jeune pétri d'humanisme et de sagesse.
Avec des personnages masculins, plus avenants les uns que les autres, “À l'est d'Éden” aurait-il le profil d'un roman à l'eau de rose ? C'est sans compter sur la personnalité étrange de Cathy Trask, la ravissante épouse d'Adam enceinte de plusieurs mois. Le regard inhabité de cet être démoniaque laisse transparaître un esprit schizophrène incapable de supporter la moindre contrariété.
Magnifique allégorie du Livre de la Genèse selon lequel toute la misère du monde découle du péché originel, “À l'est d'Éden” met en exergue une lutte à mort entre le bien et le mal.
Le titre de ce chef-d'oeuvre est lui aussi d'inspiration biblique et résume à merveille le jeune parcours de vie des jumeaux du couple Trask, Caleb et Aaron, abandonnés par leur mère à leur naissance et aussi dissemblables que l'étaient naguère Caïn et Abel.
Publié en 1952 après une longue période de gestation, ce long roman est peut-être le plus abouti et le plus fascinant du grand écrivain américain. Comme souvent chez Steinbeck le happy end est particulièrement réussi : la vie continue malgré tout...
Cette histoire courte au format "nouvelle" est la porte d'entrée idéale pour découvrir John Steinbeck.
Le contexte de l'Amérique rurale, des métayers journaliers allant de ranchs en exploitations pour gagner juste de quoi survivre jusqu'au prochain boulot et entretenir l'espoir de peut-être économiser assez pour avoir son lopin de terre à soi.
Des sentiments basiques, une sensibilité à fleur de peau, une rancoeur et une violence sous jacente dans un monde où le temps semble s'être arrêté, où l'espoir d'un avenir meilleur semble s'être figé.
Un récit âpre et intense, un presque huis-clos qui prend forme en l'espace de 48 heures à peine, un drame pressenti dès les premières lignes, une spirale qui apparaît et qui va inexorablement aspirer les deux amis de toujours, Georges le petit gars débrouillard et Lennie le gentil colosse à la force phénoménale qui n'a pas fini de grandir.
Une histoire qui, je le crois n'aurait pu se dérouler qu'aux Etats-Unis et seulement dans cette période de récession qui a vu tant d'hommes se vendre à la journée pour seulement survivre et continuer d'y croire.
Une lecture au goût d'instantané, un fait divers tragique, un pied de nez du destin, dans tous les cas une histoire qui parlera à chacun selon sa sensibilité car il n'y a pas ici de morale à rechercher ni de justification à trouver.
Le contexte de l'Amérique rurale, des métayers journaliers allant de ranchs en exploitations pour gagner juste de quoi survivre jusqu'au prochain boulot et entretenir l'espoir de peut-être économiser assez pour avoir son lopin de terre à soi.
Des sentiments basiques, une sensibilité à fleur de peau, une rancoeur et une violence sous jacente dans un monde où le temps semble s'être arrêté, où l'espoir d'un avenir meilleur semble s'être figé.
Un récit âpre et intense, un presque huis-clos qui prend forme en l'espace de 48 heures à peine, un drame pressenti dès les premières lignes, une spirale qui apparaît et qui va inexorablement aspirer les deux amis de toujours, Georges le petit gars débrouillard et Lennie le gentil colosse à la force phénoménale qui n'a pas fini de grandir.
Une histoire qui, je le crois n'aurait pu se dérouler qu'aux Etats-Unis et seulement dans cette période de récession qui a vu tant d'hommes se vendre à la journée pour seulement survivre et continuer d'y croire.
Une lecture au goût d'instantané, un fait divers tragique, un pied de nez du destin, dans tous les cas une histoire qui parlera à chacun selon sa sensibilité car il n'y a pas ici de morale à rechercher ni de justification à trouver.
C'est toujours avec grand plaisir que je retourne à mes premières amours, que je retrouve l'un de mes écrivains fétiches, le très grand John Steinbeck. Comme à son habitude, il nous emmène faire un tour sur ses terres chéries de Californie. Un vrai bonheur. Prenez place sans crainte dans l'autocar…
Pourtant, vous n'allez probablement pas voyager beaucoup pour cette fois car c'est à un autre voyage auquel Steinbeck nous convie ; un voyage au creux des esprits et des sentiments de chacun. L'auteur psychanalyse alternativement l'un ou l'autre de ses personnages et donne comme presque toujours un certain suspense à son histoire. On ne s'ennuie jamais ; on sourit, — parfois même on rit —, grâce à cette caméra embarquée aux tréfonds des âmes et des attentes humaines.
Juste une petite indication du synopsis. Juan Chicoy, brun mexicain, la petite cinquantaine bien conservée, tient une sorte de station service/relais de bus au croisement de deux axes routiers principaux de l'état de Californie (rien de surprenant puisque l'auteur parle presque exclusivement de la Californie dans ses romans).
Le bus de Juan est tombé en panne et les passagers ont été obligés de dormir tant bien que mal à la station service, absolument pas adaptée pour recevoir tant de personnes. Au petit matin, malgré tous les efforts de Juan et de son jeune mécano, le Boutonneux, tout le monde est d'une humeur massacrante et la femme de Juan, Alice, plus encore que les autres, étant ultra jalouse et devinant des maîtresses partout, frise la crise de nerfs et s'en prend donc plus que de raison à la petite employée de la station-service, Norma.
Norma, elle, ne rêve que de Clark Gable, de cinéma et d'Hollywood et il ne faudra peut-être plus la pousser beaucoup pour qu'elle veuille ficher le camp… Parmi les voyageurs, il y a un couple bourgeois d'une cinquantaine d'années, les Pritchard propre sur eux et un brin guindés ainsi que leur grande fille Mildred qui est déjà une jeune adulte et qui, elle, bien loin d'être aussi guindée, sent au fond d'elle-même un je-ne-sais-quoi lui frétiller dans les ovaires. Il y a aussi Ernest Horton, le jeune et fringant voyageur de commerce qui continue le business même en dehors des heures de travail et qui pourrait bien faire miroiter des choses à Norma. Il y a aussi ce vieux ronchon de Van Brunt qui garde le silence pour le moment mais pour combien de temps encore.
Ajoutons à cela qu'un nouveau bus va arriver et libérer une nouvelle cargaison de passagers, eux aussi fermement résolus à attraper leur correspondance. Au sein de ce nouveau bus, il y a Camille, une véritable bombe blonde à la Marilyn Monroe autour de laquelle tous les mâles tournent comme autant de mouches autour d'une tranche de viande émouvante. Cela a le don d'agacer les représentantes de l'autre sexe qui, d'une humeur de cheval, prêtes à ruer, passent à une humeur de chien, prêtes à mordre…
Juan prend beaucoup sur lui, mais entre Alice qui lui tape sur le système, les passagers qui l'assaillent de questions dont il ne peut fournir les réponses, sans oublier la chaleur, la promiscuité, les difficultés en tous genres et même la petite Mildred qui lui fait de l'œil, il risque d'avoir bien du mal à conserver son sang froid… D'ailleurs qui pourra ne pas perdre la tête dans ce bus qui devient un calvaire ?
Je vous laisse en chemin au milieu de cette pétaudière absolument succulente où les rebondissements successifs ne vont pas arranger les affaires de quiconque. J'en terminerai en concédant qu'il manque peut-être (pas sûr) le tout petit supplément d'âme qui ferait de cet excellent livre le pur chef-d'œuvre auquel John Steinbeck nous a si souvent habitué mais que c'est, en tous les cas et d'après moi, un bien bon moment de littérature. Du moins c'est mon naufragé d'avis, égaré dans une correspondance, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Pourtant, vous n'allez probablement pas voyager beaucoup pour cette fois car c'est à un autre voyage auquel Steinbeck nous convie ; un voyage au creux des esprits et des sentiments de chacun. L'auteur psychanalyse alternativement l'un ou l'autre de ses personnages et donne comme presque toujours un certain suspense à son histoire. On ne s'ennuie jamais ; on sourit, — parfois même on rit —, grâce à cette caméra embarquée aux tréfonds des âmes et des attentes humaines.
Juste une petite indication du synopsis. Juan Chicoy, brun mexicain, la petite cinquantaine bien conservée, tient une sorte de station service/relais de bus au croisement de deux axes routiers principaux de l'état de Californie (rien de surprenant puisque l'auteur parle presque exclusivement de la Californie dans ses romans).
Le bus de Juan est tombé en panne et les passagers ont été obligés de dormir tant bien que mal à la station service, absolument pas adaptée pour recevoir tant de personnes. Au petit matin, malgré tous les efforts de Juan et de son jeune mécano, le Boutonneux, tout le monde est d'une humeur massacrante et la femme de Juan, Alice, plus encore que les autres, étant ultra jalouse et devinant des maîtresses partout, frise la crise de nerfs et s'en prend donc plus que de raison à la petite employée de la station-service, Norma.
Norma, elle, ne rêve que de Clark Gable, de cinéma et d'Hollywood et il ne faudra peut-être plus la pousser beaucoup pour qu'elle veuille ficher le camp… Parmi les voyageurs, il y a un couple bourgeois d'une cinquantaine d'années, les Pritchard propre sur eux et un brin guindés ainsi que leur grande fille Mildred qui est déjà une jeune adulte et qui, elle, bien loin d'être aussi guindée, sent au fond d'elle-même un je-ne-sais-quoi lui frétiller dans les ovaires. Il y a aussi Ernest Horton, le jeune et fringant voyageur de commerce qui continue le business même en dehors des heures de travail et qui pourrait bien faire miroiter des choses à Norma. Il y a aussi ce vieux ronchon de Van Brunt qui garde le silence pour le moment mais pour combien de temps encore.
Ajoutons à cela qu'un nouveau bus va arriver et libérer une nouvelle cargaison de passagers, eux aussi fermement résolus à attraper leur correspondance. Au sein de ce nouveau bus, il y a Camille, une véritable bombe blonde à la Marilyn Monroe autour de laquelle tous les mâles tournent comme autant de mouches autour d'une tranche de viande émouvante. Cela a le don d'agacer les représentantes de l'autre sexe qui, d'une humeur de cheval, prêtes à ruer, passent à une humeur de chien, prêtes à mordre…
Juan prend beaucoup sur lui, mais entre Alice qui lui tape sur le système, les passagers qui l'assaillent de questions dont il ne peut fournir les réponses, sans oublier la chaleur, la promiscuité, les difficultés en tous genres et même la petite Mildred qui lui fait de l'œil, il risque d'avoir bien du mal à conserver son sang froid… D'ailleurs qui pourra ne pas perdre la tête dans ce bus qui devient un calvaire ?
Je vous laisse en chemin au milieu de cette pétaudière absolument succulente où les rebondissements successifs ne vont pas arranger les affaires de quiconque. J'en terminerai en concédant qu'il manque peut-être (pas sûr) le tout petit supplément d'âme qui ferait de cet excellent livre le pur chef-d'œuvre auquel John Steinbeck nous a si souvent habitué mais que c'est, en tous les cas et d'après moi, un bien bon moment de littérature. Du moins c'est mon naufragé d'avis, égaré dans une correspondance, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Bien qu'ayant déjà lu ce livre, je l'ai relu d'une traite en retenant mon souffle ! Un miracle que je sois encore en vie en y réfléchissant ;-)
A l'heure de la Grande Dépression des années trente, George et Lennie traversent le pays de ranch en ranch au gré des boulots qu'ils trouvent. Tout semble opposer les deux hommes, tant physiquement que mentalement. Mais l'amitié et LE rêve qui les lient, quoique parfois encombrants, semblent indéfectibles. Un tandem pour le moins insolite dans cet univers d'hommes solitaires et désenchantés. Mais quel tandem ! Cruellement et tendrement attachant.
Les personnages semblent tout droit sortis d'un conte… George, Lennie, le patron, la femme du patron, le palefrenier, le roulier, les joueurs de fers à cheval. Ils sont pourtant comme la moiteur de l'été qui vous colle à la peau.
Une tension s'installe sans qu'on s'en rende compte, genre duel à la Sergio Leone, il ne se passe rien, l'air est immobile, mais tous nos sens sont en alerte, tendus vers un dénouement final qu'on sait inéluctable.
« Si deux hommes essayent de se comprendre, ils seront bons l'un envers l'autre. Bien connaître un homme ne conduit jamais à la haine, mais presque toujours à l'amour. » a déclaré Steinbeck.
Et c'est exactement ce qu'il fait dans cet ouvrage. Avec une écriture assez distanciée en fait, il tente de nous faire comprendre ces hommes… et ces souris !!! C'est ingénieusement bien écrit, la simplicité portée à l'état de grâce ! Les dialogues d'une remarquable justesse donnent une épaisseur bien réelle aux personnages. Ces derniers prennent vie sous nos yeux. On voudrait tantôt les aider, les réconforter, les secouer, ou les baffer !
L'amour est un magnifique convoyeur d'espoir semble nous dire en substance l'auteur, mais qu'advient-il de l'amour par temps de misère ?
Sublime petit roman d'une grande intensité. A Lire… et relire !
A l'heure de la Grande Dépression des années trente, George et Lennie traversent le pays de ranch en ranch au gré des boulots qu'ils trouvent. Tout semble opposer les deux hommes, tant physiquement que mentalement. Mais l'amitié et LE rêve qui les lient, quoique parfois encombrants, semblent indéfectibles. Un tandem pour le moins insolite dans cet univers d'hommes solitaires et désenchantés. Mais quel tandem ! Cruellement et tendrement attachant.
Les personnages semblent tout droit sortis d'un conte… George, Lennie, le patron, la femme du patron, le palefrenier, le roulier, les joueurs de fers à cheval. Ils sont pourtant comme la moiteur de l'été qui vous colle à la peau.
Une tension s'installe sans qu'on s'en rende compte, genre duel à la Sergio Leone, il ne se passe rien, l'air est immobile, mais tous nos sens sont en alerte, tendus vers un dénouement final qu'on sait inéluctable.
« Si deux hommes essayent de se comprendre, ils seront bons l'un envers l'autre. Bien connaître un homme ne conduit jamais à la haine, mais presque toujours à l'amour. » a déclaré Steinbeck.
Et c'est exactement ce qu'il fait dans cet ouvrage. Avec une écriture assez distanciée en fait, il tente de nous faire comprendre ces hommes… et ces souris !!! C'est ingénieusement bien écrit, la simplicité portée à l'état de grâce ! Les dialogues d'une remarquable justesse donnent une épaisseur bien réelle aux personnages. Ces derniers prennent vie sous nos yeux. On voudrait tantôt les aider, les réconforter, les secouer, ou les baffer !
L'amour est un magnifique convoyeur d'espoir semble nous dire en substance l'auteur, mais qu'advient-il de l'amour par temps de misère ?
Sublime petit roman d'une grande intensité. A Lire… et relire !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Le livre qui vous a bouleversé
Mijouet
136 livres
Auteurs proches de John Steinbeck
Lecteurs de John Steinbeck Voir plus
Quiz
Voir plus
Des souris et des hommes
En quelle année est paru ce roman de John Steinbeck ?
1935
1936
1937
10 questions
908 lecteurs ont répondu
Thème : Des souris et des hommes de
John SteinbeckCréer un quiz sur cet auteur908 lecteurs ont répondu