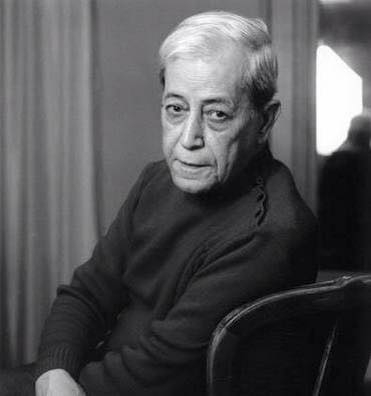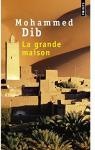Critiques de Mohammed Dib (89)
aboubaker
Lien : https://www.babelio.com/cont..
Lien : https://www.babelio.com/cont..
Pour mieux le savourer, ce texte original de Maohamed Dib ne doit pas être lu comme un simple roman, mais avant tout comme un poème. Car l'auteur n'y essaie pas de monter une intrigue ou de peindre des personnages qui, d'ailleurs, ne sont que deux, mais de mener le lecteur dans son rêve , lui faisant vivre cette aventure unique d'exploration de langage qu'il avait déjà essayée dans " Qui se souvient de la ville". Dans ce texte, chaque mot a son but, et chaque phrase fait sentir son poids, sans pour autant avoir besoin de grandes scènes réalistes, mais seulement de flashes onirique embellis par le style raffiné de l'auteur. Un roman court mais intense, racontant l'amour d'une autre façon.
A Dar-Sbitar, un quartier pauvre de Tlemcen, une petite ville d'Algérie, la famille du petit Omar survit difficilement ; la mère Aïni, veuve, a la charge de cinq bouches à nourrir, la grand-mère laissée provisoirement par les frères et soeurs, un provisoire qui va durer, Omar et ses deux soeurs. Une vie difficile dans La Grande Maison, une cohabitation, vivante, truculente, mais quelquefois pesante, constamment sous le regard et la critique des autres familles, tantôt envieuses, tantôt solidaires. Mais ce qui prédomine surtout, c'est la faim, cette faim constante qui est comme le personnage qui régule les sentiments de habitants, une faim qui transforme la mère de famille en harpie, chassant ses enfants de la maison pour qu'ils se débrouillent, le jeune Omar offrant à l'école sa protection contre un quignon de pain extorqué à ses petits camarades, ou glanant ça et là quelques légumes pourris pour préparer la soupe bien claire du soir. Heureusement la solidarité épisodique permet à la famille de survivre et à la mère de pouvoir compter sur les aides des voisines, particulièrement quand ces dernières sentent une situation particulièrement difficile pour la famille. Dans les moments de répit, on sent beaucoup d'amour, mais ces moments restent très éphémères, la mère, cumulant plusieurs emplois restant harassée et incapable de tendresse.
La Grande Maison est une chronique douce et très amère qui nous est proposée par Mohammed Dib, un premier opus d'une trilogie qui permettra d'en apprendre plus sur l'évolution du petit Omar...
J'ai aimé l'ambiance générale de ce roman d'apprentissage, malgré sa dureté, une dureté des conditions de vie et surtout ses conséquences sur la cellule familiale. J'ai été moins séduite par le style, quelquefois très poétique et quelquefois très naïf, un effet peut-être voulu par l'auteur.
Une lecture intéressante, sur les conditions vie difficiles, ou plutôt de survie, dans une Algérie des années cinquante, encore département français.
A suivre, L'Incendie et le métier à tisser .
La Grande Maison est une chronique douce et très amère qui nous est proposée par Mohammed Dib, un premier opus d'une trilogie qui permettra d'en apprendre plus sur l'évolution du petit Omar...
J'ai aimé l'ambiance générale de ce roman d'apprentissage, malgré sa dureté, une dureté des conditions de vie et surtout ses conséquences sur la cellule familiale. J'ai été moins séduite par le style, quelquefois très poétique et quelquefois très naïf, un effet peut-être voulu par l'auteur.
Une lecture intéressante, sur les conditions vie difficiles, ou plutôt de survie, dans une Algérie des années cinquante, encore département français.
A suivre, L'Incendie et le métier à tisser .
Étrange roman, que cet Habel. Je ne peux pas dire que je l’ai aimé ni que je l’ai détesté. Dès les premières pages, on patauge dans le mystère mais, au lieu d’intriguer, ce mystère déconnecte. Je n’ai pas accroché, j’ai continué à lire sans trop savoir pourquoi, surtout sans trop y porter attention et, quelques dizaines de pages plus loin, j’étais perdu. J’ai essayé de me concentrer à nouveau sur cette lecture, avec un tout petit peu de succès. Mais ce narrateur, le fameux Habel qui a inspiré le titre du roman, je ne m’y suis jamais vraiment attaché. Je me moquais de lui, de ses amourettes avec Sabine puis avec Lily. Son passé compliqué avec « le Vieux » était trop énigmatique, si j’avais pu en percer un pan ça aurait attisé ma curiosité et ça m’aurait encouragé à continuer mais non. Pareillement pour cet « événement » qui a eu lieu il y a un certain temps, ce point noir dans le pasés du narrateur. Est-ce un crime ? L’a-t-il commis ou en a-t-il été témoin ? Aurait-il pu intervenir ? Pourquoi cet événement le hante-t-il ? Surement les réponses ont été dévoilées dans une des nombreuses pages où mon attention était ailleurs… Est-ce que, pour faire référence au récit biblique de Caïn et Abel, cette fois-ci, c’est l’autre frère (Habel) le coupable ? Du moins, je l’espère ! Je dois reconnaître que, si je n’avais pas vu le nom de Mohammed Dib sur la couverture, je n’aurais jamais cru qu’il était l’auteur de ce roman. Il m’a étonné. Le style me rappelait davantage les œuvres de Patrick Modiano, une atmosphère vague et nostalgique qui m’a accompagné tout le long de ma lecture (j’y suis fortement sensible) et qui m’a poussé à la continuer. Probablement le principal point positif de Habel, selon moi.
Mohamed Dib, est un classique de la littérature algérienne . Il a écrit de très beaux romans ou plutôt une trilogie ( La Grande Maison- L'Incendie- le Métier à tisser ) où il décrit avec un grand réalisme les peines et les souffrances de la grande majorité des Algériens durant la période coloniale. La trilogie décrit la vie des Algériens à partir des années trente jus qu' au déclenchement de la Révolution le Premier novembre 1954 .
" Un été africain " a été édité et publié en 1957 . Mohamed Dib, donnant une préface à la traduction bulgare, en octobre 1961, écrit : "Avec ce roman, nous entrons dans la tragédie, mais personne ne le sait, je veux dire : aucun des personnages présents. Ce livre a été écrit pendant que les événements relatés se produisaient ; même un peu avant, pour certains . Ce n' est que rétrospectivement, aujourd’hui' hui, que les protagonistes pourraient parler de tragédie .Ceux d' entre eux du moins qui sont encore de ce monde .
Lors qu( on prononce le mot " tragédie" , on s' imagine tout de suite devant une scène, attendant que les trois coups soient frappés, que le rideau se lève et qu' apparaissent des acteurs sachant parfaitement ce
qu' ils ont à faire, que leur voix, leurs expressions, leurs gestes, étudiés, sont prêts à concourir à cette fin : donner la tragédie .
Dans cet ouvrage, il y a bien des acteurs mais ils ne sont nullement
préparés aux rôles qu' ils vont jouer, ils ne savent pas qu' ils vont participer à une tragédie, ou à quoi que ce soit de semblable, il n' y a pas de plateau,aucun rideau ne se lèvera-ni se baissera-; il n' y a pas de rideau .Les hom-
-mes et les femmes qu' on rencontrer, s' ils vont vivre une tragédie, ce n' est qu' à compter du moment où le lecteur ouvre le livre et les regardera agir . Où une relation d' eux à lui s' établira . C' est au lecteur qu' il appartient
de découvrir, à partir du libre jeu de leur comportement et de leurs pensées, mais aussi de la nécessité où ce comportement et ces pensées
s' inscriront, la réalité magique qu' ils véhiculent à leur insu. Cette réalité sera dans sa conscience, non dans celle des personnages " .
Ceci est une partie de la préface de l' auteur à son livre où il livre au lecteur les tenants et aboutissants du drame que l' auteur qualifie de tragédie, et oui, on ne peut pas la nommer autrement.
En conclusion, la lecture de ce beau livre nous montre un grand maîtrisant à merveille la langue et sa façon de nous faire sentir la population algérienne a vécu dans son âme et sa chair .
Un très beau livre qui mérite sa note de cinq sur cinq .
" Un été africain " a été édité et publié en 1957 . Mohamed Dib, donnant une préface à la traduction bulgare, en octobre 1961, écrit : "Avec ce roman, nous entrons dans la tragédie, mais personne ne le sait, je veux dire : aucun des personnages présents. Ce livre a été écrit pendant que les événements relatés se produisaient ; même un peu avant, pour certains . Ce n' est que rétrospectivement, aujourd’hui' hui, que les protagonistes pourraient parler de tragédie .Ceux d' entre eux du moins qui sont encore de ce monde .
Lors qu( on prononce le mot " tragédie" , on s' imagine tout de suite devant une scène, attendant que les trois coups soient frappés, que le rideau se lève et qu' apparaissent des acteurs sachant parfaitement ce
qu' ils ont à faire, que leur voix, leurs expressions, leurs gestes, étudiés, sont prêts à concourir à cette fin : donner la tragédie .
Dans cet ouvrage, il y a bien des acteurs mais ils ne sont nullement
préparés aux rôles qu' ils vont jouer, ils ne savent pas qu' ils vont participer à une tragédie, ou à quoi que ce soit de semblable, il n' y a pas de plateau,aucun rideau ne se lèvera-ni se baissera-; il n' y a pas de rideau .Les hom-
-mes et les femmes qu' on rencontrer, s' ils vont vivre une tragédie, ce n' est qu' à compter du moment où le lecteur ouvre le livre et les regardera agir . Où une relation d' eux à lui s' établira . C' est au lecteur qu' il appartient
de découvrir, à partir du libre jeu de leur comportement et de leurs pensées, mais aussi de la nécessité où ce comportement et ces pensées
s' inscriront, la réalité magique qu' ils véhiculent à leur insu. Cette réalité sera dans sa conscience, non dans celle des personnages " .
Ceci est une partie de la préface de l' auteur à son livre où il livre au lecteur les tenants et aboutissants du drame que l' auteur qualifie de tragédie, et oui, on ne peut pas la nommer autrement.
En conclusion, la lecture de ce beau livre nous montre un grand maîtrisant à merveille la langue et sa façon de nous faire sentir la population algérienne a vécu dans son âme et sa chair .
Un très beau livre qui mérite sa note de cinq sur cinq .
" Le Métier à tisser" est le troisième livre de la trilogie de Mohamed Dib,
trilogie composée de : "La Grande Maison", " L' Incendie" et " Le Métier à
tisser" .
Omar qui était un enfant dans le premier roman, est devenu un jeune
homme mâture , réfléchi et posé .Il entre comme apprenti chez des
tisserands d' où le titre du roman :"Le Métier à tisser" .C' est, presque la fin
des années trente et l' année 1940 est là .C' est dans cette atmosphère très
dure, tendue et où les Algériens font face aux difficultés quotidiennes de la
vie, et, les problèmes n' en manquent pas : le chômage, la maladie, la
faim, l' ignorance . C' est une population malheureuse, abandonnée a
elle-même , écrasée par tous les maux qui découlent de la colonisation .
Avec ce roman, Mohamed Dib montre que c' est tout un peuple qui
tend la main non pour mendier mais pour saisir une autre main fraternelle.
Réussira-t-il dans cette tentative ? Telle est la leçon de ce roman qui nous
parle à voix humaine d' un temps prochain proche et lointain où toute
blessure pouvait encore être guérie. C' est une leçon d' espoir ?
Avec cette trilogie, Mohamed Dib a essayé de montrer ce que la
majorité des Algériens ont enduré mais ont cru qu' un jour viendra où ils
seront libres et goutteront la joie de l' indépendance et de la liberté .
trilogie composée de : "La Grande Maison", " L' Incendie" et " Le Métier à
tisser" .
Omar qui était un enfant dans le premier roman, est devenu un jeune
homme mâture , réfléchi et posé .Il entre comme apprenti chez des
tisserands d' où le titre du roman :"Le Métier à tisser" .C' est, presque la fin
des années trente et l' année 1940 est là .C' est dans cette atmosphère très
dure, tendue et où les Algériens font face aux difficultés quotidiennes de la
vie, et, les problèmes n' en manquent pas : le chômage, la maladie, la
faim, l' ignorance . C' est une population malheureuse, abandonnée a
elle-même , écrasée par tous les maux qui découlent de la colonisation .
Avec ce roman, Mohamed Dib montre que c' est tout un peuple qui
tend la main non pour mendier mais pour saisir une autre main fraternelle.
Réussira-t-il dans cette tentative ? Telle est la leçon de ce roman qui nous
parle à voix humaine d' un temps prochain proche et lointain où toute
blessure pouvait encore être guérie. C' est une leçon d' espoir ?
Avec cette trilogie, Mohamed Dib a essayé de montrer ce que la
majorité des Algériens ont enduré mais ont cru qu' un jour viendra où ils
seront libres et goutteront la joie de l' indépendance et de la liberté .
L' auteur du roman ," L' Incendie" ,est Mohamed Dib, un classique de la littéra
-ture algérienne . Ce livre est le deuxième de sa trilogie consacrée à la tragédie de la société algérienne durant la colonisation française . Cette trilogie commence avec le premier roman " La Grande Maison" publié et édité en 1952 . le second livre " L' Incendie" publiait en 1954 et le troisième livre,
" le Métier à tisser" en 1957 .Cette période est vécue par la population algérienne de façon dramatique car cette population fait face à deux fléaux
qui sont la colonisation et les effets de la Seconde Guerre mondiale, c' est à dire que la société algérienne est prise " entre l( enclume et le marteau" à son corps défendant .L' auteur comme observateur et témoin lucide ,il analyse tout ce qui touche sa société et l' injustice faite aux Algériens .
Nous sommes à l' été 1939 et nous retrouvons les personnages du roman précédent de Mohamed Dib, La Grande Maison, en particulier un jeune garçon de onze ans, Omar. Ce dernier quitte la ville et Dar Sbitar pour aller
à la compagne. Dans une Algérie essentiellement agricole, la majorité des habitants vivent directement ou indirectement des produits de la terre. Mais peu profitent réellement des ressources du pays, les colons qui tiennent les grandes propriétés sont les principaux bénéficiaires des richesses du sol. C' est dans le village de Bni Boublen, qu' Omar est initié aux mystères de la terre par Commandar, un vieil homme estropié. A ses côtés naviguent les cultivateurs, les petits possédants pauvres, et la masse des paysans sans terre , les fellahs, pour qui la seule issue est dans l' action et la grève .
Et la seule réponse des grands propriétaires est la répression. Profitant d' un feu qui naît dans les gourbis d' ouvriers agricoles, les fellahs sont d' être des incendiaires et les meneurs sont arrêtés....
La deuxième Guerre mondiale éclate. Les hommes sont mobilisés et ne restent, alors que les femmes et les enfants . Omar rentre chez lui mais il a mûri . Tous semblent avoir oublié . Mais, Omar, lui, n' a pas oublié et
après, vingt ans lui et ceux de sa génération se révoltent et retrouvent la liberté avec l' Indépendance acquise.
Un très beau roman de Dib nous montrant les sacrifices consenties par toute une génération afin de libérer le pays de l' injustice et de toutes les injustices .
-ture algérienne . Ce livre est le deuxième de sa trilogie consacrée à la tragédie de la société algérienne durant la colonisation française . Cette trilogie commence avec le premier roman " La Grande Maison" publié et édité en 1952 . le second livre " L' Incendie" publiait en 1954 et le troisième livre,
" le Métier à tisser" en 1957 .Cette période est vécue par la population algérienne de façon dramatique car cette population fait face à deux fléaux
qui sont la colonisation et les effets de la Seconde Guerre mondiale, c' est à dire que la société algérienne est prise " entre l( enclume et le marteau" à son corps défendant .L' auteur comme observateur et témoin lucide ,il analyse tout ce qui touche sa société et l' injustice faite aux Algériens .
Nous sommes à l' été 1939 et nous retrouvons les personnages du roman précédent de Mohamed Dib, La Grande Maison, en particulier un jeune garçon de onze ans, Omar. Ce dernier quitte la ville et Dar Sbitar pour aller
à la compagne. Dans une Algérie essentiellement agricole, la majorité des habitants vivent directement ou indirectement des produits de la terre. Mais peu profitent réellement des ressources du pays, les colons qui tiennent les grandes propriétés sont les principaux bénéficiaires des richesses du sol. C' est dans le village de Bni Boublen, qu' Omar est initié aux mystères de la terre par Commandar, un vieil homme estropié. A ses côtés naviguent les cultivateurs, les petits possédants pauvres, et la masse des paysans sans terre , les fellahs, pour qui la seule issue est dans l' action et la grève .
Et la seule réponse des grands propriétaires est la répression. Profitant d' un feu qui naît dans les gourbis d' ouvriers agricoles, les fellahs sont d' être des incendiaires et les meneurs sont arrêtés....
La deuxième Guerre mondiale éclate. Les hommes sont mobilisés et ne restent, alors que les femmes et les enfants . Omar rentre chez lui mais il a mûri . Tous semblent avoir oublié . Mais, Omar, lui, n' a pas oublié et
après, vingt ans lui et ceux de sa génération se révoltent et retrouvent la liberté avec l' Indépendance acquise.
Un très beau roman de Dib nous montrant les sacrifices consenties par toute une génération afin de libérer le pays de l' injustice et de toutes les injustices .
L' auteur, Mohamed DIB, est né en 1920 à Tlemcen. Cette dernière est une
ancienne cité, au riche passé culturel de l' ouest algérien .
Mohamed DIB est considéré comme un classique de la littérature
algérienne . Il est, aussi, poète et dramaturge .
Ses premiers romans : -La Grande Maison ( 1952 ) - L' Incendie ( 1954 ) -
Le Métier à tisser ( 1957 ), peuvent considérés comme une trilogie se dérou-
-lant , toujours dans la même ville, Tlemcen. On retrouve, assez souvent les
mêmes personnages d' un livre à l' autre .
" La Grande Maison", roman publié en 1952, est appelée, aussi," Dar Sbitar "est un "Immeuble de pauvres".
Le héros de ce récit , est l' enfant Omar. C' est à travers , ses yeux que
l' auteur nous laisse découvrir la réalité de la vie quotidienne des habitants
qui est, par extrapolation la vie de la grande majorité des Algériens.
Omar est orphelin de père, il vit avec sa mère, Aini, ses deux soeurs,
Aouicha, Meriem et sa grande-mère , maternelle.
Les habitants de "Dar Sbitar" forment un microcosme qui représente la
société algérienne, tout au moins la majorité de cette celle-ci.
Ces habitants s' évertuent à vivre au jour le jour, envers tous et contre tous
Ils font face et luttent contre la faim, le froid car il neige en hiver,la jalousie
et la méchanceté des autres, des voisins par exemple et l' indifférence des.
Européens .
Le lot de misère que vit cette très modeste famille est celui de la majorité
des Algériens . Ces derniers sont abandonnée à eux-mêmes face au
chômage, la faim, la maladie, l' ignorance, la discrimination ....
Un grand et beau livre de Mohamed Dib qui témoigne de ce que fut la vie
de ses compatriotes algériens durant l' ère coloniale.
Un grand livre à lire et à méditer .
ancienne cité, au riche passé culturel de l' ouest algérien .
Mohamed DIB est considéré comme un classique de la littérature
algérienne . Il est, aussi, poète et dramaturge .
Ses premiers romans : -La Grande Maison ( 1952 ) - L' Incendie ( 1954 ) -
Le Métier à tisser ( 1957 ), peuvent considérés comme une trilogie se dérou-
-lant , toujours dans la même ville, Tlemcen. On retrouve, assez souvent les
mêmes personnages d' un livre à l' autre .
" La Grande Maison", roman publié en 1952, est appelée, aussi," Dar Sbitar "est un "Immeuble de pauvres".
Le héros de ce récit , est l' enfant Omar. C' est à travers , ses yeux que
l' auteur nous laisse découvrir la réalité de la vie quotidienne des habitants
qui est, par extrapolation la vie de la grande majorité des Algériens.
Omar est orphelin de père, il vit avec sa mère, Aini, ses deux soeurs,
Aouicha, Meriem et sa grande-mère , maternelle.
Les habitants de "Dar Sbitar" forment un microcosme qui représente la
société algérienne, tout au moins la majorité de cette celle-ci.
Ces habitants s' évertuent à vivre au jour le jour, envers tous et contre tous
Ils font face et luttent contre la faim, le froid car il neige en hiver,la jalousie
et la méchanceté des autres, des voisins par exemple et l' indifférence des.
Européens .
Le lot de misère que vit cette très modeste famille est celui de la majorité
des Algériens . Ces derniers sont abandonnée à eux-mêmes face au
chômage, la faim, la maladie, l' ignorance, la discrimination ....
Un grand et beau livre de Mohamed Dib qui témoigne de ce que fut la vie
de ses compatriotes algériens durant l' ère coloniale.
Un grand livre à lire et à méditer .
Je ne sais pas trop quoi dire concernant Le maitre de chasse… Le résumé de la 4e de couverture va à l’essentiel. Quelques années après que la France se soit retirée de l’Algérie, l’ardeur est retombée. Quelques fellahs pensaient que l’indépendance amènerait l’égalité, le partage des terres, la richesse pour tous. Malheureusement, ce n’est pas le cas et ils sont prêts à tout pour y arriver. Même se retourner contre les leurs. Le préfet Waëd (le personnage principal ?) préfère protéger ce nouveau pays, et parfois cela signifie réprimer les frères d’autrefois. Le maitre de chasse contient donc tous les éléments d’une bonne histoire. Le cœur de l’intrigue est puissant mais, malheureusement, pas suffisamment bien exploité ou développé pour m’intéresser. Du moins, pas à mon goût.
Je ne me suis jamais senti proche de Waëd, je n’ai jamais senti son urgence d’agir. Les autres personnages sont trop nombreux et on ne plonge pas suffisamment en eux. On les observe de l’extérieur, dans leurs interactions avec les autres. Cette distance, ce détachement m’a empêché de me sentir concerné par leur lutte fraticide. Et c’est en grande partie à cause du style d’écriture de Mohammed Dib. Il est correct, sans plus. Alors que, souvent, il faut plus. Pourtant, dans ses autres romans, j’ai apprécié l’attention qu’il porte aux détails, les descriptions des lieux et des paysages sont souvent révélatrices. Et cette atmosphère. Mais ici, tout semble sec. Bref, une petite déception.
Je ne me suis jamais senti proche de Waëd, je n’ai jamais senti son urgence d’agir. Les autres personnages sont trop nombreux et on ne plonge pas suffisamment en eux. On les observe de l’extérieur, dans leurs interactions avec les autres. Cette distance, ce détachement m’a empêché de me sentir concerné par leur lutte fraticide. Et c’est en grande partie à cause du style d’écriture de Mohammed Dib. Il est correct, sans plus. Alors que, souvent, il faut plus. Pourtant, dans ses autres romans, j’ai apprécié l’attention qu’il porte aux détails, les descriptions des lieux et des paysages sont souvent révélatrices. Et cette atmosphère. Mais ici, tout semble sec. Bref, une petite déception.
Le métier à tisser, le dernier tome de la trilogie Algérie, est celui que j’ai le plus apprécié. Après un été passé à la campagne, Omar retourne à Tlemcen. Là, il retrouve sa famille, sa mère et ses sœurs, mais aussi et surtout des conditions de vie toujours pénibles. Pour aider à subvenir aux besoins de la famille, il doit travailler dans un atelier de tisserands de Mahi Bouanane. Un peu contre sn gré mais, à quatorze ans, il doit faire sa part. Enfin, il joue un rôle important, principal ! L’auteur décrit très bien son travail. « Il travaillait depuis un moment, enveloppé par le bourdonnement grave d’un rouet. Les battements des peignes se chevauchaient l’un l’autre et alternaient avec les cris brefs des navettes. Il écoutait cette rumeur, écoutait le bruit doux, frôleur, de son dévidoir. La veille, il était libre, il courait, toute bride lâchée, dans les rues. Et voilà que son existence avait l’air d’être tranchée par un coup de couperet. Une subite tristesse le saisit. »
Pendant ma lecture, je pensais constamment à Émile Zola, les Rougon-Macquart et tous ces romans naturalistes ou réalistes. Mohammed Dib décrit avec habileté l’atelier où est employé le jeune Omar (une cave !), ses relations avec les autres employés, le vécu et les petites histoires de chacun mais surtout les conditions de travail. « Dans l’atmosphère confinée, étouffante, une griserie s’insinuait qui montait à la tête. » Mais ces jeunes Algériens sont habitués à un monde dur, ils continuent. « N’oublie pas que nos frères ont le don de s’accoutumer à tout, que leurs misères ne les touchent même plus ! » Mais l’auteur parvient à dépeindre la misère sans tomber dans le misérabilisme. Jamais je me suis dit, c’est trop, j’arrête. C’est qu’il y a parfois, souvent, de ces petits moments, des étincelles d’espoir qui permettent de continuer. Ne serait-ce que l’arrivée du printemps ou peut-être le début d’une amitié nouvelle.
Quand il n’est pas à l’usine, Omar déambule dans Tlemcen. Là, il croise le chemin de mendiants qui encombrent les rues, il rencontre des amis à la fontaine du Lion sur la place du Beylick, il entend les rumeurs de la guerre, du gouvernement de Vichy. Enfin, Omar grandit, il réfléchit et il change. Le garçon n’est plus que le personnage récurrent d’une suite sans fin de péripéties sympathiques mais anodines à la Poil-de-carotte ; il est le personnage principal d’une histoire qui lui permet d’évoluer psychologiquement. « Les jours s’écoulaient, Omar mûrissait. […] Il avait acquis une bonne dose d’expérience depuis qu’il travaillait ici. Les mauvais traitements n’avaient plus autant d’effet sur lui qu’aux premiers jours. Il avait appris à se défendre. » Avec ce roman, Mohammed Dib termine en grand sa trilogie, je suis presque déçu que son histoire s’arrête là finalement.
Pendant ma lecture, je pensais constamment à Émile Zola, les Rougon-Macquart et tous ces romans naturalistes ou réalistes. Mohammed Dib décrit avec habileté l’atelier où est employé le jeune Omar (une cave !), ses relations avec les autres employés, le vécu et les petites histoires de chacun mais surtout les conditions de travail. « Dans l’atmosphère confinée, étouffante, une griserie s’insinuait qui montait à la tête. » Mais ces jeunes Algériens sont habitués à un monde dur, ils continuent. « N’oublie pas que nos frères ont le don de s’accoutumer à tout, que leurs misères ne les touchent même plus ! » Mais l’auteur parvient à dépeindre la misère sans tomber dans le misérabilisme. Jamais je me suis dit, c’est trop, j’arrête. C’est qu’il y a parfois, souvent, de ces petits moments, des étincelles d’espoir qui permettent de continuer. Ne serait-ce que l’arrivée du printemps ou peut-être le début d’une amitié nouvelle.
Quand il n’est pas à l’usine, Omar déambule dans Tlemcen. Là, il croise le chemin de mendiants qui encombrent les rues, il rencontre des amis à la fontaine du Lion sur la place du Beylick, il entend les rumeurs de la guerre, du gouvernement de Vichy. Enfin, Omar grandit, il réfléchit et il change. Le garçon n’est plus que le personnage récurrent d’une suite sans fin de péripéties sympathiques mais anodines à la Poil-de-carotte ; il est le personnage principal d’une histoire qui lui permet d’évoluer psychologiquement. « Les jours s’écoulaient, Omar mûrissait. […] Il avait acquis une bonne dose d’expérience depuis qu’il travaillait ici. Les mauvais traitements n’avaient plus autant d’effet sur lui qu’aux premiers jours. Il avait appris à se défendre. » Avec ce roman, Mohammed Dib termine en grand sa trilogie, je suis presque déçu que son histoire s’arrête là finalement.
Dans L’incendie, le deuxième tome de la trilogie Algérie, Omar est envoyé à la campagne, en montange, à Bni Boublen. Là, il est initié à la vie agricole et pastorale. Rustique et archaïque. Malheureusement, elle est toute aussi rude que celle de la ville. Les gens vivent dans la pauvreté, la misère et leurs ventres sont à peine plus remplis que ceux des citadins. C’est que le fruit de leurs efforts va chez les colons français pour qui ils travaillent. Cette vie, tout ce qui la distingue, c’est un aspect plus enchanteur, mystique. Ses secrets sont dévoilés au garçon, entre autres, par le Comandar (un vieil homme amputé des jambes, rescapé de la Première Guerre mondiale), une sorte philosophe-conteur. Beaucoup sont suspendus à ses lèvres.
Mohammed Dib nous présente un autre visage de l’Algérie, celui des campagnes, de la paysannerie algérienne. En 1939, les fellahs vivent dans des conditions pénibles et travaillent pour un salaire de crève-faim. Mais, alors qu’autrefois ils acceptaient leur sort sans broncher, des murmures d’insatisfactions commencent à se propager. Certains agitateurs parlent de grèvent et le mouvement s’enclanche malgré les menaces des propriétaires terriens, pour la plupart français. Même l’incendie de leurs habitations (duquel les grévistes sont accusés et leurs meneurs, arrêtés) ne fait pas bouger les fellahs dans leur résolution.
Dans L’incendie, le jeune Omar est peu présent. En effet, il présente les lieux et les personnages mais est loin d’occuper un rôle central. Il fait surtout le lien entre le tome précédent et le suivant. Je pourrais parler de Sliman Meskine, de Ba Dedouche, de Kara Ali, du Comandar et de plusieurs autres mais aucun n’est plus important que les autres. Mais, en fait, le personnage principal est le peuple algérien des campagnes, les fellahs en tant que groupe. Par extension, c’est aussi l’Algérie. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, j’aime bien qu’un roman repose sur les épaules d’un personnage. Dans tous les cas, ça permet à l’auteur d’exploiter la montée du sentiment d’anti-colonialisme sans le trop la personnaliser. Cela contraste avec La grande maison, qui s’ouvre avec le discours du professeur Hassan qui proclame et essaie de faire comprendre à ses élèves que la France est la mère patrie. À suivre.
Mohammed Dib nous présente un autre visage de l’Algérie, celui des campagnes, de la paysannerie algérienne. En 1939, les fellahs vivent dans des conditions pénibles et travaillent pour un salaire de crève-faim. Mais, alors qu’autrefois ils acceptaient leur sort sans broncher, des murmures d’insatisfactions commencent à se propager. Certains agitateurs parlent de grèvent et le mouvement s’enclanche malgré les menaces des propriétaires terriens, pour la plupart français. Même l’incendie de leurs habitations (duquel les grévistes sont accusés et leurs meneurs, arrêtés) ne fait pas bouger les fellahs dans leur résolution.
Dans L’incendie, le jeune Omar est peu présent. En effet, il présente les lieux et les personnages mais est loin d’occuper un rôle central. Il fait surtout le lien entre le tome précédent et le suivant. Je pourrais parler de Sliman Meskine, de Ba Dedouche, de Kara Ali, du Comandar et de plusieurs autres mais aucun n’est plus important que les autres. Mais, en fait, le personnage principal est le peuple algérien des campagnes, les fellahs en tant que groupe. Par extension, c’est aussi l’Algérie. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, j’aime bien qu’un roman repose sur les épaules d’un personnage. Dans tous les cas, ça permet à l’auteur d’exploiter la montée du sentiment d’anti-colonialisme sans le trop la personnaliser. Cela contraste avec La grande maison, qui s’ouvre avec le discours du professeur Hassan qui proclame et essaie de faire comprendre à ses élèves que la France est la mère patrie. À suivre.
J’avais entendu beaucoup de commentaires positifs à l’endroit de La grande maison et, si je n’ai pas détesté, je ne peux pas dire non plus que j’ai aimé. Pourtant, le début m’a plu. Omar, un garçon de onze ans, fait preuve de débrouillardise pour trouver du pain, n’importe quelle nourriture. Et il protège les plus petits. Et il assiste à ses leçons à l’école sans vraiment tout comprendre. Je dois au moins admettre que ce personnage est attachant. Très rapidement, on assiste à des scènes de famille. La mère Aïni, qui se plaint constamment du travail, de la belle-mère paralytique dont elle doit s’occuper, de ses trois enfants qui lui réclament à manger et du père qui est mort sans s’être assuré de leur sécurité financière. Puis il y a les autres familles du carré de maison, du quartier, Dar-Sbitar. Une faune intéressante. Ce roman, c’est une galerie de personnages.
Je crois que mes réserves sont dues au fait qu’il n’y a pas vraiment d’histoire dans le sens où on l’entend habituellement. Omar, pas plus que les autres résidents de Dar-Sbitar, n’accomplit pas beaucoup à proprement parler. Il est surtout le témoin d’une situation, d’un mode de vie. Il peut témoigner des conditions pénibles dans lesquelles il vit avec sa famille et les gens de son quartier. Et il en va probablement ainsi pour beaucoup d’autres habitants de Tlemcen et de l’Algérie des années 1930. Mohammed Dib nous présente la grande misère, la pauvreté, la promiscuité, mais également le courage. Car, à aucun moment, même dans le désespoir le plus profond, les personnages n’abandonnent. Ils retroussent leurs manches et triment encore plus fort.
Quand la police a fait irruption dans Dar-Sbitar pour chercher Hamid (en vain, car il s’était sauvé) et ramasser ses papiers, j’ai cru que l’action allait décoller. Pareillement avec la Seconde Guerre mondiale qui éclate, même si l’Europe est loin. Mais non. La grande maison, c’est une collection de tranches de vie. C’est agréable à lire mais, moi, je préfère une trame narrative, avec un début, un milieu et une fin. Bref, qu’il y ait un but, une mission. Ici, j’ai l’impression que l’auteur m’amène quelque part et m’y abandonne. Notez bien, mes préférences n’enlèvent rien à l’importance de cette œuvre ni à ses qualités.
Ainsi, je dois toutefois reconnaître le grand talent de Mohammed Dib pour décrire avec réalisme la situation dans les quartiers pauvres. Et la faim. Cette faim terrible qui occupe tous les esprits. Trouver son pain quotidien est le thème central du roman, qui s’ouvre sur cette préoccupation : « - Un peu de ce que tu manges ! » Et il termine avec elle : « Omar s’accroupit lui aussi avec les autres, devant la meïda, et surveilla sa mère qui rompait le pain contre son genou. » Cette obsession (pourtant un besoin primaire !) guide Omar et sa famille tout son long mais cela peut donner l’impression que l’on va nulle part, que l’histoire tourne en rond. Et ce n’est qu’un début, car l’aventure du garçon continue avec les deux tomes suivants de cettre trilogie nommée Algérie.
Je crois que mes réserves sont dues au fait qu’il n’y a pas vraiment d’histoire dans le sens où on l’entend habituellement. Omar, pas plus que les autres résidents de Dar-Sbitar, n’accomplit pas beaucoup à proprement parler. Il est surtout le témoin d’une situation, d’un mode de vie. Il peut témoigner des conditions pénibles dans lesquelles il vit avec sa famille et les gens de son quartier. Et il en va probablement ainsi pour beaucoup d’autres habitants de Tlemcen et de l’Algérie des années 1930. Mohammed Dib nous présente la grande misère, la pauvreté, la promiscuité, mais également le courage. Car, à aucun moment, même dans le désespoir le plus profond, les personnages n’abandonnent. Ils retroussent leurs manches et triment encore plus fort.
Quand la police a fait irruption dans Dar-Sbitar pour chercher Hamid (en vain, car il s’était sauvé) et ramasser ses papiers, j’ai cru que l’action allait décoller. Pareillement avec la Seconde Guerre mondiale qui éclate, même si l’Europe est loin. Mais non. La grande maison, c’est une collection de tranches de vie. C’est agréable à lire mais, moi, je préfère une trame narrative, avec un début, un milieu et une fin. Bref, qu’il y ait un but, une mission. Ici, j’ai l’impression que l’auteur m’amène quelque part et m’y abandonne. Notez bien, mes préférences n’enlèvent rien à l’importance de cette œuvre ni à ses qualités.
Ainsi, je dois toutefois reconnaître le grand talent de Mohammed Dib pour décrire avec réalisme la situation dans les quartiers pauvres. Et la faim. Cette faim terrible qui occupe tous les esprits. Trouver son pain quotidien est le thème central du roman, qui s’ouvre sur cette préoccupation : « - Un peu de ce que tu manges ! » Et il termine avec elle : « Omar s’accroupit lui aussi avec les autres, devant la meïda, et surveilla sa mère qui rompait le pain contre son genou. » Cette obsession (pourtant un besoin primaire !) guide Omar et sa famille tout son long mais cela peut donner l’impression que l’on va nulle part, que l’histoire tourne en rond. Et ce n’est qu’un début, car l’aventure du garçon continue avec les deux tomes suivants de cettre trilogie nommée Algérie.
Ces sept admirables nouvelles racontent l’histoire d’une rencontre. Une rencontre simple, fortuite, produite au hasard et/ou produit du hasard, entre deux hommes ; entre un algérien et un français, dans un café. Comme le hasard fait bien les choses, surtout dans les lettres, cette rencontre révèle à quel point l’humanité simple peut s’accorder sur les choses de la vie, sans préjugés et sans rancœurs. Cela voudrait-il dire que la rencontre de l’Algérie et de la France, si jamais elle survienne, serait-elle comme Dib la laisse entendre dans le sens et la moralité de la nouvelle ? Ce hasard est surprenant car la rencontre de deux hommes, de deux existences humaines, aux destins fondamentalement opposés et différents, restent cependant semblables et identiques ! Les deux hommes qui se rencontrent dans ce café, au hasard encore, parviennent à la même conclusion : «"Voilà un homme qui a réfléchit ! Il est arrivé à une conclusion que je ne peux pas réfuter sans me contredire" Je resterai muet. Lui, comme s’il ne le remarquait pas, déclara encore une fois tout haut : "- Chienne de vie…"»
Au café est l’histoire d’un homme en mal de vivre qui se retrouve dans un café surpris par la nuit, comme replié sur lui-même, arrache «quelques heures» à la durée pesante du temps, «prolonge» un moment de répit, rien qu’une nuit. Au bout d’un certain moment, il est interpellé par un «inconnu», fraichement sorti de prison. Il s’en méfie, s’en éloigne. Puis, l’inconnu le surprend et le laisse écouter son histoire pour arriver enfin à une même conclusion. Le café, le lieu d’une halte, de refuge pour le narrateur qui s’y trouve par contrainte, alors que l’autre vient savourer une joie ! L’humanité simple n’est-elle pas justement, comme dans cette rencontre fortuite, faite de contrainte et de joie ? L’écriture dépouillée d’Au café, non seulement pour les besoins du genre, puise dans cet humus semblable à ces strates primitives de l’humanité commune ; commune aux deux itinéraires qui se croisent cette nuit, dans ce café ; humanité simple au point de nous laisser croire qu’un monde possible peut exister, à l’abri de préjugés, rien qu’une nuit, quelque part ; un monde fait de contraintes et de joies !
Au café est l’histoire d’un homme en mal de vivre qui se retrouve dans un café surpris par la nuit, comme replié sur lui-même, arrache «quelques heures» à la durée pesante du temps, «prolonge» un moment de répit, rien qu’une nuit. Au bout d’un certain moment, il est interpellé par un «inconnu», fraichement sorti de prison. Il s’en méfie, s’en éloigne. Puis, l’inconnu le surprend et le laisse écouter son histoire pour arriver enfin à une même conclusion. Le café, le lieu d’une halte, de refuge pour le narrateur qui s’y trouve par contrainte, alors que l’autre vient savourer une joie ! L’humanité simple n’est-elle pas justement, comme dans cette rencontre fortuite, faite de contrainte et de joie ? L’écriture dépouillée d’Au café, non seulement pour les besoins du genre, puise dans cet humus semblable à ces strates primitives de l’humanité commune ; commune aux deux itinéraires qui se croisent cette nuit, dans ce café ; humanité simple au point de nous laisser croire qu’un monde possible peut exister, à l’abri de préjugés, rien qu’une nuit, quelque part ; un monde fait de contraintes et de joies !
un petit recueil de poèmes bien écrit et qui parle de la vie
Habel fait référence a Madjnoun Leila
Abel fait référence au mythe des fils d'Adan Abel et Caïn
Abel fait référence aux multiplicités de langues la tour de Babel (le bilinguisme )
Abel fait référence au mythe des fils d'Adan Abel et Caïn
Abel fait référence aux multiplicités de langues la tour de Babel (le bilinguisme )
Poète et conteur algérien contemporain, ce recueil de nouvelles met en scène les êtres et la nature en observateur averti. On se laisse entraîner dans une tendre et fine description de l'Algérie en guerre ou en temps de paix.
Cette pièce a été créée au festival d'Avignon en 1977. intense et intrigant.
Treize nouvelles frappées le plus souvent au sceau de la terre nourricière: l’Algérie. Quelques moments qu’on pressent d’une sincérité absolue pour cet auteur à coup sûr déchiré par l’Histoire. Un très beau recueil qui en dit long sur l’homme Dib et sa complexité.
En trois parties, «Ici», «Ailleurs» et «La Guerre», Mohammed Dib nous donne à lire un recueil de poèmes qui ont en commun d’être brefs: des vers courts, octosyllabes tout au plus, majoritairement terminés par un point, et formant des strophes de trois ou quatre vers. Comme le titre le laisse prévoir, le thème de l’enfance caractérise l’ensemble du recueil. On y trouve des historiettes isolées, plus souvent des esquisses, avec force répétitions comme dans les comptines.
Un livre de Mohammed Dib qui révèle, par-delà l’économie des moyens mis en œuvre, un véritable maître de la variation.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Mohammed Dib
Lecteurs de Mohammed Dib (521)Voir plus
Quiz
Voir plus
Mohammed Dib et son oeuvre
Mohammed Dib est originaire de :
Kabylie
Tlemcen
Alger
Constantine
10 questions
10 lecteurs ont répondu
Thème :
Mohammed DibCréer un quiz sur cet auteur10 lecteurs ont répondu