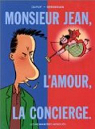Critiques de Philippe Dupuy (132)
*** Critique valable pour les deux premiers tomes ***
Henriette est une collégienne mal dans sa peau. « Une petite grosse » comme elle se définit. Mais elle a du caractère et essaie de s’imposer face à ses parents, ses profs, le monde entier… Elle a une sensibilité à fleur de peau et aimerait être écrivaine. Mais personne ne la comprend…
Henriette m’a fait penser à Mafalda de Quino. Mais chez la petite espagnole, point de complexe (ou je ne m’en souviens pas) alors que dans ces deux albums, c’est tout de même ce qu’il ressort. Ah, si cela pouvait faire en sorte que le regard des gens ne s’arrête pas à une enveloppe physique !
Lien : https://promenadesculturelle..
Henriette est une collégienne mal dans sa peau. « Une petite grosse » comme elle se définit. Mais elle a du caractère et essaie de s’imposer face à ses parents, ses profs, le monde entier… Elle a une sensibilité à fleur de peau et aimerait être écrivaine. Mais personne ne la comprend…
Henriette m’a fait penser à Mafalda de Quino. Mais chez la petite espagnole, point de complexe (ou je ne m’en souviens pas) alors que dans ces deux albums, c’est tout de même ce qu’il ressort. Ah, si cela pouvait faire en sorte que le regard des gens ne s’arrête pas à une enveloppe physique !
Lien : https://promenadesculturelle..
Rrraahhhrg ! Le grille-pain ! Aah ! oui, oui !
-
Ce tome est initialement paru après le tome 4 Monsieur Jean, tome 4 : Vivons heureux sans en avoir l'air (1997), mais son action se situe entre le tome 3 Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1997) et le tome 4. Sa première édition date de 2000 en noir & blanc, et il a été réédité en 2010, en bichromie. C’est le deuxième album hors-série après [[ASIN:2909020347 Journal d’un album]] (1994). Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario, les dessins et la bichromie, par Philippe Dupuy et Charles Berberian. Il comprend cent-vingt-quatre pages de bandes dessinées.
Chapitre un, dix pages : ça commence mal. Monsieur Jean est en train de dormir paisiblement dans son lit double, avec quelques livres sur ses draps. Le réveil sonne ; il reprend conscience. Il voit dans sa chambre, devant lui trois hommes en costumes noir avec des lunettes noires, pointant chacun un pistolet vers sa tête. Il se fait la réflexion que cette journée commence assez mal. Il sort les jambes du lit et s’assied sur son séant, et se rend dans la salle de bain. Il constate sa mine défaite et pas fraîche dans le miroir. Il urine debout. Il se rend dans la cuisine et prend un bol de café, pendant que les trois tueurs sont assis, pistolet en l’air, chacun une tasse de café devant eux. Monsieur Jean leur demande s’ils vont le tuer sans lui expliquer pourquoi ou pour qui. Il souhaite qu’ils lui laissent dire au revoir à ses amis une dernière fois. Ils lui répondent que ses amis ne sont pas vraiment des amis, désolé. Il va ensuite se couper les ongles, se faire couleur un bain, et se glisser tranquillement dedans, en fermant les yeux pour mieux en apprécier la sensation. Il les rouvre en sursaut quand il entend éternuer : les trois porte-flingues, toujours en costume, sont dans le bain avec lui. Puis Monsieur Jean s’habille, se coiffe, se regarde dans la glace. Il tombe à genoux et il les supplie de lui accorder de voir une dernière fois son film préféré : Baisers volés (1968) réalisé par François Truffaut.
Chapitre deux, cinq pages : Félix dans le bus. Félix, un copain de Monsieur Jean, lit le dernier numéro de Science & Vie, assis dans le bus. Un couple s’assied en face de lui, une jeune femme fluette et un gros malabar. Ce dernier se montre agressif vis-à-vis de sa compagne, finissant par se lever et la gifler. Félix intervient, mais les deux lui répondent agressivement, et la femme lui décoche un coup de pied dans le tibia. Chapitre trois, sept pages : la théorie des gens seuls. Félix, Clément, Monsieur Jean et deux copines sont assis sur un banc dans un patio en train de papoter tranquillement. Félix monopolise un peu la parole en exposant sa théorie des gens seuls : le problème des gens seuls, c’est qu’ils sont seuls. Et que tant qu’on est seul, on n’est pas attiré par une autre personne seule. Les gens seuls ne sont pas attirés par les autres célibataires, mais pas quelqu’un qui est déjà avec un autre.
En découvrant cet ouvrage, le lecteur note deux particularités qui sautent aux yeux : les dessins plus lâchés que dans les autres tomes avec une apparence parfois presque crayonnée, et le retour à des chapitres autonomes plutôt qu’un récit à l’échelle de l’’album. Dans la version en bichromie, les artistes ont choisi un bleu entre bleu bleuet et bleu pastel pour habiller les dessins, tout en laissant quelques zones de blanc pour des reflets, des ambiances lumineuses, la plupart des visages, ainsi que les phylactères. Les traits semblent avoir été réalisés avec un crayon gras, ce qui donne des contours parfois un peu irréguliers, pour une apparence plus spontanée, plus vivante. Le lecteur éprouve également la sensation que la densité des informations est un peu moindre que pour les albums de la série, avec une grille de six cases comme principe, en trois rangées de deux cases. Dans certaines planches des cases peuvent être fusionnées pour ne donner qu’une case de la largeur de la page. Pour l’histoire de Félix dans le bus et quelques pages éparses, les dessinateurs passent à la grille de trois (cases) par trois (bandes), dite gaufrier. Le lecteur éprouve une sensation de pages moins denses, très faciles à lire, plus animées, avec un certain nombre de gros plans et de plans poitrine. Pour autant, elles ne semblent pas vides.
En effet, la taille un peu plus grande des cases donne de l’espace aux personnages, et permet également de contenir un nombre d’informations visuelles important sans donner l’impression de saturer l’espace délimité par les bordures. Ainsi dans la planche d’ouverture avec son dessin en pleine page, le lecteur peut voir les cinq livres sur la couverture du lit, les deux sur la descente de lit avec les chaussures juste à côté, la table de chevet avec sa lampe et son verre d’eau, les chaussettes au pied du lit, le rebord de la fenêtre, un rideau non tiré et le grand cadre qui surplombe la tête de lit. Par la suite, le lecteur découvre les autres pièces de l’appartement de Monsieur Jean : l’autre côté du lit, la salle de bain avec son lavabo et sa cuvette des toilettes sans oublier une petite étagère de livres, la table de cuisine et quelques placards de rangement au mur, la baignoire, le miroir en pied. Tout du long des neuf chapitres, les artistes vont l’emmener dans de nombreux endroits différents : un petit restaurant de quartier où mangent Clément & Jean, un bus, des rues parisiennes, le salon de Monsieur Jean avec son canapé et son poste de télé, un square avec ses bancs, un pavillon à la campagne pour un anniversaire, un plateau de télévision pour une interview, un autre restaurant, une gare parisienne, une cabine d’ascenseur, une autre maison à la campagne. À chaque fois, le dosage des ingrédients s’avère parfait : assez pour que chaque lieu soit spécifique, pas trop pour ne pas alourdir la case ou ralentir la lecture.
Pas de doute, c’est bien les mêmes dessinateurs, avec les mêmes caractéristiques pour les personnages : des gros nez ou parfois très allongés pour les hommes, des nez plus menus et plus effilés pour ces dames, des silhouettes aux contours un peu arrondis et très normales pour les hommes, des morphologies plus affinées et allongées pour les femmes, des tenues peu recherchées pour les hommes, et élégantes pour les femmes même lorsqu’elles sont simples. Les yeux des personnages se réduisent souvent à un simple point, ou un trait, de même que leur bouche. Les expressions de visage peuvent être exagérées pour un effet comique à l’occasion d’une émotion plus intense. Le langage corporel reste dans un registre naturaliste, sauf pour les poses vives ou intimidantes des trois porte-flingues. Les scènes avec de nombreux personnages montrent des interactions sociales très policées, entre gens de bonne éducation. Il se produit bien un ou deux agacements pouvant aller jusqu’à l’énervement de temps à autre, toutefois le lecteur sent bien qu’aucune situation ne peut virer au drame. Pour autant, les sentiments exprimés le touchent, ainsi qu’à nouveau la situation du jeune enfant Eugène, née de Marlène qui ne s’en occupe plus et qui l’a confié à Félix dont elle s’est séparé et qui n’est pas le père, l’enfant étant souvent pris en charge par Jean.
Les deux créateurs racontent neuf histoires courtes allant de cinq à vingt-six pages, avec des situations comme la présence intermittente des porte-flingues, un voyage dans le bus, du papotage entre potes, des considérations sur le désir masculin, un anniversaire à une soirée à la campagne, l’usage d’un grille-pain, Félix éméché et quelque peu désenchanté, Félix coincé dans un ascenseur, et pour finir Monsieur Jean acceptant d’aller se mettre au vert dans la maison de campagne des parents de Cathy. Dans un premier temps, l’artifice des trois tueurs laissent le lecteur perplexe. Par la suite, il retrouve cette ambiance parisienne et même parisianiste, entre personnes sans soucis financiers (sauf pour Félix) peu stressés par les responsabilités. Félix endosse le rôle de grincheux, de déçu de la vie, avec une vision certes pessimiste, mais aussi lucide. Au cours de l’incident dans le bus, il finit par faire le constat au profit d’un couple que dans la vie, il n’y a que les mauvaises choses qui peuvent tomber sur quelqu’un par hasard, jamais les bonnes choses. Il en conclut que c’est la raison pour laquelle partout ça va mal. Le lecteur finit par se dire que ces porte-flingues qui n’apparaissent que dans la première et la dernière histoire incarnent littéralement les oiseaux de mauvais augure, la dépression qui guette, la tentation de succomber au pessimisme, sans plus essayer de lutter. Finalement ces trois tueurs relèvent bien d’une incarnation de la mort au premier degré, le risque d’estimer qu’il ne sert à rien de faire face aux aléas de la vie car ceux-ci sont trop en trop grand nombre et de trop grande ampleur pour pouvoir espérer les surmonter. Dans le même temps, Monsieur Jean fait tout pour préserver sa bulle de protection, et surtout ne pas se laisser toucher par le malheur des autres. Comme pour les dessins, la tonalité de la narration tient tout drame à distance, avec des touches humoristiques légères et touchantes, pouvant aller jusqu’à l’absurde dans cette histoire de panne d’ascenseur, et encore plus dans ce mystérieux accessoire érotique qu’est le grille-pain.
Un album hors-série : est-ce bien la peine de s’investir dans une telle lecture ? Il suffit que le lecteur feuillète l’album pour qu’il tombe sous le charme des dessins d’une rare élégance, sans afféterie, d’une belle expressivité sans moquerie, d’une clarté remarquable. Il découvre une nouvelle après l’autre, et retrouve cette intimité émotionnelle pudique avec les personnages qui lui permet de se sentir frère en humanité, même s’il n’est pas parisien.
-
Ce tome est initialement paru après le tome 4 Monsieur Jean, tome 4 : Vivons heureux sans en avoir l'air (1997), mais son action se situe entre le tome 3 Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1997) et le tome 4. Sa première édition date de 2000 en noir & blanc, et il a été réédité en 2010, en bichromie. C’est le deuxième album hors-série après [[ASIN:2909020347 Journal d’un album]] (1994). Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario, les dessins et la bichromie, par Philippe Dupuy et Charles Berberian. Il comprend cent-vingt-quatre pages de bandes dessinées.
Chapitre un, dix pages : ça commence mal. Monsieur Jean est en train de dormir paisiblement dans son lit double, avec quelques livres sur ses draps. Le réveil sonne ; il reprend conscience. Il voit dans sa chambre, devant lui trois hommes en costumes noir avec des lunettes noires, pointant chacun un pistolet vers sa tête. Il se fait la réflexion que cette journée commence assez mal. Il sort les jambes du lit et s’assied sur son séant, et se rend dans la salle de bain. Il constate sa mine défaite et pas fraîche dans le miroir. Il urine debout. Il se rend dans la cuisine et prend un bol de café, pendant que les trois tueurs sont assis, pistolet en l’air, chacun une tasse de café devant eux. Monsieur Jean leur demande s’ils vont le tuer sans lui expliquer pourquoi ou pour qui. Il souhaite qu’ils lui laissent dire au revoir à ses amis une dernière fois. Ils lui répondent que ses amis ne sont pas vraiment des amis, désolé. Il va ensuite se couper les ongles, se faire couleur un bain, et se glisser tranquillement dedans, en fermant les yeux pour mieux en apprécier la sensation. Il les rouvre en sursaut quand il entend éternuer : les trois porte-flingues, toujours en costume, sont dans le bain avec lui. Puis Monsieur Jean s’habille, se coiffe, se regarde dans la glace. Il tombe à genoux et il les supplie de lui accorder de voir une dernière fois son film préféré : Baisers volés (1968) réalisé par François Truffaut.
Chapitre deux, cinq pages : Félix dans le bus. Félix, un copain de Monsieur Jean, lit le dernier numéro de Science & Vie, assis dans le bus. Un couple s’assied en face de lui, une jeune femme fluette et un gros malabar. Ce dernier se montre agressif vis-à-vis de sa compagne, finissant par se lever et la gifler. Félix intervient, mais les deux lui répondent agressivement, et la femme lui décoche un coup de pied dans le tibia. Chapitre trois, sept pages : la théorie des gens seuls. Félix, Clément, Monsieur Jean et deux copines sont assis sur un banc dans un patio en train de papoter tranquillement. Félix monopolise un peu la parole en exposant sa théorie des gens seuls : le problème des gens seuls, c’est qu’ils sont seuls. Et que tant qu’on est seul, on n’est pas attiré par une autre personne seule. Les gens seuls ne sont pas attirés par les autres célibataires, mais pas quelqu’un qui est déjà avec un autre.
En découvrant cet ouvrage, le lecteur note deux particularités qui sautent aux yeux : les dessins plus lâchés que dans les autres tomes avec une apparence parfois presque crayonnée, et le retour à des chapitres autonomes plutôt qu’un récit à l’échelle de l’’album. Dans la version en bichromie, les artistes ont choisi un bleu entre bleu bleuet et bleu pastel pour habiller les dessins, tout en laissant quelques zones de blanc pour des reflets, des ambiances lumineuses, la plupart des visages, ainsi que les phylactères. Les traits semblent avoir été réalisés avec un crayon gras, ce qui donne des contours parfois un peu irréguliers, pour une apparence plus spontanée, plus vivante. Le lecteur éprouve également la sensation que la densité des informations est un peu moindre que pour les albums de la série, avec une grille de six cases comme principe, en trois rangées de deux cases. Dans certaines planches des cases peuvent être fusionnées pour ne donner qu’une case de la largeur de la page. Pour l’histoire de Félix dans le bus et quelques pages éparses, les dessinateurs passent à la grille de trois (cases) par trois (bandes), dite gaufrier. Le lecteur éprouve une sensation de pages moins denses, très faciles à lire, plus animées, avec un certain nombre de gros plans et de plans poitrine. Pour autant, elles ne semblent pas vides.
En effet, la taille un peu plus grande des cases donne de l’espace aux personnages, et permet également de contenir un nombre d’informations visuelles important sans donner l’impression de saturer l’espace délimité par les bordures. Ainsi dans la planche d’ouverture avec son dessin en pleine page, le lecteur peut voir les cinq livres sur la couverture du lit, les deux sur la descente de lit avec les chaussures juste à côté, la table de chevet avec sa lampe et son verre d’eau, les chaussettes au pied du lit, le rebord de la fenêtre, un rideau non tiré et le grand cadre qui surplombe la tête de lit. Par la suite, le lecteur découvre les autres pièces de l’appartement de Monsieur Jean : l’autre côté du lit, la salle de bain avec son lavabo et sa cuvette des toilettes sans oublier une petite étagère de livres, la table de cuisine et quelques placards de rangement au mur, la baignoire, le miroir en pied. Tout du long des neuf chapitres, les artistes vont l’emmener dans de nombreux endroits différents : un petit restaurant de quartier où mangent Clément & Jean, un bus, des rues parisiennes, le salon de Monsieur Jean avec son canapé et son poste de télé, un square avec ses bancs, un pavillon à la campagne pour un anniversaire, un plateau de télévision pour une interview, un autre restaurant, une gare parisienne, une cabine d’ascenseur, une autre maison à la campagne. À chaque fois, le dosage des ingrédients s’avère parfait : assez pour que chaque lieu soit spécifique, pas trop pour ne pas alourdir la case ou ralentir la lecture.
Pas de doute, c’est bien les mêmes dessinateurs, avec les mêmes caractéristiques pour les personnages : des gros nez ou parfois très allongés pour les hommes, des nez plus menus et plus effilés pour ces dames, des silhouettes aux contours un peu arrondis et très normales pour les hommes, des morphologies plus affinées et allongées pour les femmes, des tenues peu recherchées pour les hommes, et élégantes pour les femmes même lorsqu’elles sont simples. Les yeux des personnages se réduisent souvent à un simple point, ou un trait, de même que leur bouche. Les expressions de visage peuvent être exagérées pour un effet comique à l’occasion d’une émotion plus intense. Le langage corporel reste dans un registre naturaliste, sauf pour les poses vives ou intimidantes des trois porte-flingues. Les scènes avec de nombreux personnages montrent des interactions sociales très policées, entre gens de bonne éducation. Il se produit bien un ou deux agacements pouvant aller jusqu’à l’énervement de temps à autre, toutefois le lecteur sent bien qu’aucune situation ne peut virer au drame. Pour autant, les sentiments exprimés le touchent, ainsi qu’à nouveau la situation du jeune enfant Eugène, née de Marlène qui ne s’en occupe plus et qui l’a confié à Félix dont elle s’est séparé et qui n’est pas le père, l’enfant étant souvent pris en charge par Jean.
Les deux créateurs racontent neuf histoires courtes allant de cinq à vingt-six pages, avec des situations comme la présence intermittente des porte-flingues, un voyage dans le bus, du papotage entre potes, des considérations sur le désir masculin, un anniversaire à une soirée à la campagne, l’usage d’un grille-pain, Félix éméché et quelque peu désenchanté, Félix coincé dans un ascenseur, et pour finir Monsieur Jean acceptant d’aller se mettre au vert dans la maison de campagne des parents de Cathy. Dans un premier temps, l’artifice des trois tueurs laissent le lecteur perplexe. Par la suite, il retrouve cette ambiance parisienne et même parisianiste, entre personnes sans soucis financiers (sauf pour Félix) peu stressés par les responsabilités. Félix endosse le rôle de grincheux, de déçu de la vie, avec une vision certes pessimiste, mais aussi lucide. Au cours de l’incident dans le bus, il finit par faire le constat au profit d’un couple que dans la vie, il n’y a que les mauvaises choses qui peuvent tomber sur quelqu’un par hasard, jamais les bonnes choses. Il en conclut que c’est la raison pour laquelle partout ça va mal. Le lecteur finit par se dire que ces porte-flingues qui n’apparaissent que dans la première et la dernière histoire incarnent littéralement les oiseaux de mauvais augure, la dépression qui guette, la tentation de succomber au pessimisme, sans plus essayer de lutter. Finalement ces trois tueurs relèvent bien d’une incarnation de la mort au premier degré, le risque d’estimer qu’il ne sert à rien de faire face aux aléas de la vie car ceux-ci sont trop en trop grand nombre et de trop grande ampleur pour pouvoir espérer les surmonter. Dans le même temps, Monsieur Jean fait tout pour préserver sa bulle de protection, et surtout ne pas se laisser toucher par le malheur des autres. Comme pour les dessins, la tonalité de la narration tient tout drame à distance, avec des touches humoristiques légères et touchantes, pouvant aller jusqu’à l’absurde dans cette histoire de panne d’ascenseur, et encore plus dans ce mystérieux accessoire érotique qu’est le grille-pain.
Un album hors-série : est-ce bien la peine de s’investir dans une telle lecture ? Il suffit que le lecteur feuillète l’album pour qu’il tombe sous le charme des dessins d’une rare élégance, sans afféterie, d’une belle expressivité sans moquerie, d’une clarté remarquable. Il découvre une nouvelle après l’autre, et retrouve cette intimité émotionnelle pudique avec les personnages qui lui permet de se sentir frère en humanité, même s’il n’est pas parisien.
Le geste de côté. Laisser aller.
-
Ce tome constitue un ouvrage complet, indépendant de tout autre. Sa première édition date de 2018. Il a été entièrement réalisé par Philippe Dupuy, de la main gauche. Ce volume comprend quatre-vingt-seize pages. Il se compose de soixante-trois illustrations, et de six courts textes. Dans la carrière de l’auteur, il est paru entre deux ouvrages de 2016 Nuages et pluie avec Loo Hui Phang Une histoire de l’art (2016), et celui paru en 2019 Une histoire de l'art - Tome 2 – Peindre.
Le geste de côté. Laisser aller. Laisser aller et oublier le geste coutumier. Celui de la main qui sait, intuitivement, mais savante. Oublier l’aisance et les années de pratique. Retomber en enfance et découvrir l’imprévu, l’inexpérience et la spontanéité. La douleur est la chance de l’artiste. Elle l’oblige à la reconquête. Deux femmes pieds nus, debout, avec les cheveux longs, en longue robe sans manche, bras nus, côte à côte, comme adossées au mur d’une pièce, derrière celle de droite dépasse un serpent comme sortant de sa chevelure. De l’autre côté de la porte ouverte passe un lion anthropomorphe à tête de coq ; il ne semble pas être conscient de la présence des deux femmes. - Une femme nue allongée sur le ventre à même le sol, recroquevillée sur elle-même. Derrière elle, se tient une silhouette vague, avec comme une aile devant elle de la hauteur de son corps, un oiseau semble comme posé sur son épaule gauche. – Une femme étendue allongée sur le ventre, nue. Elle se trouve peut-être à même le sol d’une nature indéterminée, ou peut-être en train de flotter à la surface de l’eau d’une piscine. Derrière se trouve un aménagement végétal, formant comme une fenêtre, un minuscule bosquet, et peut-être un tronc avec de larges feuilles.
Une petite silhouette féminine nue, de profil, son bras gauche placé sous sa poitrine. En arrière-plan, un arbre en plein pied avec un feuillage, comme vu au travers d’une fenêtre de plain-pied, en ogive. Au sol un élément rond difficilement identifiable. – Une femme nue allongée à même le sol, les genoux légèrement fléchis, le corps partiellement recouvert d’un drap qu’elle maintient avec ses mains. Juste devant ses pieds se trouve un petit tronc d’arbre dénudé, peut-être un mètre de haut. – Une autre femme dénudée étendue dans l’herbe, mais au-dessus de sa poitrine, son buste est remplacé par une main gauche géante, de sorte que le poignet se raccorde à sa largeur d’épaules. – Une jeune fille habillée d’une robe se tient sur un petit monticule, presqu’un pain de sucre, bien droite, les deux bras écartés à l’horizontale, une sorte de halo émanant de la partie supérieure de son corps. Une page de texte : C’est un miroir. Le membre inerte a disparu entraînant avec lui des paysages insoupçonnés. Oublier. Être parti à leur recherche, étendus, offerts comme des amants délaissés. Ignorer tout, mais savoir. Plonger et s’abandonner dans les profondeurs.
Cet ouvrage ne semble en rien fait pour un lecteur de passage. Pour commencer, il s’agit d’une lecture de droite à gauche : la couverture se trouve en lieu et place de la quatrième de couverture avec le dos se trouvant donc sur la droite, et non sur la gauche comme pour un ouvrage occidental classique. La couverture représente une main gauche bandée, avec le titre écrit de droite à gauche T F E L, les lettres ayant également été inversées comme dans un miroir. En bas figurent le nom et le prénom de l’auteur, également écrits de droite à gauche, également avec des lettres ayant subi une rotation axiale. La finition de l’ouvrage est de type toilé, avec une couleur marronnasse, et donc une quatrième de couverture vierge. Sous réserve qu’il soit familier de l’auteur ou vraiment très curieux, le lecteur jette un coup d’œil aux pages intérieures. Il découvre comme des feuilles de papier couleur crème collées sur la page blanche, parfois une feuille de couleur ocre, parfois comme une feuille coquille d’œuf collée sur une feuille ocre, elle-même collée sur la page blanche. Parfois un collage, parfois deux images raboutées, parfois des traces de correcteur liquide. La graphie des pages de court texte est malhabile et irrégulière, tout en lettres capitales. La suite d’images ne forme pas une narration, même pour un lecteur doté d’une imagination délirante. Les textes peuvent paraître sibyllins, vaguement poétiques, ils ne racontent pas non plus une histoire. Le dernier ressemble au commentaire d’une radiographie du dos.
Malgré son caractère hermétique, cet ouvrage constitue une étape essentielle dans la vie de l’auteur, dans le développement de son art. Il fait entièrement sens si le lecteur est familier des œuvres ultérieures de Philippe Dupuy, des thèmes récurrents qui les parcourent. Sous les dehors d’une collection d’images disparates et malhabiles, avec une fixette bizarre pour les femmes nues, le lecteur retrouve la genèse de la phase suivante de l’œuvre du bédéiste. En 2022, il publie un ouvrage intitulé [[ASIN:B09LY1SB4P Mon papa dessine des femmes nues]], évoquant à la fois la nudité dans l’art et son ressenti pour de nombreux artistes picturaux, ainsi que pour les œuvres de Takako Saito. Dans J’aurais voulu faire de la bande dessinée (2020) avec Stephan Oliva & Dominique A, il évoque son intégration de dessins réalisés de la main gauche dans ses bandes dessinées, sa quête de sortir de ses habitudes de bédéiste acquises au cours de décennies de pratique pour apprendre et raffiner son art. Dans J’aurais voulu voir Godard (2023), il se confronte à la démarche artistique du cinéaste, à sa propre recherche sur la nature de l’art, sur l’exploration de pistes moins conventionnelles. Avec ces éléments en tête, le lecteur peut apprécier la présente collection de dessins. Il se souvient que dans l’ouvrage avec Oliva & A, Dupuy évoque le fait que certaines œuvres d’art parlent immédiatement, sur le plan des sentiments, des émotions, et que d’autres nécessitent une forme d’acculturation, ou de bénéficier de l’entremise d’un passeur, et qu’il en va ainsi de certaines bandes dessinées qui ne sont pas immédiatement accessibles au lecteur néophyte en bande dessinée.
Une fois sa curiosité mise en éveil, le lecteur peut accéder en ligne à un article de Frédéric Holjo qui évoque les maladies dont a souffert l’auteur à ce moment de sa vie en 2015 : discopathie, hernie, cervicarthrose, névralgie, autant de douleurs et d’empêchements physiques qui l’ont conduit à la paralysie complète de sa main droite, et à apprendre à dessiner de la main gauche. Le dernier texte inclus dans Left correspond à un diagnostic : Disque C4-C5 : Discopathie et ouverture de l’espace inter-somatique postérieur en regard une hernie paramédiane droite pré-foraminale droite sous-ligamentaire légèrement migrée vers le hait de 9 par 5 par 7mm comprimant la racine C5 droite. – Disque C5-C6 : Cervicathrose débordant circonférentiellement un peu plus dans la partie basse du foramen droit possible conflit C6 droit avec un carthrose. – Disque C6-C7 : cervicathrose et un carthrose rétrécissant les formina droit et gauche contact radiculaire C7 bilatéral. – Cervicathrose déjà évoluée C6-C7 avec retentissement foraminal droit plus marqué. Volumineuse hernie paramédiane pré-foraminale et foraminale droite C4-C5 et conflit droit. Névralgies cervico-brachiales droites hyperalgiques avec diminution de la force musculaire.
Le regard orienté par ces explications, le lecteur envisage cette collection d’un autre œil : le témoignage d’une redécouverte du dessin, sans la maîtrise de l’outil qu’est la main, avec des gestes malhabiles desquels naissent des imprévus. Par la suite, le bédéiste va conserver cette technique, réalisant parfois des dessins de la main gauche pour leur spontanéité, le contrôle amoindri du geste menant à des traits inattendus. S’il a lu ses ouvrages postérieurs à Left, le lecteur a pu faire l’expérience de ce qu’apportent ces dessins réalisés avec du lâcher prise, comment ils participent à l’expression de Philippe Dupuy, comment ils s’inscrivent aux côtés d’autres idiosyncrasies de cet artiste, aboutissant à des œuvres totalement personnelles, indissociables de l’auteur, des facettes inaltérables de sa personnalité. Dans ces images, le lecteur ne voit plus des dessins grossiers, inexpérimentés et indignes d’un professionnel. En effet, le dessinateur exprime sa vision du monde, compose des images qui lui sont propres, associe des éléments inattendus, rapproche des visuels, crée avec l’expérience de décennies accumulées en faisant avec les limitations physiques de son corps.
Dans le même temps, la pulsion d’identification des schémas, très humaine, fait son œuvre, et le lecteur se retrouve à projeter une interprétation sur ce qu’il voit, quand bien même il s’agit de dessins disparates. Il peut les apprécier un par un : tout ce que le corps féminin véhicule comme imageries culturelles et comme associations d’idées. Une femme habillée repoussant un homme habillé, tous les deux pieds nus, avec une main tendue venant de la droite pour porter assistance à la femme : une situation archétypale, des symboles, du harcèlement et de l’aide, l’éternel féminin et la pulsion masculine. L’esprit du lecteur se met en surchauffe à l’idée de toutes les significations potentielles, tout en sachant qu’il n’aura jamais la clé du mystère. Une femme allongée avec une abondante chevelure qui forme une pieuvre de sa taille, comme la manifestation de l’inconscient sous la surface, ou la personnalité profonde de cet être humain, ou… Sur la page de droite, une femme à quatre pattes, vue de dos, sa main gauche posée au sommet d’un tétraèdre, et sur la page en vis-à-vis une collection de triangles reprenant la forme générale du dessin de droite. Un cerf avec de grands bois courant vers une maison minuscule. Autant d’images qui suscitent rêveries et interrogations. Il y a bien l’esprit d’un artiste à l’œuvre, d’un poète également. Au bout de quelques pages en découvrant un nouveau dessin, le lecteur revient en arrière pour se remémorer un dessin en particulier, imaginer que les deux ont été faits à la suite, puis espacés de plusieurs pages, tout en sachant parfaitement qu’il affabule, et qu’il ne saura jamais rien de la réalité des choses. Deux radiographies retouchées et miniaturisées évoquant les examens médicaux effectués par l’artiste, attestant de ses douleurs, enfin… c’est ce que suppose le lecteur, parce que rien ne prouve qu’il s’agisse des radios de l’auteur.
C’est quoi ce truc ? Cette collection de dessins maladroits, parfois retouchés au correcteur liquide, comme réalisés sur des pages collées sur chaque page blanche, ces textes écrits de droite à gauche avec des lettres irrégulières ? Il faut que le lecteur puisse contextualiser ces images dans la vie et l’œuvre du bédéiste pour pleinement les apprécier, pour comprendre ce qu’elles racontent de sa vie et de sa vision de créateur. Il est aussi possible de se laisser porter par ces femmes, ces postures, ces dessins comme issus d’une écriture automatique, par ces associations libres, par la présence du règne animale, et laisser son esprit divaguer, lâcher prise. Unique.
-
Ce tome constitue un ouvrage complet, indépendant de tout autre. Sa première édition date de 2018. Il a été entièrement réalisé par Philippe Dupuy, de la main gauche. Ce volume comprend quatre-vingt-seize pages. Il se compose de soixante-trois illustrations, et de six courts textes. Dans la carrière de l’auteur, il est paru entre deux ouvrages de 2016 Nuages et pluie avec Loo Hui Phang Une histoire de l’art (2016), et celui paru en 2019 Une histoire de l'art - Tome 2 – Peindre.
Le geste de côté. Laisser aller. Laisser aller et oublier le geste coutumier. Celui de la main qui sait, intuitivement, mais savante. Oublier l’aisance et les années de pratique. Retomber en enfance et découvrir l’imprévu, l’inexpérience et la spontanéité. La douleur est la chance de l’artiste. Elle l’oblige à la reconquête. Deux femmes pieds nus, debout, avec les cheveux longs, en longue robe sans manche, bras nus, côte à côte, comme adossées au mur d’une pièce, derrière celle de droite dépasse un serpent comme sortant de sa chevelure. De l’autre côté de la porte ouverte passe un lion anthropomorphe à tête de coq ; il ne semble pas être conscient de la présence des deux femmes. - Une femme nue allongée sur le ventre à même le sol, recroquevillée sur elle-même. Derrière elle, se tient une silhouette vague, avec comme une aile devant elle de la hauteur de son corps, un oiseau semble comme posé sur son épaule gauche. – Une femme étendue allongée sur le ventre, nue. Elle se trouve peut-être à même le sol d’une nature indéterminée, ou peut-être en train de flotter à la surface de l’eau d’une piscine. Derrière se trouve un aménagement végétal, formant comme une fenêtre, un minuscule bosquet, et peut-être un tronc avec de larges feuilles.
Une petite silhouette féminine nue, de profil, son bras gauche placé sous sa poitrine. En arrière-plan, un arbre en plein pied avec un feuillage, comme vu au travers d’une fenêtre de plain-pied, en ogive. Au sol un élément rond difficilement identifiable. – Une femme nue allongée à même le sol, les genoux légèrement fléchis, le corps partiellement recouvert d’un drap qu’elle maintient avec ses mains. Juste devant ses pieds se trouve un petit tronc d’arbre dénudé, peut-être un mètre de haut. – Une autre femme dénudée étendue dans l’herbe, mais au-dessus de sa poitrine, son buste est remplacé par une main gauche géante, de sorte que le poignet se raccorde à sa largeur d’épaules. – Une jeune fille habillée d’une robe se tient sur un petit monticule, presqu’un pain de sucre, bien droite, les deux bras écartés à l’horizontale, une sorte de halo émanant de la partie supérieure de son corps. Une page de texte : C’est un miroir. Le membre inerte a disparu entraînant avec lui des paysages insoupçonnés. Oublier. Être parti à leur recherche, étendus, offerts comme des amants délaissés. Ignorer tout, mais savoir. Plonger et s’abandonner dans les profondeurs.
Cet ouvrage ne semble en rien fait pour un lecteur de passage. Pour commencer, il s’agit d’une lecture de droite à gauche : la couverture se trouve en lieu et place de la quatrième de couverture avec le dos se trouvant donc sur la droite, et non sur la gauche comme pour un ouvrage occidental classique. La couverture représente une main gauche bandée, avec le titre écrit de droite à gauche T F E L, les lettres ayant également été inversées comme dans un miroir. En bas figurent le nom et le prénom de l’auteur, également écrits de droite à gauche, également avec des lettres ayant subi une rotation axiale. La finition de l’ouvrage est de type toilé, avec une couleur marronnasse, et donc une quatrième de couverture vierge. Sous réserve qu’il soit familier de l’auteur ou vraiment très curieux, le lecteur jette un coup d’œil aux pages intérieures. Il découvre comme des feuilles de papier couleur crème collées sur la page blanche, parfois une feuille de couleur ocre, parfois comme une feuille coquille d’œuf collée sur une feuille ocre, elle-même collée sur la page blanche. Parfois un collage, parfois deux images raboutées, parfois des traces de correcteur liquide. La graphie des pages de court texte est malhabile et irrégulière, tout en lettres capitales. La suite d’images ne forme pas une narration, même pour un lecteur doté d’une imagination délirante. Les textes peuvent paraître sibyllins, vaguement poétiques, ils ne racontent pas non plus une histoire. Le dernier ressemble au commentaire d’une radiographie du dos.
Malgré son caractère hermétique, cet ouvrage constitue une étape essentielle dans la vie de l’auteur, dans le développement de son art. Il fait entièrement sens si le lecteur est familier des œuvres ultérieures de Philippe Dupuy, des thèmes récurrents qui les parcourent. Sous les dehors d’une collection d’images disparates et malhabiles, avec une fixette bizarre pour les femmes nues, le lecteur retrouve la genèse de la phase suivante de l’œuvre du bédéiste. En 2022, il publie un ouvrage intitulé [[ASIN:B09LY1SB4P Mon papa dessine des femmes nues]], évoquant à la fois la nudité dans l’art et son ressenti pour de nombreux artistes picturaux, ainsi que pour les œuvres de Takako Saito. Dans J’aurais voulu faire de la bande dessinée (2020) avec Stephan Oliva & Dominique A, il évoque son intégration de dessins réalisés de la main gauche dans ses bandes dessinées, sa quête de sortir de ses habitudes de bédéiste acquises au cours de décennies de pratique pour apprendre et raffiner son art. Dans J’aurais voulu voir Godard (2023), il se confronte à la démarche artistique du cinéaste, à sa propre recherche sur la nature de l’art, sur l’exploration de pistes moins conventionnelles. Avec ces éléments en tête, le lecteur peut apprécier la présente collection de dessins. Il se souvient que dans l’ouvrage avec Oliva & A, Dupuy évoque le fait que certaines œuvres d’art parlent immédiatement, sur le plan des sentiments, des émotions, et que d’autres nécessitent une forme d’acculturation, ou de bénéficier de l’entremise d’un passeur, et qu’il en va ainsi de certaines bandes dessinées qui ne sont pas immédiatement accessibles au lecteur néophyte en bande dessinée.
Une fois sa curiosité mise en éveil, le lecteur peut accéder en ligne à un article de Frédéric Holjo qui évoque les maladies dont a souffert l’auteur à ce moment de sa vie en 2015 : discopathie, hernie, cervicarthrose, névralgie, autant de douleurs et d’empêchements physiques qui l’ont conduit à la paralysie complète de sa main droite, et à apprendre à dessiner de la main gauche. Le dernier texte inclus dans Left correspond à un diagnostic : Disque C4-C5 : Discopathie et ouverture de l’espace inter-somatique postérieur en regard une hernie paramédiane droite pré-foraminale droite sous-ligamentaire légèrement migrée vers le hait de 9 par 5 par 7mm comprimant la racine C5 droite. – Disque C5-C6 : Cervicathrose débordant circonférentiellement un peu plus dans la partie basse du foramen droit possible conflit C6 droit avec un carthrose. – Disque C6-C7 : cervicathrose et un carthrose rétrécissant les formina droit et gauche contact radiculaire C7 bilatéral. – Cervicathrose déjà évoluée C6-C7 avec retentissement foraminal droit plus marqué. Volumineuse hernie paramédiane pré-foraminale et foraminale droite C4-C5 et conflit droit. Névralgies cervico-brachiales droites hyperalgiques avec diminution de la force musculaire.
Le regard orienté par ces explications, le lecteur envisage cette collection d’un autre œil : le témoignage d’une redécouverte du dessin, sans la maîtrise de l’outil qu’est la main, avec des gestes malhabiles desquels naissent des imprévus. Par la suite, le bédéiste va conserver cette technique, réalisant parfois des dessins de la main gauche pour leur spontanéité, le contrôle amoindri du geste menant à des traits inattendus. S’il a lu ses ouvrages postérieurs à Left, le lecteur a pu faire l’expérience de ce qu’apportent ces dessins réalisés avec du lâcher prise, comment ils participent à l’expression de Philippe Dupuy, comment ils s’inscrivent aux côtés d’autres idiosyncrasies de cet artiste, aboutissant à des œuvres totalement personnelles, indissociables de l’auteur, des facettes inaltérables de sa personnalité. Dans ces images, le lecteur ne voit plus des dessins grossiers, inexpérimentés et indignes d’un professionnel. En effet, le dessinateur exprime sa vision du monde, compose des images qui lui sont propres, associe des éléments inattendus, rapproche des visuels, crée avec l’expérience de décennies accumulées en faisant avec les limitations physiques de son corps.
Dans le même temps, la pulsion d’identification des schémas, très humaine, fait son œuvre, et le lecteur se retrouve à projeter une interprétation sur ce qu’il voit, quand bien même il s’agit de dessins disparates. Il peut les apprécier un par un : tout ce que le corps féminin véhicule comme imageries culturelles et comme associations d’idées. Une femme habillée repoussant un homme habillé, tous les deux pieds nus, avec une main tendue venant de la droite pour porter assistance à la femme : une situation archétypale, des symboles, du harcèlement et de l’aide, l’éternel féminin et la pulsion masculine. L’esprit du lecteur se met en surchauffe à l’idée de toutes les significations potentielles, tout en sachant qu’il n’aura jamais la clé du mystère. Une femme allongée avec une abondante chevelure qui forme une pieuvre de sa taille, comme la manifestation de l’inconscient sous la surface, ou la personnalité profonde de cet être humain, ou… Sur la page de droite, une femme à quatre pattes, vue de dos, sa main gauche posée au sommet d’un tétraèdre, et sur la page en vis-à-vis une collection de triangles reprenant la forme générale du dessin de droite. Un cerf avec de grands bois courant vers une maison minuscule. Autant d’images qui suscitent rêveries et interrogations. Il y a bien l’esprit d’un artiste à l’œuvre, d’un poète également. Au bout de quelques pages en découvrant un nouveau dessin, le lecteur revient en arrière pour se remémorer un dessin en particulier, imaginer que les deux ont été faits à la suite, puis espacés de plusieurs pages, tout en sachant parfaitement qu’il affabule, et qu’il ne saura jamais rien de la réalité des choses. Deux radiographies retouchées et miniaturisées évoquant les examens médicaux effectués par l’artiste, attestant de ses douleurs, enfin… c’est ce que suppose le lecteur, parce que rien ne prouve qu’il s’agisse des radios de l’auteur.
C’est quoi ce truc ? Cette collection de dessins maladroits, parfois retouchés au correcteur liquide, comme réalisés sur des pages collées sur chaque page blanche, ces textes écrits de droite à gauche avec des lettres irrégulières ? Il faut que le lecteur puisse contextualiser ces images dans la vie et l’œuvre du bédéiste pour pleinement les apprécier, pour comprendre ce qu’elles racontent de sa vie et de sa vision de créateur. Il est aussi possible de se laisser porter par ces femmes, ces postures, ces dessins comme issus d’une écriture automatique, par ces associations libres, par la présence du règne animale, et laisser son esprit divaguer, lâcher prise. Unique.
Bande dessinée d’idées ou une idée de la bande dessinée ?
-
Ce tome contient un récit autobiographique complet, s’appréciant mieux avec une connaissance élémentaire du réalisateur Jean-Luc Godard et de quelques-unes des caractéristiques de ses films. Sa parution initiale date de 2023. Il a entièrement été réalisé par Philippe Dupuy. Il comprend cent pages de bandes dessinées, certaines en noir & blanc, d’autres en couleurs. Il se termine avec une liste de référence des films cités ou évoqués dans l’ouvrage : Visages villages (2017) d’Agnès Varda & JR, Orphée de Jean Cocteau (1889-1963), ainsi que dix-neuf films de Godard : À bout de souffle (1960), Le petit soldat (1960), Une femme et une femme (1961), Vivre sa vie (1962), Les carabiniers (1963), Le mépris (1963), Bande à part (1964), Alphaville (1965), Pierrot le fou (1965), Masculin féminin (1966), Made in USA (1966), Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967), Week-end (1967), One + One (1968), Vladimir et Rosa (1970), Passion (1982), Prénom Carmen (1983), Je vous salue Marie (1985), Novelle vague (1990). Cette page référence également une citation de Robert Redeker provenant d’un entretien donné par JLG aux Cahiers du cinéma le dix-huit septembre 2019, et en page soixante-dix-neuf une évocation d’œuvres de Paul Klee, Edgar Degas, Pablo Picasso, Henri Matisse, Auguste Renoir, Amadeo Modigliani, Vincent van Gogh
Philippe est en route pour aller voir JLG. Enfin, disons plutôt qu’il est en route pour ne pas le voir. On plus précisément, il veut s’assurer qu’il ne le verra pas. Un jour il est tombé sur une citation de Godard. Celui-ci déclarait que s’il savait dessiner, il y aurait beaucoup de dessins. C’est quelque chose que le cinéaste regrette, ça, d’avoir oublié. Il savait un peu dessiner, et puis il n’a pas pratiqué ça ; et aujourd’hui il a un peu la flemme, mais il aimerait bien savoir dessiner, même pas habilement comme les dessinateurs de bandes dessinées, sans talent, mais dessiner à peu près correctement, dessiner quelque chose, il pense qu’il s’en servirait beaucoup. Déclaration faite dans Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Albatros, 1980.
Au volant de sa voiture, Philippe a conduit sur l’autoroute, franchit des villes, des villages, des forêts, d’autres villes, des routes pour automobiles le long d’un pont avec des arches, d’une suite de poteaux électriques, d’un mur antibruit, et enfin il a pris la sortie pour Rolle. Dans cette commune de Suisse du canton de Vaud, il parcourt les rues très tranquilles. Il cherche la maison de JLG : la trouver ou pas ? Il repense à la fameuse scène du film d’Agnès Varda dont tout le monde lui parle dès qu’il dit qu’il va aller à Rolle pour essayer de voir Godard. Dans Visages Villages, Varda et le coréalisateur JR s’arrêtent devant la maison de Godard : ils ne voient pas de sonnette, c’est fermé à clé. JR toque à la porte. Pas de réponse. Varda remarque un mot posé sur la porte : À la ville de Douarnenez, Du côté de la côte. Elle comprend qu’il évoque la mémoire de son époux Jacques Demy.
Charles Dupuy et Philippe Berberian ont formé un duo réalisant des bandes dessinées à quatre mains pendant vingt-cinq ans de 1985 à 2009, comme les séries Henriette, Monsieur Jean, ou Boboland. Puis, ils s’en sont allés chacun de leur côté, le dernier réalisant des œuvres plus aventureuses comme J'aurais voulu faire de la bande dessinée (2020), Peindre ou ne pas peindre (2021), Mon papa dessine des femmes nues (2022). La couverture avec son esthétique très particulière peut rebuter : prééminence de graphies irrégulières et hétéroclites, collage de petits dessins proches de l’esquisse. La quatrième de couverture s’apparente à un format de bandes dessinées, formulant explicitement les réticences du potentiel lecteur : encore un biopic, Godard est insupportable, incapacité à voir un seul de ses films jusqu’au bout. En page soixante-sept, l’auteur met en scène des réactions de lecteurs à sa bande dessinée : Qui aime entrer dans un album de BD comme on enfilerait des vêtements confortables à force d’être usés va être désarçonné. Difficile de mettre des mots sur des albums échappant à toute étiquette. Graphisme très rudimentaire. On a l’impression d’avoir un story-board entre les mains, avec des dessins corrigés grossièrement au Tipp-ex. Inclassable. Dessin faussement jeté. C’est un livre difficile et prétentieux. Ces dessins malhabiles faits de la main gauche avec cette justification… Ça pose le livre du côté d’un art conceptuel qui gave toujours. Ça fait poseur. C’est une bande dessinée à la frontière. Plus de questions que de réponses. Le lecteur sourit en se disant que ces objections peuvent être transposées aux films de Godard. Quelle étrange envie également de raconter une rencontre qui ne se fait pas. Au fil des réflexions de l’auteur, le lecteur relève encore le constat de Dupuy : le voilà sur un malentendu, au beau milieu d’un livre en forme d’interrogation qui prend des allures de labyrinthe. Et les remarques d’un avatar du cinéaste s’adressant à Dupuy : En fait vous vous dîtes que vous faîtes là un livre foutraque. Foutraque et égaré. Mais arrêtez donc de vous excuser. Vous craignez qu’il soit incompréhensible ? Et alors ? Dîtes-vous que ce sont parfois les autres qui sont incompréhensibles.
Ainsi bien conscient de ses a priori sur la narration visuelle et sur le thème en lui-même, le lecteur sait qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir choisi une telle bande dessinée, et qu’il s’y lance en toute connaissance de cause. Tout du long de ces cent pages, il va retrouver des marques et des artefacts de la réalisation artisanale de l’ouvrage : une pince double clip pour la page de titre pour montrer qu’il s’agit d’une pile de feuilles mises ensemble, un fond légèrement grisé pour chaque feuille pour évoquer un papier d’une qualité pas parfaite (vraisemblablement les photocopies authentiques et non retouchées des pages réelles) ; des dessins malhabiles avec des contours pas assurés et tremblotants, des textes écrits sans ligne bien droite, des mots en majuscule pour les faire ressortir, des mots parfois écrits au feutre rouge ou bleu, des petits rectangles de papier comme collés sur la page, quelques minuscules photographies au gros grain, incorporées au petit bonheur sur une page ou une autre, des graphies expérimentales évoquant un psychédélisme bon marché, une longue séquence muette sous influence onirique ou flux de pensées (pages 24 à 38), des éléments schématiques, etc. Et pour autant, les pages se lisent toutes seules, sans difficultés, sans problème de déchiffrage, ou de logique séquentielle d’une case à l’autre.
Le bédéiste maîtrise sa narration visuelle, même si l’apparence peut paraître malhabile. Le lecteur identifie aisément tout ce qui est représenté : les différentes zones traversées en voiture pour se rendre à Rolle, les conversations avec un avatar de Jean-Luc Godard dans un café, dans une barque sur le lac, dans son musée imaginaire, dans son bureau, l’extrait du film Visages Villages, la séance de dédicaces, l’évocation de l’état d’esprit de l’enfance, la reconstitution d’une scène du film Le mépris (1963), etc. En consacrant un peu d’attention, le lecteur relève la maîtrise des techniques de narration visuelle : des plans de prise de vue sophistiqués pour rendre visuellement intéressantes des conversations entre deux personnages assis, le recours au collage, la mise en œuvre de symboles jouant parfois sur les formes, parfois sur les couleurs pour relier entre eux des éléments distants de plusieurs pages, la déconstruction du dessin de la silhouette humaine sous forme d’ellipses rouges et de cercles bleus, quelques images conceptuelles allant jusqu’à l’abstraction, le jeu sur la forme des cases jusqu’à les transformer en des cubes, c’est-à-dire des éléments en trois dimensions qui s’assemble ou se bousculent sur la page en deux dimensions, de courtes expressions inscrites dans la perspective d’un dessin comme pouvait le faire Steve Ditko, des dessins minuscules accolés les uns aux autres, avec les mots dissociés disposés dans une colonne à part ou en dessous, un escalier en spirale rappelant la structure en double hélice de l’ADN, des facsimilés de tableaux classiques, etc.
Le lecteur accompagne l’auteur dans un voyage qu’il devine destiné à l’échec : d’ailleurs la visite futile d’Agnès Varda l’annonce, surtout en se disant qu’elle est plus légitime que Dupuy pour imposer ou même solliciter cette visite au réalisateur. La solution narrative s’impose d’elle-même : introduite par la citation Déjà la fiction l’emporte sur le réel (extrait de Made in USA), Philippe Dupuy commence par discuter avec un autre lui-même, tous les deux assis à la même table dans un café, puis JLG lui-même entre dans ce café et s’assoit à une autre table, indiquant explicitement à Dupuy qu’il n’est pas là, pas plus qu’ils ne sont deux. Tout cela, c’est quelque chose que le bédéiste fait parce ça l’arrange, c’est ce qu’on appelle un procédé. Il s’engage ainsi une discussion interne sous une forme de discussion entre personnages, dans différents lieux. Le lecteur voit que l’auteur met en scène sa démarche d’apprivoisement du créateur Jean-Luc Godard, au travers de ses œuvres, de quelques interviews et déclarations, de ce qu’il lui est possible de percevoir pour décortiquer sa démarche créative, son mode d’expression artistique, et, plus difficile, ce qu’il exprime, ce qu’il fait. Philippe Dupuy se montre un narrateur prévenant, même s’il craint d’être incompréhensible. Par ce mode de dialogue entre ses interrogations d’auteur et les créations du cinéaste, il fouaille sa démarche artistique, avec une honnêteté remarquable et une intimité pudique, une humilité sincère en se comparant à un monstre sacré en la matière, sans renier le caractère intellectuel de sa démarche. Il l’assume avec une citation de Simone de Beauvoir, dans Les mandarins (1954) : Je suis une intellectuelle. Ça m’agace qu’on fasse de ce mot une insulte : les gens ont l’air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles.
Une bande dessinée qui n’est pas pour tout le monde : c’est une évidence dès la couverture, et il suffit de lire le titre ou de la feuilleter pour en avoir la certitude. Pour autant, il s’agit d’une lecture très accessible, facile même. L’apparence hasardeuse et bâclées des dessins se dissipe dès la première séquence : la narration visuelle s’avère solide et fluide, avec la mise en œuvre de nombreux outils spécifiques à la bande dessinée, en toute simplicité. Un auteur parle de sa recherche de sens dans sa démarche artistique en imaginant un dialogue avec l’un des auteurs les éminents du vingtième siècle. À l’opposé d’un pensum vaniteux et stérile, le lecteur voyage dans un questionnement essentiel et vrai, sur le sens à donner ou à rechercher à son métier, à l’acte de s’exprimer, à la façon de s’extraire des schémas habituels, un peu comme Edmond Baudoin peut questionner les modalités d’expression dans Le Corps collectif: Danser l'invisible (2019).
-
Ce tome contient un récit autobiographique complet, s’appréciant mieux avec une connaissance élémentaire du réalisateur Jean-Luc Godard et de quelques-unes des caractéristiques de ses films. Sa parution initiale date de 2023. Il a entièrement été réalisé par Philippe Dupuy. Il comprend cent pages de bandes dessinées, certaines en noir & blanc, d’autres en couleurs. Il se termine avec une liste de référence des films cités ou évoqués dans l’ouvrage : Visages villages (2017) d’Agnès Varda & JR, Orphée de Jean Cocteau (1889-1963), ainsi que dix-neuf films de Godard : À bout de souffle (1960), Le petit soldat (1960), Une femme et une femme (1961), Vivre sa vie (1962), Les carabiniers (1963), Le mépris (1963), Bande à part (1964), Alphaville (1965), Pierrot le fou (1965), Masculin féminin (1966), Made in USA (1966), Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967), Week-end (1967), One + One (1968), Vladimir et Rosa (1970), Passion (1982), Prénom Carmen (1983), Je vous salue Marie (1985), Novelle vague (1990). Cette page référence également une citation de Robert Redeker provenant d’un entretien donné par JLG aux Cahiers du cinéma le dix-huit septembre 2019, et en page soixante-dix-neuf une évocation d’œuvres de Paul Klee, Edgar Degas, Pablo Picasso, Henri Matisse, Auguste Renoir, Amadeo Modigliani, Vincent van Gogh
Philippe est en route pour aller voir JLG. Enfin, disons plutôt qu’il est en route pour ne pas le voir. On plus précisément, il veut s’assurer qu’il ne le verra pas. Un jour il est tombé sur une citation de Godard. Celui-ci déclarait que s’il savait dessiner, il y aurait beaucoup de dessins. C’est quelque chose que le cinéaste regrette, ça, d’avoir oublié. Il savait un peu dessiner, et puis il n’a pas pratiqué ça ; et aujourd’hui il a un peu la flemme, mais il aimerait bien savoir dessiner, même pas habilement comme les dessinateurs de bandes dessinées, sans talent, mais dessiner à peu près correctement, dessiner quelque chose, il pense qu’il s’en servirait beaucoup. Déclaration faite dans Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris, Albatros, 1980.
Au volant de sa voiture, Philippe a conduit sur l’autoroute, franchit des villes, des villages, des forêts, d’autres villes, des routes pour automobiles le long d’un pont avec des arches, d’une suite de poteaux électriques, d’un mur antibruit, et enfin il a pris la sortie pour Rolle. Dans cette commune de Suisse du canton de Vaud, il parcourt les rues très tranquilles. Il cherche la maison de JLG : la trouver ou pas ? Il repense à la fameuse scène du film d’Agnès Varda dont tout le monde lui parle dès qu’il dit qu’il va aller à Rolle pour essayer de voir Godard. Dans Visages Villages, Varda et le coréalisateur JR s’arrêtent devant la maison de Godard : ils ne voient pas de sonnette, c’est fermé à clé. JR toque à la porte. Pas de réponse. Varda remarque un mot posé sur la porte : À la ville de Douarnenez, Du côté de la côte. Elle comprend qu’il évoque la mémoire de son époux Jacques Demy.
Charles Dupuy et Philippe Berberian ont formé un duo réalisant des bandes dessinées à quatre mains pendant vingt-cinq ans de 1985 à 2009, comme les séries Henriette, Monsieur Jean, ou Boboland. Puis, ils s’en sont allés chacun de leur côté, le dernier réalisant des œuvres plus aventureuses comme J'aurais voulu faire de la bande dessinée (2020), Peindre ou ne pas peindre (2021), Mon papa dessine des femmes nues (2022). La couverture avec son esthétique très particulière peut rebuter : prééminence de graphies irrégulières et hétéroclites, collage de petits dessins proches de l’esquisse. La quatrième de couverture s’apparente à un format de bandes dessinées, formulant explicitement les réticences du potentiel lecteur : encore un biopic, Godard est insupportable, incapacité à voir un seul de ses films jusqu’au bout. En page soixante-sept, l’auteur met en scène des réactions de lecteurs à sa bande dessinée : Qui aime entrer dans un album de BD comme on enfilerait des vêtements confortables à force d’être usés va être désarçonné. Difficile de mettre des mots sur des albums échappant à toute étiquette. Graphisme très rudimentaire. On a l’impression d’avoir un story-board entre les mains, avec des dessins corrigés grossièrement au Tipp-ex. Inclassable. Dessin faussement jeté. C’est un livre difficile et prétentieux. Ces dessins malhabiles faits de la main gauche avec cette justification… Ça pose le livre du côté d’un art conceptuel qui gave toujours. Ça fait poseur. C’est une bande dessinée à la frontière. Plus de questions que de réponses. Le lecteur sourit en se disant que ces objections peuvent être transposées aux films de Godard. Quelle étrange envie également de raconter une rencontre qui ne se fait pas. Au fil des réflexions de l’auteur, le lecteur relève encore le constat de Dupuy : le voilà sur un malentendu, au beau milieu d’un livre en forme d’interrogation qui prend des allures de labyrinthe. Et les remarques d’un avatar du cinéaste s’adressant à Dupuy : En fait vous vous dîtes que vous faîtes là un livre foutraque. Foutraque et égaré. Mais arrêtez donc de vous excuser. Vous craignez qu’il soit incompréhensible ? Et alors ? Dîtes-vous que ce sont parfois les autres qui sont incompréhensibles.
Ainsi bien conscient de ses a priori sur la narration visuelle et sur le thème en lui-même, le lecteur sait qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir choisi une telle bande dessinée, et qu’il s’y lance en toute connaissance de cause. Tout du long de ces cent pages, il va retrouver des marques et des artefacts de la réalisation artisanale de l’ouvrage : une pince double clip pour la page de titre pour montrer qu’il s’agit d’une pile de feuilles mises ensemble, un fond légèrement grisé pour chaque feuille pour évoquer un papier d’une qualité pas parfaite (vraisemblablement les photocopies authentiques et non retouchées des pages réelles) ; des dessins malhabiles avec des contours pas assurés et tremblotants, des textes écrits sans ligne bien droite, des mots en majuscule pour les faire ressortir, des mots parfois écrits au feutre rouge ou bleu, des petits rectangles de papier comme collés sur la page, quelques minuscules photographies au gros grain, incorporées au petit bonheur sur une page ou une autre, des graphies expérimentales évoquant un psychédélisme bon marché, une longue séquence muette sous influence onirique ou flux de pensées (pages 24 à 38), des éléments schématiques, etc. Et pour autant, les pages se lisent toutes seules, sans difficultés, sans problème de déchiffrage, ou de logique séquentielle d’une case à l’autre.
Le bédéiste maîtrise sa narration visuelle, même si l’apparence peut paraître malhabile. Le lecteur identifie aisément tout ce qui est représenté : les différentes zones traversées en voiture pour se rendre à Rolle, les conversations avec un avatar de Jean-Luc Godard dans un café, dans une barque sur le lac, dans son musée imaginaire, dans son bureau, l’extrait du film Visages Villages, la séance de dédicaces, l’évocation de l’état d’esprit de l’enfance, la reconstitution d’une scène du film Le mépris (1963), etc. En consacrant un peu d’attention, le lecteur relève la maîtrise des techniques de narration visuelle : des plans de prise de vue sophistiqués pour rendre visuellement intéressantes des conversations entre deux personnages assis, le recours au collage, la mise en œuvre de symboles jouant parfois sur les formes, parfois sur les couleurs pour relier entre eux des éléments distants de plusieurs pages, la déconstruction du dessin de la silhouette humaine sous forme d’ellipses rouges et de cercles bleus, quelques images conceptuelles allant jusqu’à l’abstraction, le jeu sur la forme des cases jusqu’à les transformer en des cubes, c’est-à-dire des éléments en trois dimensions qui s’assemble ou se bousculent sur la page en deux dimensions, de courtes expressions inscrites dans la perspective d’un dessin comme pouvait le faire Steve Ditko, des dessins minuscules accolés les uns aux autres, avec les mots dissociés disposés dans une colonne à part ou en dessous, un escalier en spirale rappelant la structure en double hélice de l’ADN, des facsimilés de tableaux classiques, etc.
Le lecteur accompagne l’auteur dans un voyage qu’il devine destiné à l’échec : d’ailleurs la visite futile d’Agnès Varda l’annonce, surtout en se disant qu’elle est plus légitime que Dupuy pour imposer ou même solliciter cette visite au réalisateur. La solution narrative s’impose d’elle-même : introduite par la citation Déjà la fiction l’emporte sur le réel (extrait de Made in USA), Philippe Dupuy commence par discuter avec un autre lui-même, tous les deux assis à la même table dans un café, puis JLG lui-même entre dans ce café et s’assoit à une autre table, indiquant explicitement à Dupuy qu’il n’est pas là, pas plus qu’ils ne sont deux. Tout cela, c’est quelque chose que le bédéiste fait parce ça l’arrange, c’est ce qu’on appelle un procédé. Il s’engage ainsi une discussion interne sous une forme de discussion entre personnages, dans différents lieux. Le lecteur voit que l’auteur met en scène sa démarche d’apprivoisement du créateur Jean-Luc Godard, au travers de ses œuvres, de quelques interviews et déclarations, de ce qu’il lui est possible de percevoir pour décortiquer sa démarche créative, son mode d’expression artistique, et, plus difficile, ce qu’il exprime, ce qu’il fait. Philippe Dupuy se montre un narrateur prévenant, même s’il craint d’être incompréhensible. Par ce mode de dialogue entre ses interrogations d’auteur et les créations du cinéaste, il fouaille sa démarche artistique, avec une honnêteté remarquable et une intimité pudique, une humilité sincère en se comparant à un monstre sacré en la matière, sans renier le caractère intellectuel de sa démarche. Il l’assume avec une citation de Simone de Beauvoir, dans Les mandarins (1954) : Je suis une intellectuelle. Ça m’agace qu’on fasse de ce mot une insulte : les gens ont l’air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles.
Une bande dessinée qui n’est pas pour tout le monde : c’est une évidence dès la couverture, et il suffit de lire le titre ou de la feuilleter pour en avoir la certitude. Pour autant, il s’agit d’une lecture très accessible, facile même. L’apparence hasardeuse et bâclées des dessins se dissipe dès la première séquence : la narration visuelle s’avère solide et fluide, avec la mise en œuvre de nombreux outils spécifiques à la bande dessinée, en toute simplicité. Un auteur parle de sa recherche de sens dans sa démarche artistique en imaginant un dialogue avec l’un des auteurs les éminents du vingtième siècle. À l’opposé d’un pensum vaniteux et stérile, le lecteur voyage dans un questionnement essentiel et vrai, sur le sens à donner ou à rechercher à son métier, à l’acte de s’exprimer, à la façon de s’extraire des schémas habituels, un peu comme Edmond Baudoin peut questionner les modalités d’expression dans Le Corps collectif: Danser l'invisible (2019).
Parce que le but, c’est quand même bien de faire de l’art.
-
Ce tome contient un récit complet et indépendant de tout autre, entre biographie, autobiographie et essai. Sa première édition date de 2020. Il a été réalisé par Philippe Dupuy pour le scénario, les dessins et les touches de couleurs, avec la participation de Stéphan Oliva pianiste de jazz et compositeur français, et Dominique A (Dominique Ané) auteur-compositeur-interprète français. Il comprend soixante-quatorze pages de bande dessinée. Il se termine avec le récit court intitulé J’aurais voulu être Philippe Druillet, huit pages, initialement paru dans le Cahier Aire Libre en 2018, évoquant, entre autres, l’album La Nuit paru en 1976. Sur la dernière page, l’auteur liste tous les bédéistes et artistes qu’il évoque de près ou de loin par ordre d’apparition, de Mœbius, Philippe Druillet, à Léonard de Vinci, Jean Solé, soit soixante-dix-sept artistes dont une dizaine de mangakas. Puis viennent une quinzaine de magazine ayant publié des bandes dessinées, une quinzaine de compositeurs et d’interprètes de musique classique ou pop.
Philippe Dupuy se promène dans une zone naturelle entre jardin et forêt : il observe les fruits, qui ressemblent parfois à de grosses pépites. Il trouve que c’est fou, complètement fous ces machins-là. Des matrices. Dans son esprit, il les nomme : Arzach, La nuit, Ici-même, Le bar à Joe, La R.A.B., Philémon, Hyppolite, Les frustrés, Le démon des glaces, La foire aux immortels, Les éthiopiques, Griffu, Major Fatal. Perché sur une branche d’arbre, un autre lui-même lui dit qu’il ne comprend pas ce titre : il en fait, de la bande dessinée. Le Dupuy initial répond qu’il ne sait pas, il n’en est pas si sûr. Ou pas sûr que ce qu’il fait soit de la bande dessinée. Son autre lui-même lui répond que ce n’est pas toujours simple avec lui. La réponse : pas du tout, c’est limpide. Ils arrivent devant une mare limpide et ils plongent leur regard dedans : une autre version de Philippe Dupuy s’y trouve, il a cinq ans, six ans peut-être ? Il dessine. Il dessine tout le temps. Il est allongé par terre dans le salon, sur le ventre, en train de dessiner, son horizon : les jambes de sa mère. Ses jambes. Toujours ses jambes.
Allongé sur le ventre, le jeune Philippe décalque les fascicules de Picsou Magazine. Picsou est la bande dessinée de son enfance. D’où vient tout ce calque ? Toujours il dessine. Toujours il a dessiné. Pilote débarque à la maison, comment cela est-il possible ? C’est quoi cette histoire ? Qui a eu l’idée de l’abonner à l’Hebdo ? C’est un raz-de-marée ! Il y a tout. La brèche est ouverte, il s’y engouffre. Un véritable geyser jaillit de la mare limpide, s’élevant vers le haut, charriant une vingtaine de héros comme Blueberry, le grand Duduche, la coccinelle, Laureline & Valerian, etc. New York City, en 1995, un séjour à New York avec Blutch. Francis Jacob, un ami guitariste joue ce soir-là, à l’Anarchy Café, un club de Manhattan. À l’époque Philippe dessinait ses voyages dans des carnets. Après le set, Francis fait les présentations. Le trompettiste laisse son enthousiasme jaillir en découvrant les planches du bédéiste, ce dernier estimant que jouer de la trompette est beaucoup plus impressionnant.
Après avoir raconté le réapprentissage de son métier dans Left (2018), et réalisé une trilogie sur l’histoire de l’art (évoquant en particulier le parcours de Man Ray et celui de Paul Poiret), Philippe Dupuy continue en s’interrogeant sur son art, ou au moins sur la nature de ce qu’il réalise et qui se retrouve classé dans les rayonnages Bande dessinée. La couverture donne une bonne idée de l’esthétisme des dessins : des trucs pas droits, avec un trait de contour assez fin et un peu sec. Des personnages et des objets représentés avec un degré élevé de simplification, une graphie de texte irrégulière et un peu naïve par certains côtés. Les premières pages confortent ce ressenti, avec en plus un papier légèrement jaune comme si les planches avaient été collées sur des pages blanches, l’utilisation de bouts de photographie en noir & blanc à la définition pas très élevée, et même les traces de correcteur liquide pour recouvrir une portion de case et redessiner par-dessus. Le bédéiste s’en tient majoritairement à des bordures de cases horizontales et tracées à la règle, avec une partie significative de cases sans bordures, ou avec des bordures en forme de patate irrégulière. S’il a lu ses bandes dessinées sur l’histoire de l’art, il retrouve également sa propension à réaliser des textes suivant une ligne légèrement penchée et pas horizontale, les changements de graphie imprévisibles, et quelques schémas simplistes et vite exécutés.
Dans le même temps, la cohérence de la forme apparaît exceptionnelle, parfaitement adaptée au propos, à la nature de la séquence (personnages en train de parler, de se déplacer, de se livrer à une activité) : tout coule de source avec un naturel organique. Au cours de la discussion sur le thème de la bande dessinée, le pianiste de jazz stipule l’importance de faire des œuvres personnelles : c’est exactement ce que découvre le lecteur, une œuvre personnelle, au sens où la personnalité de l’auteur s’exprime, transparaît à chaque page, à chaque case, un individu prévenant, attentif à ce que dit son interlocuteur, attentionné vis-à-vis de son lecteur pour être sûr d’être suivi et compris. Au bout de quelques pages, le lecteur s’est adapté aux idiosyncrasies narratives et visuelles, et il se retrouve bien incapable d’envisager cette narration autrement, tellement elle transcrit la personnalité de son auteur qui s’exprime sur des sujets très personnels, spécifiques à ce moment de sa carrière, à son parcours de créateur, aux personnes avec qui il échange. La narration visuelle l’emmène dans des endroits très différents : cette étrange forêt clairsemée qui doit correspondre au paysage mental de l’auteur, un club de jazz à New York, une salle de concert avec un orgue aux tuyaux fantasmagoriques, le salon familial vu par les yeux de l’enfance, une croisière au large de Nantes, un aperçu de la bibliothèque de bandes dessinées de Dominique A, le centre culturel Le lieu unique à Nantes, une soirée mondaine, une promenade dans les dunes, etc. Les images montrent des souvenirs, des concepts parfois sous la forme d’un schéma, elle recourt même à des photomontages sous la forme de collage.
En quatrième de couverture, le lecteur découvre quatre cases extraites de la page six dans lesquelles l’auteur s’interroge littéralement lui-même sur la nature de ce qu’il crée. Cette question ne fait pas entièrement sens pour le lecteur qui voit qu’il est en train de lire une bande dessinée, certes très personnelle dans ses choix esthétiques et dans son thème. Lors d’une soirée mondaine, cette question se trouve explicitée par celles que posent des invités à l’auteur sur ce qu’il fait : C’est reconnu la bande dessinée maintenant, hein ? Quels sont les titres de ses albums ? Son personnage ? Sa série ? Et ses interlocuteurs finissent par se détourner de Dupuy qui finit par se dire qu’il aurait mieux fait de dire qu’il est prothésiste dentaire, en effet ses bandes dessinées ne rentrent pas dans ces critères implicites. Au fil de l’exposé et des discussions avec ses deux interlocuteurs, le lecteur voit se dessiner plusieurs fils directeurs. Le premier apparaît quand l’auteur évoque ses lectures d’enfance, celles qui ont laissé une empreinte intense et indélébile, celles qui ont posé les fondations de ce qu’est une bande dessinée pour ce bédéiste en devenir. Lors d’un échange, Dominique A évoque le fait que les artistes vivent dans un pays où le poids historique des institutions crée des classes… Et des complexes de classe. Pour les écrivains, par exemple, le poids historique est énorme. Le lecteur fait le lien avec les années de formation du goût de Dupuy en matière de bande dessinée et il mesure tout le poids historique, exprimé de manière explicite dans la liste de fin, avec plus de soixante-dix auteurs de premier plan.
Les échanges avec le chanteur Dominique A abordent la nature de leur métier, par comparaison. Qu’est-ce qu’écrire une chanson ? Quel peut-être l’horizon d’avenir d’un chanteur-compositeur ? Est-ce forcément la renommée et le succès qu’il faut viser ? Est-ce que l’absence de renommée et de succès invalide leur démarche artistique, prouve que leur démarche est un échec par manque de légitimité par la reconnaissance du public ? La discussion développe la différence entre artisan et artiste, entre maîtrise des technique et liberté de création, en passant par les différences entre Prétendre et Avoir des prétentions, entre Avoir des ambitions et Être ambitieux. Les réflexions entre Stéphan Oliva et l’auteur s’avèrent tout aussi passionnantes et pénétrantes car le premier est un pianiste de jazz qui avait commencé à faire de la bande dessinée enfant, puis adolescent : il établit des parallèles entre la création dans ce mode d’expression, et l’improvisation en jazz ce qui est son métier. En particulier, il explique que : L’improvisation, c’est abstrait, c’est la partie non écrite de la musique. Il continue : Comme pour l’instantanéité du trait ou faire un trait, c’est déjà être dans le dessin, la pratique classique en bande dessinée est de faire d’abord un crayonné provisoire, puis d’encrer par-dessus pour rendre le dessin définitif. Pour lui, le dessin, ce n’est pas de la mise au propre : c’est quelque chose que l’on fait dans l’instant et qu’on ne pourra jamais reproduire, un saut dans le vide, sans filet, il y a alors une énergie qu’on ne retrouvera pas deux fois.
En ayant consenti quelques minutes pour s’adapter à la narration visuelle, le lecteur plonge dans une bande dessinée des plus personnelles : une réflexion sur ce mode d’expression, et une véritable profession de foi, réalisée sous la forme même d’une bande dessinée. Pour Philippe Dupuy : La bande dessinée peut tout porter, tout dire, c’est un continent à explorer, un terrain vierge aux richesse insoupçonnées, il suffit de vouloir imaginer. En se promenant dans un jardin, il effectue un parallèle supplémentaire : si les cycles de régénérescence de la nature sont d’éternels recommencement, ils n’échappent pas à l’évolution. Rien n’est immuable. L’art, parce qu’il est le fruit d’un acte créateur, se doit d’être singulier. Il ne peut pas imaginer faire de la bande dessinée autrement qu’avec singularité.
-
Ce tome contient un récit complet et indépendant de tout autre, entre biographie, autobiographie et essai. Sa première édition date de 2020. Il a été réalisé par Philippe Dupuy pour le scénario, les dessins et les touches de couleurs, avec la participation de Stéphan Oliva pianiste de jazz et compositeur français, et Dominique A (Dominique Ané) auteur-compositeur-interprète français. Il comprend soixante-quatorze pages de bande dessinée. Il se termine avec le récit court intitulé J’aurais voulu être Philippe Druillet, huit pages, initialement paru dans le Cahier Aire Libre en 2018, évoquant, entre autres, l’album La Nuit paru en 1976. Sur la dernière page, l’auteur liste tous les bédéistes et artistes qu’il évoque de près ou de loin par ordre d’apparition, de Mœbius, Philippe Druillet, à Léonard de Vinci, Jean Solé, soit soixante-dix-sept artistes dont une dizaine de mangakas. Puis viennent une quinzaine de magazine ayant publié des bandes dessinées, une quinzaine de compositeurs et d’interprètes de musique classique ou pop.
Philippe Dupuy se promène dans une zone naturelle entre jardin et forêt : il observe les fruits, qui ressemblent parfois à de grosses pépites. Il trouve que c’est fou, complètement fous ces machins-là. Des matrices. Dans son esprit, il les nomme : Arzach, La nuit, Ici-même, Le bar à Joe, La R.A.B., Philémon, Hyppolite, Les frustrés, Le démon des glaces, La foire aux immortels, Les éthiopiques, Griffu, Major Fatal. Perché sur une branche d’arbre, un autre lui-même lui dit qu’il ne comprend pas ce titre : il en fait, de la bande dessinée. Le Dupuy initial répond qu’il ne sait pas, il n’en est pas si sûr. Ou pas sûr que ce qu’il fait soit de la bande dessinée. Son autre lui-même lui répond que ce n’est pas toujours simple avec lui. La réponse : pas du tout, c’est limpide. Ils arrivent devant une mare limpide et ils plongent leur regard dedans : une autre version de Philippe Dupuy s’y trouve, il a cinq ans, six ans peut-être ? Il dessine. Il dessine tout le temps. Il est allongé par terre dans le salon, sur le ventre, en train de dessiner, son horizon : les jambes de sa mère. Ses jambes. Toujours ses jambes.
Allongé sur le ventre, le jeune Philippe décalque les fascicules de Picsou Magazine. Picsou est la bande dessinée de son enfance. D’où vient tout ce calque ? Toujours il dessine. Toujours il a dessiné. Pilote débarque à la maison, comment cela est-il possible ? C’est quoi cette histoire ? Qui a eu l’idée de l’abonner à l’Hebdo ? C’est un raz-de-marée ! Il y a tout. La brèche est ouverte, il s’y engouffre. Un véritable geyser jaillit de la mare limpide, s’élevant vers le haut, charriant une vingtaine de héros comme Blueberry, le grand Duduche, la coccinelle, Laureline & Valerian, etc. New York City, en 1995, un séjour à New York avec Blutch. Francis Jacob, un ami guitariste joue ce soir-là, à l’Anarchy Café, un club de Manhattan. À l’époque Philippe dessinait ses voyages dans des carnets. Après le set, Francis fait les présentations. Le trompettiste laisse son enthousiasme jaillir en découvrant les planches du bédéiste, ce dernier estimant que jouer de la trompette est beaucoup plus impressionnant.
Après avoir raconté le réapprentissage de son métier dans Left (2018), et réalisé une trilogie sur l’histoire de l’art (évoquant en particulier le parcours de Man Ray et celui de Paul Poiret), Philippe Dupuy continue en s’interrogeant sur son art, ou au moins sur la nature de ce qu’il réalise et qui se retrouve classé dans les rayonnages Bande dessinée. La couverture donne une bonne idée de l’esthétisme des dessins : des trucs pas droits, avec un trait de contour assez fin et un peu sec. Des personnages et des objets représentés avec un degré élevé de simplification, une graphie de texte irrégulière et un peu naïve par certains côtés. Les premières pages confortent ce ressenti, avec en plus un papier légèrement jaune comme si les planches avaient été collées sur des pages blanches, l’utilisation de bouts de photographie en noir & blanc à la définition pas très élevée, et même les traces de correcteur liquide pour recouvrir une portion de case et redessiner par-dessus. Le bédéiste s’en tient majoritairement à des bordures de cases horizontales et tracées à la règle, avec une partie significative de cases sans bordures, ou avec des bordures en forme de patate irrégulière. S’il a lu ses bandes dessinées sur l’histoire de l’art, il retrouve également sa propension à réaliser des textes suivant une ligne légèrement penchée et pas horizontale, les changements de graphie imprévisibles, et quelques schémas simplistes et vite exécutés.
Dans le même temps, la cohérence de la forme apparaît exceptionnelle, parfaitement adaptée au propos, à la nature de la séquence (personnages en train de parler, de se déplacer, de se livrer à une activité) : tout coule de source avec un naturel organique. Au cours de la discussion sur le thème de la bande dessinée, le pianiste de jazz stipule l’importance de faire des œuvres personnelles : c’est exactement ce que découvre le lecteur, une œuvre personnelle, au sens où la personnalité de l’auteur s’exprime, transparaît à chaque page, à chaque case, un individu prévenant, attentif à ce que dit son interlocuteur, attentionné vis-à-vis de son lecteur pour être sûr d’être suivi et compris. Au bout de quelques pages, le lecteur s’est adapté aux idiosyncrasies narratives et visuelles, et il se retrouve bien incapable d’envisager cette narration autrement, tellement elle transcrit la personnalité de son auteur qui s’exprime sur des sujets très personnels, spécifiques à ce moment de sa carrière, à son parcours de créateur, aux personnes avec qui il échange. La narration visuelle l’emmène dans des endroits très différents : cette étrange forêt clairsemée qui doit correspondre au paysage mental de l’auteur, un club de jazz à New York, une salle de concert avec un orgue aux tuyaux fantasmagoriques, le salon familial vu par les yeux de l’enfance, une croisière au large de Nantes, un aperçu de la bibliothèque de bandes dessinées de Dominique A, le centre culturel Le lieu unique à Nantes, une soirée mondaine, une promenade dans les dunes, etc. Les images montrent des souvenirs, des concepts parfois sous la forme d’un schéma, elle recourt même à des photomontages sous la forme de collage.
En quatrième de couverture, le lecteur découvre quatre cases extraites de la page six dans lesquelles l’auteur s’interroge littéralement lui-même sur la nature de ce qu’il crée. Cette question ne fait pas entièrement sens pour le lecteur qui voit qu’il est en train de lire une bande dessinée, certes très personnelle dans ses choix esthétiques et dans son thème. Lors d’une soirée mondaine, cette question se trouve explicitée par celles que posent des invités à l’auteur sur ce qu’il fait : C’est reconnu la bande dessinée maintenant, hein ? Quels sont les titres de ses albums ? Son personnage ? Sa série ? Et ses interlocuteurs finissent par se détourner de Dupuy qui finit par se dire qu’il aurait mieux fait de dire qu’il est prothésiste dentaire, en effet ses bandes dessinées ne rentrent pas dans ces critères implicites. Au fil de l’exposé et des discussions avec ses deux interlocuteurs, le lecteur voit se dessiner plusieurs fils directeurs. Le premier apparaît quand l’auteur évoque ses lectures d’enfance, celles qui ont laissé une empreinte intense et indélébile, celles qui ont posé les fondations de ce qu’est une bande dessinée pour ce bédéiste en devenir. Lors d’un échange, Dominique A évoque le fait que les artistes vivent dans un pays où le poids historique des institutions crée des classes… Et des complexes de classe. Pour les écrivains, par exemple, le poids historique est énorme. Le lecteur fait le lien avec les années de formation du goût de Dupuy en matière de bande dessinée et il mesure tout le poids historique, exprimé de manière explicite dans la liste de fin, avec plus de soixante-dix auteurs de premier plan.
Les échanges avec le chanteur Dominique A abordent la nature de leur métier, par comparaison. Qu’est-ce qu’écrire une chanson ? Quel peut-être l’horizon d’avenir d’un chanteur-compositeur ? Est-ce forcément la renommée et le succès qu’il faut viser ? Est-ce que l’absence de renommée et de succès invalide leur démarche artistique, prouve que leur démarche est un échec par manque de légitimité par la reconnaissance du public ? La discussion développe la différence entre artisan et artiste, entre maîtrise des technique et liberté de création, en passant par les différences entre Prétendre et Avoir des prétentions, entre Avoir des ambitions et Être ambitieux. Les réflexions entre Stéphan Oliva et l’auteur s’avèrent tout aussi passionnantes et pénétrantes car le premier est un pianiste de jazz qui avait commencé à faire de la bande dessinée enfant, puis adolescent : il établit des parallèles entre la création dans ce mode d’expression, et l’improvisation en jazz ce qui est son métier. En particulier, il explique que : L’improvisation, c’est abstrait, c’est la partie non écrite de la musique. Il continue : Comme pour l’instantanéité du trait ou faire un trait, c’est déjà être dans le dessin, la pratique classique en bande dessinée est de faire d’abord un crayonné provisoire, puis d’encrer par-dessus pour rendre le dessin définitif. Pour lui, le dessin, ce n’est pas de la mise au propre : c’est quelque chose que l’on fait dans l’instant et qu’on ne pourra jamais reproduire, un saut dans le vide, sans filet, il y a alors une énergie qu’on ne retrouvera pas deux fois.
En ayant consenti quelques minutes pour s’adapter à la narration visuelle, le lecteur plonge dans une bande dessinée des plus personnelles : une réflexion sur ce mode d’expression, et une véritable profession de foi, réalisée sous la forme même d’une bande dessinée. Pour Philippe Dupuy : La bande dessinée peut tout porter, tout dire, c’est un continent à explorer, un terrain vierge aux richesse insoupçonnées, il suffit de vouloir imaginer. En se promenant dans un jardin, il effectue un parallèle supplémentaire : si les cycles de régénérescence de la nature sont d’éternels recommencement, ils n’échappent pas à l’évolution. Rien n’est immuable. L’art, parce qu’il est le fruit d’un acte créateur, se doit d’être singulier. Il ne peut pas imaginer faire de la bande dessinée autrement qu’avec singularité.
On ne fait pas les mêmes rêves d’un lit à l’autre.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 5 : Comme s'il en pleuvait (2001). La première édition du présent tome date de 2003. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Ruby. L’album compte cinquante-quatre planches.
On ne fait pas les mêmes rêves d’un lit à l’autre. Monsieur Jean est en train de rêver : il se trouve au volant de sa voiture, à l’arrêt à un carrefour, dans une toute petite voiture. Des camions arrivent à toute vitesse, et défilent sur la route perpendiculaire, l’empêchant de passer. Depuis une fenêtre d’un immeuble, un autre monsieur Jean l’observe avec sa femme à ses côtés, tenant leur fille Julie dans les bras. Ça y est, la voie est enfin libre, c’est à lui enfin. Mais il ne sait pas conduire. Voilà le genre de rêve qu’il fait depuis qu’il a déménagé. Il se trouve allongé dans un lit avec sa compagne à ses côtés, tous les deux habillés. Il lui dit de but en blanc qu’il n’aurait jamais dû laisser son lit à Félix. Cathy répond gentiment qu’ils ne vont pas revenir là-dessus, elle dormait mal dans son lit. Il commence à vouloir l’enlacer, mais elle lui rappelle qu’ils se trouvent dans un magasin de meubles. La vendeuse revient vers eux et il déclare franchement que c’est non pour ce lit. Cathy lui demande ce qui ne va pas : il trouve que les meubles sont trop neufs et qu’ils le seront toujours. Ils ne se patineront jamais ; ils se déglingueront d’un seul coup un jour, et vite en plus. Et alors ils les jetteront. Elle se moque gentiment : il fait une dépression parce qu’il a cédé son vieil appartement avec son vieux lit, à Félix, son vieil ami, pour commencer une nouvelle vie avec elle ? Elle décide de l’emmener au rayon vaisselle.
Dans le vieil appartement, Félix est allongé sur le vieux lit qu’il trouve très bien. Liette Botinelli, sa compagne, trouve que le matelas est trop mou. En plus, c’est un lit à ressorts et elle veut un lit à lattes. En outre, c’est un vieux lit et on ne sait pas qui a dormi dedans, y en a peut-être qui sont morts et elle ne peut pas supporter cette idée. Dans le grand magasin, Monsieur Jean s’est arrêté le nez en l’air : il a l’impression de voir flotter le spectre de ses grands-parents qui lui parlent. Il leur demande ce qu’ils font là. Le papy répond qu’ils ne sont pas très fiers de lui car il s’est débarrassé de leur lit. La mamy tempère : ce n’est pas lui qui voulait s’en débarrasser, mais elle, en pointant Cathy du doigt. Celle-ci se rapproche de son compagnon et lui demande ce qu’il pense des assiettes. Elle s’adresse à une vendeuse pour savoir si ce modèle existe en plus petit. Une autre vendeuse s’approche et s’adresse à la première s’étonnant qu’elle n’ait pas signé la pétition, celle à propos de la reconduction des contrats sur novembre : elles sont quatre à ne pas avoir leur contrat renouvelé, sans avoir été prévenues, sans raison. L’autre l’éconduit en indiquant qu’elle est avec une cliente. Les grands-parents spectraux continuent à faire des reproches à leur petit-fils qui recule, ce mouvement faisant basculer une pile d’assiette à terre, où elles se brisent. La deuxième vendeuse lui dit que ce n’est pas grave. Dehors, devant la devanture, deux personnes sans abri sont affalées et font la manche. Un employé essaye de les faire bouger, en pure perte. Cathy et Jean sortent et entendent quelques bribes de l’algarade. Dans le vieil appartement, la sonnette retentit : madame Poulbot vient se plaindre du comportement d’Eugène.
Mais quelle étape de vie reste-t-il encore à franchir pour Monsieur Jean qui a endossé bon nombre de responsabilité depuis le premier tome ? Le titre évoque une sorte de bilan avant des changements significatifs. L’histoire reste constituée de petits moments de vie plutôt banals, même s’ils sont spécifiques à cet écrivain que le lecteur ne voit plus du tout écrire, à cette vie un peu bohême, sans horaires fixes, sans difficultés financières, avec une femme aimante quasi sans condition, et des amis avec leur lot de problèmes. Le lecteur retrouve avec plaisir le personnage principal toujours un peu indolent, vaguement gêné aux entournures par des questionnements sur sa vie, qu’il n’a pas envie de formuler ; fidèle en amitié avec Félix père peu responsable et Clément séducteur un peu insistant. Tout du long du tome, il retrouve également le personnage en arrière-plan : Paris. Il peut identifier des bouches de station de métro, le canal Saint Martin et ses passerelles, des quais de métro parisien, et même la sortie du souterrain routier des Halles rue de Turbigo avec son renfoncement où dorment des personnes sans abri, et même une benne à ordures ménagères parisienne reconnaissable à sa couleur Vert bambou (AC533). La série reste fidèle à son décor parisien, visiblement bien connu des auteurs.
Ce tome commence par une planche consacrée à un rêve, avec une mise en couleur déclinant une teinte vert en plusieurs nuances. Monsieur Jean est le conducteur d’une voiture à l’arrêt, et il ne détient pas son permis : une métaphore de la vie dont il semble plus observer celle des autres, que de mener la sienne au petit bonheur la chance, faute de savoir comment la conduire. Le deuxième rêve occupe les deux tiers de la planche treize, avec la même approche de la couleur, la même déclinaison en nuances de vert : cette fois-ci, Monsieur Jean est son incarnation à la fenêtre, tenant sa fille dans ses bras, auprès de sa compagne, observant son autre lui-même en contrebas dans la voiture, arrêté. Un troisième rêve occupe la moitié de la planche dix-neuf, plus étrange, Monsieur Jean étant un géant allongé dans le canal Saint Martin qui le charrie doucement, avec un autre avatar l’observant depuis la fenêtre de son appartement, une autre métaphore de la vie qui s’écoule, indépendamment de sa volonté, doucement, mais inexorablement. Cette même métaphore occupe une des trois bandes de cases de la planche vingt-et-un. Puis encore case en planche vingt-six, cette fois-ci à l’intérieur de l’appartement de Cathy et Jean, alors que l’immeuble est secoué de tremblement.
Le lecteur arrive alors à la dernière séquence onirique : elle s’avère être d’une grande ampleur puisqu’elle s’étend de la planche trente-cinq à la planche quarante-quatre, soit dix pages. Au cours de cette séquence, Monsieur Jean en vient à rencontrer un ancien habitant défunt de l’immeuble, et la couleur change de teinte : du rouge décliné en nuances. Les dessins conservent leurs caractéristiques : des traits de contour un peu ronds, parfois gras, des personnages au visage caricaturé ou esthétisé, une simplification de la silhouette humaine, des décors aux détails simplifiés tout en conservant une forte densité d’informations. Les artistes mettent à profit les possibilités de la bande dessinée pour cette partie : éléments oniriques, angle de vue exagéré, ombres chinoises, effets spéciaux illimités, immeuble en train de se déplacer dans la ville, personnage passant par une large fente dans un mur dans une évocation visuelle de la sortie du nouveau-né lors de l’accouchement, rapprochement visuel entre deux décors, mutilation du personnage le privant de ses mains et de ses avant-bras le rendant ainsi incapable d’agir. Monsieur Jean écoute le locataire défunt exposer sa théorie sur la mémoire : Il existe une partie du cerveau où se cachent tous les souvenirs qu’on veut oublier. Au début, cette partie du cerveau est aussi petite qu’un point. Ensuite, elle grandit au fur et à mesure qu’on a des choses à oublier. […] Avec le temps, sa surface devient poreuse. Il y entre et il en sort des choses de manière anarchique. Brusquement on se souvient de ce qu’on croyait avoir oublié définitivement. Et un souvenir qu’on pensait garder pour toujours disparaît.
Dans un premier temps, le lecteur peut être un peu déconcerté par l’importance donnée à cette séquence de rêve, ainsi que par l’insistance avec laquelle les deux auteurs mettent en scène un duo de personnes sans abri, bientôt rejoint par un troisième à la stature imposante. Ils ne les habillent pas d’une aura romanesque : ils vivent mal de mendicité, ils dorment à la rue, ils mangent ce qu’ils peuvent, ils se méfient les uns des autres. Cette déchéance bien rendue visuellement contraste fortement avec la vie sans souci matériel des personnages principaux. La présence des grands-parents sous forme spectrale apporte également une touche comique douce-amère, en étrange décalage avec le ton de la série, une présence quasiment dépourvue de morbidité malgré leur condition. Le lecteur repense au titre ce tome, et il voit bien comment Monsieur Jean éprouve de grandes difficultés à faire le deuil de certaines choses : le lit de ses grands-parents à l’évidence, mais aussi sa vie à la dérive qu’il contemple avec ses yeux de père responsable et rangé, la notion même de disparition, et la mort. Les auteurs évoquent le deuil de manière directe en parlant de personnes défuntes, mais aussi le deuil de la vie d’avant, d’habitudes. Monsieur Jean ressent le fait que sa vie a évolué et qu’elle ne reviendra plus jamais à ce qu’elle était avant, ce qui lui cause une inquiétude sourde, la compréhension du temps qui passe inexorablement se faisant petit à petit, d’abord inconsciemment dans son esprit. Il voit bien que sa vie n’est plus la même, que la situation même de son ami Félix Martin a évolué. Il peut faire la comparaison avec la vie des clochards qui s’accommodent de leur routine, mais aussi avec celle de Clément qui continue à se comporter avec les femmes comme il l’a toujours fait alors que lui aussi a pris de l’âge et que ce comportement n’est plus de mise. Il sourit en voyant que Félix trouve sa place dans un milieu professionnel, comme sa vision du monde avait été en avance sur celle de son entourage, qu’il n’a pas changé et que c’est plutôt son entourage qui commence à le rattraper, un étrange constat de la part des auteurs.
Le temps passe, les choses changent, les gens prennent de l’âge : il n’est pas toujours facile de s’en rendre compte, d’adapter sa façon de voir le monde à ces changements, aux années qui passent. Dupuy et Berberian font courir cette thématique tout du long de l’album avec leur narration visuelle toujours aussi élégante et sophistiquée, entremêlant des fils narratifs qui suivent différents personnages, certains très inattendus, pour envisager la mort et cette certitude : dans la vie, il n’y a qu’une seule constante, et c’est le changement.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 5 : Comme s'il en pleuvait (2001). La première édition du présent tome date de 2003. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Ruby. L’album compte cinquante-quatre planches.
On ne fait pas les mêmes rêves d’un lit à l’autre. Monsieur Jean est en train de rêver : il se trouve au volant de sa voiture, à l’arrêt à un carrefour, dans une toute petite voiture. Des camions arrivent à toute vitesse, et défilent sur la route perpendiculaire, l’empêchant de passer. Depuis une fenêtre d’un immeuble, un autre monsieur Jean l’observe avec sa femme à ses côtés, tenant leur fille Julie dans les bras. Ça y est, la voie est enfin libre, c’est à lui enfin. Mais il ne sait pas conduire. Voilà le genre de rêve qu’il fait depuis qu’il a déménagé. Il se trouve allongé dans un lit avec sa compagne à ses côtés, tous les deux habillés. Il lui dit de but en blanc qu’il n’aurait jamais dû laisser son lit à Félix. Cathy répond gentiment qu’ils ne vont pas revenir là-dessus, elle dormait mal dans son lit. Il commence à vouloir l’enlacer, mais elle lui rappelle qu’ils se trouvent dans un magasin de meubles. La vendeuse revient vers eux et il déclare franchement que c’est non pour ce lit. Cathy lui demande ce qui ne va pas : il trouve que les meubles sont trop neufs et qu’ils le seront toujours. Ils ne se patineront jamais ; ils se déglingueront d’un seul coup un jour, et vite en plus. Et alors ils les jetteront. Elle se moque gentiment : il fait une dépression parce qu’il a cédé son vieil appartement avec son vieux lit, à Félix, son vieil ami, pour commencer une nouvelle vie avec elle ? Elle décide de l’emmener au rayon vaisselle.
Dans le vieil appartement, Félix est allongé sur le vieux lit qu’il trouve très bien. Liette Botinelli, sa compagne, trouve que le matelas est trop mou. En plus, c’est un lit à ressorts et elle veut un lit à lattes. En outre, c’est un vieux lit et on ne sait pas qui a dormi dedans, y en a peut-être qui sont morts et elle ne peut pas supporter cette idée. Dans le grand magasin, Monsieur Jean s’est arrêté le nez en l’air : il a l’impression de voir flotter le spectre de ses grands-parents qui lui parlent. Il leur demande ce qu’ils font là. Le papy répond qu’ils ne sont pas très fiers de lui car il s’est débarrassé de leur lit. La mamy tempère : ce n’est pas lui qui voulait s’en débarrasser, mais elle, en pointant Cathy du doigt. Celle-ci se rapproche de son compagnon et lui demande ce qu’il pense des assiettes. Elle s’adresse à une vendeuse pour savoir si ce modèle existe en plus petit. Une autre vendeuse s’approche et s’adresse à la première s’étonnant qu’elle n’ait pas signé la pétition, celle à propos de la reconduction des contrats sur novembre : elles sont quatre à ne pas avoir leur contrat renouvelé, sans avoir été prévenues, sans raison. L’autre l’éconduit en indiquant qu’elle est avec une cliente. Les grands-parents spectraux continuent à faire des reproches à leur petit-fils qui recule, ce mouvement faisant basculer une pile d’assiette à terre, où elles se brisent. La deuxième vendeuse lui dit que ce n’est pas grave. Dehors, devant la devanture, deux personnes sans abri sont affalées et font la manche. Un employé essaye de les faire bouger, en pure perte. Cathy et Jean sortent et entendent quelques bribes de l’algarade. Dans le vieil appartement, la sonnette retentit : madame Poulbot vient se plaindre du comportement d’Eugène.
Mais quelle étape de vie reste-t-il encore à franchir pour Monsieur Jean qui a endossé bon nombre de responsabilité depuis le premier tome ? Le titre évoque une sorte de bilan avant des changements significatifs. L’histoire reste constituée de petits moments de vie plutôt banals, même s’ils sont spécifiques à cet écrivain que le lecteur ne voit plus du tout écrire, à cette vie un peu bohême, sans horaires fixes, sans difficultés financières, avec une femme aimante quasi sans condition, et des amis avec leur lot de problèmes. Le lecteur retrouve avec plaisir le personnage principal toujours un peu indolent, vaguement gêné aux entournures par des questionnements sur sa vie, qu’il n’a pas envie de formuler ; fidèle en amitié avec Félix père peu responsable et Clément séducteur un peu insistant. Tout du long du tome, il retrouve également le personnage en arrière-plan : Paris. Il peut identifier des bouches de station de métro, le canal Saint Martin et ses passerelles, des quais de métro parisien, et même la sortie du souterrain routier des Halles rue de Turbigo avec son renfoncement où dorment des personnes sans abri, et même une benne à ordures ménagères parisienne reconnaissable à sa couleur Vert bambou (AC533). La série reste fidèle à son décor parisien, visiblement bien connu des auteurs.
Ce tome commence par une planche consacrée à un rêve, avec une mise en couleur déclinant une teinte vert en plusieurs nuances. Monsieur Jean est le conducteur d’une voiture à l’arrêt, et il ne détient pas son permis : une métaphore de la vie dont il semble plus observer celle des autres, que de mener la sienne au petit bonheur la chance, faute de savoir comment la conduire. Le deuxième rêve occupe les deux tiers de la planche treize, avec la même approche de la couleur, la même déclinaison en nuances de vert : cette fois-ci, Monsieur Jean est son incarnation à la fenêtre, tenant sa fille dans ses bras, auprès de sa compagne, observant son autre lui-même en contrebas dans la voiture, arrêté. Un troisième rêve occupe la moitié de la planche dix-neuf, plus étrange, Monsieur Jean étant un géant allongé dans le canal Saint Martin qui le charrie doucement, avec un autre avatar l’observant depuis la fenêtre de son appartement, une autre métaphore de la vie qui s’écoule, indépendamment de sa volonté, doucement, mais inexorablement. Cette même métaphore occupe une des trois bandes de cases de la planche vingt-et-un. Puis encore case en planche vingt-six, cette fois-ci à l’intérieur de l’appartement de Cathy et Jean, alors que l’immeuble est secoué de tremblement.
Le lecteur arrive alors à la dernière séquence onirique : elle s’avère être d’une grande ampleur puisqu’elle s’étend de la planche trente-cinq à la planche quarante-quatre, soit dix pages. Au cours de cette séquence, Monsieur Jean en vient à rencontrer un ancien habitant défunt de l’immeuble, et la couleur change de teinte : du rouge décliné en nuances. Les dessins conservent leurs caractéristiques : des traits de contour un peu ronds, parfois gras, des personnages au visage caricaturé ou esthétisé, une simplification de la silhouette humaine, des décors aux détails simplifiés tout en conservant une forte densité d’informations. Les artistes mettent à profit les possibilités de la bande dessinée pour cette partie : éléments oniriques, angle de vue exagéré, ombres chinoises, effets spéciaux illimités, immeuble en train de se déplacer dans la ville, personnage passant par une large fente dans un mur dans une évocation visuelle de la sortie du nouveau-né lors de l’accouchement, rapprochement visuel entre deux décors, mutilation du personnage le privant de ses mains et de ses avant-bras le rendant ainsi incapable d’agir. Monsieur Jean écoute le locataire défunt exposer sa théorie sur la mémoire : Il existe une partie du cerveau où se cachent tous les souvenirs qu’on veut oublier. Au début, cette partie du cerveau est aussi petite qu’un point. Ensuite, elle grandit au fur et à mesure qu’on a des choses à oublier. […] Avec le temps, sa surface devient poreuse. Il y entre et il en sort des choses de manière anarchique. Brusquement on se souvient de ce qu’on croyait avoir oublié définitivement. Et un souvenir qu’on pensait garder pour toujours disparaît.
Dans un premier temps, le lecteur peut être un peu déconcerté par l’importance donnée à cette séquence de rêve, ainsi que par l’insistance avec laquelle les deux auteurs mettent en scène un duo de personnes sans abri, bientôt rejoint par un troisième à la stature imposante. Ils ne les habillent pas d’une aura romanesque : ils vivent mal de mendicité, ils dorment à la rue, ils mangent ce qu’ils peuvent, ils se méfient les uns des autres. Cette déchéance bien rendue visuellement contraste fortement avec la vie sans souci matériel des personnages principaux. La présence des grands-parents sous forme spectrale apporte également une touche comique douce-amère, en étrange décalage avec le ton de la série, une présence quasiment dépourvue de morbidité malgré leur condition. Le lecteur repense au titre ce tome, et il voit bien comment Monsieur Jean éprouve de grandes difficultés à faire le deuil de certaines choses : le lit de ses grands-parents à l’évidence, mais aussi sa vie à la dérive qu’il contemple avec ses yeux de père responsable et rangé, la notion même de disparition, et la mort. Les auteurs évoquent le deuil de manière directe en parlant de personnes défuntes, mais aussi le deuil de la vie d’avant, d’habitudes. Monsieur Jean ressent le fait que sa vie a évolué et qu’elle ne reviendra plus jamais à ce qu’elle était avant, ce qui lui cause une inquiétude sourde, la compréhension du temps qui passe inexorablement se faisant petit à petit, d’abord inconsciemment dans son esprit. Il voit bien que sa vie n’est plus la même, que la situation même de son ami Félix Martin a évolué. Il peut faire la comparaison avec la vie des clochards qui s’accommodent de leur routine, mais aussi avec celle de Clément qui continue à se comporter avec les femmes comme il l’a toujours fait alors que lui aussi a pris de l’âge et que ce comportement n’est plus de mise. Il sourit en voyant que Félix trouve sa place dans un milieu professionnel, comme sa vision du monde avait été en avance sur celle de son entourage, qu’il n’a pas changé et que c’est plutôt son entourage qui commence à le rattraper, un étrange constat de la part des auteurs.
Le temps passe, les choses changent, les gens prennent de l’âge : il n’est pas toujours facile de s’en rendre compte, d’adapter sa façon de voir le monde à ces changements, aux années qui passent. Dupuy et Berberian font courir cette thématique tout du long de l’album avec leur narration visuelle toujours aussi élégante et sophistiquée, entremêlant des fils narratifs qui suivent différents personnages, certains très inattendus, pour envisager la mort et cette certitude : dans la vie, il n’y a qu’une seule constante, et c’est le changement.
Je m’attendais à des critiques, mais pas de cet ordre
-
Il s’agit du premier tome hors-série accompagnant la sortie de l’album Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1994), des mêmes auteurs. Ce tome peut se lire sans avoir lu un seul album de la série Monsieur Jean. Il exhale plus de saveurs si le lecteur connaît la série. Sa première publication date de 1994. Il a également été réalisé par Philippe Dupuy et Charles Berberian, toutefois dans cet ouvrage chacun réalise seul ses propres pages, et non à quatre mains comme les albums de la série. Il s’agit d’un ouvrage en noir & blanc, édité par L’Association alors que les albums Monsieur Jean ont été publiés par Les Humanoïdes Associés. Il comprend cent-vingt-huit pages de bande dessinée.
Mercredi 11 août 1993, Charles Berberian se trouve dans un taxi et le chauffeur lui raconte une anecdote : un type qui monte dans son taxi et qui lui demande de le ramener chez lui, puis qui s’endort sans avoir donné l‘adresse, rond comme une queue de pelle. Impossible de le réveiller, et le chauffeur ne sait pas où il habite, forcément. Du coup, il a roulé pendant trois heures, le temps qu’il émerge, et le compteur tournait pendant ce temps-là, forcément. Il a même pris un autre client pendant que l’autre poivrot ronflait, client qui faisait une drôle de tête, mais en même temps, il était trop content de trouver un tacot à trois heures du mat’. Charles imagine le chauffeur sur la scène de l’Olympia en train de raconter sa blague à un public hilare. Il se lance à son tour, avec une histoire : il monte dans un taxi et le chauffeur n’arrête pas de se racler la gorge. Au bout de cinq minutes, ça lui remonte dans le nez, du coup les clients ont droit à une vidange complète du nez à coups de raclements et de reniflements sonores. Le chauffeur reste sans réaction, sans même sourire.
Quelques jours plus tard, Berberian est en train de dessiner cette scène pour le journal de l’album. Son épouse Anne vient le regarder, en tenant leur fille Nina par la main, elle-même tenant un biberon. Charles s’interrompt, et ils passent dans leur chambre, Anne demandant s’il parle déjà d’elle, des vacances, du fait qu’ils soient en vacances chez sa mère à elle dans le Quercy. Ils sortent voir les animaux dehors, avec leur fille dans les bras de son père. Ils sont donc en vacances dans le Quercy, chez Viviane la mère d’Anne, et c’est là qu’il a commencé son journal. Ils observent les poules et les cochons. Certes tout ce qu’il raconte là n’a rien à voir avec Monsieur Jean, mais c’est-à-dire qu’avec le chauffeur de taxi, ils en sont venu à parler bandes dessinées, et il a dit des trucs pas idiots à ce sujet, en gros que Charles faisait des bêtises. Ça lui évoque Astérix et Obélix. Il se souvient qu’il se marrait bien en lisant ça, il se demande où ils vont chercher toutes ces bêtises, pas vrai ? Charles éprouve la sensation que le chauffeur le punit en le fouettant. Il explique que pour trouver ces bêtises, il regarde autour de lui, il observe les gens et il en fait des histoires.
Au bout de quelques pages, le lecteur comprend que le titre est à prendre littéralement : Dupuy & Berberian ont documenté leur processus de réalisation du troisième album de la série Monsieur Jean, sous la forme d’un album de bande dessinée. Le présent ouvrage se compose de quatre parties. La première réalisée par Charles Berberian, de quarante-et-une pages, composée de trois chapitres. La deuxième réalisée par Philippe Dupuy, comprenant quarante-huit pages, et se composant de quatre chapitres. Enfin une autre partie réalisée par Berberian comptant quatorze pages, et une dernière réalisée par Dupuy, de douze pages. Chaque auteur raconte donc sa tranche de vie correspondant à la gestation de l’album, depuis les premières idées jetées par Berberian, jusqu’à la parution du tome trois de la série Monsieur Jean et à la dernière question : quel éditeur pour le Journal d’un album ? Comme dans toute autobiographie, même si celle-ci est croisée, le lecteur sait que les auteurs ont retenu des moments choisis, et les présentent comme ils l’entendent. L’un comme l’autre l’évoque de front ou de manière incidente : que raconter ? Un trajet en taxi, des anecdotes familiales, les discussions avec les fondateurs de la maison d’édition l’Association (Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, David B., Mattt Konture, Patrice Killoffer, Stanislas), et bien sûr quelques-unes de leurs interrogations, de leurs doutes, des difficultés créatrices, mais aussi des difficultés matérielles, l’éditeur Les Humanos traversant une période difficile sur le plan financier et sur le plan juridique.
Il suffit donc au lecteur de savoir que l’appellation Dupuy & Berberian recouvre un duo de bédéistes, que leur personnage principal se nomme Monsieur Jean, et que sa série se focalise sur des moments de sa vie parisienne. Charles apparaît comme un monsieur sympathique, pas trop angoissé, ne sachant pas trop comment commencer son journal, ce qui nourrit les premières scènes. Il représente ses personnages de manière semi-réaliste, avec un trait de contour un peu fin, et une apparence qui s’apparente de près à celles des personnages de la série Monsieur Jean, gros nez compris. Les dessins comprennent un degré de caricature, avec des contours pas toujours très droits, comme mal assurés ou réalisés rapidement, un air de bande dessinée indépendante, ou un dessinateur peu porté sur l’application du travail d’encrage, ou encore une bande dessinée conservant sa spontanéité. Le lecteur suit bien volontiers cet auteur dans la banalité de son métier et de sa vie de famille, mais aussi dans l’exotisme de la profession de bédéiste.
Outre le fait que le personnage principal change, le lecteur remarque bien le passage d’un auteur à l’autre car le trait de Dupuy est plus appuyé, plus gras, plus agréable à la vue. Dans le même temps, il identifie également tout de suite la parenté avec les dessins de la série Monsieur Jean, même si ce dessinateur-là n’affuble pas ses personnages de gros nez. Il se révèle être également un excellent conteur, par exemple cette page où il évoque la vie de son père en seulement six cases. En comparant ces planches-ci avec celles de la première partie, il peut se faire une vague idée de ce qu’apportent un dessinateur et l’autre. Il constate que pour l’un, comme pour l’autre, les personnages représentés arborent tous un air sympathique, sans être nunuches, mais sans agressivité. L’un et l’autre savent poser un décor en quelques traits, tout en intégrant des éléments spécifiques qui rendent unique la ferme de Viviane dans le Quercy, ou permettent de reconnaître au premier coup d’œil, la gare Montparnasse. Ils utilisent avec la même aisance le glissement vers l’exagération visuelle, que ce soit avec Charles enfant, ou la mégalomanie débridée de Charles représenté par Phillipe lors qu’il abat une quantité de pages de Monsieur Jean, tout seul.
Cette lecture exhale un peu plus de saveurs pour celui qui a lu le tome trois de la série : il peut alors faire le lien avec une ou deux anecdotes de la vie personnelle de l’un ou de l’autre, et une aventure de Jean, ou bien encore identifier la métaphore du château assiégé par des femmes qui lancent des bébés aux soldats qui montent la garde sur les remparts. Au cours des séquences, Charles comme Philippe s’interroge sur leur rapport à la création, de manière superficielle, et plus sur leur comportement, leur mode de vie. Ça commence avec Charles qui estime qu’il est un adolescent attardé, ou même un enfant attardé à collectionner des figurines des Simpson, à accumuler des bandes dessinées (jusqu’à garder de vieux albums de Ric Hochet) alors que son appartement est plein à craquer. Ça continue avec Philippe qui trouve qu’il n’arrive pas à se faire à son âge, la trentaine : il continue à acheter des casquettes, à se balader en blouson et tee-shirt, voire même en baskets, comme un adolescent boutonneux, et à dépenser son argent en cinéma et en restaurants, alors qu’à trente-trois ans il devrait consacrer son argent à élever ses enfants (à son âge, son père avait quatre enfants).
L’épilogue de Charles le met en scène comme Robin, Philippe jouant le rôle de Batman, en costume l’un et l’autre. Il est question de leur amitié et de leur collaboration professionnelle, des incertitudes sur la parution de l’album de Monsieur Jean, et de leur rémunération. Il cite un passage d’un livre de Serge Rezvani, peintre, écrivain et auteur-compositeur-interprète français d'origine iranienne : À force de me situer à côté, en indiscipline et de la peinture et de l’écriture, prétendant à la transversalité, j’en suis venu à croire, comme le tireur à l’arc aux yeux fermés, que la pensée est à la fois flèche et but, et qu’il est donc inutile et distrayant de se préoccuper de quelle nature sont la flèche et le but, car seul d’arquer son arc sans décocher la flèche suffit. Charles s’interroge sur la beauté du geste, celui de dessiner et sur sa finalité. Puis Philippe évoque les étapes successives pour finir les planches de l’album jusqu’à sa parution : un vrai jeu de l’oie où le passage d’une case à la suivante est tributaire d’événements arbitraires, totalement indépendants des auteurs, à commencer par la santé financière de leur éditeur.
Charles Berberian et Philippe Dupuy ont fait le projet de réaliser un album de leur série Monsieur Jean, le troisième tome, et d’en documenter le processus sous la forme d’un journal à la narration libre, et séparée, chacun produisant ses chapitres seul, de son côté. Ils exposent leurs doutes sur la nature nombriliste d’une telle démarche, et réalisent des pages assez proches graphiquement de la série. Ils plongent le lecteur dans leur quotidien, au travers de morceaux choisis, et mis en scène, une autre forme de construction que celle de Monsieur Jean, mais pas une œuvre spontanée et sans réflexion ou formalisation. Le tout invite le lecteur aux côtés du quotidien de deux bédéistes, avec des personnalités différentes, des narrations visuelles assez proches, pour des tranches de vie banales dans ce qu’elles ont de pragmatique, mais aussi uniques car intrinsèquement liées à eux, à leur situation personnelle du moment, à leur l’étape qu’ils effectuent dans leur métier, à la fois une étape pour grandir, à la fois un reflet de la fragilité de l’artisanat.
-
Il s’agit du premier tome hors-série accompagnant la sortie de l’album Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1994), des mêmes auteurs. Ce tome peut se lire sans avoir lu un seul album de la série Monsieur Jean. Il exhale plus de saveurs si le lecteur connaît la série. Sa première publication date de 1994. Il a également été réalisé par Philippe Dupuy et Charles Berberian, toutefois dans cet ouvrage chacun réalise seul ses propres pages, et non à quatre mains comme les albums de la série. Il s’agit d’un ouvrage en noir & blanc, édité par L’Association alors que les albums Monsieur Jean ont été publiés par Les Humanoïdes Associés. Il comprend cent-vingt-huit pages de bande dessinée.
Mercredi 11 août 1993, Charles Berberian se trouve dans un taxi et le chauffeur lui raconte une anecdote : un type qui monte dans son taxi et qui lui demande de le ramener chez lui, puis qui s’endort sans avoir donné l‘adresse, rond comme une queue de pelle. Impossible de le réveiller, et le chauffeur ne sait pas où il habite, forcément. Du coup, il a roulé pendant trois heures, le temps qu’il émerge, et le compteur tournait pendant ce temps-là, forcément. Il a même pris un autre client pendant que l’autre poivrot ronflait, client qui faisait une drôle de tête, mais en même temps, il était trop content de trouver un tacot à trois heures du mat’. Charles imagine le chauffeur sur la scène de l’Olympia en train de raconter sa blague à un public hilare. Il se lance à son tour, avec une histoire : il monte dans un taxi et le chauffeur n’arrête pas de se racler la gorge. Au bout de cinq minutes, ça lui remonte dans le nez, du coup les clients ont droit à une vidange complète du nez à coups de raclements et de reniflements sonores. Le chauffeur reste sans réaction, sans même sourire.
Quelques jours plus tard, Berberian est en train de dessiner cette scène pour le journal de l’album. Son épouse Anne vient le regarder, en tenant leur fille Nina par la main, elle-même tenant un biberon. Charles s’interrompt, et ils passent dans leur chambre, Anne demandant s’il parle déjà d’elle, des vacances, du fait qu’ils soient en vacances chez sa mère à elle dans le Quercy. Ils sortent voir les animaux dehors, avec leur fille dans les bras de son père. Ils sont donc en vacances dans le Quercy, chez Viviane la mère d’Anne, et c’est là qu’il a commencé son journal. Ils observent les poules et les cochons. Certes tout ce qu’il raconte là n’a rien à voir avec Monsieur Jean, mais c’est-à-dire qu’avec le chauffeur de taxi, ils en sont venu à parler bandes dessinées, et il a dit des trucs pas idiots à ce sujet, en gros que Charles faisait des bêtises. Ça lui évoque Astérix et Obélix. Il se souvient qu’il se marrait bien en lisant ça, il se demande où ils vont chercher toutes ces bêtises, pas vrai ? Charles éprouve la sensation que le chauffeur le punit en le fouettant. Il explique que pour trouver ces bêtises, il regarde autour de lui, il observe les gens et il en fait des histoires.
Au bout de quelques pages, le lecteur comprend que le titre est à prendre littéralement : Dupuy & Berberian ont documenté leur processus de réalisation du troisième album de la série Monsieur Jean, sous la forme d’un album de bande dessinée. Le présent ouvrage se compose de quatre parties. La première réalisée par Charles Berberian, de quarante-et-une pages, composée de trois chapitres. La deuxième réalisée par Philippe Dupuy, comprenant quarante-huit pages, et se composant de quatre chapitres. Enfin une autre partie réalisée par Berberian comptant quatorze pages, et une dernière réalisée par Dupuy, de douze pages. Chaque auteur raconte donc sa tranche de vie correspondant à la gestation de l’album, depuis les premières idées jetées par Berberian, jusqu’à la parution du tome trois de la série Monsieur Jean et à la dernière question : quel éditeur pour le Journal d’un album ? Comme dans toute autobiographie, même si celle-ci est croisée, le lecteur sait que les auteurs ont retenu des moments choisis, et les présentent comme ils l’entendent. L’un comme l’autre l’évoque de front ou de manière incidente : que raconter ? Un trajet en taxi, des anecdotes familiales, les discussions avec les fondateurs de la maison d’édition l’Association (Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, David B., Mattt Konture, Patrice Killoffer, Stanislas), et bien sûr quelques-unes de leurs interrogations, de leurs doutes, des difficultés créatrices, mais aussi des difficultés matérielles, l’éditeur Les Humanos traversant une période difficile sur le plan financier et sur le plan juridique.
Il suffit donc au lecteur de savoir que l’appellation Dupuy & Berberian recouvre un duo de bédéistes, que leur personnage principal se nomme Monsieur Jean, et que sa série se focalise sur des moments de sa vie parisienne. Charles apparaît comme un monsieur sympathique, pas trop angoissé, ne sachant pas trop comment commencer son journal, ce qui nourrit les premières scènes. Il représente ses personnages de manière semi-réaliste, avec un trait de contour un peu fin, et une apparence qui s’apparente de près à celles des personnages de la série Monsieur Jean, gros nez compris. Les dessins comprennent un degré de caricature, avec des contours pas toujours très droits, comme mal assurés ou réalisés rapidement, un air de bande dessinée indépendante, ou un dessinateur peu porté sur l’application du travail d’encrage, ou encore une bande dessinée conservant sa spontanéité. Le lecteur suit bien volontiers cet auteur dans la banalité de son métier et de sa vie de famille, mais aussi dans l’exotisme de la profession de bédéiste.
Outre le fait que le personnage principal change, le lecteur remarque bien le passage d’un auteur à l’autre car le trait de Dupuy est plus appuyé, plus gras, plus agréable à la vue. Dans le même temps, il identifie également tout de suite la parenté avec les dessins de la série Monsieur Jean, même si ce dessinateur-là n’affuble pas ses personnages de gros nez. Il se révèle être également un excellent conteur, par exemple cette page où il évoque la vie de son père en seulement six cases. En comparant ces planches-ci avec celles de la première partie, il peut se faire une vague idée de ce qu’apportent un dessinateur et l’autre. Il constate que pour l’un, comme pour l’autre, les personnages représentés arborent tous un air sympathique, sans être nunuches, mais sans agressivité. L’un et l’autre savent poser un décor en quelques traits, tout en intégrant des éléments spécifiques qui rendent unique la ferme de Viviane dans le Quercy, ou permettent de reconnaître au premier coup d’œil, la gare Montparnasse. Ils utilisent avec la même aisance le glissement vers l’exagération visuelle, que ce soit avec Charles enfant, ou la mégalomanie débridée de Charles représenté par Phillipe lors qu’il abat une quantité de pages de Monsieur Jean, tout seul.
Cette lecture exhale un peu plus de saveurs pour celui qui a lu le tome trois de la série : il peut alors faire le lien avec une ou deux anecdotes de la vie personnelle de l’un ou de l’autre, et une aventure de Jean, ou bien encore identifier la métaphore du château assiégé par des femmes qui lancent des bébés aux soldats qui montent la garde sur les remparts. Au cours des séquences, Charles comme Philippe s’interroge sur leur rapport à la création, de manière superficielle, et plus sur leur comportement, leur mode de vie. Ça commence avec Charles qui estime qu’il est un adolescent attardé, ou même un enfant attardé à collectionner des figurines des Simpson, à accumuler des bandes dessinées (jusqu’à garder de vieux albums de Ric Hochet) alors que son appartement est plein à craquer. Ça continue avec Philippe qui trouve qu’il n’arrive pas à se faire à son âge, la trentaine : il continue à acheter des casquettes, à se balader en blouson et tee-shirt, voire même en baskets, comme un adolescent boutonneux, et à dépenser son argent en cinéma et en restaurants, alors qu’à trente-trois ans il devrait consacrer son argent à élever ses enfants (à son âge, son père avait quatre enfants).
L’épilogue de Charles le met en scène comme Robin, Philippe jouant le rôle de Batman, en costume l’un et l’autre. Il est question de leur amitié et de leur collaboration professionnelle, des incertitudes sur la parution de l’album de Monsieur Jean, et de leur rémunération. Il cite un passage d’un livre de Serge Rezvani, peintre, écrivain et auteur-compositeur-interprète français d'origine iranienne : À force de me situer à côté, en indiscipline et de la peinture et de l’écriture, prétendant à la transversalité, j’en suis venu à croire, comme le tireur à l’arc aux yeux fermés, que la pensée est à la fois flèche et but, et qu’il est donc inutile et distrayant de se préoccuper de quelle nature sont la flèche et le but, car seul d’arquer son arc sans décocher la flèche suffit. Charles s’interroge sur la beauté du geste, celui de dessiner et sur sa finalité. Puis Philippe évoque les étapes successives pour finir les planches de l’album jusqu’à sa parution : un vrai jeu de l’oie où le passage d’une case à la suivante est tributaire d’événements arbitraires, totalement indépendants des auteurs, à commencer par la santé financière de leur éditeur.
Charles Berberian et Philippe Dupuy ont fait le projet de réaliser un album de leur série Monsieur Jean, le troisième tome, et d’en documenter le processus sous la forme d’un journal à la narration libre, et séparée, chacun produisant ses chapitres seul, de son côté. Ils exposent leurs doutes sur la nature nombriliste d’une telle démarche, et réalisent des pages assez proches graphiquement de la série. Ils plongent le lecteur dans leur quotidien, au travers de morceaux choisis, et mis en scène, une autre forme de construction que celle de Monsieur Jean, mais pas une œuvre spontanée et sans réflexion ou formalisation. Le tout invite le lecteur aux côtés du quotidien de deux bédéistes, avec des personnalités différentes, des narrations visuelles assez proches, pour des tranches de vie banales dans ce qu’elles ont de pragmatique, mais aussi uniques car intrinsèquement liées à eux, à leur situation personnelle du moment, à leur l’étape qu’ils effectuent dans leur métier, à la fois une étape pour grandir, à la fois un reflet de la fragilité de l’artisanat.
Cet album est un hommage à la Rubrique-à-Brac, œuvre emblématique de Marcel Gotlib, qui a marqué l’histoire de la bande dessinée. Pour cet hommage, un casting de rêve est réuni dans cet album : Zep, Berbérian, Léandri, Tardi, Belkrouf, Maëster, Dupuy, Binet, Boucq, Jannin, Mourier, Arleston, Barral, Chauzy, Mandryka, Goossens, Christin, Blutch, Lindingre, Tonino Benacquista, Bilal, Lefred Thouron, Antoine de Caunes, Jean-Yves Ferri, Margerin, Tronchet, Solé, Édika, Larcenet, Mézières, Guarnido, Julien/CDM, Ptiluc et Dal.
Chacun, dans son style, reprend quelques principes utilisés dans la Rubrique-à-Brac, quelques idées, quelques personnages. Le résultat est assez décevant, en tentant de s’accaparer le style du maître, la plupart s’y cassent les dents.
Dupuy & Berberian avec la girafe, et Blutch avec le matou matheux, reprennent et détournent un histoire de Gotlib et s’en sortent nettement mieux, ainsi que Solé, avec la morale finale sous forme de jeux de mots comme dans le tome 5 où quelques histoires avaient été scénarisées par Gotlib et dessinées par d’autre auteurs.
Manu Larcenet m’a vraiment fait rire, toujours très drôle, mais c’est du Manu Larcenet.
Le reste est assez moyen, en essayant de faire du Gotlib, ils ne parviennent pas à être drôle, même Binet et Goossens déçoivent, certains se plantent carrément, venant d'auteurs que j'admire d'habitude, c'est presque gênant.
Bref, un hommage raté et vraiment une grosse déception.
Chacun, dans son style, reprend quelques principes utilisés dans la Rubrique-à-Brac, quelques idées, quelques personnages. Le résultat est assez décevant, en tentant de s’accaparer le style du maître, la plupart s’y cassent les dents.
Dupuy & Berberian avec la girafe, et Blutch avec le matou matheux, reprennent et détournent un histoire de Gotlib et s’en sortent nettement mieux, ainsi que Solé, avec la morale finale sous forme de jeux de mots comme dans le tome 5 où quelques histoires avaient été scénarisées par Gotlib et dessinées par d’autre auteurs.
Manu Larcenet m’a vraiment fait rire, toujours très drôle, mais c’est du Manu Larcenet.
Le reste est assez moyen, en essayant de faire du Gotlib, ils ne parviennent pas à être drôle, même Binet et Goossens déçoivent, certains se plantent carrément, venant d'auteurs que j'admire d'habitude, c'est presque gênant.
Bref, un hommage raté et vraiment une grosse déception.
Ça peut tout changer. Ces petites choses mises bout à bout.
-
Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, tout en s’inscrivant dans une réflexion sur l’art et sur la bande dessinée que l’auteur a initiée depuis plusieurs tomes, avec Une histoire de l’art (2016, sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso), suivi par Peindre ou ne pas peindre - L'intégrale (2019). Sa première édition date de 2022. Il a été réalisé par Philippe Dupuy pour le scénario, les dessins et les couleurs, avec la participation de son fils Hyppolyte. Il comprend cent-cinquante-six pages de bande dessinée. Il se termine avec la liste des artistes et de leurs œuvres évoqués, de Mark Rothko avec Red Equal à Jean Dubuffet avec la Métafizix, en évoquant soixante-dix créateurs, et six œuvres réalisées par des artistes inconnus.
Incipit : David Hockney montre toujours le chemin. Reprographie avec interprétation des œuvres Red Equal de Mark Rothko, Solen d’Edward Munch, Black sun d’Alexander Calder. Cycle : effroi, sidération, colère. Reprographie avec interprétation des œuvres : Le triomphe de la mort de Pierre Bruegel l’ancien, Pinturas Negras de Francisco de Goya, Teetering towers, The woodcuts, Heavy cloud d’Ansel Kiefer. Philippe Dupuy et son fils Hippolyte visitent un musée. L’enfant n’aime pas ces images, elles sont terrifiantes. Il ajoute qu’ils sont laids, et il y a celui qui mange quelqu’un. Sur l’avant-dernier, tout est cassé, brûlé, mort. Son père lui répond qu’il sait et qu’il est désolé. Il le prend par la main et l’emmène voir d’autres tableaux, parce que ceux-là, ça fait du bien, parce que ça existe encore : Amandier en fleurs de Vincent van Gogh, Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne, Nave Nave Moe de Paul Gauguin, A closer winter tunnel de David Hockney, Le bonheur de vivre d’Henri Matisse. Le garçon fait remarquer à son père qu’ils sont tous tout nus. À Paris, dans son appartement, Philippe est à sa table à dessin en train de travailler. Son fils entre et lui demande ce qu’il fait : il répond qu’il travaille. L’enfant veut savoir ce que c’est : le père explique que c’est un collage avec un dessin de la main gauche, il fait ça de temps en temps. L’enfant remarque que son père aussi dessine des femmes toutes nues et il souhaite savoir pourquoi.
Philippe explique qu’il aime bien, parce qu’il trouve ça beau. Et puis c’est quelque chose qui se fait souvent en art. Le fils renchérit : oui, dans les peintures, il y a plein de dames toutes nues. Comme la dame dans le coquillage qui cache sa zézette avec ses cheveux. Mais, bon, il aime bien quand même les dessins de son père. Ce dernier le remercie et lui indique qu’il aime beaucoup ceux de son fils. Puis Hippolyte demande la permission de regarder un dessin animé, il choisit les Pokémons. La chanson du générique débute, le héros indiquant sa volonté de devenir le meilleur dresseur, de gagner les défis et de parcourir la Terre entière. À table, l’enfant regarde le fond de son verre : quarante-quatre ans comme maman, celle-ci répond qu’elle a vingt-deux ans dans le fond de son verre. Philippe met ses lunettes mais il n’arrive pas à lire, c’est vraiment écrit trop petit. Son fils prend le verre et lit : quatre ans.
Dès les premières planches, le lecteur fait connaissance avec la singularité de ce créateur. Il reproduit en les interprétant trois tableaux de maître, puis il réalise un triangle à main levée plaçant aux sommets les mots Effroi, Colère, Sidération. Puis suit l’interprétation d’autres tableaux, et des échanges avec son fils. À l’évidence, c’est le choix de l’auteur que de reproduire à sa manière ses œuvres d’art, plutôt que de faire usage d’une photographie de ces tableaux. Il monte ainsi comment il les perçoit, comment il les interprète, comme il les fait siens. Après ces pages en couleurs, à la peinture, au feutre, au crayon de couleur et au crayon noir, il réalise une page dans son mode graphique habituel : des traits de contour irréguliers et fins, à l’encre pour des dessins dans une veine représentative et descriptive, avec un niveau de détails variable en fonction des éléments représentés, êtres humains comme objets, entre esquisse et dessin précis à l’apparence malhabile. Dans le premier cas, le lecteur voit l’intention et la spontanéité ; dans le deuxième cas, il constate que l’artiste sait observer finement ce qui l’entoure, par exemple quand il peut identifier le mobilier urbain parisien comme les croix de Saint-André.
S’il a déjà lu des bandes dessinées récentes de cet auteur, le lecteur s’attend à la diversité des approches graphiques, et à cette impression un peu penchée. Sinon, il découvre une multitude d’idiosyncrasies qui ne relèvent pas du maniérisme ou de l’affèterie, mais de l’expression de la personnalité de l’auteur, de ses intonations, de ses hésitations, de sa façon d’appréhender le monde. Ce créateur s’exprime par chaque trait, par chaque forme, chaque mise en page, par la structure de son récit. Au fil de sa carrière, il a maîtrisé différentes techniques, les règles académiques et le savoir-faire d’un bédéiste, jusqu’à pouvoir faire totalement sien toutes les dimensions de ce mode d’expression. Il suffit de regarder les textes pour en avoir la preuve : jeu sur les polices, lettrage manuel et artisanale, ondulation des textes qui peuvent parfois épouser la forme des bordures, ou suivre la forme d’une spirale, petites annotations manuscrites en bordure de case, texte en minuscule ou en majuscule, alternance de mots en minuscules et en majuscules, et toutes ces variations participent à exprimer l’état d’esprit de l’auteur, à l’opposé de facéties artificielles et gratuites. Les modes d’expression graphique varient également en fonction de ce que l’artiste souhaite exprimer : les pages avec des dessins à base de traits de contour fins et encrés, l’interprétation d’œuvres d’art classiques, des dessins à l’encre (de femmes nues) collés sur des photographies de montagnes, des peintures abstraites à l’aquarelle avec une silhouette dessinée et collée par-dessus, les dessins de son fils intégrés à une page, voire composant la narration visuelle pendant plusieurs pages, des compositions avec les dessins à l’encre et l’aquarelle, quatre vues de Taipei réalisées au pinceau et à l’encre sous forme d’illustration en double page, une modification du rendu des formes pour raconter une performance des cubes de Takako Saito, la reprographie de deux petits livres de bande dessinée réalisés par Hippolyte comme cadeau d’anniversaire, un dessin pour illustrer un texte de Greil Marcus sur les Sex Pistols, etc.
Derrière ce titre aguicheur, le lecteur ne sait pas trop à quoi s’attendre : la dissection d’une pratique de dessin honteuse ? La visite au musée établit qu’une composante principale du récit réside dans la relation du père avec son fils. Celui-ci ressent les œuvres d’art, sans appareil analytique : il les voit mieux que l’auteur qui est incapable de se départir de sa culture picturale, de plusieurs décennies de pratique de la bande dessinée. C’est la raison pour laquelle Hippolyte pose cette question ingénue à son père : la forte proportion de corps féminins dénudés dans l’art lui saute aux yeux. À travers son fils, l’auteur retrouve la capacité d’émerveillement qui s’est émoussée en lui avec les décennies écoulées. Il se reconnecte aux émotions suscitées par les œuvres d’art, il retrouve une façon de voir qu’il avait perdue. Au fil des séquences, il apparaît d’autres facettes de sa relation avec son fils du fait du caractère intimement personnel de l’ouvrage. Ainsi il évoque le regard des autres parents commentant la différence d’âge entre les deux, le père ayant soixante ans et le fils bientôt onze ans, la mère Loo Hui Phang en a quarante-six. Les parents évoquent l’avenir de leur enfant, au regard de l’état du monde. Cela amène à des questions et des réflexions apaisées, mais pas faciles, comme Philippe se demandant à partir de quand son fils pensera que son père est vieux.
La visite au musée établit aussi une autre composante majeure : la contemplation de l’art et la relation que l’auteur entretient avec. Il avait développé ce thème dans Peindre on ne pas peindre (2019), et avait poursuivi sa réflexion sur le sujet dans 'aurais voulu faire de la bande dessinée (2020, avec Dominique A et Stéphan Oliva). Outre les artistes cités plus haut, les visites d’exposition évoquent également des œuvres de Matisse, Man Ray, Joan Miró, Fernand Léger. L’auteur passe en revue la nudité féminine dans l’art, depuis les représentations du paléolithique jusqu’au monde moderne (Pop art, Op art, Figuration narrative, libre, Cobra, Estampes, Fluxus, Photographie, Nouveau réalisme, Arte povera, Art brut, Performance, Art vidéo). Il consacré également dix pages à Takako Saito (1929-), artiste japonaise, à l’occasion d’une de ses performances à base de cubes au CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux. Le lecteur se retrouve fasciné par ce qu’en dit Dupuy qui s’avère un excellent passeur pédagogue pour parler de cette œuvre. Il revient à l’esprit du lecteur la remarque de l’auteur sur les différentes formes d’accessibilité à une œuvre, soit érudite grâce à un bagage culturel adéquat (y compris pour les bandes dessinées), soit plus immédiat comme en atteste la réponse de son fils participant spontanément à ladite performance comme les autres enfants présents, alors que les adultes ne peuvent envisager leur condition qu’en tant que spectateur. Dans cette bande dessinée, le lecteur découvre deux extraits de l’ouvrage Lipstick Traces (1989) de Greil Markus, analysant comment les Sex Pistols ouvrirent une brèche dans le monde du rock et de la chanson, dans l’écran des certitudes qui sont censées régir l’offre et la demande en matière de goût. Parce que les certitudes, les idées culturelles reçues sont hégémoniques et voudraient expliquer comment le monde est censé tourner – des constructions idéologiques perçues et vécues comme des faits naturels – cette brèche dans le milieu pop s’ouvre sur le royaume de la vie quotidienne. Le lecteur comprend que ces remarques ont eu une grande importance dans la manière dont l’auteur considère l’art en général, et le sien en particulier.
Un titre un peu provocateur, assorti d’une couverture composite cryptique. Une fois encore, le lecteur se retrouve déconcerté par la facilité et l’évidence de la narration, alors qu’elle semble si hétéroclite en apparence. Il fait entièrement confiance à l’auteur qui se montre attentionné vis-à-vis de lui, tout en réalisant une œuvre si personnelle que rien ne pourrait être modifié sans en changer profondément le sens. La narration visuelle s’avère protéiforme, dégageant un mélange de spontanéité et de sincérité, tout en révélant une extraordinaire unité parfaite entre le fond et la forme. Philippe Dupuy aborde des thèmes très personnels comme sa relation avec son fils, indissociables de son rapport à l’art, aux artistes, à sa pratique de la bande dessinée, à sa vie dans cette phase qu’il qualifie de temps additionnel, selon la formule de Christian Boltanski : les années se condensent, la forces des intentions aussi, le temps additionnel a une intensité bien différente. Merveilleux.
-
Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre, tout en s’inscrivant dans une réflexion sur l’art et sur la bande dessinée que l’auteur a initiée depuis plusieurs tomes, avec Une histoire de l’art (2016, sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso), suivi par Peindre ou ne pas peindre - L'intégrale (2019). Sa première édition date de 2022. Il a été réalisé par Philippe Dupuy pour le scénario, les dessins et les couleurs, avec la participation de son fils Hyppolyte. Il comprend cent-cinquante-six pages de bande dessinée. Il se termine avec la liste des artistes et de leurs œuvres évoqués, de Mark Rothko avec Red Equal à Jean Dubuffet avec la Métafizix, en évoquant soixante-dix créateurs, et six œuvres réalisées par des artistes inconnus.
Incipit : David Hockney montre toujours le chemin. Reprographie avec interprétation des œuvres Red Equal de Mark Rothko, Solen d’Edward Munch, Black sun d’Alexander Calder. Cycle : effroi, sidération, colère. Reprographie avec interprétation des œuvres : Le triomphe de la mort de Pierre Bruegel l’ancien, Pinturas Negras de Francisco de Goya, Teetering towers, The woodcuts, Heavy cloud d’Ansel Kiefer. Philippe Dupuy et son fils Hippolyte visitent un musée. L’enfant n’aime pas ces images, elles sont terrifiantes. Il ajoute qu’ils sont laids, et il y a celui qui mange quelqu’un. Sur l’avant-dernier, tout est cassé, brûlé, mort. Son père lui répond qu’il sait et qu’il est désolé. Il le prend par la main et l’emmène voir d’autres tableaux, parce que ceux-là, ça fait du bien, parce que ça existe encore : Amandier en fleurs de Vincent van Gogh, Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne, Nave Nave Moe de Paul Gauguin, A closer winter tunnel de David Hockney, Le bonheur de vivre d’Henri Matisse. Le garçon fait remarquer à son père qu’ils sont tous tout nus. À Paris, dans son appartement, Philippe est à sa table à dessin en train de travailler. Son fils entre et lui demande ce qu’il fait : il répond qu’il travaille. L’enfant veut savoir ce que c’est : le père explique que c’est un collage avec un dessin de la main gauche, il fait ça de temps en temps. L’enfant remarque que son père aussi dessine des femmes toutes nues et il souhaite savoir pourquoi.
Philippe explique qu’il aime bien, parce qu’il trouve ça beau. Et puis c’est quelque chose qui se fait souvent en art. Le fils renchérit : oui, dans les peintures, il y a plein de dames toutes nues. Comme la dame dans le coquillage qui cache sa zézette avec ses cheveux. Mais, bon, il aime bien quand même les dessins de son père. Ce dernier le remercie et lui indique qu’il aime beaucoup ceux de son fils. Puis Hippolyte demande la permission de regarder un dessin animé, il choisit les Pokémons. La chanson du générique débute, le héros indiquant sa volonté de devenir le meilleur dresseur, de gagner les défis et de parcourir la Terre entière. À table, l’enfant regarde le fond de son verre : quarante-quatre ans comme maman, celle-ci répond qu’elle a vingt-deux ans dans le fond de son verre. Philippe met ses lunettes mais il n’arrive pas à lire, c’est vraiment écrit trop petit. Son fils prend le verre et lit : quatre ans.
Dès les premières planches, le lecteur fait connaissance avec la singularité de ce créateur. Il reproduit en les interprétant trois tableaux de maître, puis il réalise un triangle à main levée plaçant aux sommets les mots Effroi, Colère, Sidération. Puis suit l’interprétation d’autres tableaux, et des échanges avec son fils. À l’évidence, c’est le choix de l’auteur que de reproduire à sa manière ses œuvres d’art, plutôt que de faire usage d’une photographie de ces tableaux. Il monte ainsi comment il les perçoit, comment il les interprète, comme il les fait siens. Après ces pages en couleurs, à la peinture, au feutre, au crayon de couleur et au crayon noir, il réalise une page dans son mode graphique habituel : des traits de contour irréguliers et fins, à l’encre pour des dessins dans une veine représentative et descriptive, avec un niveau de détails variable en fonction des éléments représentés, êtres humains comme objets, entre esquisse et dessin précis à l’apparence malhabile. Dans le premier cas, le lecteur voit l’intention et la spontanéité ; dans le deuxième cas, il constate que l’artiste sait observer finement ce qui l’entoure, par exemple quand il peut identifier le mobilier urbain parisien comme les croix de Saint-André.
S’il a déjà lu des bandes dessinées récentes de cet auteur, le lecteur s’attend à la diversité des approches graphiques, et à cette impression un peu penchée. Sinon, il découvre une multitude d’idiosyncrasies qui ne relèvent pas du maniérisme ou de l’affèterie, mais de l’expression de la personnalité de l’auteur, de ses intonations, de ses hésitations, de sa façon d’appréhender le monde. Ce créateur s’exprime par chaque trait, par chaque forme, chaque mise en page, par la structure de son récit. Au fil de sa carrière, il a maîtrisé différentes techniques, les règles académiques et le savoir-faire d’un bédéiste, jusqu’à pouvoir faire totalement sien toutes les dimensions de ce mode d’expression. Il suffit de regarder les textes pour en avoir la preuve : jeu sur les polices, lettrage manuel et artisanale, ondulation des textes qui peuvent parfois épouser la forme des bordures, ou suivre la forme d’une spirale, petites annotations manuscrites en bordure de case, texte en minuscule ou en majuscule, alternance de mots en minuscules et en majuscules, et toutes ces variations participent à exprimer l’état d’esprit de l’auteur, à l’opposé de facéties artificielles et gratuites. Les modes d’expression graphique varient également en fonction de ce que l’artiste souhaite exprimer : les pages avec des dessins à base de traits de contour fins et encrés, l’interprétation d’œuvres d’art classiques, des dessins à l’encre (de femmes nues) collés sur des photographies de montagnes, des peintures abstraites à l’aquarelle avec une silhouette dessinée et collée par-dessus, les dessins de son fils intégrés à une page, voire composant la narration visuelle pendant plusieurs pages, des compositions avec les dessins à l’encre et l’aquarelle, quatre vues de Taipei réalisées au pinceau et à l’encre sous forme d’illustration en double page, une modification du rendu des formes pour raconter une performance des cubes de Takako Saito, la reprographie de deux petits livres de bande dessinée réalisés par Hippolyte comme cadeau d’anniversaire, un dessin pour illustrer un texte de Greil Marcus sur les Sex Pistols, etc.
Derrière ce titre aguicheur, le lecteur ne sait pas trop à quoi s’attendre : la dissection d’une pratique de dessin honteuse ? La visite au musée établit qu’une composante principale du récit réside dans la relation du père avec son fils. Celui-ci ressent les œuvres d’art, sans appareil analytique : il les voit mieux que l’auteur qui est incapable de se départir de sa culture picturale, de plusieurs décennies de pratique de la bande dessinée. C’est la raison pour laquelle Hippolyte pose cette question ingénue à son père : la forte proportion de corps féminins dénudés dans l’art lui saute aux yeux. À travers son fils, l’auteur retrouve la capacité d’émerveillement qui s’est émoussée en lui avec les décennies écoulées. Il se reconnecte aux émotions suscitées par les œuvres d’art, il retrouve une façon de voir qu’il avait perdue. Au fil des séquences, il apparaît d’autres facettes de sa relation avec son fils du fait du caractère intimement personnel de l’ouvrage. Ainsi il évoque le regard des autres parents commentant la différence d’âge entre les deux, le père ayant soixante ans et le fils bientôt onze ans, la mère Loo Hui Phang en a quarante-six. Les parents évoquent l’avenir de leur enfant, au regard de l’état du monde. Cela amène à des questions et des réflexions apaisées, mais pas faciles, comme Philippe se demandant à partir de quand son fils pensera que son père est vieux.
La visite au musée établit aussi une autre composante majeure : la contemplation de l’art et la relation que l’auteur entretient avec. Il avait développé ce thème dans Peindre on ne pas peindre (2019), et avait poursuivi sa réflexion sur le sujet dans 'aurais voulu faire de la bande dessinée (2020, avec Dominique A et Stéphan Oliva). Outre les artistes cités plus haut, les visites d’exposition évoquent également des œuvres de Matisse, Man Ray, Joan Miró, Fernand Léger. L’auteur passe en revue la nudité féminine dans l’art, depuis les représentations du paléolithique jusqu’au monde moderne (Pop art, Op art, Figuration narrative, libre, Cobra, Estampes, Fluxus, Photographie, Nouveau réalisme, Arte povera, Art brut, Performance, Art vidéo). Il consacré également dix pages à Takako Saito (1929-), artiste japonaise, à l’occasion d’une de ses performances à base de cubes au CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux. Le lecteur se retrouve fasciné par ce qu’en dit Dupuy qui s’avère un excellent passeur pédagogue pour parler de cette œuvre. Il revient à l’esprit du lecteur la remarque de l’auteur sur les différentes formes d’accessibilité à une œuvre, soit érudite grâce à un bagage culturel adéquat (y compris pour les bandes dessinées), soit plus immédiat comme en atteste la réponse de son fils participant spontanément à ladite performance comme les autres enfants présents, alors que les adultes ne peuvent envisager leur condition qu’en tant que spectateur. Dans cette bande dessinée, le lecteur découvre deux extraits de l’ouvrage Lipstick Traces (1989) de Greil Markus, analysant comment les Sex Pistols ouvrirent une brèche dans le monde du rock et de la chanson, dans l’écran des certitudes qui sont censées régir l’offre et la demande en matière de goût. Parce que les certitudes, les idées culturelles reçues sont hégémoniques et voudraient expliquer comment le monde est censé tourner – des constructions idéologiques perçues et vécues comme des faits naturels – cette brèche dans le milieu pop s’ouvre sur le royaume de la vie quotidienne. Le lecteur comprend que ces remarques ont eu une grande importance dans la manière dont l’auteur considère l’art en général, et le sien en particulier.
Un titre un peu provocateur, assorti d’une couverture composite cryptique. Une fois encore, le lecteur se retrouve déconcerté par la facilité et l’évidence de la narration, alors qu’elle semble si hétéroclite en apparence. Il fait entièrement confiance à l’auteur qui se montre attentionné vis-à-vis de lui, tout en réalisant une œuvre si personnelle que rien ne pourrait être modifié sans en changer profondément le sens. La narration visuelle s’avère protéiforme, dégageant un mélange de spontanéité et de sincérité, tout en révélant une extraordinaire unité parfaite entre le fond et la forme. Philippe Dupuy aborde des thèmes très personnels comme sa relation avec son fils, indissociables de son rapport à l’art, aux artistes, à sa pratique de la bande dessinée, à sa vie dans cette phase qu’il qualifie de temps additionnel, selon la formule de Christian Boltanski : les années se condensent, la forces des intentions aussi, le temps additionnel a une intensité bien différente. Merveilleux.
Quand on dit : Les gens sont ceci ou cela, c’est de soi qu’on veut parler.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 6 : Inventaire avant travaux (2003). La première édition du présent tome date de 2005 et contient un marquepage en forme d’ex-libris. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Ruby. L’album compte quarante-six planches, sous la forme de quarante-et-une histoires courtes, trente-six en une page, cinq en deux pages. C’est le dernier album de la série.
Jalousie : de nuit dans le quartier du Sacré-Cœur, Cathy et Jean rentrent à pied chez eux. Elle lui parle de son déjeuner du midi, avec un vieux copain de fac. Quand il l’a appelée l’autre jour, elle était surprise mais aussi intriguée. Elle avait envie de savoir ce qu’il était devenu. Elle continue : c’était vachement sympa, il est dans la recherche maintenant. Il a bossé trois ans au Brésil et là ça fait un mois qu’il est rentré en France. Il a un parcours intéressant, ça l’a changé en mieux. Monsieur Jean finit par se demander si elle n’essayerait pas de le rendre jaloux. Le portable : Jean regarde l’écran de son téléphone portable, avec angoisse. Ce qui l’angoisse, c’est l’indicateur du niveau de charge. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne peut pas s’empêcher d’associer le nombre de bâtons au niveau de son compte en banque, ou pire au temps qu’il lui reste à vivre. Une chance au grattage : Cathy est en train de prendre un café avec sa copine Agnès célibataire, dans un troquet. Elles regardent les clients en train de gratter un jeu : le convulsif, le collectionneur, celui qui culpabilise et qui fait ça en cachette. Il y a quelque chose de sexuel dans le comportement des hommes qui grattent leur ticket de jeu.
Les gens 1 : Félix et Jean marchent dans une rue parisienne. Le premier fait observer au second qu’il a remarqué un truc. Quand on dit : Les gens sont ceci ou cela, c’est souvent de soi qu’on veut parler. Par exemple, on dit : les gens sont énervés, en fait c’est qu’on énervé soi-même. Mariage : Liette s’est lovée contre Félix sur le canapé, et lui demande s’il l’aime vraiment. Il lui répond si elle est en train de lui demander qu’ils se marient. Elle lui indique qu’elle aimerait juste qu’il s’occupe un peu plus d’elle. Avec lui, elle a l’impression de tout porter sur les épaules. Elle a l’air forte comme ça, elle peut prendre en charge plein de choses, mais elle a parfois besoin de se sentir en sécurité. Enfin bref, ce serait plus léger pour elle s’il cherchait au moins un boulot. À la boulangerie 1 : Monsieur Jean raconte à ses amis Félix et Clément qu’il rentre dans sa boulangerie et qu’il prononce un bonjour, sur un ton de voix normal. Personne ne lui répond. Il voit le coup venir : il va falloir qu’il redise bonjour, et c’est idiot car il l’a déjà dit une fois. Il ne va pas recommencer uniquement parce que ces deux abruties étaient trop occupées à discuter pour l’écouter. Quand son tour arrive et qu’il demande une baguette, la boulangère lui répond par un Bonjour peu amène.
À l’issue du tome précédent, Monsieur Jean était installé en couple avec Cathy, et ils avaient une petite fille Julie. Il avait affronté ses craintes de déchéance sociale, de peur de la séparation, de la mémoire de ses grands-parents et de leur valeur, et de la mort. Le lecteur s’interroge sur la prochaine étape qu’il va franchir dans la vie. Il découvre que les auteurs ont choisi de revenir au format de gags courts, en une page, à l’exception de cinq en deux pages. Il se rend compte que Monsieur Jean ne figure pas dans tous les gags : quinze sur quarante-et-un. Par comparaison, Félix Martin figure dans vingt-et-un. Il fait la connaissance d’une nouvelle venue : Agnès célibataire et copine de Cathy. Elle figure dans onze gags. Eugène, le fils adoptif de Félix, bénéficie également d’une bonne exposition, avec un petit air futé et malin, un préadolescent qui sait faire tourner son père en bourrique avec malice et à propos. La série se déroule toujours à Paris, avec un parisianisme peu marqué, un ou deux monuments, une bouche de métro, une colonne Morris, un trajet en métro, et une balade le long du canal Saint Martin avec la passerelle Bichat.
Ayant intégré le format d’anthologie d’histoires très courtes, le lecteur retrouve avec plaisir les personnages qu’il a côtoyés pendant les albums précédents, Monsieur Jean bien sûr, et sa compagne Cathy avec leur fille Julie, son ami Félix Martin avec son fils adoptif Eugène, et sa compagne Liette Botinelli, une courte apparition de Clément, et il fait connaissance avec Agnès, bien malheureuse d’être seule. Il retrouve avec grand plaisir les dessins avec leur esthétique si personnelle. Les personnages portent la marque des artistes : silhouettes longilignes, gros nez pour ces messieurs, nez fin et pointu pour ces dames, élégance discrète dans les tenues vestimentaires sans vêtement de marque ou de luxe, visage un peu plus expressif que dans la réalité sans aller vers la caricature comique, direction d’acteurs naturaliste. De temps à autre, le lecteur prend le temps de savourer un visage ou une apparence : la douceur du visage de Cathy, la malice dans celui d’Eugène qui n’a pas son pareil pour manipuler son père adoptif, les émotions, la déprime grandissante d’Agnès qui ne trouve pas de mec, puis son air fatigué et éteint quand elle est sous antidépresseur. Le plus effrayant devient Félix après que Liette l’ait quitté : amaigri et hagard, maniaco-dépressif : il fait peur à voir.
Le lecteur relève également que les artistes ont franchi un nouveau pallier dans la manière de représenter les décors : du grand art entre l’esquisse spontanée et le savant dosage d’informations visuelles. Impossible de se tromper dans la première bande de la première page : ces quelques traits évoquent le Sacré-Cœur, alors même qu’un regard prolongé sur cet arrière-plan finit par ne plus voir qu’un amas informe de traits hasardeux. Le lecteur parisien reconnaît sans difficulté sa ville, également grâce aux formes des mobiliers urbains, aux potelets, des détails qui attestent de la qualité d’observation des dessinateurs. Par la suite, il peut noter la petitesse des tables dans un bistro, la forme très épurée des voitures, l’exactitude du modèle de banquette dans un wagon du métro, l’étroitesse de certains trottoirs, les mauvaises surprises dans un espace vert parisien trop sollicité, et la fameuse passerelle Bichat. Cette narration visuelle ne transforme pas Paris en une version édulcorée ou fantasmée, mais rend compte du ressenti des personnages qui y évoluent.
Une fois accepté qu’il s’agit d’histoires courtes papillonnant d’un personnage à l’autre, le lecteur se dit qu’après le processus progressif de prise en charge des responsabilités d’adulte par Monsieur Jean, les auteurs mettent à profit la palette infinie des préoccupations du quotidien. Ils le font avec une verve entraînante, nourrissant leurs histoires d’une myriade de petits riens. La relation amoureuse se retrouve au cœur d’une bonne moitié de ces histoires : jalousie, comparaison avec le comportement des joueurs sur leur ticket à gratter, envie de mariage, solitude difficile à supporter, draguer avec un bébé en poussette, avoir un comportement trop intense quand on cherche à se mettre à la colle avec un mec, craindre l’âge et la nécessité de se maquiller, se faire larguer par sa compagne, tenter l’agence matrimoniale (les applis de rencontre n’existaient pas à l’époque), se comparer à une chaussette seule (Le monde est une machine à laver qui sépare ceux qui s’aiment.), constater que les filles sont lâches et que les hommes sont des imbéciles. Parmi les autres, le lecteur retrouve des situations qu’il a pu expérimenter : s’inquiéter démesurément de la charge de son téléphone, dire bonjour dans une boulangerie sans être entendu, sentir une forme de discrimination parce qu’on est trop jeune ou trop vieux, ressentir l’environnement urbain comme un milieu agressif, se contenter de réponses toutes faites, recevoir un postillon un peu trop grand, se laisser happer par un jeu sur console, se faire observer par un vigile dans un magasin. Le lecteur sent que Félix vole la vedette à Jean, avec sa déprime et son air de poète maudit, et il éprouve également une forte empathie pour Agnès désemparée de se retrouver seule dans la vie sans raison apparente.
Un dernier tome pour cette série qui est allée en se bonifiant de tome en tome. Plutôt que de se focaliser sur un chemin bien tracé pour Monsieur Jean, les auteurs font le choix d’ouvrir le champ de leurs observations à de multiples situations diverses, dont Monsieur Jean fait l’expérience d’une partie, et d’autres personnages du reste. Le lecteur se régale à chaque page, de la personnalité graphique des artistes, aussi convaincants qu’impressionnants dans leur façon de styliser les environnements, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, et d’insuffler de la vie et de la personnalité dans les protagonistes. Les questionnements sur les relations amoureuses continuent au travers de la situation des personnages. Dans le même temps, Eugène, préadolescent, assure la relève des adultes. Il manipule son père adoptif avec une efficacité redoutable, et il pose des questions sur la survenance imprévisible de la mort (juste pour prouver que l’ignorance est donc source de bonheur et de légèreté), sur l’irresponsabilité d’un adulte qui devrait lui donner l’exemple, sur l’existence de Dieu. Un tome bien agréable, même s’il fait un écart avec la progression narrative de la série : il constitue un épilogue de grande qualité.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 6 : Inventaire avant travaux (2003). La première édition du présent tome date de 2005 et contient un marquepage en forme d’ex-libris. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Ruby. L’album compte quarante-six planches, sous la forme de quarante-et-une histoires courtes, trente-six en une page, cinq en deux pages. C’est le dernier album de la série.
Jalousie : de nuit dans le quartier du Sacré-Cœur, Cathy et Jean rentrent à pied chez eux. Elle lui parle de son déjeuner du midi, avec un vieux copain de fac. Quand il l’a appelée l’autre jour, elle était surprise mais aussi intriguée. Elle avait envie de savoir ce qu’il était devenu. Elle continue : c’était vachement sympa, il est dans la recherche maintenant. Il a bossé trois ans au Brésil et là ça fait un mois qu’il est rentré en France. Il a un parcours intéressant, ça l’a changé en mieux. Monsieur Jean finit par se demander si elle n’essayerait pas de le rendre jaloux. Le portable : Jean regarde l’écran de son téléphone portable, avec angoisse. Ce qui l’angoisse, c’est l’indicateur du niveau de charge. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne peut pas s’empêcher d’associer le nombre de bâtons au niveau de son compte en banque, ou pire au temps qu’il lui reste à vivre. Une chance au grattage : Cathy est en train de prendre un café avec sa copine Agnès célibataire, dans un troquet. Elles regardent les clients en train de gratter un jeu : le convulsif, le collectionneur, celui qui culpabilise et qui fait ça en cachette. Il y a quelque chose de sexuel dans le comportement des hommes qui grattent leur ticket de jeu.
Les gens 1 : Félix et Jean marchent dans une rue parisienne. Le premier fait observer au second qu’il a remarqué un truc. Quand on dit : Les gens sont ceci ou cela, c’est souvent de soi qu’on veut parler. Par exemple, on dit : les gens sont énervés, en fait c’est qu’on énervé soi-même. Mariage : Liette s’est lovée contre Félix sur le canapé, et lui demande s’il l’aime vraiment. Il lui répond si elle est en train de lui demander qu’ils se marient. Elle lui indique qu’elle aimerait juste qu’il s’occupe un peu plus d’elle. Avec lui, elle a l’impression de tout porter sur les épaules. Elle a l’air forte comme ça, elle peut prendre en charge plein de choses, mais elle a parfois besoin de se sentir en sécurité. Enfin bref, ce serait plus léger pour elle s’il cherchait au moins un boulot. À la boulangerie 1 : Monsieur Jean raconte à ses amis Félix et Clément qu’il rentre dans sa boulangerie et qu’il prononce un bonjour, sur un ton de voix normal. Personne ne lui répond. Il voit le coup venir : il va falloir qu’il redise bonjour, et c’est idiot car il l’a déjà dit une fois. Il ne va pas recommencer uniquement parce que ces deux abruties étaient trop occupées à discuter pour l’écouter. Quand son tour arrive et qu’il demande une baguette, la boulangère lui répond par un Bonjour peu amène.
À l’issue du tome précédent, Monsieur Jean était installé en couple avec Cathy, et ils avaient une petite fille Julie. Il avait affronté ses craintes de déchéance sociale, de peur de la séparation, de la mémoire de ses grands-parents et de leur valeur, et de la mort. Le lecteur s’interroge sur la prochaine étape qu’il va franchir dans la vie. Il découvre que les auteurs ont choisi de revenir au format de gags courts, en une page, à l’exception de cinq en deux pages. Il se rend compte que Monsieur Jean ne figure pas dans tous les gags : quinze sur quarante-et-un. Par comparaison, Félix Martin figure dans vingt-et-un. Il fait la connaissance d’une nouvelle venue : Agnès célibataire et copine de Cathy. Elle figure dans onze gags. Eugène, le fils adoptif de Félix, bénéficie également d’une bonne exposition, avec un petit air futé et malin, un préadolescent qui sait faire tourner son père en bourrique avec malice et à propos. La série se déroule toujours à Paris, avec un parisianisme peu marqué, un ou deux monuments, une bouche de métro, une colonne Morris, un trajet en métro, et une balade le long du canal Saint Martin avec la passerelle Bichat.
Ayant intégré le format d’anthologie d’histoires très courtes, le lecteur retrouve avec plaisir les personnages qu’il a côtoyés pendant les albums précédents, Monsieur Jean bien sûr, et sa compagne Cathy avec leur fille Julie, son ami Félix Martin avec son fils adoptif Eugène, et sa compagne Liette Botinelli, une courte apparition de Clément, et il fait connaissance avec Agnès, bien malheureuse d’être seule. Il retrouve avec grand plaisir les dessins avec leur esthétique si personnelle. Les personnages portent la marque des artistes : silhouettes longilignes, gros nez pour ces messieurs, nez fin et pointu pour ces dames, élégance discrète dans les tenues vestimentaires sans vêtement de marque ou de luxe, visage un peu plus expressif que dans la réalité sans aller vers la caricature comique, direction d’acteurs naturaliste. De temps à autre, le lecteur prend le temps de savourer un visage ou une apparence : la douceur du visage de Cathy, la malice dans celui d’Eugène qui n’a pas son pareil pour manipuler son père adoptif, les émotions, la déprime grandissante d’Agnès qui ne trouve pas de mec, puis son air fatigué et éteint quand elle est sous antidépresseur. Le plus effrayant devient Félix après que Liette l’ait quitté : amaigri et hagard, maniaco-dépressif : il fait peur à voir.
Le lecteur relève également que les artistes ont franchi un nouveau pallier dans la manière de représenter les décors : du grand art entre l’esquisse spontanée et le savant dosage d’informations visuelles. Impossible de se tromper dans la première bande de la première page : ces quelques traits évoquent le Sacré-Cœur, alors même qu’un regard prolongé sur cet arrière-plan finit par ne plus voir qu’un amas informe de traits hasardeux. Le lecteur parisien reconnaît sans difficulté sa ville, également grâce aux formes des mobiliers urbains, aux potelets, des détails qui attestent de la qualité d’observation des dessinateurs. Par la suite, il peut noter la petitesse des tables dans un bistro, la forme très épurée des voitures, l’exactitude du modèle de banquette dans un wagon du métro, l’étroitesse de certains trottoirs, les mauvaises surprises dans un espace vert parisien trop sollicité, et la fameuse passerelle Bichat. Cette narration visuelle ne transforme pas Paris en une version édulcorée ou fantasmée, mais rend compte du ressenti des personnages qui y évoluent.
Une fois accepté qu’il s’agit d’histoires courtes papillonnant d’un personnage à l’autre, le lecteur se dit qu’après le processus progressif de prise en charge des responsabilités d’adulte par Monsieur Jean, les auteurs mettent à profit la palette infinie des préoccupations du quotidien. Ils le font avec une verve entraînante, nourrissant leurs histoires d’une myriade de petits riens. La relation amoureuse se retrouve au cœur d’une bonne moitié de ces histoires : jalousie, comparaison avec le comportement des joueurs sur leur ticket à gratter, envie de mariage, solitude difficile à supporter, draguer avec un bébé en poussette, avoir un comportement trop intense quand on cherche à se mettre à la colle avec un mec, craindre l’âge et la nécessité de se maquiller, se faire larguer par sa compagne, tenter l’agence matrimoniale (les applis de rencontre n’existaient pas à l’époque), se comparer à une chaussette seule (Le monde est une machine à laver qui sépare ceux qui s’aiment.), constater que les filles sont lâches et que les hommes sont des imbéciles. Parmi les autres, le lecteur retrouve des situations qu’il a pu expérimenter : s’inquiéter démesurément de la charge de son téléphone, dire bonjour dans une boulangerie sans être entendu, sentir une forme de discrimination parce qu’on est trop jeune ou trop vieux, ressentir l’environnement urbain comme un milieu agressif, se contenter de réponses toutes faites, recevoir un postillon un peu trop grand, se laisser happer par un jeu sur console, se faire observer par un vigile dans un magasin. Le lecteur sent que Félix vole la vedette à Jean, avec sa déprime et son air de poète maudit, et il éprouve également une forte empathie pour Agnès désemparée de se retrouver seule dans la vie sans raison apparente.
Un dernier tome pour cette série qui est allée en se bonifiant de tome en tome. Plutôt que de se focaliser sur un chemin bien tracé pour Monsieur Jean, les auteurs font le choix d’ouvrir le champ de leurs observations à de multiples situations diverses, dont Monsieur Jean fait l’expérience d’une partie, et d’autres personnages du reste. Le lecteur se régale à chaque page, de la personnalité graphique des artistes, aussi convaincants qu’impressionnants dans leur façon de styliser les environnements, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, et d’insuffler de la vie et de la personnalité dans les protagonistes. Les questionnements sur les relations amoureuses continuent au travers de la situation des personnages. Dans le même temps, Eugène, préadolescent, assure la relève des adultes. Il manipule son père adoptif avec une efficacité redoutable, et il pose des questions sur la survenance imprévisible de la mort (juste pour prouver que l’ignorance est donc source de bonheur et de légèreté), sur l’irresponsabilité d’un adulte qui devrait lui donner l’exemple, sur l’existence de Dieu. Un tome bien agréable, même s’il fait un écart avec la progression narrative de la série : il constitue un épilogue de grande qualité.
Tu attends un enfant, et tu ne sais pas qui est la mère ?
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 2 : Les nuits les plus blanches (1992) qu’il vaut mieux avoir lu avant car les auteurs développent une continuité assez lâche en arrière-plan. Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario et les dessins, par Philippe Dupuy et Charles Berberian, avec une mise en couleurs réalisée par Claude Legris & Isabelle Busschaert. Sa première édition date de 1994, et il compte quarante-six pages de bande dessinée. Il se compose de cinq histoires courtes.
Les femmes et les enfants d’abord, quatre pages. La nuit, Monsieur Jean fait l’étoile de mer dans son lit quand la sonnette retentit. Il émerge difficilement du sommeil et va ouvrir. Sur le pas de la porte l’attend Véronique, enceinte, avec un mouchoir à la main. Elle pleure et lui explique qu’elle sait que ce n’est pas une heure pour le déranger, mais elle vient de se disputer avec son mari Jacques. Il lui prépare un café et vient s’assoir en face d’elle. Elle lui raconte que Jacques est rentré très tard vers trois heures du matin, qu’ils se sont disputés et qu’elle a choisi de partir en le plantant là. Elle ne lui reproche pas vraiment de sortir, mais du fait de son état elle dort tout le temps et ils ne passent plus de temps ensemble. Le téléphone sonne : Jean répond, et il indique à Jacques qu’il peut passer. En fait, ils sont sortis ensemble ce soir-là. Manureva, onze pages. Dans la voiture, Jean raconte son cauchemar à son ami Clément qui conduit : ils se retrouvent assiégés dans un château fort, lui et tous ses avatars qui montent la garde. Dehors des femmes guerrières en armure ont ramené des machines de guerre et elles les bombardent avec des bébés vivants, affamés et hurlants. Les deux amis sont arrivés à destination : une salle de sport. Une femme vient prendre le vélo à côté de celui de Monsieur Jean et elle entame la conversation. Le courant passe bien entre eux deux.
Cathy (Norvegienne Woude), huit pages. Monsieur Jean est dans son bain, en train d’essayer de se remettre de sa rupture avec Manureva. Il repense à sa première rupture. Il était troufion, et il revenait pour une permission. Étonnamment, sa copine Catherine n’était pas venue l’attendre à la gare. Il avait fallu qu’il se rend chez elle par ses propres moyens, en faisant du stop. Sur place, Cathy recevait Brigitte une copine et Christophe un copain. Une folle jeunesse, quinze pages. Félix sonne à la porte de l’appartement de son ami Monsieur Jean, ce qui oblige ce dernier à sortir de son bain. Félix lui explique qu’il vient de se faire larguer par Marlène, sa compagne depuis deux ans. Les pompiers toquent à la porte car il faut évacuer l’immeuble pour cause de fuite de gaz. Les vacances de Monsieur Jean, huit pages. Monsieur Jean et son ami Jacques sont en train d’essayer des manteaux. Jacques indique que Véronique a accouché de jumeaux. Il lui propose de se joindre à eux pour des vacances en Bretagne début juillet. Monsieur Jean accepte : sur place, il découvre que le couple a invité une amie, Catherine.
Le titre de ce troisième tome laisse sous-entendre que Monsieur Jean serait en train de virer sa cuti, qu’il serait susceptible de s’encombrer de responsabilités avec femme et enfants. La première histoire permet de se rassurer : il s’agit de la femme d’un ami, et de son enfant à venir. La deuxième évoque une courte relation entre Monsieur Jean et Pascale qui se fait appeler Manureva. Dans la troisième, le lecteur découvre la première rupture avec une femme. Dans la quatrième, Monsieur Jean doit héberger temporairement son ami Félix, avec Eugène, un jeune garçon, fils de l’ancienne compagne de Félix. Enfin, il accepte de passer des vacances avec son ami Jacques, ainsi que son épouse Véronique, et leurs jumeaux, sans oublier une invitée de dernière minute. Il est donc bien question de femmes, deux amours du personnage principal, celle de son ami Jacques, celle de son ami Félix même si elle n’apparaît pas, et des enfants des autres. Les dessins restent également dans le même registre que ceux des tomes précédents. Sans qu’il ne soit possible de savoir qui a dessiné quoi, les artistes ont conservé leur goût pour les exagérations des personnages : femmes filiformes sauf madame Poulbot la concierge et son amie madame Colin, hommes avec un visage marqué (le gros nez de Monsieur Jean, le gros menton de Clément, le nez pointu de Félix, la bouche légèrement de travers de Jacques), représentation des décors oscillant entre le simplisme et l’épure élégante. Pas de doute, le lecteur retrouve bien ce jeune trentenaire dégagé des contingences matérielles, un peu falot dans ses relations sociales, indolent dans son comportement, vaguement neurasthénique même, dans des aventures inconséquentes dépourvues de toute action spectaculaire, souvent parisianistes.
Dans le même temps, dès la première page, le lecteur remarque de petites évolutions, en particulier graphiques. Il note que les traits du visage de Monsieur Jean ont encore gagné en épure : ce gros nez qui tire son visage vers le bas, cette absence de menton, ce gribouillis pour ses cheveux, tout cela s’assemble parfaitement pour une allure générale, mais ne résiste pas à un regard soutenu qui les sépare un par un. L’arrivée de Véronique le conforte dans ce constat : un rendu très éloigné d’une apparence photographique, avec un arrondi pour le contour du visage, deux traits un peu plus épais pour les yeux à demi-clos, quelques traits en arabesque pour les cheveux, et apposition de couleurs qui donne une cohérence au tout. Quelques pages plus loin, il fait connaissance avec Manureva dont le dessin est tout aussi épatant, lui conférant un charme fou : une sorte de gribouillis pour les cheveux en chignon, un demi-triangle très allongé pour le nez, un body de sport très collant, des sous-vêtements noirs très basiques. Cathy est tout aussi craquante avec ses cheveux courts et son petit nez en trompette. L’âge a apporté une grâce peu commune à Madame Fabienne Delboise avec ses cheveux blancs sa longue silhouette mise en valeur dans sa robe noire. Monsieur Boris Zajac apparaît maigre, avec également un visage des plus réussis avec ses gros sourcils broussailleux, ces quelques traits qui forment une chevelure grisonnante et ce long nez aquilin.
Dès la première page, le lecteur constate également une évolution significative dans la représentation de l’aménagement intérieur du petit appartement de Monsieur Jean. Les artistes effectuent un véritable travail de décoriste, de décorateurs d’intérieur même : choix du modèle de lampe de chevet, modèle des fauteuils du salon, motif imprimé des rideaux, utilisation de l’âtre de la cheminée pour ranger les bouteilles d’alcool. Par la suite, il note un autre modèle de fauteuil dans le salon de Véronique & Jacques, la décoration plus datée chez les parents de Jean, une décoration plus jeune chez Catherine il y a quelques années, des pièces beaucoup plus spacieuses chez Mme Delboise, le retour de la fenêtre de la chambre de bonne parisienne. Il prend un plaisir similaire à s’attarder sur les environnements en extérieur : une promenade au parc des Buttes Chaumont, les rues de Lille sous la pluie, la rue parisienne devant l’immeuble où loge Monsieur Jean, une belle maison au bord de la plage en Bretagne, et bien sûr le château fort.
En effet, les auteurs ne se cantonnent pas de ronronner en progressant tranquillement : ils introduisent également de vrais éléments nouveaux. C’est ainsi qu’ils mettent en œuvre une métaphore visuelle avec laquelle ils s’amusent bien : le détachement de Monsieur Jean prend la forme d’un château fort avec un mur d’enceinte, un pont-levis, et même des assiégeantes en armure médiévale. Cette indolence apparente peut alors s’interpréter comme la volonté de se mettre émotionnellement à l’abri derrière un mur. Les ébauches de relation amoureuse deviennent alors des assauts donnés par la femme correspondante pour essayer de pénétrer dans l’enceinte fortifié. C’est une belle inversion de la représentation habituelle où l’homme fait des pieds et des mains pour développer une relation qui lui permettra de pénétrer sa partenaire sexuelle : ici, la femme essaye de pénétrer son partenaire affectif. De même, sur le plan narratif, les histoires se font plus longues, il n’y en a plus en deux trois pages. Il apparaît également une continuité plus consistante. Monsieur Jean part en vacances avec le couple Véronique et Jacques qui ont fini par se réconcilier dans son appartement. Ils sont rejoints par Catherine, la première relation amoureuse sérieuse de Monsieur Jean, qui est racontée dans la troisième histoire de ce tome. De même, apparaissent des thèmes plus adultes comme les disputes de couple, la peur de ne plus plaire, le sexe passion, les familles recomposées ou plutôt décomposées avec un enfant balloté d’adulte en adulte, le suicide des personnes âgées isolées souffrant de solitude, la peur de l’engagement, les blessures affectives, les attentes des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les auteurs savent conserver un dosage élégant entre ces questions adultes, et un humour entre comédie de situation, autodérision, enfantillages.
Le lecteur était prêt à reprendre une portion de tranches de vie sans conséquence, de vague à l’âme dans un milieu parisien, témoignage d’une époque et d’un certain pan de la société. Il remarque que les dessins gagnent encore en élégance et en chic, que ce soient les personnages ou les environnements. Par ailleurs, les scénaristes se montrent plus ambitieux dans leurs histoires qui deviennent un peu plus longues et qui présentent une continuité entre elles. Dans le même temps, ils ont conservé leur humour pince-sans-rire qui participe au charme de la série, tout en évoquant des sujets moins frivoles. Le lecteur sent qu’il devient plus intime avec Monsieur Jean et que celui-ci sent que sa vie pépère ne le satisfait pas.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 2 : Les nuits les plus blanches (1992) qu’il vaut mieux avoir lu avant car les auteurs développent une continuité assez lâche en arrière-plan. Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario et les dessins, par Philippe Dupuy et Charles Berberian, avec une mise en couleurs réalisée par Claude Legris & Isabelle Busschaert. Sa première édition date de 1994, et il compte quarante-six pages de bande dessinée. Il se compose de cinq histoires courtes.
Les femmes et les enfants d’abord, quatre pages. La nuit, Monsieur Jean fait l’étoile de mer dans son lit quand la sonnette retentit. Il émerge difficilement du sommeil et va ouvrir. Sur le pas de la porte l’attend Véronique, enceinte, avec un mouchoir à la main. Elle pleure et lui explique qu’elle sait que ce n’est pas une heure pour le déranger, mais elle vient de se disputer avec son mari Jacques. Il lui prépare un café et vient s’assoir en face d’elle. Elle lui raconte que Jacques est rentré très tard vers trois heures du matin, qu’ils se sont disputés et qu’elle a choisi de partir en le plantant là. Elle ne lui reproche pas vraiment de sortir, mais du fait de son état elle dort tout le temps et ils ne passent plus de temps ensemble. Le téléphone sonne : Jean répond, et il indique à Jacques qu’il peut passer. En fait, ils sont sortis ensemble ce soir-là. Manureva, onze pages. Dans la voiture, Jean raconte son cauchemar à son ami Clément qui conduit : ils se retrouvent assiégés dans un château fort, lui et tous ses avatars qui montent la garde. Dehors des femmes guerrières en armure ont ramené des machines de guerre et elles les bombardent avec des bébés vivants, affamés et hurlants. Les deux amis sont arrivés à destination : une salle de sport. Une femme vient prendre le vélo à côté de celui de Monsieur Jean et elle entame la conversation. Le courant passe bien entre eux deux.
Cathy (Norvegienne Woude), huit pages. Monsieur Jean est dans son bain, en train d’essayer de se remettre de sa rupture avec Manureva. Il repense à sa première rupture. Il était troufion, et il revenait pour une permission. Étonnamment, sa copine Catherine n’était pas venue l’attendre à la gare. Il avait fallu qu’il se rend chez elle par ses propres moyens, en faisant du stop. Sur place, Cathy recevait Brigitte une copine et Christophe un copain. Une folle jeunesse, quinze pages. Félix sonne à la porte de l’appartement de son ami Monsieur Jean, ce qui oblige ce dernier à sortir de son bain. Félix lui explique qu’il vient de se faire larguer par Marlène, sa compagne depuis deux ans. Les pompiers toquent à la porte car il faut évacuer l’immeuble pour cause de fuite de gaz. Les vacances de Monsieur Jean, huit pages. Monsieur Jean et son ami Jacques sont en train d’essayer des manteaux. Jacques indique que Véronique a accouché de jumeaux. Il lui propose de se joindre à eux pour des vacances en Bretagne début juillet. Monsieur Jean accepte : sur place, il découvre que le couple a invité une amie, Catherine.
Le titre de ce troisième tome laisse sous-entendre que Monsieur Jean serait en train de virer sa cuti, qu’il serait susceptible de s’encombrer de responsabilités avec femme et enfants. La première histoire permet de se rassurer : il s’agit de la femme d’un ami, et de son enfant à venir. La deuxième évoque une courte relation entre Monsieur Jean et Pascale qui se fait appeler Manureva. Dans la troisième, le lecteur découvre la première rupture avec une femme. Dans la quatrième, Monsieur Jean doit héberger temporairement son ami Félix, avec Eugène, un jeune garçon, fils de l’ancienne compagne de Félix. Enfin, il accepte de passer des vacances avec son ami Jacques, ainsi que son épouse Véronique, et leurs jumeaux, sans oublier une invitée de dernière minute. Il est donc bien question de femmes, deux amours du personnage principal, celle de son ami Jacques, celle de son ami Félix même si elle n’apparaît pas, et des enfants des autres. Les dessins restent également dans le même registre que ceux des tomes précédents. Sans qu’il ne soit possible de savoir qui a dessiné quoi, les artistes ont conservé leur goût pour les exagérations des personnages : femmes filiformes sauf madame Poulbot la concierge et son amie madame Colin, hommes avec un visage marqué (le gros nez de Monsieur Jean, le gros menton de Clément, le nez pointu de Félix, la bouche légèrement de travers de Jacques), représentation des décors oscillant entre le simplisme et l’épure élégante. Pas de doute, le lecteur retrouve bien ce jeune trentenaire dégagé des contingences matérielles, un peu falot dans ses relations sociales, indolent dans son comportement, vaguement neurasthénique même, dans des aventures inconséquentes dépourvues de toute action spectaculaire, souvent parisianistes.
Dans le même temps, dès la première page, le lecteur remarque de petites évolutions, en particulier graphiques. Il note que les traits du visage de Monsieur Jean ont encore gagné en épure : ce gros nez qui tire son visage vers le bas, cette absence de menton, ce gribouillis pour ses cheveux, tout cela s’assemble parfaitement pour une allure générale, mais ne résiste pas à un regard soutenu qui les sépare un par un. L’arrivée de Véronique le conforte dans ce constat : un rendu très éloigné d’une apparence photographique, avec un arrondi pour le contour du visage, deux traits un peu plus épais pour les yeux à demi-clos, quelques traits en arabesque pour les cheveux, et apposition de couleurs qui donne une cohérence au tout. Quelques pages plus loin, il fait connaissance avec Manureva dont le dessin est tout aussi épatant, lui conférant un charme fou : une sorte de gribouillis pour les cheveux en chignon, un demi-triangle très allongé pour le nez, un body de sport très collant, des sous-vêtements noirs très basiques. Cathy est tout aussi craquante avec ses cheveux courts et son petit nez en trompette. L’âge a apporté une grâce peu commune à Madame Fabienne Delboise avec ses cheveux blancs sa longue silhouette mise en valeur dans sa robe noire. Monsieur Boris Zajac apparaît maigre, avec également un visage des plus réussis avec ses gros sourcils broussailleux, ces quelques traits qui forment une chevelure grisonnante et ce long nez aquilin.
Dès la première page, le lecteur constate également une évolution significative dans la représentation de l’aménagement intérieur du petit appartement de Monsieur Jean. Les artistes effectuent un véritable travail de décoriste, de décorateurs d’intérieur même : choix du modèle de lampe de chevet, modèle des fauteuils du salon, motif imprimé des rideaux, utilisation de l’âtre de la cheminée pour ranger les bouteilles d’alcool. Par la suite, il note un autre modèle de fauteuil dans le salon de Véronique & Jacques, la décoration plus datée chez les parents de Jean, une décoration plus jeune chez Catherine il y a quelques années, des pièces beaucoup plus spacieuses chez Mme Delboise, le retour de la fenêtre de la chambre de bonne parisienne. Il prend un plaisir similaire à s’attarder sur les environnements en extérieur : une promenade au parc des Buttes Chaumont, les rues de Lille sous la pluie, la rue parisienne devant l’immeuble où loge Monsieur Jean, une belle maison au bord de la plage en Bretagne, et bien sûr le château fort.
En effet, les auteurs ne se cantonnent pas de ronronner en progressant tranquillement : ils introduisent également de vrais éléments nouveaux. C’est ainsi qu’ils mettent en œuvre une métaphore visuelle avec laquelle ils s’amusent bien : le détachement de Monsieur Jean prend la forme d’un château fort avec un mur d’enceinte, un pont-levis, et même des assiégeantes en armure médiévale. Cette indolence apparente peut alors s’interpréter comme la volonté de se mettre émotionnellement à l’abri derrière un mur. Les ébauches de relation amoureuse deviennent alors des assauts donnés par la femme correspondante pour essayer de pénétrer dans l’enceinte fortifié. C’est une belle inversion de la représentation habituelle où l’homme fait des pieds et des mains pour développer une relation qui lui permettra de pénétrer sa partenaire sexuelle : ici, la femme essaye de pénétrer son partenaire affectif. De même, sur le plan narratif, les histoires se font plus longues, il n’y en a plus en deux trois pages. Il apparaît également une continuité plus consistante. Monsieur Jean part en vacances avec le couple Véronique et Jacques qui ont fini par se réconcilier dans son appartement. Ils sont rejoints par Catherine, la première relation amoureuse sérieuse de Monsieur Jean, qui est racontée dans la troisième histoire de ce tome. De même, apparaissent des thèmes plus adultes comme les disputes de couple, la peur de ne plus plaire, le sexe passion, les familles recomposées ou plutôt décomposées avec un enfant balloté d’adulte en adulte, le suicide des personnes âgées isolées souffrant de solitude, la peur de l’engagement, les blessures affectives, les attentes des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les auteurs savent conserver un dosage élégant entre ces questions adultes, et un humour entre comédie de situation, autodérision, enfantillages.
Le lecteur était prêt à reprendre une portion de tranches de vie sans conséquence, de vague à l’âme dans un milieu parisien, témoignage d’une époque et d’un certain pan de la société. Il remarque que les dessins gagnent encore en élégance et en chic, que ce soient les personnages ou les environnements. Par ailleurs, les scénaristes se montrent plus ambitieux dans leurs histoires qui deviennent un peu plus longues et qui présentent une continuité entre elles. Dans le même temps, ils ont conservé leur humour pince-sans-rire qui participe au charme de la série, tout en évoquant des sujets moins frivoles. Le lecteur sent qu’il devient plus intime avec Monsieur Jean et que celui-ci sent que sa vie pépère ne le satisfait pas.
Tout le monde sait que les livres gonflés à l’air du temps sont ceux qui se dégonflent le plus vite.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 1 : Monsieur Jean, l'amour, la concierge (1991) qu’il n’est pas indispensable d’avoir lu avant. Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario et les dessins, par Philippe Dupuy et Charles Berberian, avec une mise en couleurs réalisée par Claude Legris. Sa première édition date de 1992, et il compte quarante-cinq pages de bande dessinée.
Quatre saisons pour monsieur Jean, six pages. Monsieur Jean est dans la rue, devant un cinéma parisien, avec son ami Félix. Il lui demande ce qu’ils vont voir. Félix répond qu’ils ont le choix entre Massacre au coupe-ongles, en son Dolby THX et écran géant, et Prise de tête, un film de Jacques Oignon avec deux acteurs et un abat-jour. Monsieur Jean répond par un sarcasme : super, il adore les abat-jours. Félix en conclut qu’il vaut mieux qu’ils aillent manger un morceau. En attendant sa pizza, Jean continue de tirer la tronche. Félix lui demande de faire un effort car il se croirait dans un film de Jacques Oignon. Il essaie de deviner ce qui mine son ami : il aurait préféré une choucroute ? Il a le sida ? Sa concierge le trompe ? Son interlocuteur lâche le morceau : il a trente ans. Après le repas, chacun regagne ses pénates, et Monsieur Jean sent que la pizza passe mal. La nuit, il se tourne et se retourne de douleur dans son lit. Il cauchemarde qu’une armée composée de petits lui-mêmes défend une tranchée contre un ennemi invisible qui le bombarde de pizzas.
Insomnie 1, deux pages. Pas frais du tout après une nuit difficile, Monsieur Jean prend un café à une terrasse, avec son ami Clément. Il lui explique qu’en ce moment, il n’arrive jamais à s’endormir avant cinq heures du matin. Il a tout essayé : zapper pendant des heures devant son poste de télévision, lire au lit, par exemple Voyage au bout de la nuit de Céline. Rien n’y fait. Il est même allé au cinéma voir Prise de tête, le film de Jacques Oignon. Clément fait semblant de s’être endormi, tout en ronflant. Alors que Jean s’énerve que son ami se moque de lui, Clément lui donne son truc infaillible contre l’insomnie, un truc tout simple : laisser faire. – Le voyage à Lisbonne, quinze pages. Monsieur Jean est attablé chez ses parents, avec sur la table son gâteau d’anniversaire. Sa mère lui amène son cadeau, et son père se tient debout en train d’ouvrir la bouteille de champagne. Les parents se retrouvent dans la cuisine, la mère disant qu’ils auraient dû acheter le four à micro-ondes, le père rétorquant que leur fils avait besoin d’une perceuse. La mère retrouve son fils pensif dans la salle à manger. Il lui demande si elle n’aurait pas vu une boîte à chaussures dans laquelle il rangeait son courrier. Il ne l’a pas trouvé chez lui, et finalement il n’a pas le souvenir de l’avoir emportée. Concrètement, il cherche une lettre qu’il a écrite quand il avait quinze ou seize ans : elle s’adressait à l’homme qu’il serait à trente ans. Ça fait une semaine qu’il se creuse le crâne pour savoir où elle se trouve. Il a dû la mettre dans la boîte, ça semble logique.
Les co-auteurs continuent sur leur lancée, en narrant les petits riens du quotidien de Monsieur Jean, un auteur de roman. Il en a écrit au moins un : La table d’ébène, et celui-ci a rencontré un vrai succès. Au cours des histoires de ce tome, le lecteur comprend que le romancier travaille sur la traduction de nouvelles de William Somerset Maugham (1876-1965). Il est donc un peu question de culture de ci, de là, avec des références à Maugham, au film Le jour se lève (1939), de Marcel Carmé (1906-1996) avec Jules Berry (1883-1951), au groupe Genesis (un poster dans une chambre), à Frank Zappa (1940-1993, un autre poster), à Billie Holiday (1915-1959) & Thelonius Monk (1917-1982) par le biais de trois disque vinyle, et à Fernando Pessoa (1888-1935) lors du voyage de Monsieur Jean à Lisbonne. Le lecteur retrouve la structure en scénettes d’une à six pages, et une histoire plus longue de quinze pages emmenant Monsieur Jean à l’étranger, à l’instar de son voyage dans la campagne du côté d’Avignon dans le premier tome. À nouveau, les auteurs s’attachent à une forme de quotidien de leur personnage, la banalité de la vie pour lui, une forme d’exotisme pour le lecteur qui n’est pas romancier, ou pas parisien, ou qui n’a pas vécu à cette époque, ou tout cela à la fois. Il retrouve également les dessins empruntant à la ligne claire, sans en respecter toutes les caractéristiques, et évoquant de ci de là ceux de Frank Margerin.
Les artistes arrivent à un équilibre aussi élégant que savant entre dessins descriptifs avec un trait de contour d’épaisseur égale et des couleurs posées en aplats, et des touches d’exagération et de simplification pour les personnages. Sur le plan des décors et des accessoires, certaines cases peuvent donner une impression chargée : la première avec les affiches sur la façade du cinéma, la circulation, les immeubles, la queue devant le cinéma, l’eau qui s’écoule de l’appartement de Monsieur Jean dans l’escalier de son immeuble, le bureau de son éditeur, une rue de Lisbonne avec son tramway, le salon de Monsieur Jean, une rue de banlieue avec ses pavillons à deux ou trois étages. Par comparaison, d’autres semblent parfaitement équilibrées : un gros plan sur la tête de deux soldats Monsieur Jean, avec une ombre chinoise qui s’écroule en arrière-plan fauchée par une pizza, deux hippopotames amoureux dans une rivière, une demi-douzaine de personnes en train de danser au milieu du salon d’une maison en banlieue de Lisbonne, une vue de la gare de l’Est, Monsieur Jean disant au revoir à Alicia dans l’aéroport, Monsieur Jean allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, etc.
Cette image du personnage principal allongé sur son lit les yeux grands ouverts orne la couverture et s’avère saisissante dans cet état au-delà de la fatigue où le corps semble ne plus savoir comment s’éteindre. Dupuy & Berberian ont continué à travailler sur leur manière de représenter les visages, s’éloignant encore du réalisme photographique pour trouver des formes qui augmentent l’expressivité, qui font mieux apparaître l’état d’esprit du personnage. S’il commence à arrêter son regard sur le visage de Monsieur Jean, le lecteur constate qu’il a un gros nez, presque pas de menton, le plus souvent des points ou des petits traits pour les yeux et une sorte de gribouillis étudié en guise de cheveux. Par comparaison, celui de Félix est pourvu de cheveux avec une coupe à angle droit à l’arrière de son crâne et d’un nez proéminent pointu. Celui de Clément présente un énorme menton, une mèche de cheveux défiant les lois de la gravité, un nez tout aussi proéminent mais sans angle aigu. Peut-être que le lecteur ne prête pas plus attention que ça à Julie et Céline rencontrées dans la queue du cinéma, mais il est saisi par la beauté d’Alicia. Là encore, les artistes ont construit son visage en tirant vers une conceptualisation, avec son arrondi vertical parfait réalisé d’un trait élégant, son nez court, ses yeux un peu allongés. Pas grand-chose à voir avec la réalité, mais une puissance de séduction irrésistible. Dans la nouvelle Monsieur Négatif (en six pages), ils s’amusent à caricaturer une femme bien en chair, avec des jambes ridiculement petites, un torse beaucoup trop gros et long, raillant cette silhouette en l’affublant d’un jogging fluo, et faisant subir les derniers outrages à sa chevelure en la parant d’une véritable choucroute avec saucisses. Globalement, les personnages ne deviennent pas des pantins comiques pour faire rire : ils expriment une réelle personnalité, avec le plus souvent une réelle affection des auteurs pour eux, et parfois une moquerie qui ne verse pas dans la méchanceté.
Comme dans le premier tome, le lecteur se rend compte que Monsieur Jean ne lui est pas plus sympathique que ça. Un homme qui atteint trente ans, sans souci apparent, sans beaucoup de responsabilités, pas vraiment misanthrope mais plutôt vaguement ennuyé par les autres, pas assez pour être irrité contre les défauts de ses amis. Pour autant, il apprécie la compagnie féminine et prête au jeu de la séduction. Par ricochet, Félix devient même plus sympathique car il assume ses défauts, et il y met du sien en amitié, même si ce n’est pas toujours à bon escient. Pour autant, l’empathie envers Monsieur Jean fonctionne parce qu’il apparaît vulnérable, procrastinateur, la proie d’une angoisse sourde au point de ne pas réussir à dormir. Au fil de ces onze nouvelles, le lecteur retrouve ce milieu vaguement bourgeois bohème, cette vie en apparence facile sans réel souci économique. Il en vient à faire la comparaison avec les caractéristiques de sa propre vie, peut-être un travail avec des horaires très réglés à l’inverse de Monsieur Jean, ou des heures sans compter, ou un boulot alimentaire, son réseau d’amis, l’énergie qu’il peut mettre à séduire, la nature de sa relation de couple ou son célibat, ses moments personnels d’angoisse, et peut-être ses difficultés digestives. Le quotidien de Monsieur Jean ne laisse pas de marbre parce que sa banalité renvoie à celle du lecteur suscitant ainsi une réaction réflexe, ressentant ces facettes d’humanité qui le lient à lui, ce questionnement latent né de la conscience du temps qui passe et de la futilité d’être.
Un deuxième tome composé lui aussi d’historiettes sans conséquences, sans grande aventure, centrées sur un individu un tant soit peu pathétique ce qui l’empêche d’être considéré comme étant désagréable. En toile de fonds, la narration visuelle s’affine graduellement, solide et consistante, avec des personnages à la séduction émouvante d’autant plus étonnante que leur représentation flirte avec l’abstraction et la géométrie. Un milieu social bourgeois bohème et parisien, pouvant exciter les a priori du lecteur, mais en même temps des êtres humains comme tout le monde, pas plus avancés que les autres. À un moment, Monsieur Jean lit un commentaire sur son livre La table d’ébène et le critique écrit que : Tout le monde sait que les livres gonflés à l’air du temps sont ceux qui se dégonflent le plus vite. Le lecteur sourit en voyant Monsieur Jean affecté par cette remarque, et il se demande si elle s’applique à la bande dessinée qu’il vient de lire, ou si au contraire elle constitue l’exception qui confirme la règle, ou encore la preuve que ce jugement de valeur est erroné.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 1 : Monsieur Jean, l'amour, la concierge (1991) qu’il n’est pas indispensable d’avoir lu avant. Cet album a été réalisé à quatre mains pour le scénario et les dessins, par Philippe Dupuy et Charles Berberian, avec une mise en couleurs réalisée par Claude Legris. Sa première édition date de 1992, et il compte quarante-cinq pages de bande dessinée.
Quatre saisons pour monsieur Jean, six pages. Monsieur Jean est dans la rue, devant un cinéma parisien, avec son ami Félix. Il lui demande ce qu’ils vont voir. Félix répond qu’ils ont le choix entre Massacre au coupe-ongles, en son Dolby THX et écran géant, et Prise de tête, un film de Jacques Oignon avec deux acteurs et un abat-jour. Monsieur Jean répond par un sarcasme : super, il adore les abat-jours. Félix en conclut qu’il vaut mieux qu’ils aillent manger un morceau. En attendant sa pizza, Jean continue de tirer la tronche. Félix lui demande de faire un effort car il se croirait dans un film de Jacques Oignon. Il essaie de deviner ce qui mine son ami : il aurait préféré une choucroute ? Il a le sida ? Sa concierge le trompe ? Son interlocuteur lâche le morceau : il a trente ans. Après le repas, chacun regagne ses pénates, et Monsieur Jean sent que la pizza passe mal. La nuit, il se tourne et se retourne de douleur dans son lit. Il cauchemarde qu’une armée composée de petits lui-mêmes défend une tranchée contre un ennemi invisible qui le bombarde de pizzas.
Insomnie 1, deux pages. Pas frais du tout après une nuit difficile, Monsieur Jean prend un café à une terrasse, avec son ami Clément. Il lui explique qu’en ce moment, il n’arrive jamais à s’endormir avant cinq heures du matin. Il a tout essayé : zapper pendant des heures devant son poste de télévision, lire au lit, par exemple Voyage au bout de la nuit de Céline. Rien n’y fait. Il est même allé au cinéma voir Prise de tête, le film de Jacques Oignon. Clément fait semblant de s’être endormi, tout en ronflant. Alors que Jean s’énerve que son ami se moque de lui, Clément lui donne son truc infaillible contre l’insomnie, un truc tout simple : laisser faire. – Le voyage à Lisbonne, quinze pages. Monsieur Jean est attablé chez ses parents, avec sur la table son gâteau d’anniversaire. Sa mère lui amène son cadeau, et son père se tient debout en train d’ouvrir la bouteille de champagne. Les parents se retrouvent dans la cuisine, la mère disant qu’ils auraient dû acheter le four à micro-ondes, le père rétorquant que leur fils avait besoin d’une perceuse. La mère retrouve son fils pensif dans la salle à manger. Il lui demande si elle n’aurait pas vu une boîte à chaussures dans laquelle il rangeait son courrier. Il ne l’a pas trouvé chez lui, et finalement il n’a pas le souvenir de l’avoir emportée. Concrètement, il cherche une lettre qu’il a écrite quand il avait quinze ou seize ans : elle s’adressait à l’homme qu’il serait à trente ans. Ça fait une semaine qu’il se creuse le crâne pour savoir où elle se trouve. Il a dû la mettre dans la boîte, ça semble logique.
Les co-auteurs continuent sur leur lancée, en narrant les petits riens du quotidien de Monsieur Jean, un auteur de roman. Il en a écrit au moins un : La table d’ébène, et celui-ci a rencontré un vrai succès. Au cours des histoires de ce tome, le lecteur comprend que le romancier travaille sur la traduction de nouvelles de William Somerset Maugham (1876-1965). Il est donc un peu question de culture de ci, de là, avec des références à Maugham, au film Le jour se lève (1939), de Marcel Carmé (1906-1996) avec Jules Berry (1883-1951), au groupe Genesis (un poster dans une chambre), à Frank Zappa (1940-1993, un autre poster), à Billie Holiday (1915-1959) & Thelonius Monk (1917-1982) par le biais de trois disque vinyle, et à Fernando Pessoa (1888-1935) lors du voyage de Monsieur Jean à Lisbonne. Le lecteur retrouve la structure en scénettes d’une à six pages, et une histoire plus longue de quinze pages emmenant Monsieur Jean à l’étranger, à l’instar de son voyage dans la campagne du côté d’Avignon dans le premier tome. À nouveau, les auteurs s’attachent à une forme de quotidien de leur personnage, la banalité de la vie pour lui, une forme d’exotisme pour le lecteur qui n’est pas romancier, ou pas parisien, ou qui n’a pas vécu à cette époque, ou tout cela à la fois. Il retrouve également les dessins empruntant à la ligne claire, sans en respecter toutes les caractéristiques, et évoquant de ci de là ceux de Frank Margerin.
Les artistes arrivent à un équilibre aussi élégant que savant entre dessins descriptifs avec un trait de contour d’épaisseur égale et des couleurs posées en aplats, et des touches d’exagération et de simplification pour les personnages. Sur le plan des décors et des accessoires, certaines cases peuvent donner une impression chargée : la première avec les affiches sur la façade du cinéma, la circulation, les immeubles, la queue devant le cinéma, l’eau qui s’écoule de l’appartement de Monsieur Jean dans l’escalier de son immeuble, le bureau de son éditeur, une rue de Lisbonne avec son tramway, le salon de Monsieur Jean, une rue de banlieue avec ses pavillons à deux ou trois étages. Par comparaison, d’autres semblent parfaitement équilibrées : un gros plan sur la tête de deux soldats Monsieur Jean, avec une ombre chinoise qui s’écroule en arrière-plan fauchée par une pizza, deux hippopotames amoureux dans une rivière, une demi-douzaine de personnes en train de danser au milieu du salon d’une maison en banlieue de Lisbonne, une vue de la gare de l’Est, Monsieur Jean disant au revoir à Alicia dans l’aéroport, Monsieur Jean allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, etc.
Cette image du personnage principal allongé sur son lit les yeux grands ouverts orne la couverture et s’avère saisissante dans cet état au-delà de la fatigue où le corps semble ne plus savoir comment s’éteindre. Dupuy & Berberian ont continué à travailler sur leur manière de représenter les visages, s’éloignant encore du réalisme photographique pour trouver des formes qui augmentent l’expressivité, qui font mieux apparaître l’état d’esprit du personnage. S’il commence à arrêter son regard sur le visage de Monsieur Jean, le lecteur constate qu’il a un gros nez, presque pas de menton, le plus souvent des points ou des petits traits pour les yeux et une sorte de gribouillis étudié en guise de cheveux. Par comparaison, celui de Félix est pourvu de cheveux avec une coupe à angle droit à l’arrière de son crâne et d’un nez proéminent pointu. Celui de Clément présente un énorme menton, une mèche de cheveux défiant les lois de la gravité, un nez tout aussi proéminent mais sans angle aigu. Peut-être que le lecteur ne prête pas plus attention que ça à Julie et Céline rencontrées dans la queue du cinéma, mais il est saisi par la beauté d’Alicia. Là encore, les artistes ont construit son visage en tirant vers une conceptualisation, avec son arrondi vertical parfait réalisé d’un trait élégant, son nez court, ses yeux un peu allongés. Pas grand-chose à voir avec la réalité, mais une puissance de séduction irrésistible. Dans la nouvelle Monsieur Négatif (en six pages), ils s’amusent à caricaturer une femme bien en chair, avec des jambes ridiculement petites, un torse beaucoup trop gros et long, raillant cette silhouette en l’affublant d’un jogging fluo, et faisant subir les derniers outrages à sa chevelure en la parant d’une véritable choucroute avec saucisses. Globalement, les personnages ne deviennent pas des pantins comiques pour faire rire : ils expriment une réelle personnalité, avec le plus souvent une réelle affection des auteurs pour eux, et parfois une moquerie qui ne verse pas dans la méchanceté.
Comme dans le premier tome, le lecteur se rend compte que Monsieur Jean ne lui est pas plus sympathique que ça. Un homme qui atteint trente ans, sans souci apparent, sans beaucoup de responsabilités, pas vraiment misanthrope mais plutôt vaguement ennuyé par les autres, pas assez pour être irrité contre les défauts de ses amis. Pour autant, il apprécie la compagnie féminine et prête au jeu de la séduction. Par ricochet, Félix devient même plus sympathique car il assume ses défauts, et il y met du sien en amitié, même si ce n’est pas toujours à bon escient. Pour autant, l’empathie envers Monsieur Jean fonctionne parce qu’il apparaît vulnérable, procrastinateur, la proie d’une angoisse sourde au point de ne pas réussir à dormir. Au fil de ces onze nouvelles, le lecteur retrouve ce milieu vaguement bourgeois bohème, cette vie en apparence facile sans réel souci économique. Il en vient à faire la comparaison avec les caractéristiques de sa propre vie, peut-être un travail avec des horaires très réglés à l’inverse de Monsieur Jean, ou des heures sans compter, ou un boulot alimentaire, son réseau d’amis, l’énergie qu’il peut mettre à séduire, la nature de sa relation de couple ou son célibat, ses moments personnels d’angoisse, et peut-être ses difficultés digestives. Le quotidien de Monsieur Jean ne laisse pas de marbre parce que sa banalité renvoie à celle du lecteur suscitant ainsi une réaction réflexe, ressentant ces facettes d’humanité qui le lient à lui, ce questionnement latent né de la conscience du temps qui passe et de la futilité d’être.
Un deuxième tome composé lui aussi d’historiettes sans conséquences, sans grande aventure, centrées sur un individu un tant soit peu pathétique ce qui l’empêche d’être considéré comme étant désagréable. En toile de fonds, la narration visuelle s’affine graduellement, solide et consistante, avec des personnages à la séduction émouvante d’autant plus étonnante que leur représentation flirte avec l’abstraction et la géométrie. Un milieu social bourgeois bohème et parisien, pouvant exciter les a priori du lecteur, mais en même temps des êtres humains comme tout le monde, pas plus avancés que les autres. À un moment, Monsieur Jean lit un commentaire sur son livre La table d’ébène et le critique écrit que : Tout le monde sait que les livres gonflés à l’air du temps sont ceux qui se dégonflent le plus vite. Le lecteur sourit en voyant Monsieur Jean affecté par cette remarque, et il se demande si elle s’applique à la bande dessinée qu’il vient de lire, ou si au contraire elle constitue l’exception qui confirme la règle, ou encore la preuve que ce jugement de valeur est erroné.
Étienne le tient bien son billet de Loto, oh oui. Un billet gagnant affolant, à vous brûler les gants. Un billet qui le met au ralenti, l'étourdit, lui coupe l'appétit, le mène à la folie.
Complètement chamboulé, ce nouveau riche se sent « un peu comme s'il avait gagné un saut à l'élastique du premier étage de la Tour Eiffel ». La peur, le vertige face à l'avenir. Et aussi la crainte que les autres, autour de lui, ne soient plus comme avant. Pour éviter de trop réfléchir et d'avoir à prendre des décisions, Etienne s'assomme avec l'alcool. Mauvaise idée : il est victime d'hallucinations, frôle plusieurs fois la mort et n'arrête pas de perdre ce satané billet.
Album à la fois pertinent, amusant et crispant. Une variante beaucoup moins dramatique que celle de Steinbeck ("La Perle") sur le thème « l'argent ne fait pas le bonheur quand il vous déboule dessus du jour au lendemain ». Album léger mais pas superficiel, qui présente des réflexions intéressantes sur ce sujet pourtant rebattu, invitant le lecteur à s'interroger sur son propre rapport à l'argent et sur celui de ses proches. Connaît-on bien sa famille, ses amis ?
Les atermoiements de l'heureux gagnant / triste loser (oxymore ?) peuvent agacer, le tournant pris dans les dernières pages peut dérouter et sembler artificiel. Mais peu importe, on passe un moment bien agréable, le récit ne manque pas de suspense et on cogite pendant la lecture, et même après si on veut.
Complètement chamboulé, ce nouveau riche se sent « un peu comme s'il avait gagné un saut à l'élastique du premier étage de la Tour Eiffel ». La peur, le vertige face à l'avenir. Et aussi la crainte que les autres, autour de lui, ne soient plus comme avant. Pour éviter de trop réfléchir et d'avoir à prendre des décisions, Etienne s'assomme avec l'alcool. Mauvaise idée : il est victime d'hallucinations, frôle plusieurs fois la mort et n'arrête pas de perdre ce satané billet.
Album à la fois pertinent, amusant et crispant. Une variante beaucoup moins dramatique que celle de Steinbeck ("La Perle") sur le thème « l'argent ne fait pas le bonheur quand il vous déboule dessus du jour au lendemain ». Album léger mais pas superficiel, qui présente des réflexions intéressantes sur ce sujet pourtant rebattu, invitant le lecteur à s'interroger sur son propre rapport à l'argent et sur celui de ses proches. Connaît-on bien sa famille, ses amis ?
Les atermoiements de l'heureux gagnant / triste loser (oxymore ?) peuvent agacer, le tournant pris dans les dernières pages peut dérouter et sembler artificiel. Mais peu importe, on passe un moment bien agréable, le récit ne manque pas de suspense et on cogite pendant la lecture, et même après si on veut.
La générosité n’est pas une faiblesse dont s’embarrasse les banquiers.
-
Ce tome est le second d’un diptyque intitulé Peindre ou ne pas peindre, ayant fait l’objet d’une réédition Peindre ou ne pas peindre - L'intégrale en 2021. Sa première édition date de 2020 sous le titre complet de Une histoire de l'art - Tome 3 - Ne pas peindre. Le premier tome de cette série est paru en 2016, sous le titre Une histoire de l’art, et sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso, pour une promenade dans les méandres de l'histoire de l'art, après avoir fait l’objet d’une parution dématérialisée sur la plateforme Professeur Cyclope. Cet ouvrage a été réalisé par Philippe Dupuy, scénario, dessins et couleur. Il comporte environ cent-vingt pages de bande dessinée.
Devant la villa Paul Poiret inachevée, à Mézy-sur-Seine. Créer avec de la couleur. Il n’a fait que ça toute sa vie après-tout. Jouer de la couleur, lui donner forme. La faire vibrer sur les étoffes. Ses premiers mots furent pour réclamer un papier et un crayon. Sa vocation de peintre se révélait ainsi bien avant celle de couturier. On n’a pas conservé ses premières œuvres. Elles semblent n’avoir eu d’intérêt et de sens que pour lui-même. Ne pas Peindre. À Paris en 1911, au 107 du Faubourg Saint-Honoré, dans son hôtel particulier, une femme courroucée s’indigne. Il doit s’agir d’une plaisanterie, le couturier imagine-t-il vraiment qu’elle va porter ça ? Elle estime qu’elle ressemble à une colonne grecque qui se prendrait les pieds dans le tapis. Elle demande à Poiret s’il aurait perdu la tête ? Ou bien se mettrait-il à haïr à ce point les femmes ? Dans ce grand salon où elle a effectué l’essayage de la robe, Paul Poiret entre, en suggérant à la dame de se calmer. Il sait qu’elle est venue chez lui sachant que Poiret est la première maison du monde. Il se présente : il est Paul Poiret et il lui dit que c’est bien. Cette robe est bien, elle est magnifique et elle lui va magnifiquement bien. Si elle ne l’aime pas, tant pis, qu’elle la retire, mais il ne lui en fera pas une autre. C’est juste qu’ils ne sont pas faits pour s’entendre. La dame se regarde à nouveau dans le miroir en pied et elle déclare qu’on s’habitue vite, en fait.
En 1925, lors d’un dîner chez les Poiret, avec six convives et le couple Poiret, le couturier évoque son art. Il y a une question d’humeur de sa part, humeur qu’il est impuissant à régler, qui est sensible, violente, exagérée, ombrageuse, brusque, folle. Il faut lui pardonner puisque c’est elle aussi qui cause sa fantaisie, sa variété. Un invité lui fait observer que leur hôte ne pourrait plus se permettre cela aujourd’hui : il y a eu la guerre, l’époque a changé, les choses sont moins faciles. Poiret rétorque qu’il ne manquerait plus que ça : il a toujours été un homme libre, avant, pendant et après la guerre. Un autre convive lui fait observer que Mlle Chanel vient lui chatouiller la barbiche : Poiret n’est plus le seul à détenir les clés du succès. Poiret dit tout le dédain que lui inspirent les créations de Coco Chanel.
Seconde partie du diptyque Peindre ou ne pas peindre (après Une histoire de l'art, tome 2 : Peindre), troisième ouvrage consacré à une facette de l’histoire de l’art : l’auteur a choisi de mettre en scène Paul Poiret (1879-1944), grand couturier et parfumeur français, précurseur du style Art déco. Comme dans le tome précédent consacré à Man Ray (1890-1976), voilà un créateur qui a commencé par dessiner et qui s’adonnera à la peinture, mais à la fin de sa vie, plutôt qu’au début. La vie de ce créateur rencontre celle de nombreux autres artistes de la première moitié du vingtième siècle. Soit il les côtoie en personne, comme Marie Laurencin (1883-1956) pour un entraînement à l’escrime, Isadora Duncan (1877-1927), Max Jacob (1876-1944), Gabrielle-Charlotte Réju, dite Réjane (1856-1920). Soit ses créations sont comparées à celles d’autres, ou encore commentées par d’autres : Gabrielle dite Coco Chanel (1883-1971), Madeleine Vionnet -1876-1975), Jeanne Lanvin (1867-1946), Francis Picabia (1879-1953), Gertrude Stein (1874-1946), ou encore Jean Cocteau, Jean Rouché, André Derrain, Lucien Lelong, la princesse Bibesco, Robert Piquet, Dignimont. En 1922, Man Ray (1890-1976, Emmanuel Radnitsky) est présenté à Paul Poiret établissant un autre lien avec le tome précédent. En 1913, le grand couturier s’était rendu à New York pour The Armory show, faisant la connaissance du galeriste Alfred Stieglitz (1864-1946) qui a soutenu Man Ray dans sa carrière.
Comme pour le tome précédent, le lecteur peut être déstabilisé de prime abord par la structure du récit, et par la forme des images. Globalement, le déroulé de la biographie suit l’ordre chronologique, toutefois dans le détail, l’auteur s’arroge le droit de faire des allers-retours. La première page montre la villa Paul Poiret à un stade avancé de sa construction, celle-ci s’étant étalée de 1921 à 1923 du temps vivant du couturier, sans être achevée. Après cette page introductive, la scène passe en 1911 dans l’hôtel particulier de Poiret. Le dîner chez les Poiret se déroule en 1925. Puis retour en 1913 pour The Armory show, suivi par La mille et deuxième nuit le samedi 24 juin 1911, une autre fête le 20 juin 1912 intitulée Bacchus, un retour à The Armory show, etc. Le lecteur doit se laisser porter par ce réarrangement temporel, au gré de la fantaisie de l’auteur… Au plutôt en fonction des liens thématiques qui s’établissent, des connexions qu’il pointe à différents moments de la vie de Paul Poiret, le conduisant à cette présentation qui recompose la linéarité temporelle pour lui préférer un rapprochement d’événements faisant apparaître le développement artistique sous-jacent.
La narration visuelle est similaire en tout point à celle du tome précédent : des cases aux bordures arrondies, tracés à l’encre d’une façon irrégulière, avec un trait fin pas tout à fait jointif, avec un cadre parfois penché vers le haut, ou au contraire vers le bas, ne respectant pas l’horizontalité habituelle des bandes. Les formes sont tracées à l’encre d’une trait mince uniforme, parfois presque tremblant, avec des déformations de proportions de l’anatomie humaine, mais aussi des décors, faites sciemment. Au fil des séquences, l’artiste met en œuvre une riche diversité de mise en page : cases avec bordure, case sans bordure, illustration en pleine page au nombre de neuf, et des illustrations conçues sur deux pages. Ces dernières peuvent prendre la forme d’un unique dessin sur deux pages en vis-à-vis, ou d’un grand dessin sur deux pages avec de plus petits en inserts, ou de personnages représentés à plusieurs reprises comme se déplaçant sur un unique en fond de case, ou un jeu de passage d’une case à l’autre en suivant une disposition en S. Il joue également avec le positionnement des cases, certaines de la largeur de la page, d’autres disposées en deux colonnes côte à côte, induisant une lecture de haut en bas, plutôt que de gauche à droite. Le lecteur se rend compte qu’il s’adapte très rapidement à cette forme de représentation évoquant parfois Sempé, en un peu moins aérien et léger, aux fantaisies ornementales, au jeu des déformations. Cette liberté de ton et de forme dans la narration visuelle transcrit bien la puissance créatrice de Paul Poiret qui indique qu’il y a une question d’humeur de sa part, sensible, violente, exagérée, ombrageuse, brusque, folle.
Les images font vivre les personnages sous les yeux du lecteur, à la fois par leur silhouette, leur visage, leurs gestes et leur tenue vestimentaire, et elles montrent les lieux dans lesquels ils évoluent, s’avérant variés, de Paris à New York. Le lecteur assiste à de nombreux spectacles et fêtes : un dîner chez les Poiret, la mille et deuxième nuit (organisée chez Paul Poiret, avec costume de rigueur emprunté aux contes orientaux), la Fête Bacchus au pavillon Butard), une scène en une case pour chaque pièce de théâtre ou ballet dont Poiret a réalisé les costumes (Nabuchodonosor par les ballets russes en 1911, Le minaret en 1913, Aphrodite en 1914, une danse en privé d’Isadora Duncan pour Denise & Paul Poiret et leurs amis), plusieurs défilés de présentation de collection du grand couturier, une fastueuse réception pour le réveillon du vingt-quatre décembre 1924, la grande exposition internationale des arts décoratifs de 1925 (titrée Amours, orgues et délices) sur des péniches, la soirée de vernissage de l’exposition des peintures de Poiret à la galerie Charpentier en 1944.
Le lecteur découvre la biographie de ce grand couturier au fil des décennies, le rôle de muse de sa femme Denise Boulet (1886-1982), son credo de créateur, ses succès, ses difficultés financières, sa force motrice incroyable pour imaginer de nouvelles tenues, de nouveaux concepts pour les présenter, pour promouvoir son nom. Il sourit d’aise devant sa générosité quoi qu’il lui en coûte (La générosité n’est pas une faiblesse dont s’embarrasse les banquiers.), il s’amuse devant ses fanfaronnades (par exemple, quand il dit : Alors disons que Picasso est le Paul Poiret de la peinture.), ses goûts de luxe à la fois pour ses créations (de la soie brodée de serge, une multitude d’étoffes, du cachemire des Indes, du taffetas, des doublures en mousseline de soie, pour les manteaux des doublures en crêpe de Chine imprimé de fleurs dorées, et de la fourrure, loutre, zibeline, chinchilla, martre et sconse) et pour sa famille et lui (Il explique à son épouse que c’est le goût de la richesse qui le fait travailler et il ne veut pas qu’elle lui impose le goût de la pauvreté, l’argent est fait pour être dépensé).
L’auteur aborde également d’autres thèmes. La différence entre le peintre et le couturier : Le peintre doit s’imprégner, le couturier vit au rythme fou du monde qui change, des saisons qui chassent la précédente. Le peintre est un contemplatif, le couturier fait le monde, le peintre le ressent. Arrivé au tiers de l’ouvrage, juste après un dessin en pleine page montrant une statue de Bodhisattva acquise par Poiret, le lecteur découvre un passage intitulé : L’étrange guerre de monsieur Poiret 1915. Au cours de trois compositions de case en double page, les images des massacres dans les tranchées se juxtaposent avec les créations de Paul Poiret, évoquant à la fois le traumatisme de la première guerre mondiale sur le créateur, et la folie que l’esprit humain puisse être aussi bien à l’origine d’une telle tuerie de masse que de celle de la création de vêtements extraordinaires. Un passage très troublant, ce rapprochement posant également la question du rôle de l’artiste ou du créateur alors que les combats font des morts par milliers.
Après un tome consacré à Man Ray, l’auteur poursuit sa réflexion sur l’acte de création artistique, sur la vocation artistique, en l’abordant aussi bien du point de vue de la vie de famille, de la dimension économique, du rapport aux événements historiques et du rapport au monde, de la concurrence avec d’autres créateurs dans le même domaine artistique, de l‘obsolescence de la vision artistique, avec une narration visuelle très personnelle, dont les caractéristiques singulières savent rendre parlantes ces questionnements.
-
Ce tome est le second d’un diptyque intitulé Peindre ou ne pas peindre, ayant fait l’objet d’une réédition Peindre ou ne pas peindre - L'intégrale en 2021. Sa première édition date de 2020 sous le titre complet de Une histoire de l'art - Tome 3 - Ne pas peindre. Le premier tome de cette série est paru en 2016, sous le titre Une histoire de l’art, et sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso, pour une promenade dans les méandres de l'histoire de l'art, après avoir fait l’objet d’une parution dématérialisée sur la plateforme Professeur Cyclope. Cet ouvrage a été réalisé par Philippe Dupuy, scénario, dessins et couleur. Il comporte environ cent-vingt pages de bande dessinée.
Devant la villa Paul Poiret inachevée, à Mézy-sur-Seine. Créer avec de la couleur. Il n’a fait que ça toute sa vie après-tout. Jouer de la couleur, lui donner forme. La faire vibrer sur les étoffes. Ses premiers mots furent pour réclamer un papier et un crayon. Sa vocation de peintre se révélait ainsi bien avant celle de couturier. On n’a pas conservé ses premières œuvres. Elles semblent n’avoir eu d’intérêt et de sens que pour lui-même. Ne pas Peindre. À Paris en 1911, au 107 du Faubourg Saint-Honoré, dans son hôtel particulier, une femme courroucée s’indigne. Il doit s’agir d’une plaisanterie, le couturier imagine-t-il vraiment qu’elle va porter ça ? Elle estime qu’elle ressemble à une colonne grecque qui se prendrait les pieds dans le tapis. Elle demande à Poiret s’il aurait perdu la tête ? Ou bien se mettrait-il à haïr à ce point les femmes ? Dans ce grand salon où elle a effectué l’essayage de la robe, Paul Poiret entre, en suggérant à la dame de se calmer. Il sait qu’elle est venue chez lui sachant que Poiret est la première maison du monde. Il se présente : il est Paul Poiret et il lui dit que c’est bien. Cette robe est bien, elle est magnifique et elle lui va magnifiquement bien. Si elle ne l’aime pas, tant pis, qu’elle la retire, mais il ne lui en fera pas une autre. C’est juste qu’ils ne sont pas faits pour s’entendre. La dame se regarde à nouveau dans le miroir en pied et elle déclare qu’on s’habitue vite, en fait.
En 1925, lors d’un dîner chez les Poiret, avec six convives et le couple Poiret, le couturier évoque son art. Il y a une question d’humeur de sa part, humeur qu’il est impuissant à régler, qui est sensible, violente, exagérée, ombrageuse, brusque, folle. Il faut lui pardonner puisque c’est elle aussi qui cause sa fantaisie, sa variété. Un invité lui fait observer que leur hôte ne pourrait plus se permettre cela aujourd’hui : il y a eu la guerre, l’époque a changé, les choses sont moins faciles. Poiret rétorque qu’il ne manquerait plus que ça : il a toujours été un homme libre, avant, pendant et après la guerre. Un autre convive lui fait observer que Mlle Chanel vient lui chatouiller la barbiche : Poiret n’est plus le seul à détenir les clés du succès. Poiret dit tout le dédain que lui inspirent les créations de Coco Chanel.
Seconde partie du diptyque Peindre ou ne pas peindre (après Une histoire de l'art, tome 2 : Peindre), troisième ouvrage consacré à une facette de l’histoire de l’art : l’auteur a choisi de mettre en scène Paul Poiret (1879-1944), grand couturier et parfumeur français, précurseur du style Art déco. Comme dans le tome précédent consacré à Man Ray (1890-1976), voilà un créateur qui a commencé par dessiner et qui s’adonnera à la peinture, mais à la fin de sa vie, plutôt qu’au début. La vie de ce créateur rencontre celle de nombreux autres artistes de la première moitié du vingtième siècle. Soit il les côtoie en personne, comme Marie Laurencin (1883-1956) pour un entraînement à l’escrime, Isadora Duncan (1877-1927), Max Jacob (1876-1944), Gabrielle-Charlotte Réju, dite Réjane (1856-1920). Soit ses créations sont comparées à celles d’autres, ou encore commentées par d’autres : Gabrielle dite Coco Chanel (1883-1971), Madeleine Vionnet -1876-1975), Jeanne Lanvin (1867-1946), Francis Picabia (1879-1953), Gertrude Stein (1874-1946), ou encore Jean Cocteau, Jean Rouché, André Derrain, Lucien Lelong, la princesse Bibesco, Robert Piquet, Dignimont. En 1922, Man Ray (1890-1976, Emmanuel Radnitsky) est présenté à Paul Poiret établissant un autre lien avec le tome précédent. En 1913, le grand couturier s’était rendu à New York pour The Armory show, faisant la connaissance du galeriste Alfred Stieglitz (1864-1946) qui a soutenu Man Ray dans sa carrière.
Comme pour le tome précédent, le lecteur peut être déstabilisé de prime abord par la structure du récit, et par la forme des images. Globalement, le déroulé de la biographie suit l’ordre chronologique, toutefois dans le détail, l’auteur s’arroge le droit de faire des allers-retours. La première page montre la villa Paul Poiret à un stade avancé de sa construction, celle-ci s’étant étalée de 1921 à 1923 du temps vivant du couturier, sans être achevée. Après cette page introductive, la scène passe en 1911 dans l’hôtel particulier de Poiret. Le dîner chez les Poiret se déroule en 1925. Puis retour en 1913 pour The Armory show, suivi par La mille et deuxième nuit le samedi 24 juin 1911, une autre fête le 20 juin 1912 intitulée Bacchus, un retour à The Armory show, etc. Le lecteur doit se laisser porter par ce réarrangement temporel, au gré de la fantaisie de l’auteur… Au plutôt en fonction des liens thématiques qui s’établissent, des connexions qu’il pointe à différents moments de la vie de Paul Poiret, le conduisant à cette présentation qui recompose la linéarité temporelle pour lui préférer un rapprochement d’événements faisant apparaître le développement artistique sous-jacent.
La narration visuelle est similaire en tout point à celle du tome précédent : des cases aux bordures arrondies, tracés à l’encre d’une façon irrégulière, avec un trait fin pas tout à fait jointif, avec un cadre parfois penché vers le haut, ou au contraire vers le bas, ne respectant pas l’horizontalité habituelle des bandes. Les formes sont tracées à l’encre d’une trait mince uniforme, parfois presque tremblant, avec des déformations de proportions de l’anatomie humaine, mais aussi des décors, faites sciemment. Au fil des séquences, l’artiste met en œuvre une riche diversité de mise en page : cases avec bordure, case sans bordure, illustration en pleine page au nombre de neuf, et des illustrations conçues sur deux pages. Ces dernières peuvent prendre la forme d’un unique dessin sur deux pages en vis-à-vis, ou d’un grand dessin sur deux pages avec de plus petits en inserts, ou de personnages représentés à plusieurs reprises comme se déplaçant sur un unique en fond de case, ou un jeu de passage d’une case à l’autre en suivant une disposition en S. Il joue également avec le positionnement des cases, certaines de la largeur de la page, d’autres disposées en deux colonnes côte à côte, induisant une lecture de haut en bas, plutôt que de gauche à droite. Le lecteur se rend compte qu’il s’adapte très rapidement à cette forme de représentation évoquant parfois Sempé, en un peu moins aérien et léger, aux fantaisies ornementales, au jeu des déformations. Cette liberté de ton et de forme dans la narration visuelle transcrit bien la puissance créatrice de Paul Poiret qui indique qu’il y a une question d’humeur de sa part, sensible, violente, exagérée, ombrageuse, brusque, folle.
Les images font vivre les personnages sous les yeux du lecteur, à la fois par leur silhouette, leur visage, leurs gestes et leur tenue vestimentaire, et elles montrent les lieux dans lesquels ils évoluent, s’avérant variés, de Paris à New York. Le lecteur assiste à de nombreux spectacles et fêtes : un dîner chez les Poiret, la mille et deuxième nuit (organisée chez Paul Poiret, avec costume de rigueur emprunté aux contes orientaux), la Fête Bacchus au pavillon Butard), une scène en une case pour chaque pièce de théâtre ou ballet dont Poiret a réalisé les costumes (Nabuchodonosor par les ballets russes en 1911, Le minaret en 1913, Aphrodite en 1914, une danse en privé d’Isadora Duncan pour Denise & Paul Poiret et leurs amis), plusieurs défilés de présentation de collection du grand couturier, une fastueuse réception pour le réveillon du vingt-quatre décembre 1924, la grande exposition internationale des arts décoratifs de 1925 (titrée Amours, orgues et délices) sur des péniches, la soirée de vernissage de l’exposition des peintures de Poiret à la galerie Charpentier en 1944.
Le lecteur découvre la biographie de ce grand couturier au fil des décennies, le rôle de muse de sa femme Denise Boulet (1886-1982), son credo de créateur, ses succès, ses difficultés financières, sa force motrice incroyable pour imaginer de nouvelles tenues, de nouveaux concepts pour les présenter, pour promouvoir son nom. Il sourit d’aise devant sa générosité quoi qu’il lui en coûte (La générosité n’est pas une faiblesse dont s’embarrasse les banquiers.), il s’amuse devant ses fanfaronnades (par exemple, quand il dit : Alors disons que Picasso est le Paul Poiret de la peinture.), ses goûts de luxe à la fois pour ses créations (de la soie brodée de serge, une multitude d’étoffes, du cachemire des Indes, du taffetas, des doublures en mousseline de soie, pour les manteaux des doublures en crêpe de Chine imprimé de fleurs dorées, et de la fourrure, loutre, zibeline, chinchilla, martre et sconse) et pour sa famille et lui (Il explique à son épouse que c’est le goût de la richesse qui le fait travailler et il ne veut pas qu’elle lui impose le goût de la pauvreté, l’argent est fait pour être dépensé).
L’auteur aborde également d’autres thèmes. La différence entre le peintre et le couturier : Le peintre doit s’imprégner, le couturier vit au rythme fou du monde qui change, des saisons qui chassent la précédente. Le peintre est un contemplatif, le couturier fait le monde, le peintre le ressent. Arrivé au tiers de l’ouvrage, juste après un dessin en pleine page montrant une statue de Bodhisattva acquise par Poiret, le lecteur découvre un passage intitulé : L’étrange guerre de monsieur Poiret 1915. Au cours de trois compositions de case en double page, les images des massacres dans les tranchées se juxtaposent avec les créations de Paul Poiret, évoquant à la fois le traumatisme de la première guerre mondiale sur le créateur, et la folie que l’esprit humain puisse être aussi bien à l’origine d’une telle tuerie de masse que de celle de la création de vêtements extraordinaires. Un passage très troublant, ce rapprochement posant également la question du rôle de l’artiste ou du créateur alors que les combats font des morts par milliers.
Après un tome consacré à Man Ray, l’auteur poursuit sa réflexion sur l’acte de création artistique, sur la vocation artistique, en l’abordant aussi bien du point de vue de la vie de famille, de la dimension économique, du rapport aux événements historiques et du rapport au monde, de la concurrence avec d’autres créateurs dans le même domaine artistique, de l‘obsolescence de la vision artistique, avec une narration visuelle très personnelle, dont les caractéristiques singulières savent rendre parlantes ces questionnements.
La peinture, ça ne devrait être que ça : une histoire de mouvement.
-
Ce tome est le premier d’un diptyque intitulé Peindre ou ne pas peindre, ayant fait l’objet d’une réédition Peindre ou ne pas peindre en 2021. Sa première édition date de 2019 sous le titre complet de Une histoire de l'art - Tome 2 – Peindre. Le premier tome de cette série est paru en 2016, sous le titre Une histoire de l’art, et sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso, pour une promenade dans les méandres de l'histoire de l'art, après avoir fait l’objet d’une parution dématérialisée sur la plateforme Professeur Cyclope. Cet ouvrage a été réalisé par Philippe Dupuy, scénario, dessins et couleur. Il comporte cent-vingt pages de bande dessinée.
Dans une pièce, Man Ray est installé à une table d’échecs, avec un autre lui-même en face, les deux fumant une cigarette et réfléchissant à leur prochain coup. Marcel Duchamp conseille le fou, avancer le fou. Le Man Ray assis à gauche dit : La folie, c’est la peinture. Il continue : La peinture est une aventure intime déraisonnable. De l’autre côté du plateau d’échecs, Man Ray lui répond : S’en détourner pour une expression mercantile est un renoncement coupable. Le premier répond qu’il ne s’en est détourné en rien, il peint et il peindra toujours, mais l’Art ne se vend pas. Il ne voit pas pourquoi l’artiste devrait crever de faim. Duchamp lui suggère de faire un bon mariage, alors. Man Ray fait observer que Duchamp lui dit cela, lui qui a renoncé à la peinture et qui refuse l’idée même de vivre avec une femme. Son interlocuteur nuance : c’est la peinture qui s’est détournée de lui, pour le reste il refuse tout compromis. Man Ray reprend : la photographie est un bon compromis, c’est un art qui paye. Il ne partage pas le mépris qu’ont tous ces peintres pour la photographie. Ce sont deux métiers qui ne se font pas concurrence. Chacun est engagé dans une voie différente.
New York en 1904, au Metropolitan Museum of Art, le jeune Emmanuel Radnitsky effectue une visite contemplant les œuvres d’art exposées. Il rentre chez lui, plein d’images dans la tête. Arrivé dans l’appartement familial, il prend sa petite sœur par la main et l’entraîne dans sa chambre pour la dessiner, alors qu’elle s’est assise sur le lit. Sa mère intervient, ordonne à Dora de sortir d’ici, et de la laisser seule avec son fils. Manya Radnitzky exige de savoir d’où provient ce matériel de peinture. Emmanuel commence par dire qu’il se l’est acheté avec son argent de poche, puis il avoue : il ne les a pas volés, on lui a donnés. Ted et Nick, c’est eux qui les ont chapardés pour lui ; il leur donne des cours de peinture en échange. Sa mère est outrée : en plus, monsieur ne fait pas les basses besognes lui-même, son fils joue les petits caïds. Elle le prend par l’oreille, en lui indiquant qu’ils vont aller rendre tout ça à son propriétaire et lui présenter des excuses. Échecs 2 : à l’écoute de cette anecdote de la jeunesse de Man Ray, Marcel Duchamp est surpris ; c’est étonnant cette fascination pour la peinture.
Philippe Dupuy met en scène Emmanuel Radnitsky (ou Rudzitsky, 1890-1976), durant une période bien cernée de sa vie : de 1913 à 1921. Des années durant lesquelles l’artiste choisit son métier (artiste), fait connaissance avec le galeriste Alfred Stieglitz (1864-1946), choisit son nom d’artiste, suit les cours de la Ferrer Modern School (créée par Emma Goldman, 1869-1940, intellectuelle et anarchiste russe), séjourne à Ridgefield House (une communauté d’artiste dans une région rurale du New Jersey), commence à exposer, à vendre, découvre les artistes européens à l’occasion du Forum Exhibition of Americain Painters en mars 1916 (dont le tableau Nu descendant un escalier, 1912, de Marcel Duchamp), perd son modèle et son amante Adon Lacroix (pseudonyme de Donna Lecoeur), participe au mouvement Dada en 1919, et finit par partir pour l’Europe, grâce au financement de Ferdinand Howald (1856-1934, homme d’affaire et collectionneur d’art). L’artiste s’interroge sur la nature de son art, de la peinture, tout en évoluant dans un milieu lui-même riche en développements à la fois sur la nature de l’art, à la fois en œuvres novatrices. Le lecteur apprécie plus le récit s’il dispose lui-même de quelques repères artistiques, que ce soit la portée du Nu descendant un escalier, du ready-made Fontaine (1917), une partie des œuvres de Corot, Ingres, Delacroix, Courbet, Bonnard, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Derain, Matisse, Picasso, Braque, Bourdelle, Brancusi (artistes ayant exposé à The Armory show de1913 à New York). Et peut-être aussi le fait que Man Ray est passé à la postérité pour ses photographies, reconnues comme des œuvres d’art.
Le récit débute à une date indéterminée, avec deux versions de Man Ray en train de se parler au-dessus d’un jeu d’échecs, et Marcel Duchamp intervient dans la discussion : un dispositif narratif assez particulier. Deux planches après : une scène de l’enfance d’Emmanuel, marqué à jamais par une visite dans un musée d’art. après cette scène de cinq pages, retour à cette partie d’échecs métaphorique. Ces cent-vingt pages comportent environ cinquante scènes différentes, chacune portant un titre, soit unique, soit itératif. Par exemple pour la première catégorie : The Armory show 17/02/1913, Charles Daniel automne 1915, N.Y.C. 1915 : une visite d’Arthur J. Eddy, Forum Exhibition of Americain Painters mars 1916, Revolving doors 1916, La perte du modèle, Suicide 1917 l’urinoir de Marcel Duchamp, Dada 1919, Société Anonyme Catherine S. Drieer, Howald, etc. Dans la seconde catégorie : Échecs 1 à 6, Les artistes ont des vies dissolues 1 à 6, Peindre 1 à 7, ou encore Ridgefield (neuf scènes non successives, sans numérotation, mais avec un sous-titre). Pour autant, la lecture s’avère très facile car le scénariste s’en tient à un déroulé chronologique. Dès la première page, le lecteur observe également le parti pris esthétique très tranché des dessins. Des bordures de cases assez droites, mais aussi des pages composées de dessins sans bordures. Une apparence des personnages (dans le détourage des formes par un trait encré, et les traits du visage) influencée par l’art du début du XXe siècle, par exemple Marc Chagall. Une importance relativisée des décors, eux aussi subissant de légères déformations par rapport aux canons de la perspective. Une bichromie basée sur le beige. Des inversions de contraste pour les séquences intitulées Peindre, dessinées en blanc sur fond noir.
Le lecteur s’immerge dans un monde visuel à la forte personnalité, né pour partie du réapprentissage forcé du dessin suite aux événements racontés par l’auteur dans [[ASIN:2844147003 Left]] (2018), et pour partie de la mise à profit de l’histoire de l’art étudiée par lui. Le lecteur éprouve la sensation d’assister aux discussions des personnages comme s’il se tenait à côté d’eux, de se promener dans les rues de New York, dans le quartier de Brooklyn, dans Central Park, dans un atelier pour apprendre à dessiner, dans une morgue, dans la salle à manger d’un appartement de la haute bourgeoisie, dans une salle de dessin de l’école Ferrer, à la campagne dans différentes galeries, chez Walter Arensberg, etc. Il voit l’artiste évoquer plusieurs œuvres d’art, utiliser plusieurs techniques de dessins pour un élément spécifique, pour une scène : une statue de Rodin, le Nu descendant un escalier (1912), de Marcel Duchamp (1887-1968), les ready-made de Duchamp évoqués sous forme de diagramme dans ses phylactères, une représentation personnelle de Transmutation (1916) de Marcel Duchamp, de ses Revolving Doors 1916, série d’images conçues pour être présentées assemblées sur un axe central vertical, comme une porte à tambour), le ready-made Fontaine (1917, urinoir en porcelaine renversé signé R. Mutt) de Duchamp, l’affiche Réveil Matin Dada 4-5 de Francis Picabia (1879-1953), plusieurs œuvres Dada de Man Ray, la Bouteille Belle Haleine Eau de Voilette (1921) de Marcel Duchamp.
Rapidement, le lecteur comprend que les deux versions de Man Ray jouant aux échecs constituent une métaphore de ce qui se joue en lui, concernant ses interrogations sur l’art et sur le rôle de l’artiste. Au cours des séquences intitulées Peindre, il croise Psyché qui incarne l’invisible, le rien (fantôme des morts, de ce qui a été), Phasma qui est le double fantasmatique d’une réalité elle-même doublure d’un fantôme (Serait-ce là la peinture ? Siège des apparences et du mensonge ? Répétition fantomatique d’une répétition d’un fantôme ?) et enfin Oneiros, fantôme des songes, double rêvé de la réalité. Dans le même temps, Emmanuel Radnitsky travaille à sa peinture, réalise des photographies d’œuvres d’art, découvre les travaux d’autres artistes comme Corot, Ingres, Delacroix, Courbet, Bonnard, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Derain, Matisse, Picasso, Braque, Bourdelle, Brancusi à l’occasion d’expositions newyorkaises. Les muses évoquent la peinture par le biais de dualités tournant autour de la duplicité et de l’ambivalence. Vérité / Mensonge. Moyen / Résultat. Objet / Représentation. Figuration / Abstraction. Forme / Matière. Couleur / Dessin. Modèle / Copie. Figure / Fond. Lors du chapitre Échecs 5, Duchamp expose sa vision de la peinture, et de la photographie, aux deux Man Ray : La peinture, comme la photographie, comme tous les arts, ça ne devrait être que ça : une histoire de mouvement, pas de mouvement artistique, ou du rendu du mouvement, ou du geste, mais de mouvement de l’esprit. Lors de l’avant-dernier chapitre Peindre, la muse évoque la notion de flou : peintures et modèles sont des fantômes, tout y est flou.
Le lecteur ne sait pas forcément à quoi s’attendre en commençant cette histoire : il découvre un récit centré sur Man Ray, entre 1913 et 1921, dans une narration visuelle fortement influencée par les courants artistiques de l’époque. L’auteur met en scène cette phase de la vie de Man Ray, d’abord peintre par vocation, utilisant la photographie à des fins utilitaires. La maturation de l’artiste en tant que créateur sert de terreau à une réflexion sur le devenir de la peinture à cette époque, entre figuratif et abstraction, l’utilité de sa dimension purement représentative étant remise en cause par le développement de la photographie. Passionnant.
-
Ce tome est le premier d’un diptyque intitulé Peindre ou ne pas peindre, ayant fait l’objet d’une réédition Peindre ou ne pas peindre en 2021. Sa première édition date de 2019 sous le titre complet de Une histoire de l'art - Tome 2 – Peindre. Le premier tome de cette série est paru en 2016, sous le titre Une histoire de l’art, et sous la forme d’un immense leporello, livre dépliable de plus de vingt-trois mètres recto verso, pour une promenade dans les méandres de l'histoire de l'art, après avoir fait l’objet d’une parution dématérialisée sur la plateforme Professeur Cyclope. Cet ouvrage a été réalisé par Philippe Dupuy, scénario, dessins et couleur. Il comporte cent-vingt pages de bande dessinée.
Dans une pièce, Man Ray est installé à une table d’échecs, avec un autre lui-même en face, les deux fumant une cigarette et réfléchissant à leur prochain coup. Marcel Duchamp conseille le fou, avancer le fou. Le Man Ray assis à gauche dit : La folie, c’est la peinture. Il continue : La peinture est une aventure intime déraisonnable. De l’autre côté du plateau d’échecs, Man Ray lui répond : S’en détourner pour une expression mercantile est un renoncement coupable. Le premier répond qu’il ne s’en est détourné en rien, il peint et il peindra toujours, mais l’Art ne se vend pas. Il ne voit pas pourquoi l’artiste devrait crever de faim. Duchamp lui suggère de faire un bon mariage, alors. Man Ray fait observer que Duchamp lui dit cela, lui qui a renoncé à la peinture et qui refuse l’idée même de vivre avec une femme. Son interlocuteur nuance : c’est la peinture qui s’est détournée de lui, pour le reste il refuse tout compromis. Man Ray reprend : la photographie est un bon compromis, c’est un art qui paye. Il ne partage pas le mépris qu’ont tous ces peintres pour la photographie. Ce sont deux métiers qui ne se font pas concurrence. Chacun est engagé dans une voie différente.
New York en 1904, au Metropolitan Museum of Art, le jeune Emmanuel Radnitsky effectue une visite contemplant les œuvres d’art exposées. Il rentre chez lui, plein d’images dans la tête. Arrivé dans l’appartement familial, il prend sa petite sœur par la main et l’entraîne dans sa chambre pour la dessiner, alors qu’elle s’est assise sur le lit. Sa mère intervient, ordonne à Dora de sortir d’ici, et de la laisser seule avec son fils. Manya Radnitzky exige de savoir d’où provient ce matériel de peinture. Emmanuel commence par dire qu’il se l’est acheté avec son argent de poche, puis il avoue : il ne les a pas volés, on lui a donnés. Ted et Nick, c’est eux qui les ont chapardés pour lui ; il leur donne des cours de peinture en échange. Sa mère est outrée : en plus, monsieur ne fait pas les basses besognes lui-même, son fils joue les petits caïds. Elle le prend par l’oreille, en lui indiquant qu’ils vont aller rendre tout ça à son propriétaire et lui présenter des excuses. Échecs 2 : à l’écoute de cette anecdote de la jeunesse de Man Ray, Marcel Duchamp est surpris ; c’est étonnant cette fascination pour la peinture.
Philippe Dupuy met en scène Emmanuel Radnitsky (ou Rudzitsky, 1890-1976), durant une période bien cernée de sa vie : de 1913 à 1921. Des années durant lesquelles l’artiste choisit son métier (artiste), fait connaissance avec le galeriste Alfred Stieglitz (1864-1946), choisit son nom d’artiste, suit les cours de la Ferrer Modern School (créée par Emma Goldman, 1869-1940, intellectuelle et anarchiste russe), séjourne à Ridgefield House (une communauté d’artiste dans une région rurale du New Jersey), commence à exposer, à vendre, découvre les artistes européens à l’occasion du Forum Exhibition of Americain Painters en mars 1916 (dont le tableau Nu descendant un escalier, 1912, de Marcel Duchamp), perd son modèle et son amante Adon Lacroix (pseudonyme de Donna Lecoeur), participe au mouvement Dada en 1919, et finit par partir pour l’Europe, grâce au financement de Ferdinand Howald (1856-1934, homme d’affaire et collectionneur d’art). L’artiste s’interroge sur la nature de son art, de la peinture, tout en évoluant dans un milieu lui-même riche en développements à la fois sur la nature de l’art, à la fois en œuvres novatrices. Le lecteur apprécie plus le récit s’il dispose lui-même de quelques repères artistiques, que ce soit la portée du Nu descendant un escalier, du ready-made Fontaine (1917), une partie des œuvres de Corot, Ingres, Delacroix, Courbet, Bonnard, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Derain, Matisse, Picasso, Braque, Bourdelle, Brancusi (artistes ayant exposé à The Armory show de1913 à New York). Et peut-être aussi le fait que Man Ray est passé à la postérité pour ses photographies, reconnues comme des œuvres d’art.
Le récit débute à une date indéterminée, avec deux versions de Man Ray en train de se parler au-dessus d’un jeu d’échecs, et Marcel Duchamp intervient dans la discussion : un dispositif narratif assez particulier. Deux planches après : une scène de l’enfance d’Emmanuel, marqué à jamais par une visite dans un musée d’art. après cette scène de cinq pages, retour à cette partie d’échecs métaphorique. Ces cent-vingt pages comportent environ cinquante scènes différentes, chacune portant un titre, soit unique, soit itératif. Par exemple pour la première catégorie : The Armory show 17/02/1913, Charles Daniel automne 1915, N.Y.C. 1915 : une visite d’Arthur J. Eddy, Forum Exhibition of Americain Painters mars 1916, Revolving doors 1916, La perte du modèle, Suicide 1917 l’urinoir de Marcel Duchamp, Dada 1919, Société Anonyme Catherine S. Drieer, Howald, etc. Dans la seconde catégorie : Échecs 1 à 6, Les artistes ont des vies dissolues 1 à 6, Peindre 1 à 7, ou encore Ridgefield (neuf scènes non successives, sans numérotation, mais avec un sous-titre). Pour autant, la lecture s’avère très facile car le scénariste s’en tient à un déroulé chronologique. Dès la première page, le lecteur observe également le parti pris esthétique très tranché des dessins. Des bordures de cases assez droites, mais aussi des pages composées de dessins sans bordures. Une apparence des personnages (dans le détourage des formes par un trait encré, et les traits du visage) influencée par l’art du début du XXe siècle, par exemple Marc Chagall. Une importance relativisée des décors, eux aussi subissant de légères déformations par rapport aux canons de la perspective. Une bichromie basée sur le beige. Des inversions de contraste pour les séquences intitulées Peindre, dessinées en blanc sur fond noir.
Le lecteur s’immerge dans un monde visuel à la forte personnalité, né pour partie du réapprentissage forcé du dessin suite aux événements racontés par l’auteur dans [[ASIN:2844147003 Left]] (2018), et pour partie de la mise à profit de l’histoire de l’art étudiée par lui. Le lecteur éprouve la sensation d’assister aux discussions des personnages comme s’il se tenait à côté d’eux, de se promener dans les rues de New York, dans le quartier de Brooklyn, dans Central Park, dans un atelier pour apprendre à dessiner, dans une morgue, dans la salle à manger d’un appartement de la haute bourgeoisie, dans une salle de dessin de l’école Ferrer, à la campagne dans différentes galeries, chez Walter Arensberg, etc. Il voit l’artiste évoquer plusieurs œuvres d’art, utiliser plusieurs techniques de dessins pour un élément spécifique, pour une scène : une statue de Rodin, le Nu descendant un escalier (1912), de Marcel Duchamp (1887-1968), les ready-made de Duchamp évoqués sous forme de diagramme dans ses phylactères, une représentation personnelle de Transmutation (1916) de Marcel Duchamp, de ses Revolving Doors 1916, série d’images conçues pour être présentées assemblées sur un axe central vertical, comme une porte à tambour), le ready-made Fontaine (1917, urinoir en porcelaine renversé signé R. Mutt) de Duchamp, l’affiche Réveil Matin Dada 4-5 de Francis Picabia (1879-1953), plusieurs œuvres Dada de Man Ray, la Bouteille Belle Haleine Eau de Voilette (1921) de Marcel Duchamp.
Rapidement, le lecteur comprend que les deux versions de Man Ray jouant aux échecs constituent une métaphore de ce qui se joue en lui, concernant ses interrogations sur l’art et sur le rôle de l’artiste. Au cours des séquences intitulées Peindre, il croise Psyché qui incarne l’invisible, le rien (fantôme des morts, de ce qui a été), Phasma qui est le double fantasmatique d’une réalité elle-même doublure d’un fantôme (Serait-ce là la peinture ? Siège des apparences et du mensonge ? Répétition fantomatique d’une répétition d’un fantôme ?) et enfin Oneiros, fantôme des songes, double rêvé de la réalité. Dans le même temps, Emmanuel Radnitsky travaille à sa peinture, réalise des photographies d’œuvres d’art, découvre les travaux d’autres artistes comme Corot, Ingres, Delacroix, Courbet, Bonnard, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Derain, Matisse, Picasso, Braque, Bourdelle, Brancusi à l’occasion d’expositions newyorkaises. Les muses évoquent la peinture par le biais de dualités tournant autour de la duplicité et de l’ambivalence. Vérité / Mensonge. Moyen / Résultat. Objet / Représentation. Figuration / Abstraction. Forme / Matière. Couleur / Dessin. Modèle / Copie. Figure / Fond. Lors du chapitre Échecs 5, Duchamp expose sa vision de la peinture, et de la photographie, aux deux Man Ray : La peinture, comme la photographie, comme tous les arts, ça ne devrait être que ça : une histoire de mouvement, pas de mouvement artistique, ou du rendu du mouvement, ou du geste, mais de mouvement de l’esprit. Lors de l’avant-dernier chapitre Peindre, la muse évoque la notion de flou : peintures et modèles sont des fantômes, tout y est flou.
Le lecteur ne sait pas forcément à quoi s’attendre en commençant cette histoire : il découvre un récit centré sur Man Ray, entre 1913 et 1921, dans une narration visuelle fortement influencée par les courants artistiques de l’époque. L’auteur met en scène cette phase de la vie de Man Ray, d’abord peintre par vocation, utilisant la photographie à des fins utilitaires. La maturation de l’artiste en tant que créateur sert de terreau à une réflexion sur le devenir de la peinture à cette époque, entre figuratif et abstraction, l’utilité de sa dimension purement représentative étant remise en cause par le développement de la photographie. Passionnant.
Monsieur Jean est écrivain, il travaille dans son appartement, avec ses horaires décalés, et la concierge de l'immeuble n'a pas beaucoup de sympathie pour ce fainéant qui se lève tous les jours à midi.
Le dessin est simple, expressif, le livre est sous forme d'une suite d'histoires courtes, de petites anecdotes de la vie de Monsieur Jean, le personnage est très autocentré, un peu névrosé, un peu loser (il finit par avoir du succès quand même), le prototype du bobo parisien. le ton est léger, celui de la comédie, la lecture est distrayante et sympathique, mais pas inoubliable.
Le dessin est simple, expressif, le livre est sous forme d'une suite d'histoires courtes, de petites anecdotes de la vie de Monsieur Jean, le personnage est très autocentré, un peu névrosé, un peu loser (il finit par avoir du succès quand même), le prototype du bobo parisien. le ton est léger, celui de la comédie, la lecture est distrayante et sympathique, mais pas inoubliable.
Celui-là, je me demande vraiment ce qu'il fait de ses journées…
-
Ce tome est un recueil d'histoires courtes. le personnage a donné lieu à sept albums et deux hors-série : celui-ci (1991, Les nuits les plus blanches (1992), Les Femmes et les enfants d'abord (1994), Vivons heureux sans en avoir l'air (1997), Comme s'il en pleuvait (2001), Inventaire avant travaux (2003), Un certain équilibre (2005), et les deux hors-série Journal d'un album (1994) et La Théorie des gens seuls (2000). Ils ont été réalisés à quatre mains par Philippe Dupuy et Charles Berberian, chacun étant scénariste et dessinateur. Ils avaient précédemment réalisé la série le journal d'Henriette (3 albums de 1988 à 1991), avec une continuation sous le nom Henriette (4 albums de 1998 à 2003).
Ce tome regroupe onze histoires courtes. Monsieur Jean, 2 pages : il descend l'escalier de son petit immeuble parisien, en sifflotant. Au rez-de-chaussée, il salue Mme Poulbot la concierge, et madame Colin. Après son passage, celles-ci commencent à cancaner : Celui-là, la concierge se demande vraiment ce qu'il fait de ses journées… Jamais levé avant midi… Et sitôt debout, la musique à fond !!! de toute façon, elle ne l'a jamais vu partir travailler. À se demander de quoi il vit ! Et puis à n'importe quelle heure, c'est les copains qui débarquent. Et faut voir les copains ! Et puis, c'est pas pour dire, mais c'est pas les lames de rasoir qui doivent lui coûter cher ! Mais, c'est que ça plaît apparemment… Et pas toujours aux mêmes ! Madame Rose lui a même dit que parfois elle entendait des cris… le soir, madame Poulbot regarde la télévision et elle voit monsieur Jean qui est interviewé et présenté comme romancier. Chantal, sept pages : monsieur Jean retrouve son ami Félix devant l'entrée du Palais de Tokyo pour une exposition sur Henri Matisse (1869-1954). Ils font le poireau pendant trois quarts d'heure et Félix conclut qu'elle ne viendra pas. Il laisse son ami visiter l'exposition tout seul. À l'intérieur, Jean croise Chantal, une ex. ils évoquent leur relation passée.
Une bonne surprise, cinq pages : monsieur Jean prend son téléphone et appelle un copain mais celui-ci lui répond que Dominique est malade, Jean-Claude n'a pas envie, Philippe et Charles ont trop de travail, du coup il propose de remettre ça à un autre jour. Jean va chercher son carnet d'adresse et il appelle un autre ami qui lui répond qu'il n'a pas de fête en vue, peut-être la semaine prochaine. Ma concierge bien aimée, une demi-page : madame Poulbot est en train de laver les marches de l'escalier et que monsieur Jean descend et glisse. Monsieur Jean fait ses courses, six pages : Jean ouvre son réfrigérateur et constate qu'il n'y a pas grand-chose. Il commence à mentalement établir une liste de courses. Il croise madame Colin dans l'escalier. Au supermarché, il commence à remplir son caddy et repère une très belle femme blonde en tailleur rouge, en train de réaliser un sondage, un client après l'autre.
Lors de sa parution initiale, cette série a marqué les esprits en présentant la vie d'un parisien, romancier, dans ce qu'elle a de plus banale et quotidienne, un bobo, bourgeois-bohème, à l'opposé d'un héros musclé bravant les dangers et sauvant les demoiselles en détresse. de fait, la première histoire se pose là : monsieur Jean descend l'escalier et s'en va : le lecteur fait sa connaissance au travers des commérages de la concierge et d'une autre habitante de son immeuble. Glamour à mort, surtout qu'il s'agit de ménagères de plus de cinquante ans, bien empâtées. Les dessins jouent sur la caricature des visages, les expressions exagérées, pour une forme d'humour saturé de dérision. Dans un visage ou deux, le lecteur peut retrouver l'influence d'Yves Chaland (1957-1990). La mise en couleurs est de type naturaliste, avec des couleurs un peu plus vives par endroit. Il y a juste un dessin un peu coquin quand les deux rombières un peu aigries s'imaginent ce qui se passe dans la chambre de monsieur Jean, avec lui représenté en démon avec une fourche, et trois splendides jeunes femmes nues à ses pieds dans des poses lascives.
De fait, au travers de ces onze histoires courtes, le lecteur rencontre à quatre reprises la concierge qui lance des regards peu amènes à Monsieur Jean quand il emprunte l'escalier. Dans la deuxième, il rencontre une ancienne compagne et ils évoquent leur relation avec à l'esprit ce qui aurait pu être, dans une conversation douce, légèrement nostalgique. Dans la suivante, monsieur Jean essaye d'organiser une soirée entre amis pour finir par aller manger avec ses parents. Dans la cinquième, il va faire ses courses, s'imagine en train de draguer la jolie femme effectuant un sondage, pour finir par se rendre compte qu'il ne peut plus rentrer chez lui car il a oublié ses clefs sur la petite table à côté de la porte d'entrée. Par la suite, il doit garder le chat d'un copain avec la crainte qu'il ne saccage son appartement ou qu'il ne s'enfuit, aider un pote tire-au-flanc à bosser sur un slogan publicitaire. L'histoire la plus riche en suspense l'emmène dans la villa d'un producteur de ville dans le sud de la France pour améliorer un scénario de film, et il se retrouve face à deux gros bras souhaitant faire la peau du producteur magouilleur. On se rassure : pas de violence, pas de bagarre, pas de coup porté.
Le plaisir de lecture se trouve donc ailleurs : accompagner Monsieur Jean dans ses petits instants, dans sa vie ordinaire. Ordinaire à ceci près qu'il exerce un métier créatif lui donnant une liberté peu commune et qu'il ne semble pas avoir à se soucier de problématiques financières ou économiques. Les auteurs semblent prendre un malin plaisir à mettre en scène le personnage en faisant exprès de ne pas respecter l'horizon d'attente implicite. Il n'y a pas de flux de pensée du personnage qui permettrait de comprendre son processus mental ou d'avoir accès à ses opinions sans filtre, à ses valeurs implicites. Plus encore, Monsieur Jean apparaît comme un individu réservé, peu expansif, très posé, sans attachement affectif ou émotionnel. Il ne pontifie pas, il n'impose pas son point de vue, il se montre d'une politesse tranquille et peu engageante. Il ne cherche pas particulièrement à séduire, même si certaines femmes le trouvent séduisant. Il s'habille en pantalon avec un polo, un teeshirt, une fois avec une chemise et une cravate, de manière pragmatique sans recherche particulière. Il lui arrive régulièrement d'être mal rasé. Seul véritable signe particulier : il fume des cigarettes, avec une certaine nonchalance.
La première histoire montre une cage d'escalier peut-être un peu large pour un immeuble parisien. La seconde place le lecteur au pied de l'entrée du Palais de Tokyo, immédiatement identifiable. Puis elle l'emmène déambuler dans les salles de l'exposition. Dans le même temps les souvenirs évoqués entre Chantal et Jean les montrent sur les quais de la scène, dans une représentation simplifiée, tout en permettant de reconnaitre l'endroit. Dans la dernière page, les deux jeunes gens se trouvent sur un pont routier au-dessus d'un faisceau de voies ferroviaires facilement identifiable. L'histoire suivante montre Monsieur Jean dans son appartement parisien, décoré au goût de l'époque. La supérette où Monsieur Jean fait ses courses n'a rien de typiquement parisienne, en revanche l'appartement dans lequel il finit avec ses fenêtres et son toit en zinc ressort comme emblématique de l'urbanisme parisien. le séjour dans une belle villa aux alentours d'Avignon baigne dans une belle lumière ensoleillée, sans oublier la piscine. La dernière séquence de Ma concierge bien-aimée comprend une promenade dans le jardin du Luxembourg, avec le dôme du Panthéon en arrière-plan.
Monsieur Jean passe d'un environnement parisien à un autre, sans pénétrer dans les quartiers luxueux, mais sans non plus se trouver confronté à des personnes sans abri, à la pauvreté dans ce qu'elle a de plus dramatique. Sa condition de vie correspond bien à une image de bobo : aisance financière, parisien et parisianiste. Monsieur Jean ne semble pas avoir d'autre responsabilité dans la vie que de s'occuper de lui-même. Il entretient des amitiés qui semblent un peu distantes, à l'exception de celle qui la lie à Félix, et des amours avec une implication toute relative. Il apparaît comme un individu cultivé, pas forcément très doué de ses mains, mais assez intelligent pour manipuler deux gros durs. Par petites touches, il parvient à gagner la sympathie du lecteur : ses cauchemars mettant en scène sa concierge comme persécutrice, sa prévenance avec son ex-compagne, l'aide réelle qu'il apporte à son ami dans le besoin. Les auteurs mettent en oeuvre une forme d'humour froid et quelque peu distant qui fait mouche, générant un sourire chez le lecteur, quant aux infortunes de ce jeune homme blanc, économiquement indépendant, encore un peu gêné de d'assumer un repas chez papa et maman, de temps en temps.
Cette bande dessinée incarne le reflet d'une époque, le reflet d'une frange de la société parisienne. le tandem de dessinateurs a commencé à acquérir une personnalité graphique personnelle, mais elle va évoluer et s'affiner au cours des albums pour devenir très élégante. le quotidien de Monsieur Jean est fait de petits riens, pour autant ils ne sont interchangeables avec aucun autre, et ils présentent une saveur à nulle autre pareille.
-
Ce tome est un recueil d'histoires courtes. le personnage a donné lieu à sept albums et deux hors-série : celui-ci (1991, Les nuits les plus blanches (1992), Les Femmes et les enfants d'abord (1994), Vivons heureux sans en avoir l'air (1997), Comme s'il en pleuvait (2001), Inventaire avant travaux (2003), Un certain équilibre (2005), et les deux hors-série Journal d'un album (1994) et La Théorie des gens seuls (2000). Ils ont été réalisés à quatre mains par Philippe Dupuy et Charles Berberian, chacun étant scénariste et dessinateur. Ils avaient précédemment réalisé la série le journal d'Henriette (3 albums de 1988 à 1991), avec une continuation sous le nom Henriette (4 albums de 1998 à 2003).
Ce tome regroupe onze histoires courtes. Monsieur Jean, 2 pages : il descend l'escalier de son petit immeuble parisien, en sifflotant. Au rez-de-chaussée, il salue Mme Poulbot la concierge, et madame Colin. Après son passage, celles-ci commencent à cancaner : Celui-là, la concierge se demande vraiment ce qu'il fait de ses journées… Jamais levé avant midi… Et sitôt debout, la musique à fond !!! de toute façon, elle ne l'a jamais vu partir travailler. À se demander de quoi il vit ! Et puis à n'importe quelle heure, c'est les copains qui débarquent. Et faut voir les copains ! Et puis, c'est pas pour dire, mais c'est pas les lames de rasoir qui doivent lui coûter cher ! Mais, c'est que ça plaît apparemment… Et pas toujours aux mêmes ! Madame Rose lui a même dit que parfois elle entendait des cris… le soir, madame Poulbot regarde la télévision et elle voit monsieur Jean qui est interviewé et présenté comme romancier. Chantal, sept pages : monsieur Jean retrouve son ami Félix devant l'entrée du Palais de Tokyo pour une exposition sur Henri Matisse (1869-1954). Ils font le poireau pendant trois quarts d'heure et Félix conclut qu'elle ne viendra pas. Il laisse son ami visiter l'exposition tout seul. À l'intérieur, Jean croise Chantal, une ex. ils évoquent leur relation passée.
Une bonne surprise, cinq pages : monsieur Jean prend son téléphone et appelle un copain mais celui-ci lui répond que Dominique est malade, Jean-Claude n'a pas envie, Philippe et Charles ont trop de travail, du coup il propose de remettre ça à un autre jour. Jean va chercher son carnet d'adresse et il appelle un autre ami qui lui répond qu'il n'a pas de fête en vue, peut-être la semaine prochaine. Ma concierge bien aimée, une demi-page : madame Poulbot est en train de laver les marches de l'escalier et que monsieur Jean descend et glisse. Monsieur Jean fait ses courses, six pages : Jean ouvre son réfrigérateur et constate qu'il n'y a pas grand-chose. Il commence à mentalement établir une liste de courses. Il croise madame Colin dans l'escalier. Au supermarché, il commence à remplir son caddy et repère une très belle femme blonde en tailleur rouge, en train de réaliser un sondage, un client après l'autre.
Lors de sa parution initiale, cette série a marqué les esprits en présentant la vie d'un parisien, romancier, dans ce qu'elle a de plus banale et quotidienne, un bobo, bourgeois-bohème, à l'opposé d'un héros musclé bravant les dangers et sauvant les demoiselles en détresse. de fait, la première histoire se pose là : monsieur Jean descend l'escalier et s'en va : le lecteur fait sa connaissance au travers des commérages de la concierge et d'une autre habitante de son immeuble. Glamour à mort, surtout qu'il s'agit de ménagères de plus de cinquante ans, bien empâtées. Les dessins jouent sur la caricature des visages, les expressions exagérées, pour une forme d'humour saturé de dérision. Dans un visage ou deux, le lecteur peut retrouver l'influence d'Yves Chaland (1957-1990). La mise en couleurs est de type naturaliste, avec des couleurs un peu plus vives par endroit. Il y a juste un dessin un peu coquin quand les deux rombières un peu aigries s'imaginent ce qui se passe dans la chambre de monsieur Jean, avec lui représenté en démon avec une fourche, et trois splendides jeunes femmes nues à ses pieds dans des poses lascives.
De fait, au travers de ces onze histoires courtes, le lecteur rencontre à quatre reprises la concierge qui lance des regards peu amènes à Monsieur Jean quand il emprunte l'escalier. Dans la deuxième, il rencontre une ancienne compagne et ils évoquent leur relation avec à l'esprit ce qui aurait pu être, dans une conversation douce, légèrement nostalgique. Dans la suivante, monsieur Jean essaye d'organiser une soirée entre amis pour finir par aller manger avec ses parents. Dans la cinquième, il va faire ses courses, s'imagine en train de draguer la jolie femme effectuant un sondage, pour finir par se rendre compte qu'il ne peut plus rentrer chez lui car il a oublié ses clefs sur la petite table à côté de la porte d'entrée. Par la suite, il doit garder le chat d'un copain avec la crainte qu'il ne saccage son appartement ou qu'il ne s'enfuit, aider un pote tire-au-flanc à bosser sur un slogan publicitaire. L'histoire la plus riche en suspense l'emmène dans la villa d'un producteur de ville dans le sud de la France pour améliorer un scénario de film, et il se retrouve face à deux gros bras souhaitant faire la peau du producteur magouilleur. On se rassure : pas de violence, pas de bagarre, pas de coup porté.
Le plaisir de lecture se trouve donc ailleurs : accompagner Monsieur Jean dans ses petits instants, dans sa vie ordinaire. Ordinaire à ceci près qu'il exerce un métier créatif lui donnant une liberté peu commune et qu'il ne semble pas avoir à se soucier de problématiques financières ou économiques. Les auteurs semblent prendre un malin plaisir à mettre en scène le personnage en faisant exprès de ne pas respecter l'horizon d'attente implicite. Il n'y a pas de flux de pensée du personnage qui permettrait de comprendre son processus mental ou d'avoir accès à ses opinions sans filtre, à ses valeurs implicites. Plus encore, Monsieur Jean apparaît comme un individu réservé, peu expansif, très posé, sans attachement affectif ou émotionnel. Il ne pontifie pas, il n'impose pas son point de vue, il se montre d'une politesse tranquille et peu engageante. Il ne cherche pas particulièrement à séduire, même si certaines femmes le trouvent séduisant. Il s'habille en pantalon avec un polo, un teeshirt, une fois avec une chemise et une cravate, de manière pragmatique sans recherche particulière. Il lui arrive régulièrement d'être mal rasé. Seul véritable signe particulier : il fume des cigarettes, avec une certaine nonchalance.
La première histoire montre une cage d'escalier peut-être un peu large pour un immeuble parisien. La seconde place le lecteur au pied de l'entrée du Palais de Tokyo, immédiatement identifiable. Puis elle l'emmène déambuler dans les salles de l'exposition. Dans le même temps les souvenirs évoqués entre Chantal et Jean les montrent sur les quais de la scène, dans une représentation simplifiée, tout en permettant de reconnaitre l'endroit. Dans la dernière page, les deux jeunes gens se trouvent sur un pont routier au-dessus d'un faisceau de voies ferroviaires facilement identifiable. L'histoire suivante montre Monsieur Jean dans son appartement parisien, décoré au goût de l'époque. La supérette où Monsieur Jean fait ses courses n'a rien de typiquement parisienne, en revanche l'appartement dans lequel il finit avec ses fenêtres et son toit en zinc ressort comme emblématique de l'urbanisme parisien. le séjour dans une belle villa aux alentours d'Avignon baigne dans une belle lumière ensoleillée, sans oublier la piscine. La dernière séquence de Ma concierge bien-aimée comprend une promenade dans le jardin du Luxembourg, avec le dôme du Panthéon en arrière-plan.
Monsieur Jean passe d'un environnement parisien à un autre, sans pénétrer dans les quartiers luxueux, mais sans non plus se trouver confronté à des personnes sans abri, à la pauvreté dans ce qu'elle a de plus dramatique. Sa condition de vie correspond bien à une image de bobo : aisance financière, parisien et parisianiste. Monsieur Jean ne semble pas avoir d'autre responsabilité dans la vie que de s'occuper de lui-même. Il entretient des amitiés qui semblent un peu distantes, à l'exception de celle qui la lie à Félix, et des amours avec une implication toute relative. Il apparaît comme un individu cultivé, pas forcément très doué de ses mains, mais assez intelligent pour manipuler deux gros durs. Par petites touches, il parvient à gagner la sympathie du lecteur : ses cauchemars mettant en scène sa concierge comme persécutrice, sa prévenance avec son ex-compagne, l'aide réelle qu'il apporte à son ami dans le besoin. Les auteurs mettent en oeuvre une forme d'humour froid et quelque peu distant qui fait mouche, générant un sourire chez le lecteur, quant aux infortunes de ce jeune homme blanc, économiquement indépendant, encore un peu gêné de d'assumer un repas chez papa et maman, de temps en temps.
Cette bande dessinée incarne le reflet d'une époque, le reflet d'une frange de la société parisienne. le tandem de dessinateurs a commencé à acquérir une personnalité graphique personnelle, mais elle va évoluer et s'affiner au cours des albums pour devenir très élégante. le quotidien de Monsieur Jean est fait de petits riens, pour autant ils ne sont interchangeables avec aucun autre, et ils présentent une saveur à nulle autre pareille.
Werner, ancien soldat allemand durant la première guerre mondiale, débarque en Indochine, fuyant son pays et sa culpabilité vers une autre vie.
En effet, Werner ne se remet pas de la mort de son camarade sur le champ de bataille, qui s'est sacrifié pour lui, alors qu'il était marié et père de famille.
Afin de se racheter, il pense que la solution est à son tour de se marier et de fonder une famille.
Cependant, en Indochine, il est considéré comme un étranger, auquel on confie les plus basses besognes. En mode survie, dans un quotidien des plus sombres, il aperçoit une belle jeune femme dont on dit qu'elle est maudite.
Il va alors la rencontrer, assouvir avec elle ses désirs, mais est-ce la réalité ou bien s'agit-il dans les rêves mouvementés de Werner?
L'histoire, tout comme les graphismes sont sombres, le contexte malsain, mais décrit bien aussi la difficulté à se reconstruire après les horreurs de la guerre, sans soutien et dans un environnement et une culture que l'on ne connait pas.
Il me semble que plusieurs lectures sont nécessaires pour pleinement comprendre l'histoire et le message de l'auteur ainsi que s'imprégner du malaise ambiant, en y trouvant néanmoins quelques touches de positif.
En effet, Werner ne se remet pas de la mort de son camarade sur le champ de bataille, qui s'est sacrifié pour lui, alors qu'il était marié et père de famille.
Afin de se racheter, il pense que la solution est à son tour de se marier et de fonder une famille.
Cependant, en Indochine, il est considéré comme un étranger, auquel on confie les plus basses besognes. En mode survie, dans un quotidien des plus sombres, il aperçoit une belle jeune femme dont on dit qu'elle est maudite.
Il va alors la rencontrer, assouvir avec elle ses désirs, mais est-ce la réalité ou bien s'agit-il dans les rêves mouvementés de Werner?
L'histoire, tout comme les graphismes sont sombres, le contexte malsain, mais décrit bien aussi la difficulté à se reconstruire après les horreurs de la guerre, sans soutien et dans un environnement et une culture que l'on ne connait pas.
Il me semble que plusieurs lectures sont nécessaires pour pleinement comprendre l'histoire et le message de l'auteur ainsi que s'imprégner du malaise ambiant, en y trouvant néanmoins quelques touches de positif.
Elle les cumule, Henriette : le prénom pas facile à porter, le visage ingrat, l'embonpoint et surtout les parents super cons, bêtes et méchants. Le père en particulier, mais qui ne dit mot consent, la mère passive est donc à mettre dans le même sac. Ils sont du genre à fouiller votre chambre pour dénicher votre journal intime, le lire, s'en moquer, et même en faire profiter les voisins. Du genre à vous laminer le moral, à souligner que vous êtes grosse et moche. Exactement ce dont on a besoin à l'adolescence pour se sentir bien dans sa peau.
Henriette encaisse, elle a de la ressource. Jacques Brel pour modèle, des rêves plein la tête, la volonté d'écrire et d'être publiée, moins pour devenir célèbre que pour être enfin comprise, considérée, respectée. En attendant, elle s'épanche dans un carnet : "Je tiens un journal. En fait, je devrais plutôt dire : Nous nous tenons".
Elle est sensible, intelligente et courageuse, aussi, et sait prendre sa revanche mine de rien.
A la lecture des mésaventures d'Henriette, on s'indigne, on compatit, on s'émeut, on voudrait claquer le bec aux abrutis qui l'humilient, et on jubile quand elle arrive à leur damer le pion, ouvertement ou en secret. Et puis on prend conscience que cette petite est l'archétype de l'ado en pleine crise existentielle. Ses lunettes de myope, son miroir, vilain miroir, sont les prismes via lesquels l'adolescent voit ses problèmes, grossis, déformés. Il se trouve nul, moche, s'estime incompris et entouré d'adultes crétins, bornés et sadiques. De quoi souffrir, en effet, être pessimiste, révolté contre tout et contre tous, et rêver de lendemains meilleurs.
Ça bouscule les "vieux", de telles images, et tant mieux si ça nous fait méditer. Parce que finalement, on est aussi lourds que les adultes que côtoie Henriette. Enfin presque, et pas tous les jours...
Henriette encaisse, elle a de la ressource. Jacques Brel pour modèle, des rêves plein la tête, la volonté d'écrire et d'être publiée, moins pour devenir célèbre que pour être enfin comprise, considérée, respectée. En attendant, elle s'épanche dans un carnet : "Je tiens un journal. En fait, je devrais plutôt dire : Nous nous tenons".
Elle est sensible, intelligente et courageuse, aussi, et sait prendre sa revanche mine de rien.
A la lecture des mésaventures d'Henriette, on s'indigne, on compatit, on s'émeut, on voudrait claquer le bec aux abrutis qui l'humilient, et on jubile quand elle arrive à leur damer le pion, ouvertement ou en secret. Et puis on prend conscience que cette petite est l'archétype de l'ado en pleine crise existentielle. Ses lunettes de myope, son miroir, vilain miroir, sont les prismes via lesquels l'adolescent voit ses problèmes, grossis, déformés. Il se trouve nul, moche, s'estime incompris et entouré d'adultes crétins, bornés et sadiques. De quoi souffrir, en effet, être pessimiste, révolté contre tout et contre tous, et rêver de lendemains meilleurs.
Ça bouscule les "vieux", de telles images, et tant mieux si ça nous fait méditer. Parce que finalement, on est aussi lourds que les adultes que côtoie Henriette. Enfin presque, et pas tous les jours...
Ah ouais, d’accord, le genre intello-branchouille !
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1994) qu’il vaut mieux avoir lu avant. Dans la réédition en intégrale, l’éditeur a inséré le tome hors-série Monsieur Jean - HS 2 : La théorie des gens seuls (2000) entre les tomes 3 et 4 dans la mesure ou les histoires correspondantes se déroulent entre les deux, même s’il est paru après le tome 4. La première édition du présent tome date de 1998. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Isabelle Busschaert. L’album compte cinquante-quatre planches.
Dans l’appartement de Monsieur Jean, la fête bat son plein : la marmaille s’agite en tous sens, pour l’anniversaire d’Eugène, trois ou quatre ans, un vrai carnage. Jean regarde d’un air effaré les verres renversés par terre, les bibelots en train de chuter, un enfant aux doigts sales maculant son fauteuil, un autre jouant avec les allumettes pour allumer les bougies, deux autres en train de se battre pour un robot en plastique. Il intervient pour les séparer, confisque le jouet objet de discorde et le place sur une étagère en hauteur ce qui déclenche une crise de larmes chez les deux. Monsieur Jean leur tourne le dos et s’éloigne estimant l’affaire réglée. Cathy intervient prend le robot sur l’étagère et fait mine de parler à sa place pour s’adresser aux enfants. Faisant mine d’être Globultor, elle leur indique qu’il est le gardien des verres vides et des assiettes salles, qu’il voit que son trésor est éparpillé partout dans l’univers, et il leur demande de l’aider à le rassembler ici sur la table. Du coin de l’œil, Jean a vu des enfants jouer dans la pièce qui lui sert de bureau. Il découvre deux enfants en train de gribouiller sur les pages du manuscrit de son prochain livre. Il les sort de là et il se plaint à Cathy qui lui répond qu’il devrait plutôt travailler sur ordinateur et que les dessins sont plutôt pas mal.
Monsieur Jean s’isole dans son bureau et passe un coup de fil à son ami Clément qui lui propose de sortir le soir même. Pendant ce temps-là, Cathy prend en charge le déroulement de la fête d’anniversaire, toute seule. Elle va répondre au coup de sonnette : c’est Jacques qui débarque avec ses jumeaux. Il lui explique qu’il vient de se disputer avec son épouse Véronique, qu’ils ont besoin d’un peu de temps tout seuls, qu’il lui laisse les jumeaux. Elle accepte gentiment. Dans son bureau, Jean continue de papoter tranquille, pendant que la fête bat son plein dans le salon. Cathy entre dans le bureau avec air courroucé. Elle lui explique qu’elle en a assez, assez d’être la bonne poire qui rapplique quand on a besoin d’elle, tout ça parce que les enfants, monsieur, ça lui prend la tête. Parfois, elle a vraiment l’impression de le déranger. Ça fait un an qu’’ils sont ensemble et elle a l’impression qu’il s’investit à reculons. La vérité, c’est que ça lui fait peur de s’impliquer, de remettre en question son petit confort de célibataire. Elle lui dit au revoir et le laisse avec les enfants.
Au fur et à mesure des album, monsieur Jean grandit lentement mais inexorablement, poussé vers les responsabilités, confronté à des adultes, à leurs choix, à ses propres non-choix qui finalement se révèlent en être. Comme Cathy lui fait observer, il ne souhaite pas remettre en cause son petit confort de célibataire, et elle en a marre d’attendre qu’il se décide. Elle décide de s’éloigner quelques temps, profitant d’un voyage professionnel à New York : il aura ainsi tout le temps de réfléchir et de se décider, à moins que ce soit la vie qui le fasse pour lui. Le début s’avère brutal : Monsieur Jean confronté à la sauvagerie déchaînée de petits enfants hors de contrôle. Le chaos est libéré dans son petit appartement parisien, et il ne dispose d’aucun moyen pour le maîtriser, ni même pour l’endiguer. Les artistes s’amusent bien à faire s’alterner une case avec ces petits enfants sans retenue aucune, et la tête de Monsieur Jean abasourdi par ce qu’il contemple. Par comparaison, les gestes de Cathy sont calmes et posés, ses postures sont assurées et calment les enfants, en totale opposition avec le dégoût qui habite Jean. Lorsque ce dernier se rend compte que Jacques a laissé ses jumeaux, il est encore plus atterré, ne comprenant même pas comment ces enfants ont pu arriver là, totalement désemparé face à Véronique qui vient les chercher. De son côté, elle semble résignée et même quelque peu accablée par les tensions entre elle et son époux, avec une larme coulant sur sa joue, et cherchant un peu de réconfort sur l’épaule de Jean. Avec des images toutes simples, les dessinateurs savent faire passer la détresse qui l’habite.
Avec cette approche esthétique qui n’appartient qu’à eux, Dupuy & Berberian simplifient les silhouettes tout en leur donnant une réelle élégance, donnent un appendice nasal appartenant au registre gros nez aux hommes, des nez très fins et un peu pointus aux femmes. Ils jouent également sur les simplifications et les exagérations des visages pour les rendre plus expressifs : les yeux en forme de billes de loto pour l’effarement de Monsieur Jean devant les enfants déchaînés, les bouches très grandes ouvertes des enfants jusqu’à en voir la luette quand ils braillent en s’époumonant, les traits secs pour les yeux et la bouche quand Cathy est de mauvaise humeur, la bouche en croissant de Félix pour souligner sa bonne humeur insouciante, le visage très aplati de Mme Poulbot et son air satisfait, la bouche en fer à cheval de Clément pour montrer son dégout, les yeux mi-clos de Pierre-Yves, etc. Le langage corporel des personnages s’avère tout aussi parlant : Cathy qui claque une porte, Monsieur Jean étendu très détendu alors que la fête enfantine bat son plein de l’autre côté de la porte, Félix avec les épaules tombantes alors que Jean lui démontre l’inanité de son plan pour se refaire, Eugène se débattant dans la baignoire parce que du shampoing lui coule dans les yeux, Marion et ses postures attentives vis-à-vis de Jean, Pierre-Yves dans des postures pleines d’assurance pour mettre en valeur son corps bien découplé.
Les artistes ont également repris l’idée d’une métaphore visuelle, à l’instar de celle du château fort dans le tome précédent. Cette fois-ci, il s’agit d’une sirène représentée sur un tableau qui se trouve dans un restaurant japonais, spécialisé dans les teriyakis. Le lecteur la découvre pour la première fois sur la couverture : une jeune sirène accorte dont la tête a les traits de Cathy, la jeune femme que Jean fréquente depuis un an, et, sur sa queue, un jeune enfant, celui que Félix a adopté, né du précédent de lit de sa compagne, et dont il laisse la charge à Jean. Au-delà des personnages de la série, le message semble être que la femme exerce son pouvoir de séduction dans le but de transformer le mâle en père pour avoir un enfant. Néanmoins cette métaphore visuelle se fait plus polysémique que celle du château. Le lecteur comprend que Monsieur Jean est impressionné par le tableau du restaurant, et tout autant par l‘histoire que lui narre le propriétaire, à savoir un conte japonais… mais l’arrivée de Cathy l’interrompt et il ne finit pas son histoire. L’image de la sirène revient alors tarauder l’inconscient de Monsieur Jean, soit quand il se met à rêvasser, soit pendant son sommeil, s’incarnant avec le visage de femmes différentes, dans des circonstances en lien direct avec les expériences du jour du rêveur. Dans le même temps, cette silhouette de femme couchée aux jambes masquées revient sous une autre forme, dans une autre histoire relative à un autre tableau. Ainsi les dessinateurs tissent un lien entre ces différentes parties du récit, par le biais de variations d’un motif visuel.
Le lecteur remarque également que pour la première fois ce tome n’est pas découpé chapitres, chacun avec leur titre, mais forme une unité. À une ou deux reprises, il éprouve une sensation de transition un peu maladroite, comme si les scénaristes avaient construit leur récit avec plusieurs développements emboîtés à posteriori. Le lecteur oublie vite cette sensation, car la thématique de fond et le déroulement chronologique assurent une continuité narrative. Il s’agit à la fois de l’évolution de la relation entre Cathy et Monsieur Jean, à la fois de la manière dont le petit Eugène est pris en charge par des adultes, sans oublier les tensions dans le couple de Véronique & Jacques, ou encore de la tentative de séduction de Pierre-Yves, du mariage de Virginie & Laurent, et même de la solitude de madame Poulbot. Le dispositif est simple et efficace : Monsieur Jean est le témoin direct des difficultés de couple. Véronique & Jacques font face à une frustration insidieuse parce qu’ils ne trouvent plus de temps ensemble parce qu’ils doivent s’occuper de leurs jumeaux qui deviennent donc une charge. Virginie & Laurent se marient ensemble pour la deuxième fois, mais des tensions subsistent à commencer par la jalousie de Laurent. Jean se retrouve à prendre en charge l’enfant Eugène, parce que Félix le délaisse, oubliant d’aller le chercher à l’école, n’étant pas là pour son anniversaire alors qu’il devait en animer la fête. Sans oublier Marion qui est mariée et qui essaye de de se retrouver dans les bras de Jean. Avec tout ça, l’histoire sur le trafic de tableaux devient quasiment superflue. Ainsi Monsieur Jean a tous les mauvais exemples devant lui, toutes les raisons de continuer à éviter de s’engager.
Le lecteur savoure le fait que la narration des auteurs se bonifient avec les albums qui passent. Peut-être que la narration visuelle progresse plus rapidement que la construction proprement dite du récit, avec une esthétique de plus en plus personnelle, de plus en plus élégante et expressive. Pour autant, le passage d’une succession de scénettes à un récit à la taille d’un album fonctionne majoritairement bien, ainsi que la métaphore visuelle de la sirène. Le temps passe inexorablement pour tout le monde, y compris pour Monsieur Jean qui doit faire face au constat que prendre une décision ou ne pas le faire, c’est toujours choisir, et que le temps fuit.
-
Ce tome fait suite à Monsieur Jean, tome 3 : Les femmes et les enfants d'abord (1994) qu’il vaut mieux avoir lu avant. Dans la réédition en intégrale, l’éditeur a inséré le tome hors-série Monsieur Jean - HS 2 : La théorie des gens seuls (2000) entre les tomes 3 et 4 dans la mesure ou les histoires correspondantes se déroulent entre les deux, même s’il est paru après le tome 4. La première édition du présent tome date de 1998. Les deux auteurs, Philippe Dupuy et Charles Berberian, ont écrit le scénario à quatre mains et dessiné les planches à quatre mains. La mise en couleurs a été réalisée par Isabelle Busschaert. L’album compte cinquante-quatre planches.
Dans l’appartement de Monsieur Jean, la fête bat son plein : la marmaille s’agite en tous sens, pour l’anniversaire d’Eugène, trois ou quatre ans, un vrai carnage. Jean regarde d’un air effaré les verres renversés par terre, les bibelots en train de chuter, un enfant aux doigts sales maculant son fauteuil, un autre jouant avec les allumettes pour allumer les bougies, deux autres en train de se battre pour un robot en plastique. Il intervient pour les séparer, confisque le jouet objet de discorde et le place sur une étagère en hauteur ce qui déclenche une crise de larmes chez les deux. Monsieur Jean leur tourne le dos et s’éloigne estimant l’affaire réglée. Cathy intervient prend le robot sur l’étagère et fait mine de parler à sa place pour s’adresser aux enfants. Faisant mine d’être Globultor, elle leur indique qu’il est le gardien des verres vides et des assiettes salles, qu’il voit que son trésor est éparpillé partout dans l’univers, et il leur demande de l’aider à le rassembler ici sur la table. Du coin de l’œil, Jean a vu des enfants jouer dans la pièce qui lui sert de bureau. Il découvre deux enfants en train de gribouiller sur les pages du manuscrit de son prochain livre. Il les sort de là et il se plaint à Cathy qui lui répond qu’il devrait plutôt travailler sur ordinateur et que les dessins sont plutôt pas mal.
Monsieur Jean s’isole dans son bureau et passe un coup de fil à son ami Clément qui lui propose de sortir le soir même. Pendant ce temps-là, Cathy prend en charge le déroulement de la fête d’anniversaire, toute seule. Elle va répondre au coup de sonnette : c’est Jacques qui débarque avec ses jumeaux. Il lui explique qu’il vient de se disputer avec son épouse Véronique, qu’ils ont besoin d’un peu de temps tout seuls, qu’il lui laisse les jumeaux. Elle accepte gentiment. Dans son bureau, Jean continue de papoter tranquille, pendant que la fête bat son plein dans le salon. Cathy entre dans le bureau avec air courroucé. Elle lui explique qu’elle en a assez, assez d’être la bonne poire qui rapplique quand on a besoin d’elle, tout ça parce que les enfants, monsieur, ça lui prend la tête. Parfois, elle a vraiment l’impression de le déranger. Ça fait un an qu’’ils sont ensemble et elle a l’impression qu’il s’investit à reculons. La vérité, c’est que ça lui fait peur de s’impliquer, de remettre en question son petit confort de célibataire. Elle lui dit au revoir et le laisse avec les enfants.
Au fur et à mesure des album, monsieur Jean grandit lentement mais inexorablement, poussé vers les responsabilités, confronté à des adultes, à leurs choix, à ses propres non-choix qui finalement se révèlent en être. Comme Cathy lui fait observer, il ne souhaite pas remettre en cause son petit confort de célibataire, et elle en a marre d’attendre qu’il se décide. Elle décide de s’éloigner quelques temps, profitant d’un voyage professionnel à New York : il aura ainsi tout le temps de réfléchir et de se décider, à moins que ce soit la vie qui le fasse pour lui. Le début s’avère brutal : Monsieur Jean confronté à la sauvagerie déchaînée de petits enfants hors de contrôle. Le chaos est libéré dans son petit appartement parisien, et il ne dispose d’aucun moyen pour le maîtriser, ni même pour l’endiguer. Les artistes s’amusent bien à faire s’alterner une case avec ces petits enfants sans retenue aucune, et la tête de Monsieur Jean abasourdi par ce qu’il contemple. Par comparaison, les gestes de Cathy sont calmes et posés, ses postures sont assurées et calment les enfants, en totale opposition avec le dégoût qui habite Jean. Lorsque ce dernier se rend compte que Jacques a laissé ses jumeaux, il est encore plus atterré, ne comprenant même pas comment ces enfants ont pu arriver là, totalement désemparé face à Véronique qui vient les chercher. De son côté, elle semble résignée et même quelque peu accablée par les tensions entre elle et son époux, avec une larme coulant sur sa joue, et cherchant un peu de réconfort sur l’épaule de Jean. Avec des images toutes simples, les dessinateurs savent faire passer la détresse qui l’habite.
Avec cette approche esthétique qui n’appartient qu’à eux, Dupuy & Berberian simplifient les silhouettes tout en leur donnant une réelle élégance, donnent un appendice nasal appartenant au registre gros nez aux hommes, des nez très fins et un peu pointus aux femmes. Ils jouent également sur les simplifications et les exagérations des visages pour les rendre plus expressifs : les yeux en forme de billes de loto pour l’effarement de Monsieur Jean devant les enfants déchaînés, les bouches très grandes ouvertes des enfants jusqu’à en voir la luette quand ils braillent en s’époumonant, les traits secs pour les yeux et la bouche quand Cathy est de mauvaise humeur, la bouche en croissant de Félix pour souligner sa bonne humeur insouciante, le visage très aplati de Mme Poulbot et son air satisfait, la bouche en fer à cheval de Clément pour montrer son dégout, les yeux mi-clos de Pierre-Yves, etc. Le langage corporel des personnages s’avère tout aussi parlant : Cathy qui claque une porte, Monsieur Jean étendu très détendu alors que la fête enfantine bat son plein de l’autre côté de la porte, Félix avec les épaules tombantes alors que Jean lui démontre l’inanité de son plan pour se refaire, Eugène se débattant dans la baignoire parce que du shampoing lui coule dans les yeux, Marion et ses postures attentives vis-à-vis de Jean, Pierre-Yves dans des postures pleines d’assurance pour mettre en valeur son corps bien découplé.
Les artistes ont également repris l’idée d’une métaphore visuelle, à l’instar de celle du château fort dans le tome précédent. Cette fois-ci, il s’agit d’une sirène représentée sur un tableau qui se trouve dans un restaurant japonais, spécialisé dans les teriyakis. Le lecteur la découvre pour la première fois sur la couverture : une jeune sirène accorte dont la tête a les traits de Cathy, la jeune femme que Jean fréquente depuis un an, et, sur sa queue, un jeune enfant, celui que Félix a adopté, né du précédent de lit de sa compagne, et dont il laisse la charge à Jean. Au-delà des personnages de la série, le message semble être que la femme exerce son pouvoir de séduction dans le but de transformer le mâle en père pour avoir un enfant. Néanmoins cette métaphore visuelle se fait plus polysémique que celle du château. Le lecteur comprend que Monsieur Jean est impressionné par le tableau du restaurant, et tout autant par l‘histoire que lui narre le propriétaire, à savoir un conte japonais… mais l’arrivée de Cathy l’interrompt et il ne finit pas son histoire. L’image de la sirène revient alors tarauder l’inconscient de Monsieur Jean, soit quand il se met à rêvasser, soit pendant son sommeil, s’incarnant avec le visage de femmes différentes, dans des circonstances en lien direct avec les expériences du jour du rêveur. Dans le même temps, cette silhouette de femme couchée aux jambes masquées revient sous une autre forme, dans une autre histoire relative à un autre tableau. Ainsi les dessinateurs tissent un lien entre ces différentes parties du récit, par le biais de variations d’un motif visuel.
Le lecteur remarque également que pour la première fois ce tome n’est pas découpé chapitres, chacun avec leur titre, mais forme une unité. À une ou deux reprises, il éprouve une sensation de transition un peu maladroite, comme si les scénaristes avaient construit leur récit avec plusieurs développements emboîtés à posteriori. Le lecteur oublie vite cette sensation, car la thématique de fond et le déroulement chronologique assurent une continuité narrative. Il s’agit à la fois de l’évolution de la relation entre Cathy et Monsieur Jean, à la fois de la manière dont le petit Eugène est pris en charge par des adultes, sans oublier les tensions dans le couple de Véronique & Jacques, ou encore de la tentative de séduction de Pierre-Yves, du mariage de Virginie & Laurent, et même de la solitude de madame Poulbot. Le dispositif est simple et efficace : Monsieur Jean est le témoin direct des difficultés de couple. Véronique & Jacques font face à une frustration insidieuse parce qu’ils ne trouvent plus de temps ensemble parce qu’ils doivent s’occuper de leurs jumeaux qui deviennent donc une charge. Virginie & Laurent se marient ensemble pour la deuxième fois, mais des tensions subsistent à commencer par la jalousie de Laurent. Jean se retrouve à prendre en charge l’enfant Eugène, parce que Félix le délaisse, oubliant d’aller le chercher à l’école, n’étant pas là pour son anniversaire alors qu’il devait en animer la fête. Sans oublier Marion qui est mariée et qui essaye de de se retrouver dans les bras de Jean. Avec tout ça, l’histoire sur le trafic de tableaux devient quasiment superflue. Ainsi Monsieur Jean a tous les mauvais exemples devant lui, toutes les raisons de continuer à éviter de s’engager.
Le lecteur savoure le fait que la narration des auteurs se bonifient avec les albums qui passent. Peut-être que la narration visuelle progresse plus rapidement que la construction proprement dite du récit, avec une esthétique de plus en plus personnelle, de plus en plus élégante et expressive. Pour autant, le passage d’une succession de scénettes à un récit à la taille d’un album fonctionne majoritairement bien, ainsi que la métaphore visuelle de la sirène. Le temps passe inexorablement pour tout le monde, y compris pour Monsieur Jean qui doit faire face au constat que prendre une décision ou ne pas le faire, c’est toujours choisir, et que le temps fuit.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Philippe Dupuy
Quiz
Voir plus
Paris en poésie
Guillaume Apollinaire - "Le pont ..."
Mirabeau
Louis-Philippe
des Arts
10 questions
145 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poésie française
, Paris (France)Créer un quiz sur cet auteur145 lecteurs ont répondu