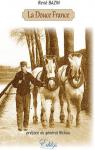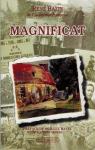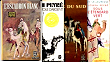Critiques de René Bazin (49)
Cette première découverte de René Bazin m'a tellement emballée que je me suis empressée d'en commencer un deuxième.
Il y a d'abord cette écriture somptueuse, pas encore moderne mais plus tout à fait 19ème, qui fait le charme des beaux romans du début du dernier siècle.
Il y a ensuite ce climat dur de campagne miséreuse, qui pose un décor puissant à l'intrigue, tragique : le couple Louarn survit avec difficulté avec ses trois enfants dans leur ferme qui peine à nourrir la famille, malgré le travail harassant du père. Voilà que la mère, Donatienne, à qui sa famille a reproché de s'être mariée en dessous de ses ambitions, sent de nouveau pulser en elle l'énergie de sa jeune vie quand arrive de Paris une réponse favorable à son offre de faire la nourrice pour ramener un peu d'argent.
Donatienne partie, Jean reste seul à la ferme avec les enfants, et l'attend. Il travaille avec plus de vigueur encore, mais les dettes continuent de s'accumuler. Donatienne ne revient pas...
Coup de coeur de l'été pour ce roman social qui, bien qu'assez manichéen dans l'approche morale de son sujet, met en scène deux personnages fortement incarnés, autant dans l'attachement du père à ses valeurs de responsabilité familiale et de labeur que dans la complexité des aspirations et revirements de Donatienne.
Il y a d'abord cette écriture somptueuse, pas encore moderne mais plus tout à fait 19ème, qui fait le charme des beaux romans du début du dernier siècle.
Il y a ensuite ce climat dur de campagne miséreuse, qui pose un décor puissant à l'intrigue, tragique : le couple Louarn survit avec difficulté avec ses trois enfants dans leur ferme qui peine à nourrir la famille, malgré le travail harassant du père. Voilà que la mère, Donatienne, à qui sa famille a reproché de s'être mariée en dessous de ses ambitions, sent de nouveau pulser en elle l'énergie de sa jeune vie quand arrive de Paris une réponse favorable à son offre de faire la nourrice pour ramener un peu d'argent.
Donatienne partie, Jean reste seul à la ferme avec les enfants, et l'attend. Il travaille avec plus de vigueur encore, mais les dettes continuent de s'accumuler. Donatienne ne revient pas...
Coup de coeur de l'été pour ce roman social qui, bien qu'assez manichéen dans l'approche morale de son sujet, met en scène deux personnages fortement incarnés, autant dans l'attachement du père à ses valeurs de responsabilité familiale et de labeur que dans la complexité des aspirations et revirements de Donatienne.
« La Terre Qui Meurt » est indéniablement un chef d’œuvre, d’abord de par une intrigue quasiment shakespearienne, d’un académisme flamboyant, qui se trouve transposée avec un étonnant réalisme dans un terroir vendéen. Les personnages y sont forts, intenses, crédibles, et nous parlent encore bien des années plus tard.
C’est aussi le récit d’une terre qui meurt de sa belle mort, à l’image de Mathurin, l’enfant du terroir aussi handicapé que sa ruralité d’un autre âge, qui meurt d’avoir couru après un rêve impossible. Bazin célèbre la paysannerie, mais ne s’illusionne pas sur la fin effective d’une certaine ruralité française somme tout assez égoïste, très centrée sur elle-même et trop préoccupée de son image et de sa postérité. On se serait attendu à une œuvre plus militante, mais il faut croire que le maréchal Pétain lui-même n’a rien compris à ce livre. En effet, il n’est pas question ici d’un retour à la terre, mais du désespoir d’en vivre et de la difficulté même d’y survivre. René Bazin ne juge pas ses personnages, auxquels il trouve à tous d’assez tendres circonstances atténuantes. Il se contente de faire le constat d’un monde en mutation, tout en attribuant la principale responsabilité de cette mutation à la terre elle-même, à laquelle on a peut-être trop demandé et trop longtemps.
Au-delà de sa narration, « La Terre Qui Meurt » est surtout une merveilleuse évocation d’une paysannerie aujourd’hui révolue, qui vivait en autarcie fusionnelle avec la nature. René Bazin déploie d’ailleurs sa plus belle plume pour décrire la nature environnante, dans ce qu’elle a de plus magnifique. Ce roman n’est pas seulement une histoire, c’est aussi une peinture, celle d’un village, d’une ferme, d’une région que l’auteur décrit avec joliesse et poésie.
Avec le temps « La Terre Qui Meurt » est devenu un roman emblématique de la Vendée, ce qui lui a plutôt nui qu’autre chose, car le roman ne porte pas forcément les valeurs de son auteur ou de cette région. L’action ou les personnages auraient pu être transposés dans n’importe quelle autre campagne rurale de France. Le roman plaide même pour l’acceptation soumise à ce que les générations se succèdent sans forcément se ressembler. Ni progressiste ni réactionnaire militant, ce roman ne se veut rien d’autre que le constat d’un inéluctable changement d’époque, et des extrêmes difficultés de ceux qui le traversent, tant les vieillards qui s’accrochent à leurs valeurs traditionnelles que les jeunes gens qui aspirent à d’autres modes de vie. Sur ce plan-là, c’est un roman universel, sans réel message politique, âpre et réaliste comme la vie rurale elle-même, parfois nostalgique et attendri comme nous le sommes tous un peu…
Lien : https://mortefontaine.wordpr..
C’est aussi le récit d’une terre qui meurt de sa belle mort, à l’image de Mathurin, l’enfant du terroir aussi handicapé que sa ruralité d’un autre âge, qui meurt d’avoir couru après un rêve impossible. Bazin célèbre la paysannerie, mais ne s’illusionne pas sur la fin effective d’une certaine ruralité française somme tout assez égoïste, très centrée sur elle-même et trop préoccupée de son image et de sa postérité. On se serait attendu à une œuvre plus militante, mais il faut croire que le maréchal Pétain lui-même n’a rien compris à ce livre. En effet, il n’est pas question ici d’un retour à la terre, mais du désespoir d’en vivre et de la difficulté même d’y survivre. René Bazin ne juge pas ses personnages, auxquels il trouve à tous d’assez tendres circonstances atténuantes. Il se contente de faire le constat d’un monde en mutation, tout en attribuant la principale responsabilité de cette mutation à la terre elle-même, à laquelle on a peut-être trop demandé et trop longtemps.
Au-delà de sa narration, « La Terre Qui Meurt » est surtout une merveilleuse évocation d’une paysannerie aujourd’hui révolue, qui vivait en autarcie fusionnelle avec la nature. René Bazin déploie d’ailleurs sa plus belle plume pour décrire la nature environnante, dans ce qu’elle a de plus magnifique. Ce roman n’est pas seulement une histoire, c’est aussi une peinture, celle d’un village, d’une ferme, d’une région que l’auteur décrit avec joliesse et poésie.
Avec le temps « La Terre Qui Meurt » est devenu un roman emblématique de la Vendée, ce qui lui a plutôt nui qu’autre chose, car le roman ne porte pas forcément les valeurs de son auteur ou de cette région. L’action ou les personnages auraient pu être transposés dans n’importe quelle autre campagne rurale de France. Le roman plaide même pour l’acceptation soumise à ce que les générations se succèdent sans forcément se ressembler. Ni progressiste ni réactionnaire militant, ce roman ne se veut rien d’autre que le constat d’un inéluctable changement d’époque, et des extrêmes difficultés de ceux qui le traversent, tant les vieillards qui s’accrochent à leurs valeurs traditionnelles que les jeunes gens qui aspirent à d’autres modes de vie. Sur ce plan-là, c’est un roman universel, sans réel message politique, âpre et réaliste comme la vie rurale elle-même, parfois nostalgique et attendri comme nous le sommes tous un peu…
Lien : https://mortefontaine.wordpr..
Un livre qui commençait bien, dans le milieu ouvrier de la fin du XIXème siècle à Nantes. Un livre qui commençait comme un gentil roman de terroir. Dommage qu’il vire un peu trop à la bondieuserie et à la belle et noble charité impossible à être critiquée ou même seulement questionnée.
Cela reste cependant une lecture agréable et facile. Un style classique avec des phrases amples qui confinent parfois au pédantisme. Il était temps, au bout d’à peine trois-cents courtes pages, que le livre s’arrête avant de tomber trop profondément dans la mièvrerie.
Cela reste cependant une lecture agréable et facile. Un style classique avec des phrases amples qui confinent parfois au pédantisme. Il était temps, au bout d’à peine trois-cents courtes pages, que le livre s’arrête avant de tomber trop profondément dans la mièvrerie.
Au début de l'autre siècle, en Bretagne, la closerie de Ros Grignon est tenue par un jeune couple composé de Jean Louarn et de son épouse Donatienne. Ils vivent chichement sur cette petite ferme de quatre hectares, ne ménagent ni leur temps ni leur peine mais connaissent pourtant la misère et les fins de mois difficile. Donatienne vient juste d'accoucher de son troisième enfant quand arrive une lettre de Paris lui proposant une place de nourrice chez un médecin aisé. La mort dans l'âme, la jeune femme accepte de quitter enfants et mari dans l'espoir d'améliorer par son sacrifice le sort de sa famille. Jean doit embaucher une petite servante pour s'occuper des enfants et travailler deux fois plus sur des terres dont il n'arrive pas à payer la location. Quatre mois passent. Aucune nouvelle de Donatienne. Aucun argent n'arrive. Les dettes s'accumulant, un huissier vient saisir les biens de la famille. Il ne reste plus d'autre solution à Jean que de partir sur les routes avec les deux petits dans une charrette et l'aînée à ses côtés pour aller louer ses bras ici et là sans savoir s'il pourra retrouver sa femme un jour.
Un très beau roman de terroir plein de tendresse et d'humanité comme on n'en écrit plus de nos jours. Une tragédie de la pauvreté à une époque où la Bretagne était une des régions les plus pauvres de France, où les femmes venaient se louer comme nourrices dans la capitale et où les hommes émigraient vers des provinces moins pauvres dans l'espoir d'y trouver un peu de travail. Les personnages de Donatienne et de Jean sont attachants. Le lecteur découvrira que même si la pauvre Bretonne s'est laissée griser par les sortilèges d'une vie plus douce et plus facile et même si Jean s'est retrouvé dans la peau d'une sorte de « père courage », tous deux ne sont en fait que d'innocentes victimes d'un sort contraire, de la pauvreté et de l'injustice sociale. René Bazin montre dans ce livre des accents humanistes dignes d'un Emile Zola ou d'un Victor Hugo. Une écriture claire, limpide, particulièrement agréable. Un livre qui n'a pas pris une seule ride. A conseiller aux fans d'Anglade, Bordes, Michelet et autres Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Un très beau roman de terroir plein de tendresse et d'humanité comme on n'en écrit plus de nos jours. Une tragédie de la pauvreté à une époque où la Bretagne était une des régions les plus pauvres de France, où les femmes venaient se louer comme nourrices dans la capitale et où les hommes émigraient vers des provinces moins pauvres dans l'espoir d'y trouver un peu de travail. Les personnages de Donatienne et de Jean sont attachants. Le lecteur découvrira que même si la pauvre Bretonne s'est laissée griser par les sortilèges d'une vie plus douce et plus facile et même si Jean s'est retrouvé dans la peau d'une sorte de « père courage », tous deux ne sont en fait que d'innocentes victimes d'un sort contraire, de la pauvreté et de l'injustice sociale. René Bazin montre dans ce livre des accents humanistes dignes d'un Emile Zola ou d'un Victor Hugo. Une écriture claire, limpide, particulièrement agréable. Un livre qui n'a pas pris une seule ride. A conseiller aux fans d'Anglade, Bordes, Michelet et autres Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Un livre d'hier (1913) qui a le mérite de nous faire découvrir la vie en Alsace pendant son annexion par l'Allemagne durant 38 ans. Cette histoire familiale fait revivre les tensions et des différents au sein d'une même famille et de la population avec intensité et émotion.
L'intérêt de ce journal est de témoigner de ce que fut la réaction d'un intellectuel catholique à la guerre et d'en suivre l'évolution.
Ce livre de René Bazin a été publié en l'année 1901. L'Alsace était annexée depuis trente ans; près de Strasbourg, dans leur village d'Alsheim, la famille Oberlé va se diviser, se déchirer: le père, exploitant forestier, vendra son bois aux Allemands. Comment vivre autrement, si les commandes ne viennent plus de France ? La fille, née après la défaite, n'aura connu que la nouvelle situation: elle ne verra pas de mal à se fiancer avec un officier teuton. Par contre, le grand-père - non loin du trépas -, la mère et le fils resteront intransigeants: ne rien lâcher, ne rien céder aux vainqueurs, aux oppresseurs.
Ce contexte cornélien et les dilemmes qui l'accompagnent nous sont décrits dans une langue parfaite, avec une précision absolue et une intensité dramatique croissante: nous sommes là en présence de la grande littérature. "Je suis l'Alsace", dit Jean, le fils, organisant sa désertion. En lisant ce livre, nous sommes avec lui dans ce village Alsacien, dans cette maison familiale au charme perdu, dans les forêts des Vosges, et dans les rues de Strasbourg. Nous prenons conscience du drame qui s'est déroulé là-bas entre les années 1870 et 1918, et nous accompagnons les Oberlé dans leurs déchirements.
Ce petit livre est un grand livre. Il ne faut surtout pas oublier cet auteur - que reste-t'il de son succès d'hier? - , homme de l'ouest tranquille qui a si bien su se transposer, un temps, dans l'est de la France opprimé.
Ce contexte cornélien et les dilemmes qui l'accompagnent nous sont décrits dans une langue parfaite, avec une précision absolue et une intensité dramatique croissante: nous sommes là en présence de la grande littérature. "Je suis l'Alsace", dit Jean, le fils, organisant sa désertion. En lisant ce livre, nous sommes avec lui dans ce village Alsacien, dans cette maison familiale au charme perdu, dans les forêts des Vosges, et dans les rues de Strasbourg. Nous prenons conscience du drame qui s'est déroulé là-bas entre les années 1870 et 1918, et nous accompagnons les Oberlé dans leurs déchirements.
Ce petit livre est un grand livre. Il ne faut surtout pas oublier cet auteur - que reste-t'il de son succès d'hier? - , homme de l'ouest tranquille qui a si bien su se transposer, un temps, dans l'est de la France opprimé.
De Saint Paul à Saint François d'Assise en passant par Saint Augustin, les vies de saint racontent souvent la même histoire : une jeunesse impie, une conversion et une vie exemplaire. le bienheureux Charles de Foucauld a d'abord été militaire, élève de Saint-Cyr (dans la même promo que Pétain), puis explorateur au Maroc, incroyant ; il est devenu moine trappiste sur le tard, dans une extrême contrition. Il était attiré par une solitude et une mortification que n'assouvissait pas la vie monacale. On peut dire qu'il est donc retourné aux sources de l'érémitisme chrétien: la vie dans le désert.
L'Eglise se méfie de ces extrêmes humilités qui peuvent cacher un grand orgueil, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais Charles de Foucauld s'est toujours soumis à sa hiérarchie et c'est selon la volonté de l'Eglise et dans un contexte très particulier qu'il est parti, hors de toute communauté, littéralement prêcher dans le désert. de bonnes intentions, il n'en manquait pas, il a racheté avec ses pauvres moyens quelques esclaves, il a tenté quelques douces conversions par l'exemple sans beaucoup de résultat ; l'Afrique du Nord était toujours hermétique au christianisme, malgré la présence française en Algérie depuis 1830. Il écrit en 1905 : « Au Maroc, grand comme la France, avec dix millions d'habitants, pas un seul prêtre à l'intérieur ; au Sahara, sept ou huit fois grand comme la France et bien plus peuplé qu'on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires ! Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci… ».
On peut accuser les Français de tous les maux en Afrique du Nord, mais certainement pas d'avoir fait du prosélytisme religieux, et si aucun effort n'avait été fait jusqu'en 1905, tout esprit sensé pouvait juger que rien ne serait jamais fait de ce côté-là. Charles de Foucauld était une exception, il croyait dur comme fer à la mission civilisatrice de la France : « Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons, au lieu d'exploiter, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc seront, dans cinquante ans, un prolongement de la France. Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l'union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. »
Cependant, il se faisait peu d'illusions sur la conversion des Arabes musulmans, au contraire il voyait leur influence s'accroître. C'est plutôt sur les antiques Berbères, dont la foi lui paraissait plus superficielle, qu'il comptait s'appuyer pour introduire le christianisme. Il part donc s'installer à Tamanrasset, un village de « vingt feux », deux trois maisons et quelques tentes, en plein milieu des territoires touareg du Hoggar, seul. Dans cette solitude, son action ne pouvait se limiter qu'à la simple présence et l'exemple d'une vie humble et charitable. René Bazin évoque des rumeurs selon lesquelles le Père de Foucauld aurait poussé la tolérance de l'Islam jusqu'à réciter des versets du Coran lors de funérailles, il le nie, mais il rapporte aussi le témoignage d'un certain docteur Hérisson qui a vu Charles de Foucauld encourager quelques musulmans tièdes à faire leur prière. Voilà où il en était, à essayer de rendre ces nomades sédentaires, à leur apprendre à récolter la nourriture, la laine et à ne pas perdre tout lien avec la religion, quelle qu'elle soit. La base : se rendre acceptable par ses bienfaits. Et aussi préparer la voie aux futurs missionnaires en étudiant la langue et la culture. Il a écrit un dictionnaire et traduit des poésies.
Avec tout ce qu'il s'est passé en un siècle, on rêve beaucoup sur ce qu'aurait pu devenir l'Afrique du Nord, si les conseils du Père de Foucauld avaient été suivis et sans quelques évènements. Il ne s'agit pas tellement de la loi sur la laïcité, que René Bazin semble déplorer. Elle n'a certainement pas favorisée les missionnaires, mais s'il n'y en avait que cinquante-six en 1910, ce n'était pas la faute à cette loi, c'est qu'il n'y avait jamais eu une réelle volonté de christianiser ces colonies avant. C'est toujours l'exploitation économique qui avait primée, comme le regrettait Charles de Foucauld. Par contre, il y a les guerres européennes et l'Allemagne dépourvue d'empire colonial, qui ont certainement jouées un grand rôle dans le processus de décolonisation, à commencer par la mort du Père de Foucauld.
L'Eglise se méfie de ces extrêmes humilités qui peuvent cacher un grand orgueil, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais Charles de Foucauld s'est toujours soumis à sa hiérarchie et c'est selon la volonté de l'Eglise et dans un contexte très particulier qu'il est parti, hors de toute communauté, littéralement prêcher dans le désert. de bonnes intentions, il n'en manquait pas, il a racheté avec ses pauvres moyens quelques esclaves, il a tenté quelques douces conversions par l'exemple sans beaucoup de résultat ; l'Afrique du Nord était toujours hermétique au christianisme, malgré la présence française en Algérie depuis 1830. Il écrit en 1905 : « Au Maroc, grand comme la France, avec dix millions d'habitants, pas un seul prêtre à l'intérieur ; au Sahara, sept ou huit fois grand comme la France et bien plus peuplé qu'on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires ! Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci… ».
On peut accuser les Français de tous les maux en Afrique du Nord, mais certainement pas d'avoir fait du prosélytisme religieux, et si aucun effort n'avait été fait jusqu'en 1905, tout esprit sensé pouvait juger que rien ne serait jamais fait de ce côté-là. Charles de Foucauld était une exception, il croyait dur comme fer à la mission civilisatrice de la France : « Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons, au lieu d'exploiter, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc seront, dans cinquante ans, un prolongement de la France. Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l'union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. »
Cependant, il se faisait peu d'illusions sur la conversion des Arabes musulmans, au contraire il voyait leur influence s'accroître. C'est plutôt sur les antiques Berbères, dont la foi lui paraissait plus superficielle, qu'il comptait s'appuyer pour introduire le christianisme. Il part donc s'installer à Tamanrasset, un village de « vingt feux », deux trois maisons et quelques tentes, en plein milieu des territoires touareg du Hoggar, seul. Dans cette solitude, son action ne pouvait se limiter qu'à la simple présence et l'exemple d'une vie humble et charitable. René Bazin évoque des rumeurs selon lesquelles le Père de Foucauld aurait poussé la tolérance de l'Islam jusqu'à réciter des versets du Coran lors de funérailles, il le nie, mais il rapporte aussi le témoignage d'un certain docteur Hérisson qui a vu Charles de Foucauld encourager quelques musulmans tièdes à faire leur prière. Voilà où il en était, à essayer de rendre ces nomades sédentaires, à leur apprendre à récolter la nourriture, la laine et à ne pas perdre tout lien avec la religion, quelle qu'elle soit. La base : se rendre acceptable par ses bienfaits. Et aussi préparer la voie aux futurs missionnaires en étudiant la langue et la culture. Il a écrit un dictionnaire et traduit des poésies.
Avec tout ce qu'il s'est passé en un siècle, on rêve beaucoup sur ce qu'aurait pu devenir l'Afrique du Nord, si les conseils du Père de Foucauld avaient été suivis et sans quelques évènements. Il ne s'agit pas tellement de la loi sur la laïcité, que René Bazin semble déplorer. Elle n'a certainement pas favorisée les missionnaires, mais s'il n'y en avait que cinquante-six en 1910, ce n'était pas la faute à cette loi, c'est qu'il n'y avait jamais eu une réelle volonté de christianiser ces colonies avant. C'est toujours l'exploitation économique qui avait primée, comme le regrettait Charles de Foucauld. Par contre, il y a les guerres européennes et l'Allemagne dépourvue d'empire colonial, qui ont certainement jouées un grand rôle dans le processus de décolonisation, à commencer par la mort du Père de Foucauld.
Ecrit juste avant le Premier conflit mondial – et revu en 1928, lors de sa reparution –, ce texte à destination des « écoliers de France » exalte précisément la France, depuis ses métiers, quelques grandes figures, ses fêtes religieuses jusqu’à ses conquêtes et ses batailles dans les contrées lointaines d’Amérique, d’Afrique et d’Extrême-Orient.
Certes, à notre époque, on peut être décontenancé par ce ton déclamatoire et très chrétien, mais il faut replacer ledit texte dans son contexte, c’est-à-dire à une époque où l’amour de sa patrie n’était pas aussi suspect que de nos jours.
Toutefois, des phrases sonnent étrangement juste. Comment, par exemple, à la lumière de la désertification de nos campagnes, ne pas adhérer à ce compliment adressé au facteur : « Il y aurait sans vous, dans le monde, moins de fraternité » ?
Oui, Jeanne d’Arc et Jean-François Millet y sont encensés pour leur ferveur religieuse, Pâques, où l’on doit avoir « l’âme fleurie, comme les genêts », est aussi vanté, comme le christianisme en général, mais en ce temps-là on ne niait pas nos origines.
Oui, encore, on peut s’étonner de lire autant d’incitations au sacrifice de sa vie pour son pays à destination d’enfants – affirmant que « c’est au cœur des jeunes que les idées héroïques germent le plus vite » –, mais il est des phrases qui résonnent encore aujourd’hui avec force et qu’il faudrait rétablir dans les écoles : « L’habitude de penser à la France est un secours humain qui a soutenu beaucoup de bons Français, même en dehors des champs de bataille, aux heures de lassitude, dans l’épreuve exceptionnelle ou commune. »
René Bazin aime charnellement la France et entend le faire savoir aux plus jeunes, tantôt solennellement, tantôt joyeusement en faisant danser les fuseaux des dentelières : « Votre bruit est aussi plein de promesses que le bruit des moulins. »
Et puis il y a la France glorieuse, que l’auteur met en avant – dans l’attente, sans doute, d’un conflit avec l’Allemagne qui se précise de plus en plus à l’époque –, citant ces exemples de soldats valeureux du Sahara ou de Pékin – pendant la révolte des Boxers, qui étaient cependant légitimes à vouloir chasser les colons de chez eux. Car, se dirait le plus retors des lecteurs, peut-on, dans le même livre, défendre Jeanne chassant les Anglais et ne pas comprendre que d’autres l’imitent, même si c’est à nos dépens ?
Ce qui n’interdit pas de tordre le cou à certaines idées reçues, une note rappelant que la France ne s’est pas invitée en Algérie pour le seul plaisir de conquérir un territoire : « C’est en 1830 que Charles X prit la décision d’éradiquer à sa source le problème des pirates barbaresques qui désolaient les rivages de la Méditerranée, par la conquête de l’Algérie. »
Bazin réclame par ailleurs à cor et à cri le retour de l’Alsace-Lorraine – alors allemande – dans le giron national. Une Alsace-Lorraine dont l’auteur chante le sentiment français et « qui n’a de révolté que son idéal ; qui demande la liberté d’aimer ce que nous aimons, et de se souvenir de nous ». Lors de la réédition de La Douce France, il se félicitera du retour en France de ces « magnifiques » provinces, restées fidèles à la Mère-patrie, écrit-il.
Il y a aussi les regrets, ceux notamment d’avoir délaissé et perdu les territoires français d’Amérique (histoire narrée par Alain Dubos dans L’épopée américaine de la France: histoires de la Nouvelle-France).
C’était un autre temps, avant que l’Europe ne s’effondre, depuis les tranchées jusqu’aux plages du Débarquement, et se laisse ensuite diluer dans une mondialisation qui détruit les identités des peuples au profit d’une poignée de milliardaires. Et ce temps-là, si nous nous sentons assez français – quelle que soit la couleur de notre peau ou notre origine –, nous ne pouvons que le regretter.
Ce remarquable roman national mérite enfin d’être lu parce qu’il dit combien la France est grande, malgré ce que de vulgaires détracteurs, vivant à ses crochets, prétendent !
Certes, à notre époque, on peut être décontenancé par ce ton déclamatoire et très chrétien, mais il faut replacer ledit texte dans son contexte, c’est-à-dire à une époque où l’amour de sa patrie n’était pas aussi suspect que de nos jours.
Toutefois, des phrases sonnent étrangement juste. Comment, par exemple, à la lumière de la désertification de nos campagnes, ne pas adhérer à ce compliment adressé au facteur : « Il y aurait sans vous, dans le monde, moins de fraternité » ?
Oui, Jeanne d’Arc et Jean-François Millet y sont encensés pour leur ferveur religieuse, Pâques, où l’on doit avoir « l’âme fleurie, comme les genêts », est aussi vanté, comme le christianisme en général, mais en ce temps-là on ne niait pas nos origines.
Oui, encore, on peut s’étonner de lire autant d’incitations au sacrifice de sa vie pour son pays à destination d’enfants – affirmant que « c’est au cœur des jeunes que les idées héroïques germent le plus vite » –, mais il est des phrases qui résonnent encore aujourd’hui avec force et qu’il faudrait rétablir dans les écoles : « L’habitude de penser à la France est un secours humain qui a soutenu beaucoup de bons Français, même en dehors des champs de bataille, aux heures de lassitude, dans l’épreuve exceptionnelle ou commune. »
René Bazin aime charnellement la France et entend le faire savoir aux plus jeunes, tantôt solennellement, tantôt joyeusement en faisant danser les fuseaux des dentelières : « Votre bruit est aussi plein de promesses que le bruit des moulins. »
Et puis il y a la France glorieuse, que l’auteur met en avant – dans l’attente, sans doute, d’un conflit avec l’Allemagne qui se précise de plus en plus à l’époque –, citant ces exemples de soldats valeureux du Sahara ou de Pékin – pendant la révolte des Boxers, qui étaient cependant légitimes à vouloir chasser les colons de chez eux. Car, se dirait le plus retors des lecteurs, peut-on, dans le même livre, défendre Jeanne chassant les Anglais et ne pas comprendre que d’autres l’imitent, même si c’est à nos dépens ?
Ce qui n’interdit pas de tordre le cou à certaines idées reçues, une note rappelant que la France ne s’est pas invitée en Algérie pour le seul plaisir de conquérir un territoire : « C’est en 1830 que Charles X prit la décision d’éradiquer à sa source le problème des pirates barbaresques qui désolaient les rivages de la Méditerranée, par la conquête de l’Algérie. »
Bazin réclame par ailleurs à cor et à cri le retour de l’Alsace-Lorraine – alors allemande – dans le giron national. Une Alsace-Lorraine dont l’auteur chante le sentiment français et « qui n’a de révolté que son idéal ; qui demande la liberté d’aimer ce que nous aimons, et de se souvenir de nous ». Lors de la réédition de La Douce France, il se félicitera du retour en France de ces « magnifiques » provinces, restées fidèles à la Mère-patrie, écrit-il.
Il y a aussi les regrets, ceux notamment d’avoir délaissé et perdu les territoires français d’Amérique (histoire narrée par Alain Dubos dans L’épopée américaine de la France: histoires de la Nouvelle-France).
C’était un autre temps, avant que l’Europe ne s’effondre, depuis les tranchées jusqu’aux plages du Débarquement, et se laisse ensuite diluer dans une mondialisation qui détruit les identités des peuples au profit d’une poignée de milliardaires. Et ce temps-là, si nous nous sentons assez français – quelle que soit la couleur de notre peau ou notre origine –, nous ne pouvons que le regretter.
Ce remarquable roman national mérite enfin d’être lu parce qu’il dit combien la France est grande, malgré ce que de vulgaires détracteurs, vivant à ses crochets, prétendent !
En Nivernais, sur le domaine du général de Meximien, travaille une escouade de bûcherons sous la houlette bienveillante de son fils Michel. Mais en ce début de XXème siècle, la vie n'est facile pour personne. L'un des plus anciens bûcheron, Gilbert Cloquet, a fondé le premier syndicat d'ouvriers agricoles de la région. Mais de revendications en provocations, il s'est laissé déborder au point que les plus extrémistes l'ont évincé et commencent même à se retourner contre lui. De son côté, Michel va devoir quitter une propriété agricole qui est restée plus de quatre siècles dans sa famille. Son père veut s'en séparer pour pouvoir assurer le train de vie de son épouse qui ne peut vivre qu'à Paris et sur un certain pied.
Un roman paysan d'un auteur assez oublié, mais qu'il serait peut-être intéressant de découvrir ou redécouvrir ne serait-ce que pour prendre connaissance du tableau qu'il brosse de la fin d'un certain type de société rurale et de rapports humains passant de la soumission à la révolte dans les années précédents la Première Guerre Mondiale. L'Eglise a perdu toute influence, c'est tout juste si sept ou huit femmes assistent encore à la messe du dimanche. Le dernier aristocrate est un jeune homme philanthrope, idéaliste et souffreteux qui mourra sans descendance. Les ouvriers prennent conscience que l'union fait la force. Le lecteur assiste à la montée en puissance du mouvement syndical, lequel n'apparut pas sans violence ni injustice. Un livre comme on n'en écrit plus. Une langue et un style impeccable bien qu'un peu alourdi par de nombreuses descriptions de paysages. Intéressant néanmoins pour qui s'intéresse à l'Histoire et à la sociologie.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Un roman paysan d'un auteur assez oublié, mais qu'il serait peut-être intéressant de découvrir ou redécouvrir ne serait-ce que pour prendre connaissance du tableau qu'il brosse de la fin d'un certain type de société rurale et de rapports humains passant de la soumission à la révolte dans les années précédents la Première Guerre Mondiale. L'Eglise a perdu toute influence, c'est tout juste si sept ou huit femmes assistent encore à la messe du dimanche. Le dernier aristocrate est un jeune homme philanthrope, idéaliste et souffreteux qui mourra sans descendance. Les ouvriers prennent conscience que l'union fait la force. Le lecteur assiste à la montée en puissance du mouvement syndical, lequel n'apparut pas sans violence ni injustice. Un livre comme on n'en écrit plus. Une langue et un style impeccable bien qu'un peu alourdi par de nombreuses descriptions de paysages. Intéressant néanmoins pour qui s'intéresse à l'Histoire et à la sociologie.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Pierre Noellet, fils aîné de métayers de la Vendée angevine annonce à son père qu’il désire être prêtre et donc poursuivre des études. La famille, très honorée par cette nouvelle, accepte le sacrifice de perdre une aide précieuse pour la métairie, le second fils étant de santé fragile. Mais Pierre n’a peu à peu qu’un désir en tête : s’élever de sa condition sociale. Il avoue donc ne pas avoir la vocation sacerdotale et sera prêt à tout, jusqu’à rompre avec sa famille, pour la jeune châtelaine qu’il désire épouser…
Grand roman émouvant, dramatique mais plein de charme et de poésie.
Une description magnifique du pays des Mauges campe le décor.
René Bazin dévoile les méandres de l’âme humaine, les sentiments profonds et contradictoires des membres d’une même famille si ancrée dans la tradition et le terroir.
Pour bons lecteurs à partir de 15 ans.
Lien : https://123loisirs.com/livre..
Grand roman émouvant, dramatique mais plein de charme et de poésie.
Une description magnifique du pays des Mauges campe le décor.
René Bazin dévoile les méandres de l’âme humaine, les sentiments profonds et contradictoires des membres d’une même famille si ancrée dans la tradition et le terroir.
Pour bons lecteurs à partir de 15 ans.
Lien : https://123loisirs.com/livre..
Voilà une très belle lecture que je viens de finir. Le grand-père d'Hervé BAZIN dont je n'avais rien lu jusque là, m'a entraînée dans les jolies forêts d'Alsace.
Sa plume est poétique et il parle si bien de cette région magnifique et de ses habitants si pleins de fierté, que je suis allée vérifier s'il n'y avait jamais vécu.
La période historique dont il a fait le décor de son histoire n'est pas souvent mise en avant. Les déchirures d'un peuple entre ceux qui ont fait le choix de s'acclimater avec l'envahisseur ou de refuser toute compromission, provoquent des haines ancestrales entre familles qui autrefois étaient amies, ou même au sein d'un même clan comme celui des Oberlé.
Ce fut vraiment une belle surprise et je lirais sans doute d'autres titres de cet auteur.
Sa plume est poétique et il parle si bien de cette région magnifique et de ses habitants si pleins de fierté, que je suis allée vérifier s'il n'y avait jamais vécu.
La période historique dont il a fait le décor de son histoire n'est pas souvent mise en avant. Les déchirures d'un peuple entre ceux qui ont fait le choix de s'acclimater avec l'envahisseur ou de refuser toute compromission, provoquent des haines ancestrales entre familles qui autrefois étaient amies, ou même au sein d'un même clan comme celui des Oberlé.
Ce fut vraiment une belle surprise et je lirais sans doute d'autres titres de cet auteur.
Bazin René
La terre qui meurt
Un livre sur la France profonde, la terre qui disparaît.
Une famille les Luminaux, qui sont attachés à leur terre depuis plusieurs générations. Mais faute de bonnes récoltes ils sont presque à la ruine.
Il compte sur ses enfants mais un qui est handicapé, un qui est paresseux, un parti au loin et une fille Rousille qui a donné son cœur à Nesmy mais que le père a chassé.
Il compte sur ce fils qui doit revenir.
Mais ce roman montre les difficultés de gens de la terre, de l’attrait des villes, c’est même triste car si même ce n’était pas de ce jour, il faut bien se dire que c’est encore le cas ; l’épuisement, le manque de bras et toutes les normes demandées aux agriculteurs aujourd’hui. On pourrait refaire ce livre avec e qui se passe à l’heure actuelle.
La terre qui meurt
Un livre sur la France profonde, la terre qui disparaît.
Une famille les Luminaux, qui sont attachés à leur terre depuis plusieurs générations. Mais faute de bonnes récoltes ils sont presque à la ruine.
Il compte sur ses enfants mais un qui est handicapé, un qui est paresseux, un parti au loin et une fille Rousille qui a donné son cœur à Nesmy mais que le père a chassé.
Il compte sur ce fils qui doit revenir.
Mais ce roman montre les difficultés de gens de la terre, de l’attrait des villes, c’est même triste car si même ce n’était pas de ce jour, il faut bien se dire que c’est encore le cas ; l’épuisement, le manque de bras et toutes les normes demandées aux agriculteurs aujourd’hui. On pourrait refaire ce livre avec e qui se passe à l’heure actuelle.
Magnifique texte, un peu désuet cependant, mais émouvant. Très agréable à lire.
Lien : http://araucaria.20six.fr/
Lien : http://araucaria.20six.fr/
J’avais aimé le ton bucolique des nouvelles de Bazin (grand-oncle d’Hervé, l’autre auteur du même nom, plus connu d’ailleurs), j’étais moins férue de ses romans moralisateurs à forte tendance catholique. J’ai ouvert ce nouvel opus sans savoir de quel côté pencherait la balance, et l’aventure ne m’a pas déçue !
Les Baltus sont une famille de Lorrains de langue allemande, mais viscéralement attachés à la France. Le rattachement à l’Allemagne après la défaite de 1870 est un déchirement et le personnage principal, Jacques Baltus, instituteur, ne peut qu’enfouir ses sentiments patriotiques pour continuer à exercer, en allemand. Mais vient la guerre suivante, celle de 1914, et les déchirements sont douloureux pour ces Lorrains que l’on amène se battre contre ce qu’ils considèrent comme leur pays, la France. Alors, quelle délivrance que la victoire française en 1918, malgré les plaies difficiles à panser.
Mais les Lorrains ne sont pas au bout de leur chemin de croix. Qui peut comprendre le patriotisme, et même l’héroïsme, de ces villages entiers qui ont vécu sous le joug allemand ? Et puis, humiliation supplémentaire, la France retrouvée veut faire subir à la Lorraine l’ignominie de la loi sur la laïcité, passée alors que la Lorraine n’était pas française. Comment Jacques Baltus, catholique fervent (et c’est dans cette religion plus française qu’allemande que René Bazin ancre le patriotisme lorrain en faveur de la France, un point sur la véracité duquel je ne saurais me prononcer), peut accepter d’enseigner dans une école qui deviendrait laïque, comment peut-on lui demander de ne pas vivre sa religion huit heures par jour, car pour lui comme pour son frère l’abbé Gérard, ne pas mentionner sa religion, c’est comme la renier.
Etrange comment ce livre si daté se révèle d’actualité, puisqu’on y voit le tiraillement entre laïcité et expression de sa foi. C’est ici un catholique qui parle, aujourd’hui, les religions se posant ces questions sont plus diverses, mais la question demeure. L’obligation de neutralité, qui n’existe aujourd’hui me semble-t-il que pour les fonctionnaires, est-elle ou non une entrave à la liberté religieuse. Je suis pour ma part convaincue du bien-fondé de la laïcité, d’une laïcité qui libère, mais il est intéressant de voir le point de vue inverse, celui d’un homme qui se sent enfermé par l’interdiction d’exprimer publiquement sa foi, puisque c’est elle et ses valeurs qui sous-tendent son action et ce qu’il est. Publié en 1926, ce roman est loin des débats passionnels actuels et permet donc d’écouter calmement ce point de vue qui remet en cause la laïcité en y voyant une entrave (et ici, une entrave à l’expression pleine de ce qu’est être français, un lien entre identité nationale et religion à l’opposé des tensions actuelles).
Je m’imagine bien où René Bazin, fondateur en 1917 d’un Bureau catholique de la presse (dont je ne connais pas le rôle, mais l’intitulé se suffit à lui-même), veut en venir. Je ne le suivrai pas sur ce chemin-là. La laïcité est pour moi une valeur républicaine insécable des trois mots qui font notre devise. Mais ce livre m’a permis de m’interroger sur le processus d’acceptation de ce principe et de la philosophie qui le sous-tend. Accepter la laïcité, c’est accepter une certaine conception de la religion, celui d’une religion personnelle et non publique, une conception qui n’est pas aussi évidente qu’on veut parfois le croire et qui demande une véritable réflexion et peut-être évolution de certaines conceptions personnelles.
On connait la fin de l’histoire, du moins la fin provisoire, qui fait que les lois de séparation des Eglises et de l’Etat ne s’appliquent toujours pas en Alsace et en Lorraine. Peut-être cela changera-t-il, je crois que je le souhaite même (en mettant tout de même un bémol avant de m’attirer peut-être des foudres régionalistes, je suis assez peu au fait de la question et mon opinion est donc peu fondée et demanderait à être étayée). Mais ce livre est vraiment passionnant, dans sa première partie sur le patriotisme blessé et dans sa seconde partie dans l’affrontement entre religion et laïcité. Modernité de la question de l’engagement, posée dans une situation très marquée historiquement et qui permet de prendre de la distance avec la situation actuelle tout en éclairant un débat très contemporain.
Un livre méconnu, parfois agaçant de bondieuserie, mais passionnant à lire et à réfléchir.
Les Baltus sont une famille de Lorrains de langue allemande, mais viscéralement attachés à la France. Le rattachement à l’Allemagne après la défaite de 1870 est un déchirement et le personnage principal, Jacques Baltus, instituteur, ne peut qu’enfouir ses sentiments patriotiques pour continuer à exercer, en allemand. Mais vient la guerre suivante, celle de 1914, et les déchirements sont douloureux pour ces Lorrains que l’on amène se battre contre ce qu’ils considèrent comme leur pays, la France. Alors, quelle délivrance que la victoire française en 1918, malgré les plaies difficiles à panser.
Mais les Lorrains ne sont pas au bout de leur chemin de croix. Qui peut comprendre le patriotisme, et même l’héroïsme, de ces villages entiers qui ont vécu sous le joug allemand ? Et puis, humiliation supplémentaire, la France retrouvée veut faire subir à la Lorraine l’ignominie de la loi sur la laïcité, passée alors que la Lorraine n’était pas française. Comment Jacques Baltus, catholique fervent (et c’est dans cette religion plus française qu’allemande que René Bazin ancre le patriotisme lorrain en faveur de la France, un point sur la véracité duquel je ne saurais me prononcer), peut accepter d’enseigner dans une école qui deviendrait laïque, comment peut-on lui demander de ne pas vivre sa religion huit heures par jour, car pour lui comme pour son frère l’abbé Gérard, ne pas mentionner sa religion, c’est comme la renier.
Etrange comment ce livre si daté se révèle d’actualité, puisqu’on y voit le tiraillement entre laïcité et expression de sa foi. C’est ici un catholique qui parle, aujourd’hui, les religions se posant ces questions sont plus diverses, mais la question demeure. L’obligation de neutralité, qui n’existe aujourd’hui me semble-t-il que pour les fonctionnaires, est-elle ou non une entrave à la liberté religieuse. Je suis pour ma part convaincue du bien-fondé de la laïcité, d’une laïcité qui libère, mais il est intéressant de voir le point de vue inverse, celui d’un homme qui se sent enfermé par l’interdiction d’exprimer publiquement sa foi, puisque c’est elle et ses valeurs qui sous-tendent son action et ce qu’il est. Publié en 1926, ce roman est loin des débats passionnels actuels et permet donc d’écouter calmement ce point de vue qui remet en cause la laïcité en y voyant une entrave (et ici, une entrave à l’expression pleine de ce qu’est être français, un lien entre identité nationale et religion à l’opposé des tensions actuelles).
Je m’imagine bien où René Bazin, fondateur en 1917 d’un Bureau catholique de la presse (dont je ne connais pas le rôle, mais l’intitulé se suffit à lui-même), veut en venir. Je ne le suivrai pas sur ce chemin-là. La laïcité est pour moi une valeur républicaine insécable des trois mots qui font notre devise. Mais ce livre m’a permis de m’interroger sur le processus d’acceptation de ce principe et de la philosophie qui le sous-tend. Accepter la laïcité, c’est accepter une certaine conception de la religion, celui d’une religion personnelle et non publique, une conception qui n’est pas aussi évidente qu’on veut parfois le croire et qui demande une véritable réflexion et peut-être évolution de certaines conceptions personnelles.
On connait la fin de l’histoire, du moins la fin provisoire, qui fait que les lois de séparation des Eglises et de l’Etat ne s’appliquent toujours pas en Alsace et en Lorraine. Peut-être cela changera-t-il, je crois que je le souhaite même (en mettant tout de même un bémol avant de m’attirer peut-être des foudres régionalistes, je suis assez peu au fait de la question et mon opinion est donc peu fondée et demanderait à être étayée). Mais ce livre est vraiment passionnant, dans sa première partie sur le patriotisme blessé et dans sa seconde partie dans l’affrontement entre religion et laïcité. Modernité de la question de l’engagement, posée dans une situation très marquée historiquement et qui permet de prendre de la distance avec la situation actuelle tout en éclairant un débat très contemporain.
Un livre méconnu, parfois agaçant de bondieuserie, mais passionnant à lire et à réfléchir.
Quelle bonne idée que de rassembler les textes de grands auteurs tels que Balzac, Flaubert ou René Bazin autour du thème de la Loire en Anjou et en Touraine ! D'un écrivain à l'autre, on retrouve des images du fleuve et des lieux semblables et différentes à la fois, car perçues de façon personnelle et subjective, parfois selon l'humeur du moment, par l'une ou l'autre de ces figures marquantes de la littérature française.
Et ce n'est pas toujours à l'avantage de la région que la plume se manie. Hugo n'aime pas les peupliers. Stendhal trouve les îles de Loire ridicules. Flaubert met en avant l'ennui ressenti en province, qui n'est pas seulement propre à Mme Bovary.
Heureusement, certains lieux, comme la maison de la Grenadière, inspirent de belles lignes à Balzac, Stendhal aussi, ou Béranger. Les différents textes se font écho. Le lieu en devient presque familier au lecteur. On a très envie de découvrir les ruines de l'Abbaye de Marmoutiers mentionnées par Hugo et plus loin par Stendhal.
La Loire apparaît sous ses différents aspects. Balzac va jusqu'à la comparer à la baie de Naples et au lac de Genève. Stendhal raconte une descente en bateau vapeur rocambolesque. Flaubert a des mots très sévères pour le paysage des rives du fleuve. Michelet n'y voit que mollesse et paresse. Les auteurs évoquent les changements considérables au gré des saisons.
Il ressort malgré tout de ces textes une particularité de la région que d'autres peuvent lui envier pour sa douceur, les rêveries qu'elle inspire, et la richesse de son patrimoine historique.
Voyage en Val de Loire est à emporter lors d'un circuit au long du fleuve, à pied, à vélo, ou en canoë, pour en découvrir au mieux les attraits, et comprendre aussi ce qui peut sembler monotone, mais fait partie de la poésie qui s'y attache.
Et ce n'est pas toujours à l'avantage de la région que la plume se manie. Hugo n'aime pas les peupliers. Stendhal trouve les îles de Loire ridicules. Flaubert met en avant l'ennui ressenti en province, qui n'est pas seulement propre à Mme Bovary.
Heureusement, certains lieux, comme la maison de la Grenadière, inspirent de belles lignes à Balzac, Stendhal aussi, ou Béranger. Les différents textes se font écho. Le lieu en devient presque familier au lecteur. On a très envie de découvrir les ruines de l'Abbaye de Marmoutiers mentionnées par Hugo et plus loin par Stendhal.
La Loire apparaît sous ses différents aspects. Balzac va jusqu'à la comparer à la baie de Naples et au lac de Genève. Stendhal raconte une descente en bateau vapeur rocambolesque. Flaubert a des mots très sévères pour le paysage des rives du fleuve. Michelet n'y voit que mollesse et paresse. Les auteurs évoquent les changements considérables au gré des saisons.
Il ressort malgré tout de ces textes une particularité de la région que d'autres peuvent lui envier pour sa douceur, les rêveries qu'elle inspire, et la richesse de son patrimoine historique.
Voyage en Val de Loire est à emporter lors d'un circuit au long du fleuve, à pied, à vélo, ou en canoë, pour en découvrir au mieux les attraits, et comprendre aussi ce qui peut sembler monotone, mais fait partie de la poésie qui s'y attache.
Après une visite à Strasbourg et son musée de l'histoire de l'Alsace, je me suis laissée tenter par ce livre, qui met en lumière toutes les souffrances vécues par ces alsaciens malmenés, mal aimés, déchirés. L'écriture en est un peu désuète, mais l'histoire de cette famille reflète à coup sûr les dissensions coutumières en pays occupé. Et dire qu'ils ont dû revivre tout cela en 1918 lors du retour de l'Alsace à la France ! Cette région a souffert plus qu'à son tour...
Histoire d'amour dans la paysannerie bretonne du XIXe siècle, tout autant centrée sur Donatienne que sur son époux, Jean Louarn. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, l'histoire n'est nullement brodée de bons sentiments, les personnages sont ambigus, prennent des mauvaises décisions, subissent des coups du sort terribles. L'auteur laisse quelquefois échapper des saillies de moralisme, mais elles ne gâchent nullement l'expérience littéraire. Le style de l'ouvrage est très agréable. J'en conseille la lecture.
René Bazin est un académicien portant une grande importance à l'histoire religieuse de la France et à la papauté. Ce roman biographique en est la preuve puisqu'il retrace l'histoire de Pie X, autrement appelé Giuseppe Melchiorre Sarto. Il s'agit donc d'un récit hagiographique qu'il faut lire, non pas forcément sous un angle religieux et admiratif, mais plutôt social et philosophique pour qu'il soit accessible à tous les publics.
RÉSUMÉ DE PIE X
Ce livre décrit la vie de Giuseppe Melchiorre Sarto, né à Riese, destiné à la vie religieuse et devenu Pape. Il a réalisé de nombreuses choses pour le monde catholique et a activement participé à l'évolution de la religion à travers les âges. C'est aussi le Pape qui a vu les lois de séparation de l'Etat avec la religion activement appliquées en France. On ne peut pas dire que la religion avait un réel pouvoir sur l'Etat, mais des traces de la religion étaient encore très ancrées dans les mœurs et les habitudes. Supprimer les dernières traces du culte était donc nécessaire pour passer à autre chose et permettre à la France de devenir un pays plus laïc. Qui plus est, il s'agit aussi du Pape qui a vu s'annoncer la Première Guerre mondiale.
REDÉCOUVRIR DES ÉVÉNEMENTS D'UN POINT DE VUE RELIGIEUX
LA SÉPARATION DE L'ETAT FRANÇAIS ET DE LA RELIGION
Si l'Etat français a toujours été très proche de la religion catholique, le moment est arrivé de séparer explicitement les deux pouvoir. Cela faisait sens dans un monde où toutes les cultures doivent trouver leur place. La France a toujours été un pays plutôt cosmopolite, et imposer le culte religieux ne pouvait plus faire sens. Dans cette biographie, le lecteur est invité à découvrir combien des actes qui sont bien ancrés dans la société aujourd'hui ont été perçus à l'époque par le monde catholique.
Séparer le pouvoir de la religion était une catastrophe pour Pie X. Cela pouvait engendrer beaucoup de ses fidèles à perdre la foi. C'était aussi une inquiétude par rapport au confort de la pratique. En effet, les églises ont été réquisitionnées par les mairies et les prêtres se sont vus refuser les aides financières qu'ils avaient jusqu'alors. Cependant, les religieux français ont assuré au Pape qu'ils continueraient à se battre et à pratiquer la religion. C'était donc une catastrophe pour l'image de la religion et la position de pouvoir, mais une façon de plus de tester la croyance des catholiques. Qui plus est, ce phénomène de laïcisation des pays s'est poursuivi au cours du temps. On voit donc un Pape qui s'inquiète pour le confort de ses semblables et qui voit sa religion remise en question.
L'ÉMERGENCE DES NOUVELLES CROYANCES ET LES DÉRIVES DU CULTE
Ce roman permet aussi de voir comme un pouvoir agit pour lutter contre une idée naissante. Effectivement, sous Pie X, de nouvelles pratiques religieuses se créent donnant naissance à un nouveau protestantisme. Le Pape condamne donc formellement ces pratiques en agissant directement sur les lois qu'il peut modifier. Il doit donc lutter contre un état émergent de croyance qui dérive de la branche du catholicisme. C'est un danger permanent et un besoin de régulation qui sont transcrits entre ces pages.
Enfin, ce sont aussi des moments de grâce où l'auteur reconnaît que malgré tout, une forme de respect permanente entre les religions. Ce qui compte, c'est que chacun puisse coexister, bien que le Pape applique toujours activement son pouvoir sans en abuser et dans l'intérêt général.
UN RÉCIT HAGIOGRAPHIQUE ET UNE PHILOSOPHIE AVANT TOUT
PARLER D'UN GRAND HOMME POUR SA VOCATION RELIGIEUSE
L'hagiographie consiste en la rédaction de la vie d'un Saint ou d'un homme religieux. Il a pour but de retracer la vie d'un personnage dans ce qu'il a fait de grand et de louable. C'est un texte absolument religieux très en place au Moyen Âge, à une époque où les prêtres et les ermites partaient à travers le monde pour convertir leurs semblables. En revanche, il a perdu son sens dans un monde où la religion occupe une place mineure, c'est donc un genre littéraire très méconnu de nos jours.
Ce sont donc des textes biographiques très élogieux qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui mais René Bazin se prête à l'exercice dans cet ouvrage comme dans d'autres de ses œuvres. C'est donc un texte qui n'est pas accessible. Pourtant René Bazin écrit très bien, mais, à part des personnes s'intéressant de près la religion, ce genre de roman trouve difficilement son public. En revanche, il est possible de trouver quelques intérêts, d'un point de vue neutre, à la lecture de ce roman.
UNE PHILOSOPHIE DONT ON PEUT GARDER DES ENSEIGNEMENTS
Il est tout de même possible de retirer du bon de cette lecture. En effet, le lecteur s'enrichit de la philosophie d'un personnage "exemplaire". Le Pape doit être une figure modèle pensant aux autres avant lui-même. Il est aussi un modèle d'abnégation et de soutien aux pauvres. Il détient un pouvoir et doit faire respecter ce qu'il y a de mieux pour la religion tout en respectant la liberté des uns et des autres.
Ce Pape en particulier a entrepris de grands projets et s'est donné corps et âme pour son peuple. On découvre aussi l'allégeance et le rôle de la religion dans un pays comme l'Italie. Ce pays est le centre de la religion catholique qui joue son rôle dans le monde entier. Et qu'on soit religieux ou non, on a tous à apprendre de la bienveillance des uns et des autres. Ce roman appuie au moins sur ce point : la solidarité n'est pas juste un mot et n'a pas de limites.
Lien : https://culturelivresque.fr/..
RÉSUMÉ DE PIE X
Ce livre décrit la vie de Giuseppe Melchiorre Sarto, né à Riese, destiné à la vie religieuse et devenu Pape. Il a réalisé de nombreuses choses pour le monde catholique et a activement participé à l'évolution de la religion à travers les âges. C'est aussi le Pape qui a vu les lois de séparation de l'Etat avec la religion activement appliquées en France. On ne peut pas dire que la religion avait un réel pouvoir sur l'Etat, mais des traces de la religion étaient encore très ancrées dans les mœurs et les habitudes. Supprimer les dernières traces du culte était donc nécessaire pour passer à autre chose et permettre à la France de devenir un pays plus laïc. Qui plus est, il s'agit aussi du Pape qui a vu s'annoncer la Première Guerre mondiale.
REDÉCOUVRIR DES ÉVÉNEMENTS D'UN POINT DE VUE RELIGIEUX
LA SÉPARATION DE L'ETAT FRANÇAIS ET DE LA RELIGION
Si l'Etat français a toujours été très proche de la religion catholique, le moment est arrivé de séparer explicitement les deux pouvoir. Cela faisait sens dans un monde où toutes les cultures doivent trouver leur place. La France a toujours été un pays plutôt cosmopolite, et imposer le culte religieux ne pouvait plus faire sens. Dans cette biographie, le lecteur est invité à découvrir combien des actes qui sont bien ancrés dans la société aujourd'hui ont été perçus à l'époque par le monde catholique.
Séparer le pouvoir de la religion était une catastrophe pour Pie X. Cela pouvait engendrer beaucoup de ses fidèles à perdre la foi. C'était aussi une inquiétude par rapport au confort de la pratique. En effet, les églises ont été réquisitionnées par les mairies et les prêtres se sont vus refuser les aides financières qu'ils avaient jusqu'alors. Cependant, les religieux français ont assuré au Pape qu'ils continueraient à se battre et à pratiquer la religion. C'était donc une catastrophe pour l'image de la religion et la position de pouvoir, mais une façon de plus de tester la croyance des catholiques. Qui plus est, ce phénomène de laïcisation des pays s'est poursuivi au cours du temps. On voit donc un Pape qui s'inquiète pour le confort de ses semblables et qui voit sa religion remise en question.
L'ÉMERGENCE DES NOUVELLES CROYANCES ET LES DÉRIVES DU CULTE
Ce roman permet aussi de voir comme un pouvoir agit pour lutter contre une idée naissante. Effectivement, sous Pie X, de nouvelles pratiques religieuses se créent donnant naissance à un nouveau protestantisme. Le Pape condamne donc formellement ces pratiques en agissant directement sur les lois qu'il peut modifier. Il doit donc lutter contre un état émergent de croyance qui dérive de la branche du catholicisme. C'est un danger permanent et un besoin de régulation qui sont transcrits entre ces pages.
Enfin, ce sont aussi des moments de grâce où l'auteur reconnaît que malgré tout, une forme de respect permanente entre les religions. Ce qui compte, c'est que chacun puisse coexister, bien que le Pape applique toujours activement son pouvoir sans en abuser et dans l'intérêt général.
UN RÉCIT HAGIOGRAPHIQUE ET UNE PHILOSOPHIE AVANT TOUT
PARLER D'UN GRAND HOMME POUR SA VOCATION RELIGIEUSE
L'hagiographie consiste en la rédaction de la vie d'un Saint ou d'un homme religieux. Il a pour but de retracer la vie d'un personnage dans ce qu'il a fait de grand et de louable. C'est un texte absolument religieux très en place au Moyen Âge, à une époque où les prêtres et les ermites partaient à travers le monde pour convertir leurs semblables. En revanche, il a perdu son sens dans un monde où la religion occupe une place mineure, c'est donc un genre littéraire très méconnu de nos jours.
Ce sont donc des textes biographiques très élogieux qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui mais René Bazin se prête à l'exercice dans cet ouvrage comme dans d'autres de ses œuvres. C'est donc un texte qui n'est pas accessible. Pourtant René Bazin écrit très bien, mais, à part des personnes s'intéressant de près la religion, ce genre de roman trouve difficilement son public. En revanche, il est possible de trouver quelques intérêts, d'un point de vue neutre, à la lecture de ce roman.
UNE PHILOSOPHIE DONT ON PEUT GARDER DES ENSEIGNEMENTS
Il est tout de même possible de retirer du bon de cette lecture. En effet, le lecteur s'enrichit de la philosophie d'un personnage "exemplaire". Le Pape doit être une figure modèle pensant aux autres avant lui-même. Il est aussi un modèle d'abnégation et de soutien aux pauvres. Il détient un pouvoir et doit faire respecter ce qu'il y a de mieux pour la religion tout en respectant la liberté des uns et des autres.
Ce Pape en particulier a entrepris de grands projets et s'est donné corps et âme pour son peuple. On découvre aussi l'allégeance et le rôle de la religion dans un pays comme l'Italie. Ce pays est le centre de la religion catholique qui joue son rôle dans le monde entier. Et qu'on soit religieux ou non, on a tous à apprendre de la bienveillance des uns et des autres. Ce roman appuie au moins sur ce point : la solidarité n'est pas juste un mot et n'a pas de limites.
Lien : https://culturelivresque.fr/..
Bazin René
Magnificat (1931)
J’ai beaucoup aimé surtout l’écriture de l’auteur, on en arriverait presque à sentir les odeurs des forêts, des fleurs, des petits sentiers etc.
C’est merveilleux cette capacité à décrire la nature pour permettre au lecteur non pas seulement de lire mais de voir.
L’histoire est simple, dans le Morbihan, des agriculteurs, attachés fermement à leur terres, travaillant sans relâche. Le respect des autres et surtout du père.
Mais ce n’est pas que cela, c’est aussi la guerre 14/18 où le fils doit partir, ce fils dont on attend le retour et surtout Anna qui l’aime profondément, mais lui de son côté, son désir le plus profond est de devenir prêtre.
C’est un livre d’une grande intensité tant dans la description de cette vie rurale de l’époque et de cette horrible guerre.
On y retrouve toutes les formes de loyauté, de fidélité de dévouement etc…..
Magnificat (1931)
J’ai beaucoup aimé surtout l’écriture de l’auteur, on en arriverait presque à sentir les odeurs des forêts, des fleurs, des petits sentiers etc.
C’est merveilleux cette capacité à décrire la nature pour permettre au lecteur non pas seulement de lire mais de voir.
L’histoire est simple, dans le Morbihan, des agriculteurs, attachés fermement à leur terres, travaillant sans relâche. Le respect des autres et surtout du père.
Mais ce n’est pas que cela, c’est aussi la guerre 14/18 où le fils doit partir, ce fils dont on attend le retour et surtout Anna qui l’aime profondément, mais lui de son côté, son désir le plus profond est de devenir prêtre.
C’est un livre d’une grande intensité tant dans la description de cette vie rurale de l’époque et de cette horrible guerre.
On y retrouve toutes les formes de loyauté, de fidélité de dévouement etc…..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de René Bazin
Quiz
Voir plus
Culture générale en fleurs
Qui a écrit et chanté "Une jolie fleur" ?
Charles Aznavour
Hugues Auffray
Georges Brassens
Gilbert Bécaud
15 questions
233 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature française
, chanson française
, poésie française
, cuisineCréer un quiz sur cet auteur233 lecteurs ont répondu