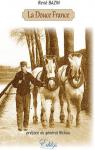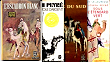Critiques de René Bazin (49)
Nous sommes en 1924. Baltus le Lorrain est l’histoire d’une famille de trois frères implantée dans un village de Lorraine depuis des générations. L’essentiel du roman se noue autour de Jacques l’instituteur ; son fils Nicolas a disparu pendant la grande guerre et sa femme refusant de croire à sa mort, devenue folle, continue, depuis six ans, à le chercher dans la forêt avoisinante… René Bazin nous raconte le drame poignant de ces Français enrôlés de force dans les armées prussiennes.
Voici, par exemple, la dernière lettre envoyée par le jeune Nicolas, peu avant d’être tué par les balles françaises :
« Ne craignez rien, le père ; je ne tirerai jamais un coup de fusil contre les Français ; je fais le geste d’épauler, quand il le faut : je ne tire pas ; le feldwebel me complimente de la propreté de mon arme, eh ! je crois bien ! pas une balle n’a passé par le canon ; je sème mes cartouches dans les tranchées, ou quand je vais en reconnaissance… »
Le roman pourrait aussi s’intituler « De l’occupation étrangère à la guerre scolaire », car une grande partie est consacrée à la lutte qui dresse les Alsaciens-Lorrains patriotes catholiques contre la tentative de laicisation de l’école.
Des pages propres à émouvoir non seulement les Lorrains mais tous les auditeurs sensibles à la détresse d’une famille dans la tourmente
> Écouter un extrait : 01. La Horgne-aux-moutons.
Lien : http://www.litteratureaudio...
Voici, par exemple, la dernière lettre envoyée par le jeune Nicolas, peu avant d’être tué par les balles françaises :
« Ne craignez rien, le père ; je ne tirerai jamais un coup de fusil contre les Français ; je fais le geste d’épauler, quand il le faut : je ne tire pas ; le feldwebel me complimente de la propreté de mon arme, eh ! je crois bien ! pas une balle n’a passé par le canon ; je sème mes cartouches dans les tranchées, ou quand je vais en reconnaissance… »
Le roman pourrait aussi s’intituler « De l’occupation étrangère à la guerre scolaire », car une grande partie est consacrée à la lutte qui dresse les Alsaciens-Lorrains patriotes catholiques contre la tentative de laicisation de l’école.
Des pages propres à émouvoir non seulement les Lorrains mais tous les auditeurs sensibles à la détresse d’une famille dans la tourmente
> Écouter un extrait : 01. La Horgne-aux-moutons.
Lien : http://www.litteratureaudio...
J’avais aimé le ton bucolique des nouvelles de Bazin (grand-oncle d’Hervé, l’autre auteur du même nom, plus connu d’ailleurs), j’étais moins férue de ses romans moralisateurs à forte tendance catholique. J’ai ouvert ce nouvel opus sans savoir de quel côté pencherait la balance, et l’aventure ne m’a pas déçue !
Les Baltus sont une famille de Lorrains de langue allemande, mais viscéralement attachés à la France. Le rattachement à l’Allemagne après la défaite de 1870 est un déchirement et le personnage principal, Jacques Baltus, instituteur, ne peut qu’enfouir ses sentiments patriotiques pour continuer à exercer, en allemand. Mais vient la guerre suivante, celle de 1914, et les déchirements sont douloureux pour ces Lorrains que l’on amène se battre contre ce qu’ils considèrent comme leur pays, la France. Alors, quelle délivrance que la victoire française en 1918, malgré les plaies difficiles à panser.
Mais les Lorrains ne sont pas au bout de leur chemin de croix. Qui peut comprendre le patriotisme, et même l’héroïsme, de ces villages entiers qui ont vécu sous le joug allemand ? Et puis, humiliation supplémentaire, la France retrouvée veut faire subir à la Lorraine l’ignominie de la loi sur la laïcité, passée alors que la Lorraine n’était pas française. Comment Jacques Baltus, catholique fervent (et c’est dans cette religion plus française qu’allemande que René Bazin ancre le patriotisme lorrain en faveur de la France, un point sur la véracité duquel je ne saurais me prononcer), peut accepter d’enseigner dans une école qui deviendrait laïque, comment peut-on lui demander de ne pas vivre sa religion huit heures par jour, car pour lui comme pour son frère l’abbé Gérard, ne pas mentionner sa religion, c’est comme la renier.
Etrange comment ce livre si daté se révèle d’actualité, puisqu’on y voit le tiraillement entre laïcité et expression de sa foi. C’est ici un catholique qui parle, aujourd’hui, les religions se posant ces questions sont plus diverses, mais la question demeure. L’obligation de neutralité, qui n’existe aujourd’hui me semble-t-il que pour les fonctionnaires, est-elle ou non une entrave à la liberté religieuse. Je suis pour ma part convaincue du bien-fondé de la laïcité, d’une laïcité qui libère, mais il est intéressant de voir le point de vue inverse, celui d’un homme qui se sent enfermé par l’interdiction d’exprimer publiquement sa foi, puisque c’est elle et ses valeurs qui sous-tendent son action et ce qu’il est. Publié en 1926, ce roman est loin des débats passionnels actuels et permet donc d’écouter calmement ce point de vue qui remet en cause la laïcité en y voyant une entrave (et ici, une entrave à l’expression pleine de ce qu’est être français, un lien entre identité nationale et religion à l’opposé des tensions actuelles).
Je m’imagine bien où René Bazin, fondateur en 1917 d’un Bureau catholique de la presse (dont je ne connais pas le rôle, mais l’intitulé se suffit à lui-même), veut en venir. Je ne le suivrai pas sur ce chemin-là. La laïcité est pour moi une valeur républicaine insécable des trois mots qui font notre devise. Mais ce livre m’a permis de m’interroger sur le processus d’acceptation de ce principe et de la philosophie qui le sous-tend. Accepter la laïcité, c’est accepter une certaine conception de la religion, celui d’une religion personnelle et non publique, une conception qui n’est pas aussi évidente qu’on veut parfois le croire et qui demande une véritable réflexion et peut-être évolution de certaines conceptions personnelles.
On connait la fin de l’histoire, du moins la fin provisoire, qui fait que les lois de séparation des Eglises et de l’Etat ne s’appliquent toujours pas en Alsace et en Lorraine. Peut-être cela changera-t-il, je crois que je le souhaite même (en mettant tout de même un bémol avant de m’attirer peut-être des foudres régionalistes, je suis assez peu au fait de la question et mon opinion est donc peu fondée et demanderait à être étayée). Mais ce livre est vraiment passionnant, dans sa première partie sur le patriotisme blessé et dans sa seconde partie dans l’affrontement entre religion et laïcité. Modernité de la question de l’engagement, posée dans une situation très marquée historiquement et qui permet de prendre de la distance avec la situation actuelle tout en éclairant un débat très contemporain.
Un livre méconnu, parfois agaçant de bondieuserie, mais passionnant à lire et à réfléchir.
Les Baltus sont une famille de Lorrains de langue allemande, mais viscéralement attachés à la France. Le rattachement à l’Allemagne après la défaite de 1870 est un déchirement et le personnage principal, Jacques Baltus, instituteur, ne peut qu’enfouir ses sentiments patriotiques pour continuer à exercer, en allemand. Mais vient la guerre suivante, celle de 1914, et les déchirements sont douloureux pour ces Lorrains que l’on amène se battre contre ce qu’ils considèrent comme leur pays, la France. Alors, quelle délivrance que la victoire française en 1918, malgré les plaies difficiles à panser.
Mais les Lorrains ne sont pas au bout de leur chemin de croix. Qui peut comprendre le patriotisme, et même l’héroïsme, de ces villages entiers qui ont vécu sous le joug allemand ? Et puis, humiliation supplémentaire, la France retrouvée veut faire subir à la Lorraine l’ignominie de la loi sur la laïcité, passée alors que la Lorraine n’était pas française. Comment Jacques Baltus, catholique fervent (et c’est dans cette religion plus française qu’allemande que René Bazin ancre le patriotisme lorrain en faveur de la France, un point sur la véracité duquel je ne saurais me prononcer), peut accepter d’enseigner dans une école qui deviendrait laïque, comment peut-on lui demander de ne pas vivre sa religion huit heures par jour, car pour lui comme pour son frère l’abbé Gérard, ne pas mentionner sa religion, c’est comme la renier.
Etrange comment ce livre si daté se révèle d’actualité, puisqu’on y voit le tiraillement entre laïcité et expression de sa foi. C’est ici un catholique qui parle, aujourd’hui, les religions se posant ces questions sont plus diverses, mais la question demeure. L’obligation de neutralité, qui n’existe aujourd’hui me semble-t-il que pour les fonctionnaires, est-elle ou non une entrave à la liberté religieuse. Je suis pour ma part convaincue du bien-fondé de la laïcité, d’une laïcité qui libère, mais il est intéressant de voir le point de vue inverse, celui d’un homme qui se sent enfermé par l’interdiction d’exprimer publiquement sa foi, puisque c’est elle et ses valeurs qui sous-tendent son action et ce qu’il est. Publié en 1926, ce roman est loin des débats passionnels actuels et permet donc d’écouter calmement ce point de vue qui remet en cause la laïcité en y voyant une entrave (et ici, une entrave à l’expression pleine de ce qu’est être français, un lien entre identité nationale et religion à l’opposé des tensions actuelles).
Je m’imagine bien où René Bazin, fondateur en 1917 d’un Bureau catholique de la presse (dont je ne connais pas le rôle, mais l’intitulé se suffit à lui-même), veut en venir. Je ne le suivrai pas sur ce chemin-là. La laïcité est pour moi une valeur républicaine insécable des trois mots qui font notre devise. Mais ce livre m’a permis de m’interroger sur le processus d’acceptation de ce principe et de la philosophie qui le sous-tend. Accepter la laïcité, c’est accepter une certaine conception de la religion, celui d’une religion personnelle et non publique, une conception qui n’est pas aussi évidente qu’on veut parfois le croire et qui demande une véritable réflexion et peut-être évolution de certaines conceptions personnelles.
On connait la fin de l’histoire, du moins la fin provisoire, qui fait que les lois de séparation des Eglises et de l’Etat ne s’appliquent toujours pas en Alsace et en Lorraine. Peut-être cela changera-t-il, je crois que je le souhaite même (en mettant tout de même un bémol avant de m’attirer peut-être des foudres régionalistes, je suis assez peu au fait de la question et mon opinion est donc peu fondée et demanderait à être étayée). Mais ce livre est vraiment passionnant, dans sa première partie sur le patriotisme blessé et dans sa seconde partie dans l’affrontement entre religion et laïcité. Modernité de la question de l’engagement, posée dans une situation très marquée historiquement et qui permet de prendre de la distance avec la situation actuelle tout en éclairant un débat très contemporain.
Un livre méconnu, parfois agaçant de bondieuserie, mais passionnant à lire et à réfléchir.
Ce n'est pas si facile de trouver une bonne biographie d'un homme tel que Charles de Foucauld. Un biographe catholique aura tendance à passer très vite sur la première partie de sa vie, trouvant probablement qu'une bringue pareille, ça fait désordre, et un biographe totalement fermé sur le sujet de la religion (oui, vous me direz pourquoi écrire une biographie de Charles de Foucauld alors? Les gens sont plein de contradictions mais c'est comme ça) , au contraire sera complètement perdu par sa conversion et verra dans sa décision d'aller s'installer au beau milieu des Touaregs non pas la volonté de vivre dans la pauvreté du Christ et de témoigner de celui-ci mais une quelconque machination colonialiste.
Cette biographie-ci a l'avantage d'avoir été écrite il y a tellement longtemps que l'auteur est allé interviewer des personnes ayant connu Foucauld et peut ainsi offrir des témoignages, pas seulement des faits déformés par les années. C'est tout de même très marqué par l'époque où René Bazin vivait, un éditeur lui dirait probablement aujourd'hui que c'est franchement paternaliste pour les habitants de l'Afrique du Nord, quoique moins que je le craignais.
C'est un témoignage d'une époque révolue, autant qu'une biographie, et cela la rend doublement intéressante....quoiqu'avec des longueurs, il y a des moments où j'ai du lutter!
C'était vraiment une figure étonnante, aussi bien jeune, avant sa conversion, où il pénétra pour jouer les géographes déguisé en juif dans le Maroc interdit aux chrétiens, qu'ensuite, ascète et ermite qui ne rêvait que d'être rejoint par d'autres prêtres que pour former une communauté fraternelle mais qui jamais ne fut exaucé...entre autres parce que les instances du clergé trouvaient que les règles qu'il s'imposait étaient si dures que nul autre n'aurait pu y résister !
Malgré ses longueurs et son style passé de mode, je suis bien contente d'être arrivée au bout de ce portrait d'un homme exceptionnel.
Cette biographie-ci a l'avantage d'avoir été écrite il y a tellement longtemps que l'auteur est allé interviewer des personnes ayant connu Foucauld et peut ainsi offrir des témoignages, pas seulement des faits déformés par les années. C'est tout de même très marqué par l'époque où René Bazin vivait, un éditeur lui dirait probablement aujourd'hui que c'est franchement paternaliste pour les habitants de l'Afrique du Nord, quoique moins que je le craignais.
C'est un témoignage d'une époque révolue, autant qu'une biographie, et cela la rend doublement intéressante....quoiqu'avec des longueurs, il y a des moments où j'ai du lutter!
C'était vraiment une figure étonnante, aussi bien jeune, avant sa conversion, où il pénétra pour jouer les géographes déguisé en juif dans le Maroc interdit aux chrétiens, qu'ensuite, ascète et ermite qui ne rêvait que d'être rejoint par d'autres prêtres que pour former une communauté fraternelle mais qui jamais ne fut exaucé...entre autres parce que les instances du clergé trouvaient que les règles qu'il s'imposait étaient si dures que nul autre n'aurait pu y résister !
Malgré ses longueurs et son style passé de mode, je suis bien contente d'être arrivée au bout de ce portrait d'un homme exceptionnel.
La canonisation de Charles de Foucauld m'a incité à reparcourir la biographie que René Bazin publia en 1921, cinq ans après la mort de l'ermite, qui reste, à mes yeux, la plus intéressante de toutes, car l'auteur connaissait le religieux, rencontra nombre de personnes qui l'avaient côtoyé lors des différentes étapes de sa vie d'officier, de débauché, d'explorateur, de géographe, de religieux puis de prêtre et eut accès à ses correspondances.
Le titre de l'ouvrage souligne les deux dimensions du personnage.
Explorateur au Maroc, Foucauld est un géographe qui établit la première cartographie du royaume et publia une étude remarquable, honorée d'un prix de la société de géographie, qui montre la curiosité et l'attention aux autres de celui qui parcourut à pied le Maroc. Sa découverte des Marocains et de leur religiosité joua un rôle important dans sa conversion.
Ermite au Sahara, frère Charles vécut humblement et pauvrement au milieu des esclaves et des défavorisés au coeur du Sahara et finit assassiné durant la première guerre mondiale.
Cette biographie contribua à la notoriété du martyre et fut la première pierre du long chemin qui mena à sa canonisation et associe la mémoire de l'écrivain à celle du religieux.
La mémoire de Bazin est également attachée à ses romans « La terre qui meurt » et « Les Oberlé » mais je me demande si cette biographie ne sera pas, dans le temps, son oeuvre marquante de la même façon que la « Vie héroïque de Guynemer » contribue à sauver Henry Bordeaux de l'oubli où sombrent ses romans, que les biographies d'André Maurois survivent mieux que ses romans et que « Marie-Antoinette » immortalise Stefan Zweig.
Une biographie assure-t-elle à son auteur une pérennité supérieure à celle d'un roman ?
PS : mon analyse de l'étude que Mgr Jean-Claude Boulanger consacre à la spiritualité de Charles de Foucauld
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Le titre de l'ouvrage souligne les deux dimensions du personnage.
Explorateur au Maroc, Foucauld est un géographe qui établit la première cartographie du royaume et publia une étude remarquable, honorée d'un prix de la société de géographie, qui montre la curiosité et l'attention aux autres de celui qui parcourut à pied le Maroc. Sa découverte des Marocains et de leur religiosité joua un rôle important dans sa conversion.
Ermite au Sahara, frère Charles vécut humblement et pauvrement au milieu des esclaves et des défavorisés au coeur du Sahara et finit assassiné durant la première guerre mondiale.
Cette biographie contribua à la notoriété du martyre et fut la première pierre du long chemin qui mena à sa canonisation et associe la mémoire de l'écrivain à celle du religieux.
La mémoire de Bazin est également attachée à ses romans « La terre qui meurt » et « Les Oberlé » mais je me demande si cette biographie ne sera pas, dans le temps, son oeuvre marquante de la même façon que la « Vie héroïque de Guynemer » contribue à sauver Henry Bordeaux de l'oubli où sombrent ses romans, que les biographies d'André Maurois survivent mieux que ses romans et que « Marie-Antoinette » immortalise Stefan Zweig.
Une biographie assure-t-elle à son auteur une pérennité supérieure à celle d'un roman ?
PS : mon analyse de l'étude que Mgr Jean-Claude Boulanger consacre à la spiritualité de Charles de Foucauld
Lien : https://www.babelio.com/livr..
De Saint Paul à Saint François d'Assise en passant par Saint Augustin, les vies de saint racontent souvent la même histoire : une jeunesse impie, une conversion et une vie exemplaire. le bienheureux Charles de Foucauld a d'abord été militaire, élève de Saint-Cyr (dans la même promo que Pétain), puis explorateur au Maroc, incroyant ; il est devenu moine trappiste sur le tard, dans une extrême contrition. Il était attiré par une solitude et une mortification que n'assouvissait pas la vie monacale. On peut dire qu'il est donc retourné aux sources de l'érémitisme chrétien: la vie dans le désert.
L'Eglise se méfie de ces extrêmes humilités qui peuvent cacher un grand orgueil, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais Charles de Foucauld s'est toujours soumis à sa hiérarchie et c'est selon la volonté de l'Eglise et dans un contexte très particulier qu'il est parti, hors de toute communauté, littéralement prêcher dans le désert. de bonnes intentions, il n'en manquait pas, il a racheté avec ses pauvres moyens quelques esclaves, il a tenté quelques douces conversions par l'exemple sans beaucoup de résultat ; l'Afrique du Nord était toujours hermétique au christianisme, malgré la présence française en Algérie depuis 1830. Il écrit en 1905 : « Au Maroc, grand comme la France, avec dix millions d'habitants, pas un seul prêtre à l'intérieur ; au Sahara, sept ou huit fois grand comme la France et bien plus peuplé qu'on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires ! Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci… ».
On peut accuser les Français de tous les maux en Afrique du Nord, mais certainement pas d'avoir fait du prosélytisme religieux, et si aucun effort n'avait été fait jusqu'en 1905, tout esprit sensé pouvait juger que rien ne serait jamais fait de ce côté-là. Charles de Foucauld était une exception, il croyait dur comme fer à la mission civilisatrice de la France : « Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons, au lieu d'exploiter, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc seront, dans cinquante ans, un prolongement de la France. Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l'union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. »
Cependant, il se faisait peu d'illusions sur la conversion des Arabes musulmans, au contraire il voyait leur influence s'accroître. C'est plutôt sur les antiques Berbères, dont la foi lui paraissait plus superficielle, qu'il comptait s'appuyer pour introduire le christianisme. Il part donc s'installer à Tamanrasset, un village de « vingt feux », deux trois maisons et quelques tentes, en plein milieu des territoires touareg du Hoggar, seul. Dans cette solitude, son action ne pouvait se limiter qu'à la simple présence et l'exemple d'une vie humble et charitable. René Bazin évoque des rumeurs selon lesquelles le Père de Foucauld aurait poussé la tolérance de l'Islam jusqu'à réciter des versets du Coran lors de funérailles, il le nie, mais il rapporte aussi le témoignage d'un certain docteur Hérisson qui a vu Charles de Foucauld encourager quelques musulmans tièdes à faire leur prière. Voilà où il en était, à essayer de rendre ces nomades sédentaires, à leur apprendre à récolter la nourriture, la laine et à ne pas perdre tout lien avec la religion, quelle qu'elle soit. La base : se rendre acceptable par ses bienfaits. Et aussi préparer la voie aux futurs missionnaires en étudiant la langue et la culture. Il a écrit un dictionnaire et traduit des poésies.
Avec tout ce qu'il s'est passé en un siècle, on rêve beaucoup sur ce qu'aurait pu devenir l'Afrique du Nord, si les conseils du Père de Foucauld avaient été suivis et sans quelques évènements. Il ne s'agit pas tellement de la loi sur la laïcité, que René Bazin semble déplorer. Elle n'a certainement pas favorisée les missionnaires, mais s'il n'y en avait que cinquante-six en 1910, ce n'était pas la faute à cette loi, c'est qu'il n'y avait jamais eu une réelle volonté de christianiser ces colonies avant. C'est toujours l'exploitation économique qui avait primée, comme le regrettait Charles de Foucauld. Par contre, il y a les guerres européennes et l'Allemagne dépourvue d'empire colonial, qui ont certainement jouées un grand rôle dans le processus de décolonisation, à commencer par la mort du Père de Foucauld.
L'Eglise se méfie de ces extrêmes humilités qui peuvent cacher un grand orgueil, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais Charles de Foucauld s'est toujours soumis à sa hiérarchie et c'est selon la volonté de l'Eglise et dans un contexte très particulier qu'il est parti, hors de toute communauté, littéralement prêcher dans le désert. de bonnes intentions, il n'en manquait pas, il a racheté avec ses pauvres moyens quelques esclaves, il a tenté quelques douces conversions par l'exemple sans beaucoup de résultat ; l'Afrique du Nord était toujours hermétique au christianisme, malgré la présence française en Algérie depuis 1830. Il écrit en 1905 : « Au Maroc, grand comme la France, avec dix millions d'habitants, pas un seul prêtre à l'intérieur ; au Sahara, sept ou huit fois grand comme la France et bien plus peuplé qu'on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires ! Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci… ».
On peut accuser les Français de tous les maux en Afrique du Nord, mais certainement pas d'avoir fait du prosélytisme religieux, et si aucun effort n'avait été fait jusqu'en 1905, tout esprit sensé pouvait juger que rien ne serait jamais fait de ce côté-là. Charles de Foucauld était une exception, il croyait dur comme fer à la mission civilisatrice de la France : « Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons, au lieu d'exploiter, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc seront, dans cinquante ans, un prolongement de la France. Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l'union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. »
Cependant, il se faisait peu d'illusions sur la conversion des Arabes musulmans, au contraire il voyait leur influence s'accroître. C'est plutôt sur les antiques Berbères, dont la foi lui paraissait plus superficielle, qu'il comptait s'appuyer pour introduire le christianisme. Il part donc s'installer à Tamanrasset, un village de « vingt feux », deux trois maisons et quelques tentes, en plein milieu des territoires touareg du Hoggar, seul. Dans cette solitude, son action ne pouvait se limiter qu'à la simple présence et l'exemple d'une vie humble et charitable. René Bazin évoque des rumeurs selon lesquelles le Père de Foucauld aurait poussé la tolérance de l'Islam jusqu'à réciter des versets du Coran lors de funérailles, il le nie, mais il rapporte aussi le témoignage d'un certain docteur Hérisson qui a vu Charles de Foucauld encourager quelques musulmans tièdes à faire leur prière. Voilà où il en était, à essayer de rendre ces nomades sédentaires, à leur apprendre à récolter la nourriture, la laine et à ne pas perdre tout lien avec la religion, quelle qu'elle soit. La base : se rendre acceptable par ses bienfaits. Et aussi préparer la voie aux futurs missionnaires en étudiant la langue et la culture. Il a écrit un dictionnaire et traduit des poésies.
Avec tout ce qu'il s'est passé en un siècle, on rêve beaucoup sur ce qu'aurait pu devenir l'Afrique du Nord, si les conseils du Père de Foucauld avaient été suivis et sans quelques évènements. Il ne s'agit pas tellement de la loi sur la laïcité, que René Bazin semble déplorer. Elle n'a certainement pas favorisée les missionnaires, mais s'il n'y en avait que cinquante-six en 1910, ce n'était pas la faute à cette loi, c'est qu'il n'y avait jamais eu une réelle volonté de christianiser ces colonies avant. C'est toujours l'exploitation économique qui avait primée, comme le regrettait Charles de Foucauld. Par contre, il y a les guerres européennes et l'Allemagne dépourvue d'empire colonial, qui ont certainement jouées un grand rôle dans le processus de décolonisation, à commencer par la mort du Père de Foucauld.
Bonne Perrette était une merveilleuse conteuse. Personnage réel de l’enfance de René Bazin, prétexte inventé pour faire de ces nouvelles éparses une gerbe ? Je ne sais, mais j’ai aimé ces contes à la fois divers et tous emprunts d’un charme enfantin.
La première partie du recueil est constituée de souvenirs d’enfances. Des mauvais tours qui auraient pu avoir de fâcheuses conséquences, des espiègleries d’enfants, tous l’expression d’une enfance heureuse passée au grand air à vadrouiller dans les champs, se prendre pour des indiens ou chasser les oiseaux. Rien d’exceptionnel dans ces instants de vie, mais la plume simple et alerte de René Bazin m’a accrochée et je me suis laissée prendre par les jeux de ces enfants, rêvant à une enfance champêtre que je n’ai pas eue et à des fonds de culotte verts d’avoir trop trainé dans l’herbe que j’aurais aimé ramener le soir à la maison.
La seconde partie est consacrée aux contes de bonne Perrette proprement dit. Les histoires qu’elle racontait aux enfants dont elle avait la charge, le petit René et ses trois frères et sœurs. On voyage de la Vendée maritime à la Provence, avec des histoires à la morale très douce. Ce sont ces histoires que l’on racontait j’imagine au coin du feu ou à un enfant pour qu’il s’endorme, des histoires qui paraissent toutes crédibles tellement leur magie est légère, certaines sont même ancrées dans les tristes et nombreux soubresauts de l’histoire du XVIIIème siècle. Il est surtout question de paysans qui peinent pour vivre mais qui savent aimer la douceur de leur vie familiale. Il y a une pointe de patriotisme, nécessaire j’imagine à l’éducation des petits gars de l’époque.
Et si ces histoires sont celles d’un temps où l’on prenait le temps de les raconter, un temps qui peut-être ne reviendra plus, elles peuvent encore prendre le goût des sucettes au caramel comme on en faisait avant, et nous rappeler sans nostalgie que les plaisirs simples existent toujours et sont parfois les meilleurs.
J’ai d’ailleurs aimé m’apercevoir que la première partie, intitulée “Souvenirs d’enfant” (et non “Souvenirs d’enfance”, soulignant le caractère très personnel que René Bazin veut donner à ces nouvelles) se termine sur l’image de la porte de la vitrine qui se ferme définitivement sur une collection d’œufs, comme une porte qui se ferme aussi sur l’enfance, « Et ni l’œuf de la corneille à bec rouge, ni celui d’aucun autre oiseau ne vint plus enrichir ma collection. J’ai fermé la vitrine, et ne l’ai jamais rouverte. » (“La corneille à bec rouge”, Partie 1, “Souvenirs d’enfant”). La seconde partie, elle, celle contenant les “Contes de bonne Perrette” se termine par un retour aux sources : « Justine posa en travers, sur le dos des deux premiers bœufs, l’aiguillon d’autrefois. Dans l’air matinal, quatre noms, lancés à tue-tête par une voix jeune, chaude, heureuse, apprit à la Vendée qu’un de ses fils était de retour : »Caillard, Rougeaud, Mortagne, Maréchaux ! » / Et les bœufs descendirent sagement, bien droit vers la cornouille. » (“Le Retour”, Partie 2, “Contes de bonne Perrette”). C’est comme si ces contes nous ouvraient à nouveau à cette part d’enfant qui sommeille en nous et que nous oublions parfois au fil des ans, mais que la bonne Perrette rouvre pour le petit René, et j’espère que chacun de nous peut penser de temps en temps à sa bonne Perrette à lui ou à elle, pour se souvenir, mais aussi vivre cette insouciance et cette grande aventure qu’est une enfance heureuse.
La première partie du recueil est constituée de souvenirs d’enfances. Des mauvais tours qui auraient pu avoir de fâcheuses conséquences, des espiègleries d’enfants, tous l’expression d’une enfance heureuse passée au grand air à vadrouiller dans les champs, se prendre pour des indiens ou chasser les oiseaux. Rien d’exceptionnel dans ces instants de vie, mais la plume simple et alerte de René Bazin m’a accrochée et je me suis laissée prendre par les jeux de ces enfants, rêvant à une enfance champêtre que je n’ai pas eue et à des fonds de culotte verts d’avoir trop trainé dans l’herbe que j’aurais aimé ramener le soir à la maison.
La seconde partie est consacrée aux contes de bonne Perrette proprement dit. Les histoires qu’elle racontait aux enfants dont elle avait la charge, le petit René et ses trois frères et sœurs. On voyage de la Vendée maritime à la Provence, avec des histoires à la morale très douce. Ce sont ces histoires que l’on racontait j’imagine au coin du feu ou à un enfant pour qu’il s’endorme, des histoires qui paraissent toutes crédibles tellement leur magie est légère, certaines sont même ancrées dans les tristes et nombreux soubresauts de l’histoire du XVIIIème siècle. Il est surtout question de paysans qui peinent pour vivre mais qui savent aimer la douceur de leur vie familiale. Il y a une pointe de patriotisme, nécessaire j’imagine à l’éducation des petits gars de l’époque.
Et si ces histoires sont celles d’un temps où l’on prenait le temps de les raconter, un temps qui peut-être ne reviendra plus, elles peuvent encore prendre le goût des sucettes au caramel comme on en faisait avant, et nous rappeler sans nostalgie que les plaisirs simples existent toujours et sont parfois les meilleurs.
J’ai d’ailleurs aimé m’apercevoir que la première partie, intitulée “Souvenirs d’enfant” (et non “Souvenirs d’enfance”, soulignant le caractère très personnel que René Bazin veut donner à ces nouvelles) se termine sur l’image de la porte de la vitrine qui se ferme définitivement sur une collection d’œufs, comme une porte qui se ferme aussi sur l’enfance, « Et ni l’œuf de la corneille à bec rouge, ni celui d’aucun autre oiseau ne vint plus enrichir ma collection. J’ai fermé la vitrine, et ne l’ai jamais rouverte. » (“La corneille à bec rouge”, Partie 1, “Souvenirs d’enfant”). La seconde partie, elle, celle contenant les “Contes de bonne Perrette” se termine par un retour aux sources : « Justine posa en travers, sur le dos des deux premiers bœufs, l’aiguillon d’autrefois. Dans l’air matinal, quatre noms, lancés à tue-tête par une voix jeune, chaude, heureuse, apprit à la Vendée qu’un de ses fils était de retour : »Caillard, Rougeaud, Mortagne, Maréchaux ! » / Et les bœufs descendirent sagement, bien droit vers la cornouille. » (“Le Retour”, Partie 2, “Contes de bonne Perrette”). C’est comme si ces contes nous ouvraient à nouveau à cette part d’enfant qui sommeille en nous et que nous oublions parfois au fil des ans, mais que la bonne Perrette rouvre pour le petit René, et j’espère que chacun de nous peut penser de temps en temps à sa bonne Perrette à lui ou à elle, pour se souvenir, mais aussi vivre cette insouciance et cette grande aventure qu’est une enfance heureuse.
Roman peu connu de Bazin, il n'a d'ailleurs aucune critique, il n'en demeure pas moins très intéressant.
Nous suivons Davidée, jeune institutrice qui arrive dans un village pour débuter sa carrière.
Elle sera attachée à ses élèves, ce qui ne doit pas se faire, elle discutera avec un curé, ce qui ne doit absolument pas se faire dans ces temps où l'école est devenue laïque et strictement laïque.
Et elle tombera amoureuse doucement d'un homme, qui, si aux 1ers abords n'est pas fréquentable, il n'aura de cesse de lui monter son humanité et son amour.
Beaucoup de thèmes abordés dans ce livre mais un goût d'inachevé ..
Je reviens tout de même sur mon avis parce que je ne parle pas du personnage central, Davidee qui est une jeune femme pleine de force, d'espérance et d'humanité. J'ai adoré ce petit bout de femme !
Nous suivons Davidée, jeune institutrice qui arrive dans un village pour débuter sa carrière.
Elle sera attachée à ses élèves, ce qui ne doit pas se faire, elle discutera avec un curé, ce qui ne doit absolument pas se faire dans ces temps où l'école est devenue laïque et strictement laïque.
Et elle tombera amoureuse doucement d'un homme, qui, si aux 1ers abords n'est pas fréquentable, il n'aura de cesse de lui monter son humanité et son amour.
Beaucoup de thèmes abordés dans ce livre mais un goût d'inachevé ..
Je reviens tout de même sur mon avis parce que je ne parle pas du personnage central, Davidee qui est une jeune femme pleine de force, d'espérance et d'humanité. J'ai adoré ce petit bout de femme !
Un livre qui commençait bien, dans le milieu ouvrier de la fin du XIXème siècle à Nantes. Un livre qui commençait comme un gentil roman de terroir. Dommage qu’il vire un peu trop à la bondieuserie et à la belle et noble charité impossible à être critiquée ou même seulement questionnée.
Cela reste cependant une lecture agréable et facile. Un style classique avec des phrases amples qui confinent parfois au pédantisme. Il était temps, au bout d’à peine trois-cents courtes pages, que le livre s’arrête avant de tomber trop profondément dans la mièvrerie.
Cela reste cependant une lecture agréable et facile. Un style classique avec des phrases amples qui confinent parfois au pédantisme. Il était temps, au bout d’à peine trois-cents courtes pages, que le livre s’arrête avant de tomber trop profondément dans la mièvrerie.
« Eh bien ! mademoiselle, c’est précisément parce qu’ils n’attendent rien de l’autre vie qu’ils réclament leurs droits dans celle-ci. »
Un roman ancien qui parle du monde des ouvriers -et des ouvrières, dans la région nantaise à la fin du 19ème siècle. Eux face à l’ingratitude des patrons d’entreprise qui rechignent à leur accorder une pension à l’occasion d’un accident de travail (zavaient qu’à faire attention, aussi pff) et elles, jeunesses foudroyées dont les yeux se meurent dix heures par jour sur une étoffe qu’elles ne porteront jamais, petit monde des couturières ayant pourtant l’énergie de leur fraicheur pour créer des modèles uniques. J’ai trouvé ce roman très tourné vers la condition des femmes, la modiste qui souhaite devenir première des petites mains, la femme du patron de l’entreprise qui est rabaissée par son époux intransigeant, la jeune fille abusée par le jeune bourgeois qui va devenir le maître de l’usine, ou encore celle rejetée par sa mère qui n’a plus les moyens de subvenir à leurs besoins, obligée de quitter Paris pour Nantes. Drame bien construit autour d’un non-dit qui phagocyte bien des destins, j’ai lu avec plaisir ce roman dont l’écriture est splendide.
Un roman ancien qui parle du monde des ouvriers -et des ouvrières, dans la région nantaise à la fin du 19ème siècle. Eux face à l’ingratitude des patrons d’entreprise qui rechignent à leur accorder une pension à l’occasion d’un accident de travail (zavaient qu’à faire attention, aussi pff) et elles, jeunesses foudroyées dont les yeux se meurent dix heures par jour sur une étoffe qu’elles ne porteront jamais, petit monde des couturières ayant pourtant l’énergie de leur fraicheur pour créer des modèles uniques. J’ai trouvé ce roman très tourné vers la condition des femmes, la modiste qui souhaite devenir première des petites mains, la femme du patron de l’entreprise qui est rabaissée par son époux intransigeant, la jeune fille abusée par le jeune bourgeois qui va devenir le maître de l’usine, ou encore celle rejetée par sa mère qui n’a plus les moyens de subvenir à leurs besoins, obligée de quitter Paris pour Nantes. Drame bien construit autour d’un non-dit qui phagocyte bien des destins, j’ai lu avec plaisir ce roman dont l’écriture est splendide.
Au début de l'autre siècle, en Bretagne, la closerie de Ros Grignon est tenue par un jeune couple composé de Jean Louarn et de son épouse Donatienne. Ils vivent chichement sur cette petite ferme de quatre hectares, ne ménagent ni leur temps ni leur peine mais connaissent pourtant la misère et les fins de mois difficile. Donatienne vient juste d'accoucher de son troisième enfant quand arrive une lettre de Paris lui proposant une place de nourrice chez un médecin aisé. La mort dans l'âme, la jeune femme accepte de quitter enfants et mari dans l'espoir d'améliorer par son sacrifice le sort de sa famille. Jean doit embaucher une petite servante pour s'occuper des enfants et travailler deux fois plus sur des terres dont il n'arrive pas à payer la location. Quatre mois passent. Aucune nouvelle de Donatienne. Aucun argent n'arrive. Les dettes s'accumulant, un huissier vient saisir les biens de la famille. Il ne reste plus d'autre solution à Jean que de partir sur les routes avec les deux petits dans une charrette et l'aînée à ses côtés pour aller louer ses bras ici et là sans savoir s'il pourra retrouver sa femme un jour.
Un très beau roman de terroir plein de tendresse et d'humanité comme on n'en écrit plus de nos jours. Une tragédie de la pauvreté à une époque où la Bretagne était une des régions les plus pauvres de France, où les femmes venaient se louer comme nourrices dans la capitale et où les hommes émigraient vers des provinces moins pauvres dans l'espoir d'y trouver un peu de travail. Les personnages de Donatienne et de Jean sont attachants. Le lecteur découvrira que même si la pauvre Bretonne s'est laissée griser par les sortilèges d'une vie plus douce et plus facile et même si Jean s'est retrouvé dans la peau d'une sorte de « père courage », tous deux ne sont en fait que d'innocentes victimes d'un sort contraire, de la pauvreté et de l'injustice sociale. René Bazin montre dans ce livre des accents humanistes dignes d'un Emile Zola ou d'un Victor Hugo. Une écriture claire, limpide, particulièrement agréable. Un livre qui n'a pas pris une seule ride. A conseiller aux fans d'Anglade, Bordes, Michelet et autres Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Un très beau roman de terroir plein de tendresse et d'humanité comme on n'en écrit plus de nos jours. Une tragédie de la pauvreté à une époque où la Bretagne était une des régions les plus pauvres de France, où les femmes venaient se louer comme nourrices dans la capitale et où les hommes émigraient vers des provinces moins pauvres dans l'espoir d'y trouver un peu de travail. Les personnages de Donatienne et de Jean sont attachants. Le lecteur découvrira que même si la pauvre Bretonne s'est laissée griser par les sortilèges d'une vie plus douce et plus facile et même si Jean s'est retrouvé dans la peau d'une sorte de « père courage », tous deux ne sont en fait que d'innocentes victimes d'un sort contraire, de la pauvreté et de l'injustice sociale. René Bazin montre dans ce livre des accents humanistes dignes d'un Emile Zola ou d'un Victor Hugo. Une écriture claire, limpide, particulièrement agréable. Un livre qui n'a pas pris une seule ride. A conseiller aux fans d'Anglade, Bordes, Michelet et autres Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Histoire d'amour dans la paysannerie bretonne du XIXe siècle, tout autant centrée sur Donatienne que sur son époux, Jean Louarn. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, l'histoire n'est nullement brodée de bons sentiments, les personnages sont ambigus, prennent des mauvaises décisions, subissent des coups du sort terribles. L'auteur laisse quelquefois échapper des saillies de moralisme, mais elles ne gâchent nullement l'expérience littéraire. Le style de l'ouvrage est très agréable. J'en conseille la lecture.
Un magnifique roman de compagne très touchant! Comment vivre aisément une histoire d'amour sans argent, surtout en milieu rural où l'effort physique n'est pas toujours proportionnel au résultat escompté! Nous sommes dans la Bretagne, le couple habitant la closerie de Ros Grignon est assailli de dettes au risque de voir un jour leur propriété hypothéquée ou saisie...Donatienne se propose comme nourrice pour aider son mari à faire face à la situation, seulement elle trouve une place à Paris, elle devra quitter sa région! O Paris! Ville de toutes les possibilités, de toutes les perversions! ...Donatienne sera-t-elle engloutie par ces lueurs vives de Paris ou se souviendra-t-elle de son mari et de ses trois enfants?!!
Cette première découverte de René Bazin m'a tellement emballée que je me suis empressée d'en commencer un deuxième.
Il y a d'abord cette écriture somptueuse, pas encore moderne mais plus tout à fait 19ème, qui fait le charme des beaux romans du début du dernier siècle.
Il y a ensuite ce climat dur de campagne miséreuse, qui pose un décor puissant à l'intrigue, tragique : le couple Louarn survit avec difficulté avec ses trois enfants dans leur ferme qui peine à nourrir la famille, malgré le travail harassant du père. Voilà que la mère, Donatienne, à qui sa famille a reproché de s'être mariée en dessous de ses ambitions, sent de nouveau pulser en elle l'énergie de sa jeune vie quand arrive de Paris une réponse favorable à son offre de faire la nourrice pour ramener un peu d'argent.
Donatienne partie, Jean reste seul à la ferme avec les enfants, et l'attend. Il travaille avec plus de vigueur encore, mais les dettes continuent de s'accumuler. Donatienne ne revient pas...
Coup de coeur de l'été pour ce roman social qui, bien qu'assez manichéen dans l'approche morale de son sujet, met en scène deux personnages fortement incarnés, autant dans l'attachement du père à ses valeurs de responsabilité familiale et de labeur que dans la complexité des aspirations et revirements de Donatienne.
Il y a d'abord cette écriture somptueuse, pas encore moderne mais plus tout à fait 19ème, qui fait le charme des beaux romans du début du dernier siècle.
Il y a ensuite ce climat dur de campagne miséreuse, qui pose un décor puissant à l'intrigue, tragique : le couple Louarn survit avec difficulté avec ses trois enfants dans leur ferme qui peine à nourrir la famille, malgré le travail harassant du père. Voilà que la mère, Donatienne, à qui sa famille a reproché de s'être mariée en dessous de ses ambitions, sent de nouveau pulser en elle l'énergie de sa jeune vie quand arrive de Paris une réponse favorable à son offre de faire la nourrice pour ramener un peu d'argent.
Donatienne partie, Jean reste seul à la ferme avec les enfants, et l'attend. Il travaille avec plus de vigueur encore, mais les dettes continuent de s'accumuler. Donatienne ne revient pas...
Coup de coeur de l'été pour ce roman social qui, bien qu'assez manichéen dans l'approche morale de son sujet, met en scène deux personnages fortement incarnés, autant dans l'attachement du père à ses valeurs de responsabilité familiale et de labeur que dans la complexité des aspirations et revirements de Donatienne.
BAZIN, RENé : Donatienne - Romans
Donatienne est l'histoire d'une jeune bretonne mariée et mère de famille qui part à la ville comme nourrice pour aider financièrement son mari et ses enfants. Happée par le tourbillon des conversations des autres bonnes, par leur amoralité, enivrée par le luxe, l'argent gagné sans efforts, elle oublie les siens et devient la maîtresse d'un valet déluré. Son mari chassé par la misère de sa ferme erre sur les routes avec les trois enfants et finit par échouer en Auvergne où il travaille comme manoeuvre dans une carrière...
Donatienne est un personnage complexe et très humain avec ses failles et son courage. Ce personnage a parcouru un cycle de vie et de réflexions. Désir de fuir l'enfermement et la misère de la campagne, fascination de la ville et du luxe, oubli et mépris de son origine et de ses valeurs, échec, malheur, remords, solitude, remise en cause puis décision et enfin retrouvailles avec les siens et sa culture. La coiffe bretonne étant le symbole de son appartenance culturelle, elle la retire sous les moqueries des camarades en arrivant à Paris et la remet quand elle retrouve les siens. Ce roman, certes moraliste, s'attache à décrire, comme ceux des naturalistes, la condition sociale des bonnes, leurs logements, les bureaux de placement mais s'attarde aussi sur l'intériorité, la psychologie de Donatienne et surtout la complexité de son cheminement. La chute et la rédemption réunissent en un même personnage les figures de Madeleine et de Marie et lui confèrent une richesse qui l'éloigne de la caricature.
Édition conjointe Ebooks libres et gratuits et l'Association des amis de René Bazin. - Parution le 28/11/2009
Mobipocket : 171 Ko | eReader : 180 Ko | PDF : 562 Ko | Source Word : 276 Ko | HTML : 309 Ko | Sony Reader : 179 Ko | ePub : 132 Ko
Lien : http://www.ebooksgratuits.co..
Donatienne est l'histoire d'une jeune bretonne mariée et mère de famille qui part à la ville comme nourrice pour aider financièrement son mari et ses enfants. Happée par le tourbillon des conversations des autres bonnes, par leur amoralité, enivrée par le luxe, l'argent gagné sans efforts, elle oublie les siens et devient la maîtresse d'un valet déluré. Son mari chassé par la misère de sa ferme erre sur les routes avec les trois enfants et finit par échouer en Auvergne où il travaille comme manoeuvre dans une carrière...
Donatienne est un personnage complexe et très humain avec ses failles et son courage. Ce personnage a parcouru un cycle de vie et de réflexions. Désir de fuir l'enfermement et la misère de la campagne, fascination de la ville et du luxe, oubli et mépris de son origine et de ses valeurs, échec, malheur, remords, solitude, remise en cause puis décision et enfin retrouvailles avec les siens et sa culture. La coiffe bretonne étant le symbole de son appartenance culturelle, elle la retire sous les moqueries des camarades en arrivant à Paris et la remet quand elle retrouve les siens. Ce roman, certes moraliste, s'attache à décrire, comme ceux des naturalistes, la condition sociale des bonnes, leurs logements, les bureaux de placement mais s'attarde aussi sur l'intériorité, la psychologie de Donatienne et surtout la complexité de son cheminement. La chute et la rédemption réunissent en un même personnage les figures de Madeleine et de Marie et lui confèrent une richesse qui l'éloigne de la caricature.
Édition conjointe Ebooks libres et gratuits et l'Association des amis de René Bazin. - Parution le 28/11/2009
Mobipocket : 171 Ko | eReader : 180 Ko | PDF : 562 Ko | Source Word : 276 Ko | HTML : 309 Ko | Sony Reader : 179 Ko | ePub : 132 Ko
Lien : http://www.ebooksgratuits.co..
"Donatienne" est un très beau roman qui se partage entre Bretagne, Paris et Creuse. Jean et Donatienne forment un couple d'agriculteurs pauvres limite nécessiteux. Ils vivent sur une lande chiche, élève trois jeunes enfants et peinent à survivre. Lorsque Donatienne reçoit une offre d'embauche en qualité de nourrice dans une famille bourgeoise de Paris, le couple n'hésite pas longtemps et Donatienne, abandonnant à contrecœur mari et enfants, "monte à la capitale". Le contraste que cette dernière offre entre la vie bretonne de la jeune femme et sa nouvelle condition de nourrice nantie est tel que Donatienne perd la tête et décide de tourner le dos au passé, se refusant à retourner auprès des siens.
Ce roman est d'une étonnante modernité et d'une grande sensibilité. Il explore le thème de la famille et de la précarité, et dresse aussi une figure de femme à contrecourant. Le récit s'attache aussi à Jean, le mari délaissé et contraint d'errer sur les chemins avec ses enfants pour gagner son pain. Cette galerie de personnages touchants et attachants offre une large palette d'émotions et de personnalités bien fouillées.
Les descriptions de la Bretagne et des autres lieux sont réalistes et picturales, juste belles. Le ton est juste lui aussi, le rythme bon. Il y a quelque chose de "Rémi sans famille" et d'Emile Zola dans "Donatienne" qui m'a fait beaucoup apprécier cette lecture très humaine.
Challenge XXème siècle 2022
Challenge XIXème siècle 2022
Ce roman est d'une étonnante modernité et d'une grande sensibilité. Il explore le thème de la famille et de la précarité, et dresse aussi une figure de femme à contrecourant. Le récit s'attache aussi à Jean, le mari délaissé et contraint d'errer sur les chemins avec ses enfants pour gagner son pain. Cette galerie de personnages touchants et attachants offre une large palette d'émotions et de personnalités bien fouillées.
Les descriptions de la Bretagne et des autres lieux sont réalistes et picturales, juste belles. Le ton est juste lui aussi, le rythme bon. Il y a quelque chose de "Rémi sans famille" et d'Emile Zola dans "Donatienne" qui m'a fait beaucoup apprécier cette lecture très humaine.
Challenge XXème siècle 2022
Challenge XIXème siècle 2022
L'intérêt de ce journal est de témoigner de ce que fut la réaction d'un intellectuel catholique à la guerre et d'en suivre l'évolution.
Au début de l'autre siècle, cinq religieuses, soeurs de Sainte Hildegarde, consacrent leur vie à éduquer des petites filles défavorisées d'un quartier populaire du vieux Lyon. Tout un petit monde d'ouvriers, de canuts et d'employés de manufactures fait appel à elles pour toutes sortes de menus services, de soutien moral voire d'aides matérielles diverses et variées. Jusqu'au jour où elles apprennent que, par décision des autorités politiques, leur école doit être définitivement fermée. Les soeurs espèrent pouvoir se réfugier dans leur maison-mère située à Clermont-Ferrand, mais cela s'avère impossible faute de place. Par la force injuste des choses, elles se retrouvent rendues à la vie civile, sans argent, sans famille et dispersées aux quatre coins de la France. Pour survivre, elles en sont réduites à accepter les travaux les plus ingrats, les tâches les plus rebutantes et les statuts sociaux les plus humbles. Seule soeur Léonide, l''ancienne tourière, pourra retrouver une place d'enseignante. Soeur Pascale, la plus douce et la plus jolie des cinq, devra subir un authentique calvaire...
« L'isolée » est un roman comme plus personne n'en écrit de nos jours. Bien que publié en 1905, il reste intéressant par les thèmes abordés : les conséquences des mesures de laïcisation de la société, les tentatives de destruction des congrégations et la volonté étatique d'extirper toute religion et toute solidarité d'un peuple encore croyant quitte à répandre injustice et malheur parmi les plus déshérités, sans oublier le mystère de l'appel de Dieu, de la vocation religieuse et de la voie de la souffrance et du martyre. Certains pourront penser que l'on nage dans la bien-pensance et la bondieuserie. Pourtant, à une époque gorgée d'hédonisme, dopée de violence et aveuglée par la haine de soi et le mépris de l'autre, un peu de fraîcheur d'âme, d'idéal, de solidarité et même de dévouement pour son prochain font encore l'effet d'une bien agréable brise un jour de canicule. La langue de Bazin est d'une fort belle élégance et d'une grande pureté ce qui permet une lecture agréable et fluide. L'intérêt se maintient de bout en bout d'autant plus facilement que le lecteur se sent tout de suite pris d'empathie pour ces cinq femmes et tout particulièrement pour le personnage de la malheureuse Pascale. Seul marque de l'outrage du temps : une certaine lenteur ; un auteur moderne aurait raconté la même chose sous forme d'une nouvelle ou d'une novella qui aurait utilisé moitié moins de pages. Chaque époque vit à son rythme ; nul doute que la nôtre est un tantinet plus rapide...
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
« L'isolée » est un roman comme plus personne n'en écrit de nos jours. Bien que publié en 1905, il reste intéressant par les thèmes abordés : les conséquences des mesures de laïcisation de la société, les tentatives de destruction des congrégations et la volonté étatique d'extirper toute religion et toute solidarité d'un peuple encore croyant quitte à répandre injustice et malheur parmi les plus déshérités, sans oublier le mystère de l'appel de Dieu, de la vocation religieuse et de la voie de la souffrance et du martyre. Certains pourront penser que l'on nage dans la bien-pensance et la bondieuserie. Pourtant, à une époque gorgée d'hédonisme, dopée de violence et aveuglée par la haine de soi et le mépris de l'autre, un peu de fraîcheur d'âme, d'idéal, de solidarité et même de dévouement pour son prochain font encore l'effet d'une bien agréable brise un jour de canicule. La langue de Bazin est d'une fort belle élégance et d'une grande pureté ce qui permet une lecture agréable et fluide. L'intérêt se maintient de bout en bout d'autant plus facilement que le lecteur se sent tout de suite pris d'empathie pour ces cinq femmes et tout particulièrement pour le personnage de la malheureuse Pascale. Seul marque de l'outrage du temps : une certaine lenteur ; un auteur moderne aurait raconté la même chose sous forme d'une nouvelle ou d'une novella qui aurait utilisé moitié moins de pages. Chaque époque vit à son rythme ; nul doute que la nôtre est un tantinet plus rapide...
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Roman avec peu de personnages qui pose la question de la foi profonde qui se démarque ou pas de celle de façade ou celle qu'on a reçue en héritage familial. Le temps évoqué est celui de la jeunesse à l'heure des choix de vie.
Roman d'un autre temps, qui décrit des sentiments exaltés et purs. Récit de doutes et de choix très bien écrit.
Roman d'un autre temps, qui décrit des sentiments exaltés et purs. Récit de doutes et de choix très bien écrit.
j en suis à la moitie et j aime cette étude de moeurs ou la moralité prime
Ecrit juste avant le Premier conflit mondial – et revu en 1928, lors de sa reparution –, ce texte à destination des « écoliers de France » exalte précisément la France, depuis ses métiers, quelques grandes figures, ses fêtes religieuses jusqu’à ses conquêtes et ses batailles dans les contrées lointaines d’Amérique, d’Afrique et d’Extrême-Orient.
Certes, à notre époque, on peut être décontenancé par ce ton déclamatoire et très chrétien, mais il faut replacer ledit texte dans son contexte, c’est-à-dire à une époque où l’amour de sa patrie n’était pas aussi suspect que de nos jours.
Toutefois, des phrases sonnent étrangement juste. Comment, par exemple, à la lumière de la désertification de nos campagnes, ne pas adhérer à ce compliment adressé au facteur : « Il y aurait sans vous, dans le monde, moins de fraternité » ?
Oui, Jeanne d’Arc et Jean-François Millet y sont encensés pour leur ferveur religieuse, Pâques, où l’on doit avoir « l’âme fleurie, comme les genêts », est aussi vanté, comme le christianisme en général, mais en ce temps-là on ne niait pas nos origines.
Oui, encore, on peut s’étonner de lire autant d’incitations au sacrifice de sa vie pour son pays à destination d’enfants – affirmant que « c’est au cœur des jeunes que les idées héroïques germent le plus vite » –, mais il est des phrases qui résonnent encore aujourd’hui avec force et qu’il faudrait rétablir dans les écoles : « L’habitude de penser à la France est un secours humain qui a soutenu beaucoup de bons Français, même en dehors des champs de bataille, aux heures de lassitude, dans l’épreuve exceptionnelle ou commune. »
René Bazin aime charnellement la France et entend le faire savoir aux plus jeunes, tantôt solennellement, tantôt joyeusement en faisant danser les fuseaux des dentelières : « Votre bruit est aussi plein de promesses que le bruit des moulins. »
Et puis il y a la France glorieuse, que l’auteur met en avant – dans l’attente, sans doute, d’un conflit avec l’Allemagne qui se précise de plus en plus à l’époque –, citant ces exemples de soldats valeureux du Sahara ou de Pékin – pendant la révolte des Boxers, qui étaient cependant légitimes à vouloir chasser les colons de chez eux. Car, se dirait le plus retors des lecteurs, peut-on, dans le même livre, défendre Jeanne chassant les Anglais et ne pas comprendre que d’autres l’imitent, même si c’est à nos dépens ?
Ce qui n’interdit pas de tordre le cou à certaines idées reçues, une note rappelant que la France ne s’est pas invitée en Algérie pour le seul plaisir de conquérir un territoire : « C’est en 1830 que Charles X prit la décision d’éradiquer à sa source le problème des pirates barbaresques qui désolaient les rivages de la Méditerranée, par la conquête de l’Algérie. »
Bazin réclame par ailleurs à cor et à cri le retour de l’Alsace-Lorraine – alors allemande – dans le giron national. Une Alsace-Lorraine dont l’auteur chante le sentiment français et « qui n’a de révolté que son idéal ; qui demande la liberté d’aimer ce que nous aimons, et de se souvenir de nous ». Lors de la réédition de La Douce France, il se félicitera du retour en France de ces « magnifiques » provinces, restées fidèles à la Mère-patrie, écrit-il.
Il y a aussi les regrets, ceux notamment d’avoir délaissé et perdu les territoires français d’Amérique (histoire narrée par Alain Dubos dans L’épopée américaine de la France: histoires de la Nouvelle-France).
C’était un autre temps, avant que l’Europe ne s’effondre, depuis les tranchées jusqu’aux plages du Débarquement, et se laisse ensuite diluer dans une mondialisation qui détruit les identités des peuples au profit d’une poignée de milliardaires. Et ce temps-là, si nous nous sentons assez français – quelle que soit la couleur de notre peau ou notre origine –, nous ne pouvons que le regretter.
Ce remarquable roman national mérite enfin d’être lu parce qu’il dit combien la France est grande, malgré ce que de vulgaires détracteurs, vivant à ses crochets, prétendent !
Certes, à notre époque, on peut être décontenancé par ce ton déclamatoire et très chrétien, mais il faut replacer ledit texte dans son contexte, c’est-à-dire à une époque où l’amour de sa patrie n’était pas aussi suspect que de nos jours.
Toutefois, des phrases sonnent étrangement juste. Comment, par exemple, à la lumière de la désertification de nos campagnes, ne pas adhérer à ce compliment adressé au facteur : « Il y aurait sans vous, dans le monde, moins de fraternité » ?
Oui, Jeanne d’Arc et Jean-François Millet y sont encensés pour leur ferveur religieuse, Pâques, où l’on doit avoir « l’âme fleurie, comme les genêts », est aussi vanté, comme le christianisme en général, mais en ce temps-là on ne niait pas nos origines.
Oui, encore, on peut s’étonner de lire autant d’incitations au sacrifice de sa vie pour son pays à destination d’enfants – affirmant que « c’est au cœur des jeunes que les idées héroïques germent le plus vite » –, mais il est des phrases qui résonnent encore aujourd’hui avec force et qu’il faudrait rétablir dans les écoles : « L’habitude de penser à la France est un secours humain qui a soutenu beaucoup de bons Français, même en dehors des champs de bataille, aux heures de lassitude, dans l’épreuve exceptionnelle ou commune. »
René Bazin aime charnellement la France et entend le faire savoir aux plus jeunes, tantôt solennellement, tantôt joyeusement en faisant danser les fuseaux des dentelières : « Votre bruit est aussi plein de promesses que le bruit des moulins. »
Et puis il y a la France glorieuse, que l’auteur met en avant – dans l’attente, sans doute, d’un conflit avec l’Allemagne qui se précise de plus en plus à l’époque –, citant ces exemples de soldats valeureux du Sahara ou de Pékin – pendant la révolte des Boxers, qui étaient cependant légitimes à vouloir chasser les colons de chez eux. Car, se dirait le plus retors des lecteurs, peut-on, dans le même livre, défendre Jeanne chassant les Anglais et ne pas comprendre que d’autres l’imitent, même si c’est à nos dépens ?
Ce qui n’interdit pas de tordre le cou à certaines idées reçues, une note rappelant que la France ne s’est pas invitée en Algérie pour le seul plaisir de conquérir un territoire : « C’est en 1830 que Charles X prit la décision d’éradiquer à sa source le problème des pirates barbaresques qui désolaient les rivages de la Méditerranée, par la conquête de l’Algérie. »
Bazin réclame par ailleurs à cor et à cri le retour de l’Alsace-Lorraine – alors allemande – dans le giron national. Une Alsace-Lorraine dont l’auteur chante le sentiment français et « qui n’a de révolté que son idéal ; qui demande la liberté d’aimer ce que nous aimons, et de se souvenir de nous ». Lors de la réédition de La Douce France, il se félicitera du retour en France de ces « magnifiques » provinces, restées fidèles à la Mère-patrie, écrit-il.
Il y a aussi les regrets, ceux notamment d’avoir délaissé et perdu les territoires français d’Amérique (histoire narrée par Alain Dubos dans L’épopée américaine de la France: histoires de la Nouvelle-France).
C’était un autre temps, avant que l’Europe ne s’effondre, depuis les tranchées jusqu’aux plages du Débarquement, et se laisse ensuite diluer dans une mondialisation qui détruit les identités des peuples au profit d’une poignée de milliardaires. Et ce temps-là, si nous nous sentons assez français – quelle que soit la couleur de notre peau ou notre origine –, nous ne pouvons que le regretter.
Ce remarquable roman national mérite enfin d’être lu parce qu’il dit combien la France est grande, malgré ce que de vulgaires détracteurs, vivant à ses crochets, prétendent !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de René Bazin
Quiz
Voir plus
Culture générale facile
Qui était surnommé le Roi Soleil ?
Louis XVI
Louis XIV
François 1e
11 questions
66 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture généraleCréer un quiz sur cet auteur66 lecteurs ont répondu