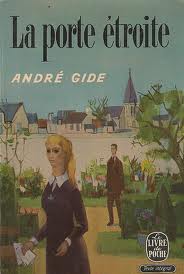L'éléphant est au milieu du couloir pendant tout le livre et pourtant il n'est presque jamais désigné. Un bout de patte à la dernière page « Elle prétend que c'est lui [l'enfant Ali] qui surtout me retient ici. Peut-être a-t-elle un peu raison… » et un aperçu fugace d'une défense quand on apprend, au détour d'une phrase, que Michel embrasse un jeune garçon. Au final il est question en termes voilés d'une jeune homme très très conventionnel et cérébral, coincé, marié pour satisfaire son père mourant et qui, à l'occasion d'un voyage de santé au Maghreb découvre son corps et celui des mineurs des alentours. Ce non-dit très bourgeois, très vingtième siècle, m'a gêné pour apprécier complètement le texte (ou est-ce la pédophilie du personnage ?). Pourtant le style de Gide est agréable à lire, tout classique qu'il est avec des subjonctifs imparfaits et des tournures un peu surannées. Au final, les pages se tournent quand même facilement et le livre fait réfléchir à la morale, au sens de la vie…
Peut-on vraiment parler d'immoralité quand on lit la vie fragmentée Michel qui tente de fuir ses vices dans le voyage ? Il trouve une femme, apprend à l'aimer, s'enquit de quiconque le fréquente, est charitable et érudit. Pourtant, si les vicissitudes de cette pauvre âme nous semblent aisément dissimulées, elles demeurent frappantes sous une plume sans réserve qui fait croire à l'autobiographie. Après tout, c'est comme si nous étions un des amis de Michel à qui il conte l'histoire, et nous aussi, nous vivons le deuil de sa femme. Tout est si réel : on respire quand il exhale, on se gèle quand il prend peur, on brûle quand il est déjà calciné.. C'est presque un livre à lire à l'envers, il est en miroir, il me semble, et les 50 dernières pages, ainsi que les 50 premières montrent la circularité de cette vie.
— Lors de ses noces en Afrique, Michel tombe gravement malade. En réchappant à la mort, il comprend la nécessité d'une véritable renaissance – une palingénésie – en s'affranchissant de sa culture. Au contact du jeune Moktir s'opère sa métamorphose vers l'affirmation de soi. Il ne réagit pas lorsque le garçon vole les ciseaux de Marceline. le retour en Normandie ne fait que confirmer sa lassitude à l'égard de son propre savoir ; l'"homme civilisé" qu'il fut ne lui correspond plus. Et l'oasis africain de l'attirer de nouveau pour retrouver son "être authentique", achevant sa conversion à l'immoralisme, sans retour en arrière possible.
L'immoraliste conte les voyages d'un intellectuel français de France en Afrique du Nord en passant par l'Italie puis le retour vers la France et la Normandie avant de retourner en Afrique du Nord.
Dans ce court roman, nous avons une narration étrange où plusieurs comparses font un long voyage pour retrouver un ami mystérieux, Michel dans une village perdu du Nord de l'Afrique. Il conte ensuite ses deux-trois dernières années de vie à ses amis les questionnant au final sa moralité.
On se demande bien comment il a rencontré ses amis et entretenu ses liens d'amitiés alors qu'ils sont absents de ces trois années de récession. peut-être sont-ce davantage des apôtres imaginaires, des êtres vaporeux à qui il soumet ses choix au cours de ces trois dernières années de vie.
Toujours est-il que l'on suit donc les tribulations de Michel qui épouse Marceline pour faire plaisir à son père mourant. Scientifique brillant, il s'en va ensuite sur les traces de ses terrains de recherche accompagné de sa jeune épouse. Malade, elle s'occupera de lui et il s'y attachera mais aussi des nombreux jeunes garçons qu'il rencontrera au cours de son existence.
Un moment charnière fut celui du vol de ciseaux par un de ces enfants de passage. Dès cet instant, le chapardeur devient son favori et le "vice" de l'immoralité commence à étreindre Michel alors que l'état de santé de Marceline commence à se dégrader. Cause à effet?
Il tente alors de jouer les maris modèles, les patrons de ferme, les intellectuels à Paris pour s'éloigner toujours plus de ces idéaux-types. le retour vers l'Afrique du Nord est alors le paroxysme de cette transformation immorale. fait-il se voyage pour continuer des explorations scientifiques? le fait-il pour la santé de sa femme? ou le fait-il pour retrouver le garçon au ciseaux dont on lui a reparlé à Paris. Menalque, un scientifique parisien désavoué lui compte est parti sur ces traces avant de lui-même repartir en mission de recherche.
Ce Ménalque est finalement un autre lui-même, serait-il un personnage inventé pour faire de lui le surhomme qu'il n'est pas.
Les allusions sexuelles sont de plus en plus explicites au fur et à mesure de la lecture pour s'accélérer brusquement vers la fin du livre comme pour signifier l'acte, le choix de l'immoralité.
Un livre très intriguant à lire car il ne s'y passe pas grand chose, aucun personnage n'est attachant et on ne comprend que vers la fin où l'auteur veut nous mener. Heureusement que le roman est court.
Quelques réflexions aussi stimulantes sur le poids du souvenir et du passé comme impossibilité de penser le présent ou l'avenir.
Dans ce court roman, nous avons une narration étrange où plusieurs comparses font un long voyage pour retrouver un ami mystérieux, Michel dans une village perdu du Nord de l'Afrique. Il conte ensuite ses deux-trois dernières années de vie à ses amis les questionnant au final sa moralité.
On se demande bien comment il a rencontré ses amis et entretenu ses liens d'amitiés alors qu'ils sont absents de ces trois années de récession. peut-être sont-ce davantage des apôtres imaginaires, des êtres vaporeux à qui il soumet ses choix au cours de ces trois dernières années de vie.
Toujours est-il que l'on suit donc les tribulations de Michel qui épouse Marceline pour faire plaisir à son père mourant. Scientifique brillant, il s'en va ensuite sur les traces de ses terrains de recherche accompagné de sa jeune épouse. Malade, elle s'occupera de lui et il s'y attachera mais aussi des nombreux jeunes garçons qu'il rencontrera au cours de son existence.
Un moment charnière fut celui du vol de ciseaux par un de ces enfants de passage. Dès cet instant, le chapardeur devient son favori et le "vice" de l'immoralité commence à étreindre Michel alors que l'état de santé de Marceline commence à se dégrader. Cause à effet?
Il tente alors de jouer les maris modèles, les patrons de ferme, les intellectuels à Paris pour s'éloigner toujours plus de ces idéaux-types. le retour vers l'Afrique du Nord est alors le paroxysme de cette transformation immorale. fait-il se voyage pour continuer des explorations scientifiques? le fait-il pour la santé de sa femme? ou le fait-il pour retrouver le garçon au ciseaux dont on lui a reparlé à Paris. Menalque, un scientifique parisien désavoué lui compte est parti sur ces traces avant de lui-même repartir en mission de recherche.
Ce Ménalque est finalement un autre lui-même, serait-il un personnage inventé pour faire de lui le surhomme qu'il n'est pas.
Les allusions sexuelles sont de plus en plus explicites au fur et à mesure de la lecture pour s'accélérer brusquement vers la fin du livre comme pour signifier l'acte, le choix de l'immoralité.
Un livre très intriguant à lire car il ne s'y passe pas grand chose, aucun personnage n'est attachant et on ne comprend que vers la fin où l'auteur veut nous mener. Heureusement que le roman est court.
Quelques réflexions aussi stimulantes sur le poids du souvenir et du passé comme impossibilité de penser le présent ou l'avenir.
Une exploration des frontières morales.
L'Immoraliste, oeuvre magistrale d'André Gide, s'ouvre sur le journal intime de Michel, jeune homme en quête de soi-même. Accompagné de son épouse Marceline, il entreprend un voyage en Afrique du Nord. Ce périple, loin d'être une simple exploration géographique, devient une plongée profonde dans les méandres de l'âme de Michel. Au fil des pages, le protagoniste émerge de l'ombre des conventions sociales, s'affranchissant des normes morales pour embrasser une existence authentique.
L'Immoraliste se distingue par son exploration subtile des thèmes de la moralité et de l'authenticité. Gide utilise le personnage de Michel pour sonder les profondeurs de l'identité individuelle et questionner les contraintes imposées par la société. le récit, narré de manière introspective, offre une fenêtre sur les conflits intérieurs de Michel, entre les attentes sociales et ses propres désirs. L'auteur, par le biais de Michel, interroge la nature changeante de la morale, soulignant la nécessité de se libérer des entraves conventionnelles pour atteindre une véritable compréhension de soi.
Les descriptions minutieuses de l'environnement exotique renforcent la métaphore du voyage comme exploration intérieure. le désert, avec ses étendues arides, devient le terrain symbolique où Michel abandonne les dogmes moraux comme autant de mirages. L'utilisation habile du symbolisme et de l'allégorie par Gide enrichit l'expérience de lecture, invitant le lecteur à plonger au-delà de la surface narrative.
L'Immoraliste captive par son exploration audacieuse de la psyché humaine et des normes sociales. Gide offre un récit qui résiste à la simplicité, éveillant des questions profondes sur la nature de la moralité et de l'authenticité. Cependant, la nature controversée du protagoniste pourrait dérouter, suscitant des réactions mitigées. L'on pourraient percevoir Michel comme un rebelle courageux, bravant les conventions pour trouver sa vérité, tandis que d'autres pourraient le condamner comme égoïste et éthiquement défaillant.
La prose raffinée de Gide, bien que magnifique, peut parfois défier la compréhension immédiate, nécessitant une lecture attentive. Cependant, cette complexité linguistique contribue à la richesse de l'oeuvre pour ceux prêts à s'immerger dans ses nuances.
En somme, l'Immoraliste offre une exploration captivante et provocante qui invite le lecteur à remettre en question les fondements mêmes de la moralité, tout en offrant une expérience littéraire exigeante mais gratifiante.
Michel.
Lien : https://fureur-de-lire.blogs..
L'Immoraliste, oeuvre magistrale d'André Gide, s'ouvre sur le journal intime de Michel, jeune homme en quête de soi-même. Accompagné de son épouse Marceline, il entreprend un voyage en Afrique du Nord. Ce périple, loin d'être une simple exploration géographique, devient une plongée profonde dans les méandres de l'âme de Michel. Au fil des pages, le protagoniste émerge de l'ombre des conventions sociales, s'affranchissant des normes morales pour embrasser une existence authentique.
L'Immoraliste se distingue par son exploration subtile des thèmes de la moralité et de l'authenticité. Gide utilise le personnage de Michel pour sonder les profondeurs de l'identité individuelle et questionner les contraintes imposées par la société. le récit, narré de manière introspective, offre une fenêtre sur les conflits intérieurs de Michel, entre les attentes sociales et ses propres désirs. L'auteur, par le biais de Michel, interroge la nature changeante de la morale, soulignant la nécessité de se libérer des entraves conventionnelles pour atteindre une véritable compréhension de soi.
Les descriptions minutieuses de l'environnement exotique renforcent la métaphore du voyage comme exploration intérieure. le désert, avec ses étendues arides, devient le terrain symbolique où Michel abandonne les dogmes moraux comme autant de mirages. L'utilisation habile du symbolisme et de l'allégorie par Gide enrichit l'expérience de lecture, invitant le lecteur à plonger au-delà de la surface narrative.
L'Immoraliste captive par son exploration audacieuse de la psyché humaine et des normes sociales. Gide offre un récit qui résiste à la simplicité, éveillant des questions profondes sur la nature de la moralité et de l'authenticité. Cependant, la nature controversée du protagoniste pourrait dérouter, suscitant des réactions mitigées. L'on pourraient percevoir Michel comme un rebelle courageux, bravant les conventions pour trouver sa vérité, tandis que d'autres pourraient le condamner comme égoïste et éthiquement défaillant.
La prose raffinée de Gide, bien que magnifique, peut parfois défier la compréhension immédiate, nécessitant une lecture attentive. Cependant, cette complexité linguistique contribue à la richesse de l'oeuvre pour ceux prêts à s'immerger dans ses nuances.
En somme, l'Immoraliste offre une exploration captivante et provocante qui invite le lecteur à remettre en question les fondements mêmes de la moralité, tout en offrant une expérience littéraire exigeante mais gratifiante.
Michel.
Lien : https://fureur-de-lire.blogs..
Quel bonheur de découvrir André Gide. Il fait partie de ces auteurs que j'ai boudé plus jeune. J'ai trouvé l'immoraliste dans une boîte à livres et je m'empresserai de lire ses autres oeuvres.
Son style d'écriture est impeccable, c'est beau. C'est une touchante histoire, proche de la vie de l'auteur. On voyage avec lui. On est transposé à une autre époque. Super !
Son style d'écriture est impeccable, c'est beau. C'est une touchante histoire, proche de la vie de l'auteur. On voyage avec lui. On est transposé à une autre époque. Super !
Un style éblouissant, surtout dans la première moitié du livre, et vers la fin. La mort du père sans doute au début du récit, et qui précède le frôlement de sa propre mort durant son voyage de noces (début pressenti d'une vie conforme et sans surprises ?) entraîne un besoin de vivre jusqu'à l'ivresse chez notre héros. Mais comment ? Rejet du passé, d'abord sous une forme attenuée puis presque définitive, absolue, dans un second temps ; notre personnage retourne cependant sur ses pas, et les traces de son nouvel éveil vers la fin du roman - boucle géographique à défaut de pouvoir être réellement temporelle. Ce qui rend cette lecture parfois irritante c'est, je trouve, le contraste qui se pose de plus en plus entre ce style donc éblouissant, l'éclatante beauté des lieux, l'absolu de certains personnages, la grandeur des situations... et le héros qui finalement n'entame que très peu la morale, par de misérables accrocs, reste au bord des possibles, et se voit donc déçu toujours par tout nouveau cadre rempli de promesses (et le lecteur, la lectrice avec lui), ce qui l'amène chaque fois et jusqu'à la fin à devoir se trouver un autre cadre.
Le héros honnêtement ne cherche qu'à se découvrir, puisqu'il sent qu'il se méconnaît à présent. Il se laisse guider par ses sensations, cherchant le plaisir mais en effet sans y plonger comme on longerait sans fin la rive d'un cours d'eau ayant grand soif mais ne s'autorisant qu'une gorgée avant de s'éloigner et de chercher chaque fois une autre rivière.
Le personnage n'est pas égoïste, il est pris d'une nécessité avec laquelle il compose, bassement plutôt que de manière éclatante. Il ne quitte pas sa femme Marceline et l'entoure de soins autant que possible de soins, d'amour. On voudrait qu'il s'en sépare pour une relation homosexuelle franche (vers la fin du livre, il ne s'autorise qu'un baiser furtif avec un jeune cocher). Il n'en a pas le courage... Non : il semble qu'il n'en ait pas la pensée, simplement quelques traces de désirs et de sensations. Il frôle les interdits, les nuits où l'on croit chaque fois qu'il se passera quelque chose de marquant, de révélateur. Mais non, non... le roman est déceptif comme la vie ( pourtant a priori grandiose) peut l'être si l'on ne réussit pas à mettre des mots sur ses désirs et aspirations, restant dans le pressentiment d'autres possibles, condamnés à ne chercher en une chasse obstinée quotidienne que des sensations fugaces, maigres ou abondantes pitances, selon les jours. L'époque aide à mettre la vie, sa vie en mots ou pas. Et les écrivains, écrivaines sont aux premières loges pour s'y employer, chacun, chacune en son époque. Comme Gide.
Le héros honnêtement ne cherche qu'à se découvrir, puisqu'il sent qu'il se méconnaît à présent. Il se laisse guider par ses sensations, cherchant le plaisir mais en effet sans y plonger comme on longerait sans fin la rive d'un cours d'eau ayant grand soif mais ne s'autorisant qu'une gorgée avant de s'éloigner et de chercher chaque fois une autre rivière.
Le personnage n'est pas égoïste, il est pris d'une nécessité avec laquelle il compose, bassement plutôt que de manière éclatante. Il ne quitte pas sa femme Marceline et l'entoure de soins autant que possible de soins, d'amour. On voudrait qu'il s'en sépare pour une relation homosexuelle franche (vers la fin du livre, il ne s'autorise qu'un baiser furtif avec un jeune cocher). Il n'en a pas le courage... Non : il semble qu'il n'en ait pas la pensée, simplement quelques traces de désirs et de sensations. Il frôle les interdits, les nuits où l'on croit chaque fois qu'il se passera quelque chose de marquant, de révélateur. Mais non, non... le roman est déceptif comme la vie ( pourtant a priori grandiose) peut l'être si l'on ne réussit pas à mettre des mots sur ses désirs et aspirations, restant dans le pressentiment d'autres possibles, condamnés à ne chercher en une chasse obstinée quotidienne que des sensations fugaces, maigres ou abondantes pitances, selon les jours. L'époque aide à mettre la vie, sa vie en mots ou pas. Et les écrivains, écrivaines sont aux premières loges pour s'y employer, chacun, chacune en son époque. Comme Gide.
Pédophile ! Un mot terrible en 2023...
Mais en 1902, au Maghreb, avec des petits garçons pauvres, que dit la loi ? Dit-elle quelque chose ?
Immoraliste, peut-être... C'est tout.
Et encore, ce n'est pas à cause de ça que Michel se sent immoral, car les enfants rient parce qu'il leur donne des piécettes.
Il se sent immoral parce que.... Mais je ne vais pas divulgâcher, comme on dit !
Divulgâcher, un beau mot-valise que j'ai appris sur un site de lecture comprenant beaucoup de Québecois : évidemment, l'anglais "spoiler" est une trahison envers les cousins de France.
Le verbe anglais to spoil, « gâcher, abimer », est issu de l'ancien français espoillier, lui-même issu du latin spoliare.
.
Revenons au livre :
sans vraiment divulgâcher, je vais analyser cette oeuvre à ma façon... Ah oui, c'est du divulgâchage quand même ? Oh, et puis zut !
J'ai ajouté une étoile, car, parti d'un rythme lent que je n'aime pas, tout s'accétère vers la fin : Michel recherche la vraie vie comme je l'ai fait un certain temps, lui s'étourdissant de petits garçons arabes puis un petit Normand, avant de revenir aux petits Arabes ; moi avec les femmes...
Malade au début du livre, frôlant l'aile de la mort, mais soigné par sa femme Marceline, Michel pense qu'en devenant un important chercheur en civilisation gothique ( les Goths d'Athalaric, pas les jeunes gens habillés de noir en 2023 ), il se révèle.
Mais, discutant avec Ménalque, personnage récurrent chez André Gide, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de vie : la Culture, n'est pas la vie, elle fait illusion et elle détruit la vie.
Alors, TGV embarquant derrière lui sa femme malade de la tuberculose, se sentant coupable et essayant de lui porter plein d'attentions malgré tout, il court après la vraie vie !
Docteur Jekyll le jour, Mister Hyde la nuit...
Pour employer les mots que j'utilise dans "L'homme cardinal", il est déchiré entre son cerveau et ses tripes ; son "surmoi" et son "ça", cherchant son véritable "moi", son coeur, son homme cardinal.
Le "Das" est quelque chose de terrible ! Mais il est, quelque part, la création : sans lui, point de déchirement, point de cri, point de révolte, comme pour moi, l'homme cardinal qui fut un volcan, évidemment crachant de tous les côtés. Pas étonnant qu'une prof de philo ait dit :
"Ce n'est pas de la philo, ça !"
Evidemment, ce n'est pas une dissertation dans les règles de l'art comme je l'apprends à mes jeunes élèves en cours de soutien, qui passent le bac de Français. C'est une révolte, c'est ma révolution française, comme "L'immoraliste" est peut être la révolution d'André Gide comme le suggère peut être "Stratégies narratives de l'aveu homosexuel dans les autobiographies d'André Gide et Julien Green" : ici, la stratégie consiste à rejeter la "faute morale" non pas sur l'homosexualité, mais sur la fureur de vivre ( James Dean, ou Cyril Collard, auteur de "Les nuits fauves" ) du TGV Michel ( André Gide ? ) qui traîne coupablement son wagon ( "elle est lasse" est répété au moins 20 fois dans le livre ) Marceline derrière lui....
... Alors que la cure en Suisse commençait à la guérir... Mais la Suisse est trop calme pour un fou comme Michel...
Mais en 1902, au Maghreb, avec des petits garçons pauvres, que dit la loi ? Dit-elle quelque chose ?
Immoraliste, peut-être... C'est tout.
Et encore, ce n'est pas à cause de ça que Michel se sent immoral, car les enfants rient parce qu'il leur donne des piécettes.
Il se sent immoral parce que.... Mais je ne vais pas divulgâcher, comme on dit !
Divulgâcher, un beau mot-valise que j'ai appris sur un site de lecture comprenant beaucoup de Québecois : évidemment, l'anglais "spoiler" est une trahison envers les cousins de France.
Le verbe anglais to spoil, « gâcher, abimer », est issu de l'ancien français espoillier, lui-même issu du latin spoliare.
.
Revenons au livre :
sans vraiment divulgâcher, je vais analyser cette oeuvre à ma façon... Ah oui, c'est du divulgâchage quand même ? Oh, et puis zut !
J'ai ajouté une étoile, car, parti d'un rythme lent que je n'aime pas, tout s'accétère vers la fin : Michel recherche la vraie vie comme je l'ai fait un certain temps, lui s'étourdissant de petits garçons arabes puis un petit Normand, avant de revenir aux petits Arabes ; moi avec les femmes...
Malade au début du livre, frôlant l'aile de la mort, mais soigné par sa femme Marceline, Michel pense qu'en devenant un important chercheur en civilisation gothique ( les Goths d'Athalaric, pas les jeunes gens habillés de noir en 2023 ), il se révèle.
Mais, discutant avec Ménalque, personnage récurrent chez André Gide, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de vie : la Culture, n'est pas la vie, elle fait illusion et elle détruit la vie.
Alors, TGV embarquant derrière lui sa femme malade de la tuberculose, se sentant coupable et essayant de lui porter plein d'attentions malgré tout, il court après la vraie vie !
Docteur Jekyll le jour, Mister Hyde la nuit...
Pour employer les mots que j'utilise dans "L'homme cardinal", il est déchiré entre son cerveau et ses tripes ; son "surmoi" et son "ça", cherchant son véritable "moi", son coeur, son homme cardinal.
Le "Das" est quelque chose de terrible ! Mais il est, quelque part, la création : sans lui, point de déchirement, point de cri, point de révolte, comme pour moi, l'homme cardinal qui fut un volcan, évidemment crachant de tous les côtés. Pas étonnant qu'une prof de philo ait dit :
"Ce n'est pas de la philo, ça !"
Evidemment, ce n'est pas une dissertation dans les règles de l'art comme je l'apprends à mes jeunes élèves en cours de soutien, qui passent le bac de Français. C'est une révolte, c'est ma révolution française, comme "L'immoraliste" est peut être la révolution d'André Gide comme le suggère peut être "Stratégies narratives de l'aveu homosexuel dans les autobiographies d'André Gide et Julien Green" : ici, la stratégie consiste à rejeter la "faute morale" non pas sur l'homosexualité, mais sur la fureur de vivre ( James Dean, ou Cyril Collard, auteur de "Les nuits fauves" ) du TGV Michel ( André Gide ? ) qui traîne coupablement son wagon ( "elle est lasse" est répété au moins 20 fois dans le livre ) Marceline derrière lui....
... Alors que la cure en Suisse commençait à la guérir... Mais la Suisse est trop calme pour un fou comme Michel...
L'Immoraliste/André Gide
Dans ce roman psychologique autobiographique universellement connu publié en 1902, André Gide use de la technique du récit enchâssé c'est à dire que le récit de Michel est introduit par un tiers qui lui rend visite en Algérie avec d'autres amis.
Michel a besoin de parler, de se confier, de se libérer, de plaider son innocence au cours de cet examen de conscience tourmenté.
C'est la nuit aux portes du désert au coeur de l'oasis….
La dernière fois que les amis se sont rencontrés, c'était lors du mariage de Michel avec Marcelline, une très jolie femme, douce et tendre. Un mariage un peu contraint pour Michel, afin de faire plaisir à son père.
Michel, lui le bourgeois, fait carrière dans l'étude des civilisations antiques et son père a tracé sa voie pour lui.
De voyages en voyages avec sa tendre épouse qu'il commence à aimer, de la Tunisie à l'Italie, Michel tombe malade. Son épouse prend soin de lui et ils partent en Algérie pour bénéficier d'un meilleur climat. Convalescent, ils repartent pour la Sicile puis l'Algérie.
Au cours de ses pérégrinations, rétabli, Michel se découvre un nouveau corps, un nouvel être qui avait été étouffé par une éducation huguenote très puritaine.
Il veut assumer ses pulsions amorales, au mépris de tout ordre social et de sa vie conjugale. Il lui faut rejeter toutes contraintes sociales et morales. Mais à quoi va lui servir cette liberté ?
Ce récit qui fait partie des grands classiques que je relis pour la troisième fois est bien sûr parfaitement écrit : on ne vante plus le style sobre et clair de Gide.
Il n'est pas douteux que le parcours de Michel puisse se calquer sur celui d'André Gide lui-même, dont l'amoralisme nietzschéen restera en pointillé tout en affirmant sa liberté intérieure.
« Savoir se libérer n'est rien ; l'ardu, c'est savoir être libre. »
Dans ce roman psychologique autobiographique universellement connu publié en 1902, André Gide use de la technique du récit enchâssé c'est à dire que le récit de Michel est introduit par un tiers qui lui rend visite en Algérie avec d'autres amis.
Michel a besoin de parler, de se confier, de se libérer, de plaider son innocence au cours de cet examen de conscience tourmenté.
C'est la nuit aux portes du désert au coeur de l'oasis….
La dernière fois que les amis se sont rencontrés, c'était lors du mariage de Michel avec Marcelline, une très jolie femme, douce et tendre. Un mariage un peu contraint pour Michel, afin de faire plaisir à son père.
Michel, lui le bourgeois, fait carrière dans l'étude des civilisations antiques et son père a tracé sa voie pour lui.
De voyages en voyages avec sa tendre épouse qu'il commence à aimer, de la Tunisie à l'Italie, Michel tombe malade. Son épouse prend soin de lui et ils partent en Algérie pour bénéficier d'un meilleur climat. Convalescent, ils repartent pour la Sicile puis l'Algérie.
Au cours de ses pérégrinations, rétabli, Michel se découvre un nouveau corps, un nouvel être qui avait été étouffé par une éducation huguenote très puritaine.
Il veut assumer ses pulsions amorales, au mépris de tout ordre social et de sa vie conjugale. Il lui faut rejeter toutes contraintes sociales et morales. Mais à quoi va lui servir cette liberté ?
Ce récit qui fait partie des grands classiques que je relis pour la troisième fois est bien sûr parfaitement écrit : on ne vante plus le style sobre et clair de Gide.
Il n'est pas douteux que le parcours de Michel puisse se calquer sur celui d'André Gide lui-même, dont l'amoralisme nietzschéen restera en pointillé tout en affirmant sa liberté intérieure.
« Savoir se libérer n'est rien ; l'ardu, c'est savoir être libre. »
Je ne connaissais pas l'oeuve d'André Gide, si n'est par des lectures imposées pendant les années collège (Les Faux-Monnayeurs, auxquels je n'ai vraiment rien compris). Il me paraissait donc durablement ennuyant...
Je m'attaque donc à cet auteur très classique, tout en étant porteur d'une réputation iconoclaste, voire sulfureuse. Amoureux puis époux de sa cousine Madeleine, ayant fait plus tard son coming out en tant qu'homosexuel à tendance pédophile, s'étant déclaré communiste jusqu'à son voyage en URSS qui le fit changer d'avis, André Gide ne s'est pas facilité la tâche à une époque de grande rigidité morale que fut la IIIe République jusqu'à la Première Guerre.
En 1902, il publie l'Immoraliste, oeuvre avec laquelle il aborde la vie de couple, ou plutôt le parcours de l'individu au sein de celle-ci.
La question qui vient immédiatement, est celle de découvrir en quoi Michel, le narrateur, est un immoraliste, quelqu'un d'immoral (ou d'amoral plutôt?)
On le retrouve avec sa nouvelle épouse, Marceline, en Algérie, à Biskra, où il tombe gravement malade. Marceline est très belle, attentionnée, le couple est fort. Mais Michel aime à s'entourer des jeunes garçons de l'oasis proche. Cela réveille sa vitalité et il s'en retrouve petit à petit guéri. Cette attirance peut être qualifiée de pédophilie (on dit “pédérastie” à cette époque) et elle se heurte à l'éducation protestante très rigide de Michel. D'avoir été guéri, insuffle à Michel un nouvel élan: désormais, il abandonnera la morale et suivra ses pulsions.
Michel et Marceline quittent ensuite l'Algérie pour se retrouver en Italie (de laquelle il décrit de façon magnifique la côte amalfitaine, Ravello en particulier), en Normandie sur les terres familiales, à Paris, puis un retour final en Algérie. Pendant tout ce périple, Michel continue sa conquête de liberté individuelle au détriment de la morale. Son individualité passe avant toute autre considération. Sa vie est faite d'oisiveté et de décisions incongrues, dans lesquelles il n'obéit qu'à ses sens ... Sans doute est-ce cela également, l'absence de morale qu'évoque le titre: ne suivre que ses propres envies, y faire plier les autres et partir quand ses volontés sont contrariées.
Durant le séjour à Paris, Michel, devenu professeur de philologie, domaine dans lequel il est une sommité, rencontre Ménalque, un de ses étudiants. Il fera avec ce dernier de très riches échanges. Ces discussions font entrer des éléments philosophiques dans cet ouvrage. Il est notamment beaucoup question de liberté, ce qu'elle sous entend, comment parvenir à la faire sienne, qu'en faire une fois conquise. Ce sont les passages les plus intéressants du livre. Je vous livre celui-ci en pâture: “... mais la plupart d'entre eux pensent n'obtenir d'eux-mêmes rien de bon que par la contrainte; ils ne se plaisent que contrefaits. C'est à soi-même que chacun prétend le moins ressembler. Chacun se propose un patron, puis l'imite; même il ne choisit pas le patron qu'il imite; il accepte le patron choisi”. Ou ce passage ci: “savoir se libérer n'est rien , l'ardu, c'est savoir être libre”. C'est nihiliste, nietzschien même...
Puis, dans le récit, Marceline tombe gravement malade à son tour. Michel, uniquement régi par ses propres désirs et aspirations, ne lui apporte aucun secours, la néglige même, sans que cette mort n'éveille le moindre remords en lui. Son nihilisme atteint son comble...
Le récit est limpide, facile à lire, d'un style suranné, mais beau, simple, sans vocabulaire exagérément complexe. le livre n'a rien de choquant, Gide aborde la pédophilie avec beaucoup de pudeur et de non dits. Malgré cela, je reste sur ma faim, je me suis un peu ennuyé, à l'instar d'ailleurs du Michel du livre.
Voilà donc ma rencontre avec André Gide faite.
Je m'attaque donc à cet auteur très classique, tout en étant porteur d'une réputation iconoclaste, voire sulfureuse. Amoureux puis époux de sa cousine Madeleine, ayant fait plus tard son coming out en tant qu'homosexuel à tendance pédophile, s'étant déclaré communiste jusqu'à son voyage en URSS qui le fit changer d'avis, André Gide ne s'est pas facilité la tâche à une époque de grande rigidité morale que fut la IIIe République jusqu'à la Première Guerre.
En 1902, il publie l'Immoraliste, oeuvre avec laquelle il aborde la vie de couple, ou plutôt le parcours de l'individu au sein de celle-ci.
La question qui vient immédiatement, est celle de découvrir en quoi Michel, le narrateur, est un immoraliste, quelqu'un d'immoral (ou d'amoral plutôt?)
On le retrouve avec sa nouvelle épouse, Marceline, en Algérie, à Biskra, où il tombe gravement malade. Marceline est très belle, attentionnée, le couple est fort. Mais Michel aime à s'entourer des jeunes garçons de l'oasis proche. Cela réveille sa vitalité et il s'en retrouve petit à petit guéri. Cette attirance peut être qualifiée de pédophilie (on dit “pédérastie” à cette époque) et elle se heurte à l'éducation protestante très rigide de Michel. D'avoir été guéri, insuffle à Michel un nouvel élan: désormais, il abandonnera la morale et suivra ses pulsions.
Michel et Marceline quittent ensuite l'Algérie pour se retrouver en Italie (de laquelle il décrit de façon magnifique la côte amalfitaine, Ravello en particulier), en Normandie sur les terres familiales, à Paris, puis un retour final en Algérie. Pendant tout ce périple, Michel continue sa conquête de liberté individuelle au détriment de la morale. Son individualité passe avant toute autre considération. Sa vie est faite d'oisiveté et de décisions incongrues, dans lesquelles il n'obéit qu'à ses sens ... Sans doute est-ce cela également, l'absence de morale qu'évoque le titre: ne suivre que ses propres envies, y faire plier les autres et partir quand ses volontés sont contrariées.
Durant le séjour à Paris, Michel, devenu professeur de philologie, domaine dans lequel il est une sommité, rencontre Ménalque, un de ses étudiants. Il fera avec ce dernier de très riches échanges. Ces discussions font entrer des éléments philosophiques dans cet ouvrage. Il est notamment beaucoup question de liberté, ce qu'elle sous entend, comment parvenir à la faire sienne, qu'en faire une fois conquise. Ce sont les passages les plus intéressants du livre. Je vous livre celui-ci en pâture: “... mais la plupart d'entre eux pensent n'obtenir d'eux-mêmes rien de bon que par la contrainte; ils ne se plaisent que contrefaits. C'est à soi-même que chacun prétend le moins ressembler. Chacun se propose un patron, puis l'imite; même il ne choisit pas le patron qu'il imite; il accepte le patron choisi”. Ou ce passage ci: “savoir se libérer n'est rien , l'ardu, c'est savoir être libre”. C'est nihiliste, nietzschien même...
Puis, dans le récit, Marceline tombe gravement malade à son tour. Michel, uniquement régi par ses propres désirs et aspirations, ne lui apporte aucun secours, la néglige même, sans que cette mort n'éveille le moindre remords en lui. Son nihilisme atteint son comble...
Le récit est limpide, facile à lire, d'un style suranné, mais beau, simple, sans vocabulaire exagérément complexe. le livre n'a rien de choquant, Gide aborde la pédophilie avec beaucoup de pudeur et de non dits. Malgré cela, je reste sur ma faim, je me suis un peu ennuyé, à l'instar d'ailleurs du Michel du livre.
Voilà donc ma rencontre avec André Gide faite.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de André Gide (126)
Voir plus
Quiz
Voir plus
André Gide
Né en ...
1869
1889
1909
1929
10 questions
108 lecteurs ont répondu
Thème :
André GideCréer un quiz sur ce livre108 lecteurs ont répondu