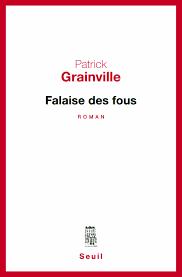>
Critique de Rodin_Marcel
Grainville Patrick (1947-) – "Falaise des fous" – Seuil, 2018 (ISBN 978-2-02-137537-4) – format 15x22cm, 643 p.
de Patrick Grainville, j'ai lu précédemment les romans "L'orgie, la neige " (1990, cf recension du 3 août 2016), "L'atelier du peintre" (1988, cf recension du 2 septembre 2016), "Bison" (2014, cf recension du 29 décembre 2016).
C'est un auteur dont j'apprécie le style, l'écriture, le talent narratif, et, sans doute par-dessus tout, l'aptitude à traduire en texte(s) ce que l'art de la peinture expose en images, couleurs, dessins. Sur ce point, il s'avère excellent, et il faut remonter à Marcel Proust – avec son peintre Elstir – pour trouver un littérateur aussi talentueux. Pour moi qui n'apprécie pas spécialement les impressionnistes, Grainville (lui-même d'origine normande) fournit des liens et accès à ces oeuvres du XIXème siècle, qu'il prend pour thème dans ce roman dont le titre "Falaise des fous" évoque les falaises d'Etretat.
Par ailleurs, avant de rédiger cette recension, j'ai tenu à visiter l'exposition en cours actuellement au musée Marmottan "Collections privées : un voyage des impressionnistes aux fauves" (cf recension).
Toutes ces précautions préliminaires étant prises, force m'est de reconnaître que je suis déçu par ce roman, le (provisoirement) dernier publié par l'auteur.
La tranche chronologique parcourue ici est précisée d'emblée : le narrateur parlant à la forme "je" s'attable en 1927 (cf p. 47, 53) pour consigner les étapes importantes de sa vie depuis sa naissance en 1847 (cf p. 12), une vie relativement sédentaire ayant pour cadre la région d'Etretat, plus largement de Rouen au Havre, avec quelques rares incursions parisiennes (et une escapade, ratée, à New-York pp 264-294). Il résume rapidement sa jeunesse, et la trame s'étoffe à partir de la guerre de 1870 (abordée dès la p. 35) puis de la Commune de Paris.
Dans un premier temps, le récit est largement dominé par deux peintres, Gustave Courbet (1819-1877 – une présentation truculente dès les pages 25-37) et Claude Monet (1840-1926), lors de leurs séjours respectifs en Normandie (Courbet "la vague" de 1869, Monet "la terrasse à Sainte Adresse" de 1867, dont une reproduction constitue la couverture du roman).
Il y aura ensuite des pages remarquables sur le travail de Monet en train de peindre les "falaises à Etretat" entre 1883 et 1886 puis les "cathédrales de Rouen" entre 1892 et 1895.
Bien sûr, Grainville évoque également l'écrivain Maupassant, non seulement par quelques allusions à la présence de cet écrivain en Normandie, mais aussi (et surtout) en insérant une intrigue amoureuse de type "Bel ami" dans son propre récit : le narrateur "compagnonera" sucessivement avec trois femmes, la première étant mariée mais adepte de l'adultère à la Maupassant, la deuxième étant la fille adoptive de la première désireuse de détrôner sa belle-mère, la troisième enfin ayant assumé la fonction de modèle dans les ateliers d'apprentis artistes peintres, les trois se connaissant et se fréquentant (cf p. 346).
Vers la moitié du texte, le roman bascule. L'affaire Dreyfus est d'abord évoquée en passant (p. 313), puis revient (p. 357) pour finir par occuper la plus grande part de l'espace narratif. Là, malheureusement, l'intérêt faiblit nettement : que pourrait bien ajouter un écrivain d'aujourd'hui à la narration de cette affaire connue et si souvent évoquée, entre autres par d'autres écrivains, contemporains eux de l'affaire elle-même, de l'ampleur d'un Zola ou d'un Proust ?
L'auteur délaisse le terrain de la peinture – même s'il évoque largement les postures politiques des peintres impressionnistes anti- ou pro- dreyfusards – pour évoquer ses homologues littérateurs, mais il est en ce domaine nettement moins fécond qu'en causant de peinture.
Vers la fin enfin, il passe à l'évocation de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, et s'expose au même reproche : que pourrait-il bien ajouter après "Le grand troupeau" de Jean Giono (cf recension), "La main coupée" de Blaise Cendrars (cf recension), «Les Croix de bois» de Roland Dorgelès (cf recension), "Im Westen nichts Neues" d' Erich Maria Remarque (cf recension), "Le Don paisible" publié sous le nom de Cholokhov (cf recension), voire un écrit postérieur comme celui de Claude Duneton "Le monument" (cf recension) ?
Pire encore, non seulement il n'évoque aucun de ces ouvrages (publiés certes pour certains après la date de référence de 1927), mais il axe tout son récit sur la publication du "Feu" de Barbusse (cf recension du 11 février 2015), un roman de propagande qui n'est qu'un pamphlet politique très en vogue chez les enseignants franchouillards, écrit par un "planqué de l'arrière", dont les qualités littéraires s'avèrent toutes relatives.
Et Patrick Grainville dérape lorsqu'il laisse échapper une comparaison entre Proust et Barbusse (cf p. 601) qui sombre carrément dans le ridicule : a-t-il vraiment lu "la recherche du temps perdu" jusqu'au bout ?
Au vu des thèmes abordés, des milieux sociaux évoqués, aurait-il voulu se fourvoyer et produire un "complément" voire un "résumé" si ce n'est une "variante" du grand oeuvre proustien ?
A travers le personnage de Gosselin, Grainville copie également Proust en organisant un contrepoint serré entre l'art pictural de l'époque et les "progrès" techniques, qu'il s'agisse de l'apparition de la voiture ou de celle de l'aviation.
Heureusement, il retourne à ce qu'il connaît dans les toutes dernières pages (pp.630-643), évoquant, mêlant, mélangeant Monet et Lindbergh...
Un livre à lire, pour sa première partie...
de Patrick Grainville, j'ai lu précédemment les romans "L'orgie, la neige " (1990, cf recension du 3 août 2016), "L'atelier du peintre" (1988, cf recension du 2 septembre 2016), "Bison" (2014, cf recension du 29 décembre 2016).
C'est un auteur dont j'apprécie le style, l'écriture, le talent narratif, et, sans doute par-dessus tout, l'aptitude à traduire en texte(s) ce que l'art de la peinture expose en images, couleurs, dessins. Sur ce point, il s'avère excellent, et il faut remonter à Marcel Proust – avec son peintre Elstir – pour trouver un littérateur aussi talentueux. Pour moi qui n'apprécie pas spécialement les impressionnistes, Grainville (lui-même d'origine normande) fournit des liens et accès à ces oeuvres du XIXème siècle, qu'il prend pour thème dans ce roman dont le titre "Falaise des fous" évoque les falaises d'Etretat.
Par ailleurs, avant de rédiger cette recension, j'ai tenu à visiter l'exposition en cours actuellement au musée Marmottan "Collections privées : un voyage des impressionnistes aux fauves" (cf recension).
Toutes ces précautions préliminaires étant prises, force m'est de reconnaître que je suis déçu par ce roman, le (provisoirement) dernier publié par l'auteur.
La tranche chronologique parcourue ici est précisée d'emblée : le narrateur parlant à la forme "je" s'attable en 1927 (cf p. 47, 53) pour consigner les étapes importantes de sa vie depuis sa naissance en 1847 (cf p. 12), une vie relativement sédentaire ayant pour cadre la région d'Etretat, plus largement de Rouen au Havre, avec quelques rares incursions parisiennes (et une escapade, ratée, à New-York pp 264-294). Il résume rapidement sa jeunesse, et la trame s'étoffe à partir de la guerre de 1870 (abordée dès la p. 35) puis de la Commune de Paris.
Dans un premier temps, le récit est largement dominé par deux peintres, Gustave Courbet (1819-1877 – une présentation truculente dès les pages 25-37) et Claude Monet (1840-1926), lors de leurs séjours respectifs en Normandie (Courbet "la vague" de 1869, Monet "la terrasse à Sainte Adresse" de 1867, dont une reproduction constitue la couverture du roman).
Il y aura ensuite des pages remarquables sur le travail de Monet en train de peindre les "falaises à Etretat" entre 1883 et 1886 puis les "cathédrales de Rouen" entre 1892 et 1895.
Bien sûr, Grainville évoque également l'écrivain Maupassant, non seulement par quelques allusions à la présence de cet écrivain en Normandie, mais aussi (et surtout) en insérant une intrigue amoureuse de type "Bel ami" dans son propre récit : le narrateur "compagnonera" sucessivement avec trois femmes, la première étant mariée mais adepte de l'adultère à la Maupassant, la deuxième étant la fille adoptive de la première désireuse de détrôner sa belle-mère, la troisième enfin ayant assumé la fonction de modèle dans les ateliers d'apprentis artistes peintres, les trois se connaissant et se fréquentant (cf p. 346).
Vers la moitié du texte, le roman bascule. L'affaire Dreyfus est d'abord évoquée en passant (p. 313), puis revient (p. 357) pour finir par occuper la plus grande part de l'espace narratif. Là, malheureusement, l'intérêt faiblit nettement : que pourrait bien ajouter un écrivain d'aujourd'hui à la narration de cette affaire connue et si souvent évoquée, entre autres par d'autres écrivains, contemporains eux de l'affaire elle-même, de l'ampleur d'un Zola ou d'un Proust ?
L'auteur délaisse le terrain de la peinture – même s'il évoque largement les postures politiques des peintres impressionnistes anti- ou pro- dreyfusards – pour évoquer ses homologues littérateurs, mais il est en ce domaine nettement moins fécond qu'en causant de peinture.
Vers la fin enfin, il passe à l'évocation de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, et s'expose au même reproche : que pourrait-il bien ajouter après "Le grand troupeau" de Jean Giono (cf recension), "La main coupée" de Blaise Cendrars (cf recension), «Les Croix de bois» de Roland Dorgelès (cf recension), "Im Westen nichts Neues" d' Erich Maria Remarque (cf recension), "Le Don paisible" publié sous le nom de Cholokhov (cf recension), voire un écrit postérieur comme celui de Claude Duneton "Le monument" (cf recension) ?
Pire encore, non seulement il n'évoque aucun de ces ouvrages (publiés certes pour certains après la date de référence de 1927), mais il axe tout son récit sur la publication du "Feu" de Barbusse (cf recension du 11 février 2015), un roman de propagande qui n'est qu'un pamphlet politique très en vogue chez les enseignants franchouillards, écrit par un "planqué de l'arrière", dont les qualités littéraires s'avèrent toutes relatives.
Et Patrick Grainville dérape lorsqu'il laisse échapper une comparaison entre Proust et Barbusse (cf p. 601) qui sombre carrément dans le ridicule : a-t-il vraiment lu "la recherche du temps perdu" jusqu'au bout ?
Au vu des thèmes abordés, des milieux sociaux évoqués, aurait-il voulu se fourvoyer et produire un "complément" voire un "résumé" si ce n'est une "variante" du grand oeuvre proustien ?
A travers le personnage de Gosselin, Grainville copie également Proust en organisant un contrepoint serré entre l'art pictural de l'époque et les "progrès" techniques, qu'il s'agisse de l'apparition de la voiture ou de celle de l'aviation.
Heureusement, il retourne à ce qu'il connaît dans les toutes dernières pages (pp.630-643), évoquant, mêlant, mélangeant Monet et Lindbergh...
Un livre à lire, pour sa première partie...