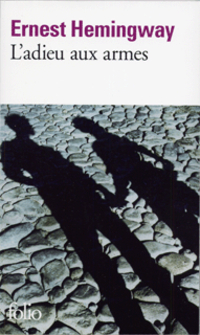Citations sur L'Adieu aux armes (98)
Le vin est une grande chose, dis-je. Ca vous fait oublier tout ce qui est mauvais.
A quoi bon n'être pas blessé, si c'est pour mourir de peur ?
Non. On ne trouve jamais rien. Nous naissons avec tout notre avoir et nous ne changeons jamais. Nous n'acquérons jamais rien de nouveau. Nous sommes complets dès le début.
- Il n'arrive jamais rien aux braves.
- Ils meurent naturellement.
- Oui, mais une fois seulement.
- Ils meurent naturellement.
- Oui, mais une fois seulement.
- […] Dis, mon chéri, est-ce que tu n’aimerais pas te laisser pousser la barbe ?
- Tu voudrais ?
- Ça serait peut-être drôle. J’aimerais te voir avec une barbe.
- C’est bien, je vais la laisser pousser. Je vais commencer tout de suite. C’est une bonne idée. Ca nous donnera quelque chose à faire.
- Tu voudrais ?
- Ça serait peut-être drôle. J’aimerais te voir avec une barbe.
- C’est bien, je vais la laisser pousser. Je vais commencer tout de suite. C’est une bonne idée. Ca nous donnera quelque chose à faire.
C'est quand on est vaincu qu'on devient chrétien.
- Ils étaient battus dès le début. Ils ont été battus le jour où on les a enlevés à leurs fermes pour les enrôler dans l'armée. C'est pour cette raison que le paysan a du bon sens parce qu'il a été vaincu dès le commencement. Donnez-lui le pouvoir et vous verrez ce que deviendra son bon sens.
Nous étions tous fichus. Le gros point était de ne pas l'admettre. La victoire resterait au pays qui serait le dernier à s'apercevoir qu'il était fichu.
Ils me demandèrent si le président Wilson déclarerait la guerre à l'Autriche et je répondis que ce n'était plus qu'une question de jours. Je ne savais point quel griefs nous pouvions avoir contre l'Autriche, mais il me semblait logique qu'on lui déclarât la guerre tout comme à l'Allemagne. Ils me demandèrent si nous déclarerions la guerre à la Turquie. Je répondis que c'était douteux. "Turkey, dis-je, est notre oiseau national" ; mais le calembour traduit était très mauvais ; ils avaient l'air de ne pas comprendre et de se méfier, aussi dis-je que oui, que probablement nous déclarerions la guerre à la Turquie.
"On se battait dans les montagnes, et le soir, nous pouvions apercevoir les éclairs de l'artillerie. Parfois, dans l'obscurité, nous entendions des régiments passer sous nos fenêtres avec des canons traînés par des tracteurs. La nuit, le mouvement était intense.
Les vignes étaient clairsemées, dénudées, et toute la campagne était mouillée et brune, tuée par l'automne. Tout petit et assis entre deux généraux nous apercevions souvent le roi Vittorio Emanuele derrière les vitres de sa voiture qui filait très vite. Il circulait ainsi presque chaque jour pour voir comment allaient les choses. Et les choses allaient très mal.
A l'entrée de l'hiver une pluie persistante se mit à tomber, et la pluie amena le choléra. Mais on put l'enrayer et, en fin de compte, il n'y eut, dans l'armée que sept mille hommes qui en moururent.
Nous étions chargés d'évacuer les blessés et les malades des postes de secours, de les transporter des montagnes aux gares de triage et de les diriger sur les hôpitaux indiqués sur leurs feuilles de route. Evidemment ma présence importait peu. Les chauffeurs des ambulances britanniques étaient tués parfois. Oh ! je savais que je ne serais pas tué. Pas dans cette guerre. Elle ne m'intéressait pas personnellement et elle me semblait pas plus dangereuse qu'une guerre de cinéma.
Miss Barkley était assez grande. Elle portait ce qui pour moi était un uniforme d'infirmière. Elle avait la peau ambrée et des yeux gris. Je la trouvais très belle. Je pensais qu'elle était un peu folle. Personnellement je n'y voyais aucun inconvénient. Peu m'importait l'aventure dans laquelle je me lançais. Je n'avais nulle intention de l'aimer. C'était un peu, comme le bridge, dans lequel on disait des mots au lieu de jouer des cartes. Il fallait faire semblant de jouer pour un enjeu quelconque. Cela me convenait parfaitement.
Le lendemain, on nous dit qu'il allait y avoir une attaque sur la rivière, en amont, et qu'il nous fallait envoyer quatre voitures. Je me trouvais dans la première voiture. Nous garâmes les voitures derrière une briqueterie. Les fours et de grands trous avaient été aménagés en postes de secours. Il faisait noir et, derrière nous, les longs faisceaux des projecteurs autrichiens balayaient les montagnes. Le silence dura quelques minutes, puis tous les canons derrière nous entrèrent en action. Un obus éclata tout près de la rivière. Un autre arriva sur nous, si brusquement que nous eûmes à peine le temps de l'entendre venir.
Le sol était défoncé et, en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête j'entendis quelqu'un crier. J'essayai de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. Dans une éblouissante clarté je voyais les obus à étoile monter, éclater, flotter dans l'air, tout blancs. J'entendis quelqu'un crier " Mamma mia ! Oh ! Mamma mia ! " et vis Passini les jambes broyées au-dessus du genoux. Je compris que j'étais également blessé.
Les Anglais étaient arrivés avec trois ambulances, on m'apporta au poste de secours. Il y avait des odeurs fortes, odeurs de produits chimiques, et la fade odeur du sang. Le soir qui précéda mon départ Rinaldi vint me voir avec le major de notre mess. Ils me dirent que j'allais être hospitalisé à Milan dans un hôpital américain récemment installé. Il me dit également que Miss Barkley allait être envoyée à Milan elle aussi.
Quand je m'éveillai le soleil entrait à flot dans ma chambre. Je ressentis une douleur aiguë dans les jambes. Je les regardai dans leurs bandages sales, et cette vue me rappela où j'étais. J'entendis des pas qui s'approchaient. Je tournai les yeux vers la porte. C'était Catherine Barkley. Elle était fraîche et belle. Il me sembla que je n'avais jamais vu de femme aussi belle. Dieu sait que je ne voulais pas tomber amoureux d'elle. Je ne voulais tomber amoureux de personne. Mais Dieu sait aussi, que, malgré cela, j'étais amoureux, et j'étais là, dans ce lit d'hôpital, à Milan, et toutes sortes de choses me passaient par la tête, et je me sentais merveilleusement bien.
Catherine Barkley était fort aimée des autres infirmières parce qu'elle était toujours disposée à assurer le service de nuit. Nous passions ensemble tous les moments de loisir. Je l'aimais beaucoup et elle m'aimait. Je dormais le jour et nous nous envoyions des billets toute la journée quand nous étions éveillés. Ferguson se chargeait de les transmettre.
L'été fut charmant. Dès que je pus sortir, nous fîmes des promenades en voiture dans le parc. Je me rappelle la voiture, le cheval qui marchait lentement, et, devant nous, le dos du cocher avec son haut-de-forme verni, et Catherine Barkley assise à côté de moi. Je disais à Catherine que je voulais l'épouser, mais Catherine disait que si nous étions mariés on la renverrait, et que cela bouleverserait notre vie. J'aurais voulu que nous fussions mariés, parce que, j'avais peur d'avoir un enfant, mais nous prétendions que nous étions mariés et nous ne nous préoccupions guère, et au fond j'étais peut-être heureux de n'être pas marié.
C'est ainsi que s'écoula l'été. Je ne me souviens pas très bien des journées, sinon qu'elles étaient très chaudes et que les journaux ne parlaient que de victoires. Au front nous avancions sur le Carso. Nous avions pris Kuk, de l'autre côté de la Plava, et nous cherchions à nous emparer du plateau de Bainsizza. La guerre semblait devoir se prolonger. L'Amérique venait d'entrer en guerre, mais je pensais qu'il faudrait bien un an avant qu'on pût envoyer des contingents suffisant et les entraîner au combat. Il me semblait que cette guerre là c'était peut-être une nouvelle guerre de Cent ans.
Un jour Catherine m'annonça : " Je vais avoir un bébé, chéri. Presque trois mois déjà. Ca ne t'ennuie pas, dis ? Je t'en supplie, il ne faut pas que ça te tourmente.
Pendant un instant nous restâmes tranquilles sans dire un mot. Nous étions soudain séparés comme des gens qui se trouvent embarrassés parce que quelqu'un est entré brusquement dans la chambre.
-Tu n'as pas l'impression d'être pris au piège ? -
- Peut-être un peu, mais pas par toi. On se trouve toujours pris au piège, au sens biologique -
Nous étions de nouveau ensemble. Toute gêne avait disparu.
- Nous ne sommes en réalité qu'une seule et même personne et il ne faut pas faire exprès de ne pas nous comprendre -
- Non il ne faut pas. Parce que nous sommes seuls, nous deux ; et dans le monde il y a tous les autres. Si quelque chose se mettait entre nous, nous serions perdus et le monde nous reprendrait -
Le soir de mon départ pour le front, je fis mes adieux à l'hôpital et je partis. Je descendis jusqu'au coin où il y avait un cabaret dans lequel j'attendis Catherine en regardant par la fenêtre. Dehors il faisait noir et froid, et il y avait du brouillard. Quand j'aperçus Catherine je frappai au carreau. Nous partîmes ensemble sur le trottoir, le long des cabarets. Nous avions dépassé la cathédrale. Elle était belle dans le brouillard.
Il y avait un hôtel face à la gare et nous y trouvâmes une chambre. Catherine s'était assise sur le lit et regardait le lustre en cristal taillé. Elle n'avait pas l'air heureux.
- C'est la première fois que j'ai l'impression d'être une grue -
Je n'avais pas prévu que les choses tourneraient ainsi.
- Tu es ma bonne petite femme -
- Ah certes oui, je suis bien à toi - dit-elle Je suis une petite femme toute simple.
Mais bientôt ce fut le temps de partir.
La pluie semblait très claire et transparente dans la lumière de la gare.
- Autant se dire adieu maintenant, adieu, dis-je, prends bien soin de toi et de la petite Catherine -
- Adieu chéri -
Je descendis sous la pluie et la voiture partit. Catherine se pencha et je vis son visage dans la lumière. Elle sourit et agita la main et me fit signe d'aller m'abriter. J'obéis et restai debout, les yeux fixés sur la voiture qui tournait au coin de la rue. Alors seulement je traversai le hall et passai sur la voie.
C'était l'automne. Les arbres étaient nus et les routes boueuses. D'Udine je me rendis à Gorizia sur un camion. Là je fis la connaissance de Gino qui me raconta que le San Gabriele avait été un véritable enfer et que j'avais eu de la chance d'être blessé dès le début. Il dit que les Autrichiens avaient beaucoup d'artillerie dans les bois, plus loin et au-dessus de nous, et que la nuit, ils bombardaient violemment les routes. Nous manquions de nourriture.
J'ai toujours été embarrassé par les mots sacrés ; glorieux, sacrifice. Nous les avions lus sur les proclamations que les colleurs d'affiches placardaient depuis longtemps sur d'autres proclamations. Je n'avais rien vu de sacré, et ce qu'on appelait glorieux n'avait pas de gloire, et les sacrifices ressemblaient aux abattoirs de Chicago avec cette différence que la viande ne servait qu'à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots qu'on ne pouvait plus tolérer. Les mots abstrait tels que gloire, honneur, courage ou sainteté étaient indécents.
Le vent s'éleva dans la nuit et, à trois heures du matin, sous une pluie torrentielle, le bombardement commença.
La nuit suivante la retraite commença. Elle s'effectua, méthodique, mouillée, lugubre. Dans la nuit, sur les routes où nous avancions lentement, nous rencontrâmes des troupes qui marchaient sous la pluie, des chevaux qui tiraient des voitures, des mules, des camions, et tout cela s'éloignait du front. Il n'y avait pas plus de désordre que quand on avançait.
A Gorizia je trouvai une note pour moi me recommandant de remplir mes voitures avec le matériel empilé dans le vestibule et de me diriger sur Pordenone. Quand nous nous trouvâmes sur la route, les troupes, les camions, les charrettes et les canons y formaient une large colonne qui se déplaçait lentement. La pluie s'apaisait et nous avancions. L'aube n'avait pas encore paru que nous étions de nouveau arrêtés et je compris qu'il nous faudrait abandonner la grand-route e passer à travers champs si nous voulions jamais a
Les vignes étaient clairsemées, dénudées, et toute la campagne était mouillée et brune, tuée par l'automne. Tout petit et assis entre deux généraux nous apercevions souvent le roi Vittorio Emanuele derrière les vitres de sa voiture qui filait très vite. Il circulait ainsi presque chaque jour pour voir comment allaient les choses. Et les choses allaient très mal.
A l'entrée de l'hiver une pluie persistante se mit à tomber, et la pluie amena le choléra. Mais on put l'enrayer et, en fin de compte, il n'y eut, dans l'armée que sept mille hommes qui en moururent.
Nous étions chargés d'évacuer les blessés et les malades des postes de secours, de les transporter des montagnes aux gares de triage et de les diriger sur les hôpitaux indiqués sur leurs feuilles de route. Evidemment ma présence importait peu. Les chauffeurs des ambulances britanniques étaient tués parfois. Oh ! je savais que je ne serais pas tué. Pas dans cette guerre. Elle ne m'intéressait pas personnellement et elle me semblait pas plus dangereuse qu'une guerre de cinéma.
Miss Barkley était assez grande. Elle portait ce qui pour moi était un uniforme d'infirmière. Elle avait la peau ambrée et des yeux gris. Je la trouvais très belle. Je pensais qu'elle était un peu folle. Personnellement je n'y voyais aucun inconvénient. Peu m'importait l'aventure dans laquelle je me lançais. Je n'avais nulle intention de l'aimer. C'était un peu, comme le bridge, dans lequel on disait des mots au lieu de jouer des cartes. Il fallait faire semblant de jouer pour un enjeu quelconque. Cela me convenait parfaitement.
Le lendemain, on nous dit qu'il allait y avoir une attaque sur la rivière, en amont, et qu'il nous fallait envoyer quatre voitures. Je me trouvais dans la première voiture. Nous garâmes les voitures derrière une briqueterie. Les fours et de grands trous avaient été aménagés en postes de secours. Il faisait noir et, derrière nous, les longs faisceaux des projecteurs autrichiens balayaient les montagnes. Le silence dura quelques minutes, puis tous les canons derrière nous entrèrent en action. Un obus éclata tout près de la rivière. Un autre arriva sur nous, si brusquement que nous eûmes à peine le temps de l'entendre venir.
Le sol était défoncé et, en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête j'entendis quelqu'un crier. J'essayai de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. Dans une éblouissante clarté je voyais les obus à étoile monter, éclater, flotter dans l'air, tout blancs. J'entendis quelqu'un crier " Mamma mia ! Oh ! Mamma mia ! " et vis Passini les jambes broyées au-dessus du genoux. Je compris que j'étais également blessé.
Les Anglais étaient arrivés avec trois ambulances, on m'apporta au poste de secours. Il y avait des odeurs fortes, odeurs de produits chimiques, et la fade odeur du sang. Le soir qui précéda mon départ Rinaldi vint me voir avec le major de notre mess. Ils me dirent que j'allais être hospitalisé à Milan dans un hôpital américain récemment installé. Il me dit également que Miss Barkley allait être envoyée à Milan elle aussi.
Quand je m'éveillai le soleil entrait à flot dans ma chambre. Je ressentis une douleur aiguë dans les jambes. Je les regardai dans leurs bandages sales, et cette vue me rappela où j'étais. J'entendis des pas qui s'approchaient. Je tournai les yeux vers la porte. C'était Catherine Barkley. Elle était fraîche et belle. Il me sembla que je n'avais jamais vu de femme aussi belle. Dieu sait que je ne voulais pas tomber amoureux d'elle. Je ne voulais tomber amoureux de personne. Mais Dieu sait aussi, que, malgré cela, j'étais amoureux, et j'étais là, dans ce lit d'hôpital, à Milan, et toutes sortes de choses me passaient par la tête, et je me sentais merveilleusement bien.
Catherine Barkley était fort aimée des autres infirmières parce qu'elle était toujours disposée à assurer le service de nuit. Nous passions ensemble tous les moments de loisir. Je l'aimais beaucoup et elle m'aimait. Je dormais le jour et nous nous envoyions des billets toute la journée quand nous étions éveillés. Ferguson se chargeait de les transmettre.
L'été fut charmant. Dès que je pus sortir, nous fîmes des promenades en voiture dans le parc. Je me rappelle la voiture, le cheval qui marchait lentement, et, devant nous, le dos du cocher avec son haut-de-forme verni, et Catherine Barkley assise à côté de moi. Je disais à Catherine que je voulais l'épouser, mais Catherine disait que si nous étions mariés on la renverrait, et que cela bouleverserait notre vie. J'aurais voulu que nous fussions mariés, parce que, j'avais peur d'avoir un enfant, mais nous prétendions que nous étions mariés et nous ne nous préoccupions guère, et au fond j'étais peut-être heureux de n'être pas marié.
C'est ainsi que s'écoula l'été. Je ne me souviens pas très bien des journées, sinon qu'elles étaient très chaudes et que les journaux ne parlaient que de victoires. Au front nous avancions sur le Carso. Nous avions pris Kuk, de l'autre côté de la Plava, et nous cherchions à nous emparer du plateau de Bainsizza. La guerre semblait devoir se prolonger. L'Amérique venait d'entrer en guerre, mais je pensais qu'il faudrait bien un an avant qu'on pût envoyer des contingents suffisant et les entraîner au combat. Il me semblait que cette guerre là c'était peut-être une nouvelle guerre de Cent ans.
Un jour Catherine m'annonça : " Je vais avoir un bébé, chéri. Presque trois mois déjà. Ca ne t'ennuie pas, dis ? Je t'en supplie, il ne faut pas que ça te tourmente.
Pendant un instant nous restâmes tranquilles sans dire un mot. Nous étions soudain séparés comme des gens qui se trouvent embarrassés parce que quelqu'un est entré brusquement dans la chambre.
-Tu n'as pas l'impression d'être pris au piège ? -
- Peut-être un peu, mais pas par toi. On se trouve toujours pris au piège, au sens biologique -
Nous étions de nouveau ensemble. Toute gêne avait disparu.
- Nous ne sommes en réalité qu'une seule et même personne et il ne faut pas faire exprès de ne pas nous comprendre -
- Non il ne faut pas. Parce que nous sommes seuls, nous deux ; et dans le monde il y a tous les autres. Si quelque chose se mettait entre nous, nous serions perdus et le monde nous reprendrait -
Le soir de mon départ pour le front, je fis mes adieux à l'hôpital et je partis. Je descendis jusqu'au coin où il y avait un cabaret dans lequel j'attendis Catherine en regardant par la fenêtre. Dehors il faisait noir et froid, et il y avait du brouillard. Quand j'aperçus Catherine je frappai au carreau. Nous partîmes ensemble sur le trottoir, le long des cabarets. Nous avions dépassé la cathédrale. Elle était belle dans le brouillard.
Il y avait un hôtel face à la gare et nous y trouvâmes une chambre. Catherine s'était assise sur le lit et regardait le lustre en cristal taillé. Elle n'avait pas l'air heureux.
- C'est la première fois que j'ai l'impression d'être une grue -
Je n'avais pas prévu que les choses tourneraient ainsi.
- Tu es ma bonne petite femme -
- Ah certes oui, je suis bien à toi - dit-elle Je suis une petite femme toute simple.
Mais bientôt ce fut le temps de partir.
La pluie semblait très claire et transparente dans la lumière de la gare.
- Autant se dire adieu maintenant, adieu, dis-je, prends bien soin de toi et de la petite Catherine -
- Adieu chéri -
Je descendis sous la pluie et la voiture partit. Catherine se pencha et je vis son visage dans la lumière. Elle sourit et agita la main et me fit signe d'aller m'abriter. J'obéis et restai debout, les yeux fixés sur la voiture qui tournait au coin de la rue. Alors seulement je traversai le hall et passai sur la voie.
C'était l'automne. Les arbres étaient nus et les routes boueuses. D'Udine je me rendis à Gorizia sur un camion. Là je fis la connaissance de Gino qui me raconta que le San Gabriele avait été un véritable enfer et que j'avais eu de la chance d'être blessé dès le début. Il dit que les Autrichiens avaient beaucoup d'artillerie dans les bois, plus loin et au-dessus de nous, et que la nuit, ils bombardaient violemment les routes. Nous manquions de nourriture.
J'ai toujours été embarrassé par les mots sacrés ; glorieux, sacrifice. Nous les avions lus sur les proclamations que les colleurs d'affiches placardaient depuis longtemps sur d'autres proclamations. Je n'avais rien vu de sacré, et ce qu'on appelait glorieux n'avait pas de gloire, et les sacrifices ressemblaient aux abattoirs de Chicago avec cette différence que la viande ne servait qu'à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots qu'on ne pouvait plus tolérer. Les mots abstrait tels que gloire, honneur, courage ou sainteté étaient indécents.
Le vent s'éleva dans la nuit et, à trois heures du matin, sous une pluie torrentielle, le bombardement commença.
La nuit suivante la retraite commença. Elle s'effectua, méthodique, mouillée, lugubre. Dans la nuit, sur les routes où nous avancions lentement, nous rencontrâmes des troupes qui marchaient sous la pluie, des chevaux qui tiraient des voitures, des mules, des camions, et tout cela s'éloignait du front. Il n'y avait pas plus de désordre que quand on avançait.
A Gorizia je trouvai une note pour moi me recommandant de remplir mes voitures avec le matériel empilé dans le vestibule et de me diriger sur Pordenone. Quand nous nous trouvâmes sur la route, les troupes, les camions, les charrettes et les canons y formaient une large colonne qui se déplaçait lentement. La pluie s'apaisait et nous avancions. L'aube n'avait pas encore paru que nous étions de nouveau arrêtés et je compris qu'il nous faudrait abandonner la grand-route e passer à travers champs si nous voulions jamais a
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ernest Hemingway (70)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le vieil homme et la mer
En quelle année est paru ce texte ?
1951
1952
1953
10 questions
245 lecteurs ont répondu
Thème : Le Vieil Homme et la Mer de
Ernest HemingwayCréer un quiz sur ce livre245 lecteurs ont répondu