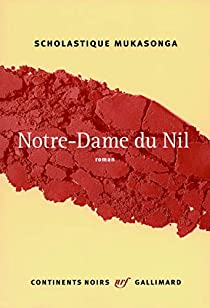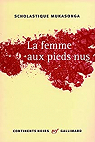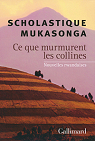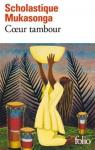C'est un roman bouleversant.
Il se compose comme d'un ensemble de nouvelles mais c'est un tout. On est envoûté et fasciné par une ambiance qui combine la plus absolue beauté et les plus grandes violences qui sont ici d'une totale absurdité. C'est terrible et poétique à la fois.
On ne sort pas indemne de ce type de lecture.
Il se compose comme d'un ensemble de nouvelles mais c'est un tout. On est envoûté et fasciné par une ambiance qui combine la plus absolue beauté et les plus grandes violences qui sont ici d'une totale absurdité. C'est terrible et poétique à la fois.
On ne sort pas indemne de ce type de lecture.
Une année scolaire dans le lycée Notre Dame du Nil au Rwanda qui forme l'élite féminine du Rwanda
Une année pour comprendre les haines raciales Hutu / Tutsi
Une année pour s'imprégner des coutumes, croyances des habitants
Une année pour constater les dégâts du colonialisme des idées
Une année pour constater les dégâts du colonialisme aux mains de l'Eglise ( tant et tant d'ardeur au service du mal depuis de si nombreux siècles)
Une année pour bien se remémorer notre bassesse
Un beau livre sans beaucoup d'espoir
Une année pour comprendre les haines raciales Hutu / Tutsi
Une année pour s'imprégner des coutumes, croyances des habitants
Une année pour constater les dégâts du colonialisme des idées
Une année pour constater les dégâts du colonialisme aux mains de l'Eglise ( tant et tant d'ardeur au service du mal depuis de si nombreux siècles)
Une année pour bien se remémorer notre bassesse
Un beau livre sans beaucoup d'espoir
Quelque part au Rwanda, à la source du Nil, à 2500 m d'altitude se trouve un collège pour jeunes filles. La majorité des élèves sont des hutus, mais il y a aussi quelques tutsis. On comprends très vite la différence de classe entre hutus et tutsis. Des faits historiques rendent l'histoire plus vraie comme la visite du roi et de la reine des Belges au Rwanda dans les années 70 , comme aussi une blanche qui s'occupe de l'étude des gorilles dans les montagnes. Un très bon roman dans un dépaysement total mais pas loin, dans le temps, d'un génocide qui se prépare.
Difficile de passer à côté de ce livre quand on se pique, comme moi, de s'intéresser aux littératures étrangères. Et pourtant il m'a fallu le défi de littérature africaine de cette année pour enfin me décider à l'ouvrir.
Scholastique Mukasonga, rescapée du génocide de 1994, a choisi pour évoquer son pays et ses difficultés (un bel euphémisme de ma part) à faire nation de placer son texte dans un lieu et un temps qui semble de prime abord éloigné de ses préoccupations.
Le lieu, c'est le pensionnat pour jeunes filles fortunées de Notre-Dame du Nil, dans les collines verdoyantes du Rwanda, pas loin de l'une des sources du grand fleuve ; le temps, c'est une année scolaire un peu particulière, une dizaine d'années après l'indépendance et alors que la politique pro-Hutu se durcit et donne lieu notamment à une dé-Tutsisation des établissements scolaires. Les personnages, ce sont bien sûr les jeunes filles scolarisées dans cet établissement, principalement des Hutus socialement connectées aux hautes sphères du pouvoir et de l'argent qui se préparent à faire un beau mariage, et quelques Tutsis pour respecter le quota, sélectionnées elles par concours. Il y a aussi le personnel de l'école : des religieuses, un prêtre pas très net, des professeurs belges, des objecteurs de conscience français, et puis il ne faut pas oublier de mentionner le voisin, un vieux colon belge propriétaire d'une plantation de café.
Avec cette panoplie de personnages, ce n'est pas vraiment un roman que Scholastique Mukasonga écrit, mais plutôt une série de scènes qui présentent une unité de lieu et de temps. Et avec ces scènes, Sholastique Mukasonga évoque les différentes facettes du pays. La plus évidente : la rivalité devenue haine qui sépare Hutus et Tutsis ; la plus dérangeante : la fascination des Européens pour les Tutsis et leurs relectures fantasques mais mortifères de la mythologie égyptienne ou de l'Ancien Testament ; la moins questionnée : l'exclusion systématique des Batwas ; etc. le portrait que Scholastique Mukasonga fait de son pays est multiple et complexe et elle montre, sans le dire, comment cette complexité a abouti vingt ans plus tard au génocide que l'on connaît. Car toute la rhétorique était déjà en place, pas seulement une discrimination ouverte, mais aussi tout un discours de rabaissement et d'appel à l'extermination. Comme un relent de : « on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ».
Une lecture qui se déroule assez facilement grâce au style sans inutile fioriture de l'autrice, mais qui fait beaucoup réfléchir. C'était, j'imagine, un pari risqué de parler du génocide sans un parler. Ce pari est réussi, et en plus dans un livre accessible qui pourra plaire à de nombreux lecteurs, que demander de plus ?
Scholastique Mukasonga, rescapée du génocide de 1994, a choisi pour évoquer son pays et ses difficultés (un bel euphémisme de ma part) à faire nation de placer son texte dans un lieu et un temps qui semble de prime abord éloigné de ses préoccupations.
Le lieu, c'est le pensionnat pour jeunes filles fortunées de Notre-Dame du Nil, dans les collines verdoyantes du Rwanda, pas loin de l'une des sources du grand fleuve ; le temps, c'est une année scolaire un peu particulière, une dizaine d'années après l'indépendance et alors que la politique pro-Hutu se durcit et donne lieu notamment à une dé-Tutsisation des établissements scolaires. Les personnages, ce sont bien sûr les jeunes filles scolarisées dans cet établissement, principalement des Hutus socialement connectées aux hautes sphères du pouvoir et de l'argent qui se préparent à faire un beau mariage, et quelques Tutsis pour respecter le quota, sélectionnées elles par concours. Il y a aussi le personnel de l'école : des religieuses, un prêtre pas très net, des professeurs belges, des objecteurs de conscience français, et puis il ne faut pas oublier de mentionner le voisin, un vieux colon belge propriétaire d'une plantation de café.
Avec cette panoplie de personnages, ce n'est pas vraiment un roman que Scholastique Mukasonga écrit, mais plutôt une série de scènes qui présentent une unité de lieu et de temps. Et avec ces scènes, Sholastique Mukasonga évoque les différentes facettes du pays. La plus évidente : la rivalité devenue haine qui sépare Hutus et Tutsis ; la plus dérangeante : la fascination des Européens pour les Tutsis et leurs relectures fantasques mais mortifères de la mythologie égyptienne ou de l'Ancien Testament ; la moins questionnée : l'exclusion systématique des Batwas ; etc. le portrait que Scholastique Mukasonga fait de son pays est multiple et complexe et elle montre, sans le dire, comment cette complexité a abouti vingt ans plus tard au génocide que l'on connaît. Car toute la rhétorique était déjà en place, pas seulement une discrimination ouverte, mais aussi tout un discours de rabaissement et d'appel à l'extermination. Comme un relent de : « on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ».
Une lecture qui se déroule assez facilement grâce au style sans inutile fioriture de l'autrice, mais qui fait beaucoup réfléchir. C'était, j'imagine, un pari risqué de parler du génocide sans un parler. Ce pari est réussi, et en plus dans un livre accessible qui pourra plaire à de nombreux lecteurs, que demander de plus ?
Une écriture toute en finesse et en images au service de ce livre qui se situe dans les années 1970, presque vingt ans avant le génocide au Rwanda, et qui nous en montre les racines profondes, à travers les projections de certains Européens sur les Tutsis comme peuple élu, la lâcheté et la complicité de puissances étrangères comme la Belgique et la France, mais aussi le sort des femmes, les dominées des dominés.
Un roman féministe, mais pas seulement!
Un texte passionné, passionnant ...
Un beau moment de littérature récompensé par le RENAUDOT 2012.
Un roman féministe, mais pas seulement!
Un texte passionné, passionnant ...
Un beau moment de littérature récompensé par le RENAUDOT 2012.
C'est une histoire d'école pas comme les autres, qui se déroule à la fin des années 1970 dans un lycée niché dans les montagnes du Rwanda, près de la source du Nil ('On est si près du ciel, murmure Mère Supérieure , joignant les mains'), où les élèves, filles de riches, apprennent un peu de Dieu et beaucoup sur la façon de maintenir le statu quo.
L'école fait théoriquement partie des efforts du gouvernement pour promouvoir l'éducation des femmes au Rwanda, mais dans certaines limites : le lycée est une intrusion blanche en Afrique, construite sous la direction de 'surveillants blancs qui ne faisaient que regarder de grandes feuilles de papier qu'ils déroulaient comme des rouleaux de tissu de la boutique pakistanaise, et qui devenaient fous de rage quand ils appelaient les contremaîtres noirs, comme s'ils crachaient du feu'. Les filles doivent être les locomotives du changement, tout en respectant strictement les règles : elles doivent parler français – le swahili est interdit – et on leur apprend que « L Histoire signifiait l'Europe, et la Géographie, l'Afrique. L'Afrique n'avait pas d'histoire… ce sont les Européens qui avaient découvert l'Afrique et l'avaient entraînée dans l'histoire.
le conflit ethnique est d'abord traité de façon comique et satirique, le roman se concentre sur différentes filles, leurs histoires individuelles mais liées, clignotantes comme les écailles d'un poisson. Elles ont de grandes personnalités, forgées dès leurs débuts privilégiés dans la vie, avec Gloriosa la plus grande de toutes, adepte des manières de gouverner le monde, de manipuler les autres : 'Ce n'est pas des mensonges, c'est de la politique', dit-elle, quand elle feint d'avoir été attaquée par la milice pour se tirer d'affaire le temps d'une escapade: 'Je suis sûre qu'ils voulaient nous violer, probablement même nous tuer'.
Notre-Dame du Nil est animée de tensions. Parfois, c'est drôle, comme lorsque les filles se disputent la meilleure recette de bananes - ou lorsque les enseignants se battent contre les élèves pour des affiches de personnalités de la culture pop telles que Brigitte Bardot et Johnny Hallyday. 'Satan, prévient l'aumônier de l'école, prend toutes les apparences disponibles'.
Mais bouillonne la division ethnique entre Hutu et Tutsi, qui a conduit en 1994 au massacre près d'un million de Tutsi en trois mois, mais la merveille de Notre-Dame du Nil réside dans sa touche lumineuse et légère.
le conflit ethnique est d'abord traité de façon comique – Gloriosa, une Hutu, veut détruire le nez de la statue de la Vierge de l'école parce que ses traits blancs la font ressembler à une Tutsi – et satirique : on apprend aux filles qu'à l'école, 'c'est comme si vous n'étiez plus Hutu ou Tutsi [mais] ce que les Belges appelaient autrefois civilisées'. Mais les haines anciennes ne se taisent pas : les deux filles tutsi du lycée, Virginia et Veronica, sont 'notre quota ', dit Gloriosa, parmi les 'vraies filles rwandaises'.
le drame qui clôt le livre, lorsque la menace de 'dé-tutsifier nos écoles' se réalise, est un présage de violence à venir. On entend le grondement de ce que Mukasonga dans ses mémoires, Cafards, appelle 'la machinerie du génocide'.
Grâce à Mukasonga nous en entendons encore tous les échos.
Lien : http://holophernes.over-blog..
Nous sommes au début des 70, le Rwanda a déjà connu des soulèvements, il en connaîtra encore. le pays au mille collines s'est libéré du joug des colonisateurs il y a une dizaine d'années, renversant les jeux de pouvoirs et plaçant à sa tête un gouvernement pro-hutu. Virginia et Veronica représentent le quota tutsie du lycée Notre Dame du Nil. Un lycée destiné à l'élite féminine rwandaise, pas la plus intelligente ou la plus prometteuse, mais la plus nantie, la plus politiquement correcte...
L'autrice nous propose de passer une année scolaire dans un lycée pour jeunes filles, pas très loin de l'endroit où le Nil prend sa source. Chaque chapitre s'apparente à une chronique de la vie scolaire. En toile de fond, on sent déjà tous les relents putrides qui conduiront le pays, 20 ans plus tard, au génocides des Tutsis. La discrimination est partout dans le lycée. Ca commence avec les jeunes tutsies qui ne peuvent manger qu'une fois que leurs camarades se sont rassasiées, devant se contenter des restes. Ca se poursuit à travers la polémique sur le nez de la Vierge Noire qui domine la source du Nil; c'est dans toutes ces petites choses du quotidien, entre brimades et mauvais coups, entre croyances et jalousie.
J'ai trouvé que l'autrice rendait bien le contexte de l'époque et permettait d'apporter un éclairage sur ce qu'il s'est passé en 1994. Comme une conclusion prévisible d'un contexte politique exacerbé, au point de pourrir les relations entre élèves vingt ans plus tôt. Et le tout sous l'oeil indifférent, quand il n'était pas encourageant, de l'encadrement religieux; blanc, évidemment.
J'ai été beaucoup moins séduite par le style de Scholastique Mukasonga qui se résume bien souvent à des phrases courtes "sujet-verbe-complément". A la limite, si tout le roman avait été écrit comme les premières pages où il n'y a finalement pas de virgule ça aurait pu donner un certain rythme ou du moins apporter une dimension complémentaire au récit. Mais finalement il n'en est rien. les phrases se sont allongées, les virgules sont apparues, et bien que la structure "sujet-verbe-complément" soit restée la norme, ce souffle rythmique attendu n'a pas pris.
L'histoire se passe en 1970, dans un lycée rwandais pour la future “élite” féminine.
On y découvre la haine des Hutus pour les Tutsis, ainsi que les fantasmes des Blancs à propos de ces derniers. Dans ce microcosme, la violence est prête à se déchainer.
L'autrice nous montre les prémisses du génocide, toute la beauté et les déchirures du Rwanda.
C'est vraiment très bien, et facile à lire. Je vous le conseille chaleureusement !
On y découvre la haine des Hutus pour les Tutsis, ainsi que les fantasmes des Blancs à propos de ces derniers. Dans ce microcosme, la violence est prête à se déchainer.
L'autrice nous montre les prémisses du génocide, toute la beauté et les déchirures du Rwanda.
C'est vraiment très bien, et facile à lire. Je vous le conseille chaleureusement !
Rwanda, isolé dans la montagne près des sources du Nil, un lycée pour jeunes filles accueille les filles de l'élite du pays, majoritairement d'origine Hutu, et quelques Tutsis tolérées ou méprisées, pour répondre aux quotas imposés.
Au fil de l'année scolaire, on assiste au gré des discussions entre lycéennes à une sorte de huis-clos où la haine s'insinue, reflet sans doute de la société rwandaise dont les fissures menacent d'exploser.
Avec beaucoup de délicatesse mais de vérité aussi, l'auteure fait ressortir tous les non-dit, les rancoeurs, les envies de vengeance, la sensation de pouvoir et d'impunité de certaines face aux sentiments d'acceptation ou de résignation des autres, mais également l'amitié, la vie.
La politique est aussi largement évoquée, qu'elle soit interne au pays ou en lien avec l'Europe, en un constat édifiant d'incapacité.
L'attente monte, l'épilogue malheureux que l'on sent venir, inéluctable, se produit bien, et on garde le goût amer et peu d'espoir en achevant la lecture, l'impression que la roue tourne parfois mais revient plus souvent au pire de l'être humain.
Evoquant les prémisses d'un génocide à travers un moment d'histoire, Scholastique Mukasonga écrit là un livre très actuel, sans fioriture, juste tout simplement, qui ne pourra que toucher.
Lien : https://mesmotsmeslivres.wor..
Au fil de l'année scolaire, on assiste au gré des discussions entre lycéennes à une sorte de huis-clos où la haine s'insinue, reflet sans doute de la société rwandaise dont les fissures menacent d'exploser.
Avec beaucoup de délicatesse mais de vérité aussi, l'auteure fait ressortir tous les non-dit, les rancoeurs, les envies de vengeance, la sensation de pouvoir et d'impunité de certaines face aux sentiments d'acceptation ou de résignation des autres, mais également l'amitié, la vie.
La politique est aussi largement évoquée, qu'elle soit interne au pays ou en lien avec l'Europe, en un constat édifiant d'incapacité.
L'attente monte, l'épilogue malheureux que l'on sent venir, inéluctable, se produit bien, et on garde le goût amer et peu d'espoir en achevant la lecture, l'impression que la roue tourne parfois mais revient plus souvent au pire de l'être humain.
Evoquant les prémisses d'un génocide à travers un moment d'histoire, Scholastique Mukasonga écrit là un livre très actuel, sans fioriture, juste tout simplement, qui ne pourra que toucher.
Lien : https://mesmotsmeslivres.wor..
Au Rwanda, le lycée Notre-Dame du Nil forme l'élite féminine du pays. Une élite majoritairement Hutu, avec un petit quota pour les Tutsis. Deux pour vingt. Et l'année entière pour que grandisse la haine...
Le début du livre s'ouvre sur l'origine de ce lycée et sa fonction. Un lycée pour les filles uniquement "c'est pour les filles qu'on a construit le lycée bien haut, bien loin, pour les éloigner, les protéger du mal, des tentations de la grande ville", pendant que les garçons restent en bas, dans la capitale. Perché sur la montagne, à 2500 mètres près de la source du Nil, d'où son nom, il s'agit de faire en sorte que ces demoiselles acquièrent une bonne éducation et fasse un beau mariage. "Les pensionnaires du lycée sont filles de ministres, de militaires haut gradés, d'hommes d'affaires, de riches commerçants. Le mariage de leurs filles, c'est de la politique." Mais il y a aussi quelques jeunes filles -une minorité- qui ne doivent leur présence qu'à leurs bons résultats scolaires. Le lycée est l'occasion de leur inculquer à toutes les bonnes manières, mais aussi et surtout d'appréhender un mode de vie à l'occidentale, qui sera indispensable à leur vie future, quand elles seront mariées. La nourriture, si différente de celle de leurs mères, le fait de ne pouvoir dormir à plusieurs dans le même lit comme elles le feraient chez elles, tout est source de chamboulements des repères.
Quant aux adultes qui entourent les jeunes filles, ils ne sont pas toujours très respectables, malgré les apparences. Le père Herménégilde, par exemple. Dans son discours de bienvenue, à la rentrée, il se vante d'avoir inspiré les idées du Manifeste des Bahutu (rédigé en 1957 par neuf intellectuels hutus, fortement chrétiens). Il exprime des idées anti-tutsis, même si ce n'est pas toujours de façon très explicite. Mais aussi et surtout, son attitude envers les jeunes filles est loin d'être celui qui convient à un homme d'Eglise. L'auteur dénonce, par ce personnage, des pratiques inacceptables.
Mais c'est surtout autour des personnages de quelques lycéennes que se construit le récit de Notre-Dame du Nil. Godelive, Immaculée, Goretti, Frida, Modesta, partagée entre sa double identité à la fois hutue et tutsie ; Véronica, qui jouera Isis pour le vieux fou de Fontenaille et Virginia, dont le nom signifie "ne la faîtes pas pleurer". Mais aussi Gloriosa, l'impitoyable, "celle de la houe". Farouchement anti-tutsi, elle milite pour la cause du "Peuple Majoritaire" au sein du lycée, répandant auprès de ses camarades tout le fiel et la méchanceté dont elle est capable. Elle va jouer un rôle crucial dans le basculement des événements, quand va se profiler le drame.
Scholastique Mukasonga continue, à travers ce roman, d'explorer les entrailles du génocide. Ce sont ici les prémices auxquels nous assistons, à sa construction lente mais méthodique, à son caractère implacable. Ce qui s'est passé a pris sa source ici, dans les coeurs et les têtes quelques vingt ans plus tôt, comme un terreau longtemps entretenu. Comme dans La femme aux pieds nus, qu'elle avait écrit pour rendre hommage à sa mère tuée durant le génocide, l'auteur découpe son roman en chapitres consacrés à une certaine thématique, tout en continuant son cheminement narratif. Le rôle de la pluie dans la culture rwandaise ; les gorilles, qui divise rwandais et Blancs ; la place des femmes, la responsabilité des Belges dans la scission du pays sont des thèmes abordés en filigrane, avec une grande justesse. Nous y apprenons beaucoup de la culture, des croyances, du mode de vie des rwandais.
Quand j'ai rencontré l'auteure à Saint-Malo pour le festival Étonnants Voyageurs, je lui ai dit que je n'avais appris l'existence du génocide qu'au lycée, à dix-huit ans. C'était en 2004, dix ans après. Et que j'étais choquée de voir à quel point peu de jeunes savent encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé. Elle m'a dit : "c'est très fort ce que vous venez de dire, ça me touche beaucoup ; ça prouve qu'on doit continuer d'en parler." Alors voilà, j'ai tenu ma promesse, Madame Mukasonga, j'en ai parlé, même si c'est bien peu de choses, voilà qui est fait.
De mon côté, j'espère que vous continuerez longtemps à éveiller les consciences et les cœurs de vos lecteurs avec des livres aussi nécessaires que celui-ci.
http://manouselivre.com/notre-dame-du-nil/
Lien : http://manouselivre.com
Le début du livre s'ouvre sur l'origine de ce lycée et sa fonction. Un lycée pour les filles uniquement "c'est pour les filles qu'on a construit le lycée bien haut, bien loin, pour les éloigner, les protéger du mal, des tentations de la grande ville", pendant que les garçons restent en bas, dans la capitale. Perché sur la montagne, à 2500 mètres près de la source du Nil, d'où son nom, il s'agit de faire en sorte que ces demoiselles acquièrent une bonne éducation et fasse un beau mariage. "Les pensionnaires du lycée sont filles de ministres, de militaires haut gradés, d'hommes d'affaires, de riches commerçants. Le mariage de leurs filles, c'est de la politique." Mais il y a aussi quelques jeunes filles -une minorité- qui ne doivent leur présence qu'à leurs bons résultats scolaires. Le lycée est l'occasion de leur inculquer à toutes les bonnes manières, mais aussi et surtout d'appréhender un mode de vie à l'occidentale, qui sera indispensable à leur vie future, quand elles seront mariées. La nourriture, si différente de celle de leurs mères, le fait de ne pouvoir dormir à plusieurs dans le même lit comme elles le feraient chez elles, tout est source de chamboulements des repères.
Quant aux adultes qui entourent les jeunes filles, ils ne sont pas toujours très respectables, malgré les apparences. Le père Herménégilde, par exemple. Dans son discours de bienvenue, à la rentrée, il se vante d'avoir inspiré les idées du Manifeste des Bahutu (rédigé en 1957 par neuf intellectuels hutus, fortement chrétiens). Il exprime des idées anti-tutsis, même si ce n'est pas toujours de façon très explicite. Mais aussi et surtout, son attitude envers les jeunes filles est loin d'être celui qui convient à un homme d'Eglise. L'auteur dénonce, par ce personnage, des pratiques inacceptables.
Mais c'est surtout autour des personnages de quelques lycéennes que se construit le récit de Notre-Dame du Nil. Godelive, Immaculée, Goretti, Frida, Modesta, partagée entre sa double identité à la fois hutue et tutsie ; Véronica, qui jouera Isis pour le vieux fou de Fontenaille et Virginia, dont le nom signifie "ne la faîtes pas pleurer". Mais aussi Gloriosa, l'impitoyable, "celle de la houe". Farouchement anti-tutsi, elle milite pour la cause du "Peuple Majoritaire" au sein du lycée, répandant auprès de ses camarades tout le fiel et la méchanceté dont elle est capable. Elle va jouer un rôle crucial dans le basculement des événements, quand va se profiler le drame.
Scholastique Mukasonga continue, à travers ce roman, d'explorer les entrailles du génocide. Ce sont ici les prémices auxquels nous assistons, à sa construction lente mais méthodique, à son caractère implacable. Ce qui s'est passé a pris sa source ici, dans les coeurs et les têtes quelques vingt ans plus tôt, comme un terreau longtemps entretenu. Comme dans La femme aux pieds nus, qu'elle avait écrit pour rendre hommage à sa mère tuée durant le génocide, l'auteur découpe son roman en chapitres consacrés à une certaine thématique, tout en continuant son cheminement narratif. Le rôle de la pluie dans la culture rwandaise ; les gorilles, qui divise rwandais et Blancs ; la place des femmes, la responsabilité des Belges dans la scission du pays sont des thèmes abordés en filigrane, avec une grande justesse. Nous y apprenons beaucoup de la culture, des croyances, du mode de vie des rwandais.
Quand j'ai rencontré l'auteure à Saint-Malo pour le festival Étonnants Voyageurs, je lui ai dit que je n'avais appris l'existence du génocide qu'au lycée, à dix-huit ans. C'était en 2004, dix ans après. Et que j'étais choquée de voir à quel point peu de jeunes savent encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé. Elle m'a dit : "c'est très fort ce que vous venez de dire, ça me touche beaucoup ; ça prouve qu'on doit continuer d'en parler." Alors voilà, j'ai tenu ma promesse, Madame Mukasonga, j'en ai parlé, même si c'est bien peu de choses, voilà qui est fait.
De mon côté, j'espère que vous continuerez longtemps à éveiller les consciences et les cœurs de vos lecteurs avec des livres aussi nécessaires que celui-ci.
http://manouselivre.com/notre-dame-du-nil/
Lien : http://manouselivre.com
Les Dernières Actualités
Voir plus

Out of Africa
Aela
20 livres
Autres livres de Scholastique Mukasonga (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Afrique dans la littérature
Dans quel pays d'Afrique se passe une aventure de Tintin ?
Le Congo
Le Mozambique
Le Kenya
La Mauritanie
10 questions
292 lecteurs ont répondu
Thèmes :
afriqueCréer un quiz sur ce livre292 lecteurs ont répondu