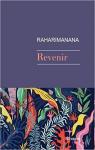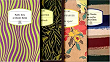Critiques de Raharimanana (36)
Œuvre monumentale à l'écriture ensorcelante de poésie. L'image y erre tandis que l'imaginaire envahit le réel et voilà que de l'histoire d'un homme, transpire celle d'un pays, du monde depuis ses origines jusqu'à l'éternité et de l'humain dans sa plus haute bassesse et ses rêves transis. La colère devient cendre manuscrite pour revenir, vers sa terre, son père, son Aimée, soi-même...
L'auteur nous emmène dans un voyage, un aller-retour, au rythme de respirations saccadées, au rythme des vagues, au rythme de ses voyages aussi: ses voyages dans sa mémoire, ses voyages bien réels au Rwanda, en Europe au fil de ses lectures publiques, ses voyages dans son île. Mais qui est Elle? La mémoire, l'enfance, la mère, son île, Madagascar, sa femme, ou un peu tout ceci? L'histoire se mêle à l'histoire. Un magnifique poème.
Avec « Revenir », roman autobiographique, l’écrivain cherche, et trouve, sa place dans l’histoire de son île.
Lien : http://www.lemonde.fr/livres..
Lien : http://www.lemonde.fr/livres..
Le texte est constitué de textes courts, ciselés comme de la poésie en prose, qui évoquent tous de l’ultraviolence (corps en putréfaction, viols, génocides,…). Certains évoquent la colonisation de Madagascar par les Français, d’autres le génocide rwandais au début des années 90. Le tout reste trop hermétique pour être vraiment apprécié. Une postface ou une préface auraient été des additions bienvenues pour éclairer ma lanterne.
Une fois de plus, Raharimanana me sidère par la violence crue de sa langue, qui tranche le monde et les cadavres qui s'y empilent. Une poésie abyssale et mortelle, qui entremêle récits hachés de génocides, de meurtres et de naufrage dans la drogue, et qui ravive les thèmes chers à la culture malgache : la présence des morts dans le monde du vivant, le temps qui s'étire et nous perd, un monde d'esprits toujours à fleur de peau.
C'est magnifique et horrible en même temps, et la prose si particulière de Raharimanana nous suspend entre cette terrible réalité et un flottement dans un autre monde, comme pour s'abstraire des atrocités terrestres, sans toutefois y parvenir.
C'est magnifique et horrible en même temps, et la prose si particulière de Raharimanana nous suspend entre cette terrible réalité et un flottement dans un autre monde, comme pour s'abstraire des atrocités terrestres, sans toutefois y parvenir.
violence terrible, langue splendide, travaillée et comme expulsée, tendresse. Et belle construction pour maintenir la distance, faire littérature.
Plus que des nouvelles, j'ai trouvé que ces brefs textes de Raharimanana étaient de véritables poèmes en prose, tant le travail sur les sons, les rythmes, sur les constructions syntaxiques, jouent sur le sens, voire l'essence même, de chacun.
Car oui, ces textes-rêves, tour à tour d'une violence à la limite du soutenable, tour à tour d'un onirisme évanescent à la limite du compréhensible et du discernable, sont d'une grande beauté stylistique, qui frappe, qui écorche, qui ne laisse pas indemne, malgré, parfois, un certain hermétisme.
Je réitèrerai la lecture de l'auteur, dans tous les cas.
Car oui, ces textes-rêves, tour à tour d'une violence à la limite du soutenable, tour à tour d'un onirisme évanescent à la limite du compréhensible et du discernable, sont d'une grande beauté stylistique, qui frappe, qui écorche, qui ne laisse pas indemne, malgré, parfois, un certain hermétisme.
Je réitèrerai la lecture de l'auteur, dans tous les cas.
« Tisser » (2021, Mémoires d’Encrier, 96 p.) de Jean-Luc V. Raharimanana, auteur malgache, dont le nom signifie « celui qui a le don de créer ». C’est un petit livre imprimé en France sur du papier (c’est important de le noter) issu de forêts durablement gérées (tout comme celui du lapin) et de sources contrôlées (mais il est précisé en janvier 2021, donc depuis ???). Il me paraissait important de l’écrire, vu que l’imprimeur a gâché l’encre de 80 caractères pour nous prévenir. Je viens de vérifier dans le beau « Rien du Tout » de Olivia Tapiero (2021, Mémoires d’Encrier, 136 p.), donc du même éditeur/imprimeur. Les deux livres ont bien été élevés sous la même mère au vrai grain bio et non en hors-sol.
L’auteur donc de « Tisser » vit en France à Tours et a déjà publié un certain nombre d’autres romans, de la poésie, et un « beau-livre » (c’est décrit ainsi) « Portraits d’insurgés » avec des photos de Pierrot Men (2011, Vents d’ailleurs, 64 p.) sur la révolution de 1947, qui suit de « Le Bateau Ivre Histoires en Terre Malgache » avec Pascal Grimaud (2004, Images en Manœuvres, 64 p.). On lui doit aussi l’édition de livres sur la littérature malgache et un intéressant ouvrage « Les Comores, une littérature en archipel », avec Magali Nirina Marson (2011, Revue Interculturel Francophonies, Lecce, Italie, 384 p.).
En fait l’auteur s’interroge depuis 1989, c’est-à-dire depuis qu’il a monté une pièce « Le prophète et le président » (2008, Editions Ndzé ), pièce commandée par l’Alliance Française d’Antananarivo. Mais la liberté de ton agace et le dossier atterri sur le bureau du ministre de la culture, un certain Jack L. qui envoie derechef un émissaire pour demander d’interrompre la création « pour préserver les relations entre la France et Madagascar ». L’auteur bénéficiera d’une bourse en France et en 1993, la pièce sera diffusée sur RFI. Il y est question de deux fous, qui veulent s’évader en entraînant les autres à leur suite. Dans leur bouche, l’auteur a mis des mots de politiciens qui parlent. « Vive la République de mon trafic ! Quel dommage que la République n’accepte pas un roi ! Mais moi ! Moi, je serai un Président à vie. Par compensation ! Si on ne se prosterne pas devant moi, du moins aurais-je la satisfaction de voir tous ces gens me lécher les bottes ». Il faut reconnaître que depuis la fin de la première république de Madagascar en 1975, la grande ïle en est à sa quatrième république. Ce genre de gouvernement s’use vite sous les tropiques.
« Tisser » c’est tisser l’utopie, à travers les mémoires et les vies. « Tisser les mémoires. Tisser les vies. Tisser l'utopie ». Un enfant mort-né raconte la genèse du monde. Pour cela, il fait appel aux mythes qu’on ne lui a pas encore raconté. Et il décrit la quête de liberté, puis les dérives des régimes totalitaires et les luttes pour la libération ou les formes de résistance.
Il invoque Ralanitra-Nanahary, le principe mâle, que d’autres nomment Zanahary-Ambony, le Dieu d’en-haut. Mais il y a aussi Ratany, le principe femelle ou la Terre, que les autres appellent Zanahary-Ambany, le Dieu d’en-bas, femelle. Bagarre, comme il se doit, entre eux, ce qui fait que le soleil alla d’est en ouest. « Le Ciel recula pour ne pas brûler. / La Terre se retira pour ne pas ombrager. / Et l’Humanité fût ». C’est aussi simple et beau que cela. Suivent ensuite des vers « sous l’encre du Grand Césaire », « pains des mots et minerais secrets » avant de constater que l’on est chez « Les demoiselles d’Avignon » entre visages et masques.
C’est oublier les deux jeunes gens qui habitaient sur une île. « Zatovotsinataonjanahary, le Beau-jeune-homme-que-Dieu-n’a-pas-créé. L’autre se disait Zatovotsinataonolo, le Beau-jeune-homme-que-personne-n’a-créé ». Ce sont des jumeaux qui se ressemblent, comme il se doit et comme deux gouttes d’eau. Cependant, pour correspondre au mythe, l’un a identifié Dieu, le second a identifié la mère.
Et les luttes post-coloniales dans tout cela ? Il faudra bien y venir. Ne pas oublier que l’auteur est marqué par l’histoire de l’ile, de la grande révolution de 1947. L’arrivée des colonisateurs, qui imposent de plus leur religion, catholique de préférence, implique aussi la parte du folklore local et des traditions qui vont avec. « Et c’est toute l’histoire de l’Afrique qui est sous-jacente ? » « A quel endroit de notre tissu notre déchirure a-t-elle été engagée. La trace de la déchirure est-elle toujours nécessaire ? »
La vie est faite de toute une série de fibres, chacune a sa nature, sa force, son identité, sa faiblesse aussi. Unies entre elles, tisées elles forment un motif différent. Tisser, dans l’idée de l’auteur, c'est s’identifier à une fibre, accepter de se réunir à d'autres pour une existence différente, forcément plus forte et plus vaste.
L’auteur donc de « Tisser » vit en France à Tours et a déjà publié un certain nombre d’autres romans, de la poésie, et un « beau-livre » (c’est décrit ainsi) « Portraits d’insurgés » avec des photos de Pierrot Men (2011, Vents d’ailleurs, 64 p.) sur la révolution de 1947, qui suit de « Le Bateau Ivre Histoires en Terre Malgache » avec Pascal Grimaud (2004, Images en Manœuvres, 64 p.). On lui doit aussi l’édition de livres sur la littérature malgache et un intéressant ouvrage « Les Comores, une littérature en archipel », avec Magali Nirina Marson (2011, Revue Interculturel Francophonies, Lecce, Italie, 384 p.).
En fait l’auteur s’interroge depuis 1989, c’est-à-dire depuis qu’il a monté une pièce « Le prophète et le président » (2008, Editions Ndzé ), pièce commandée par l’Alliance Française d’Antananarivo. Mais la liberté de ton agace et le dossier atterri sur le bureau du ministre de la culture, un certain Jack L. qui envoie derechef un émissaire pour demander d’interrompre la création « pour préserver les relations entre la France et Madagascar ». L’auteur bénéficiera d’une bourse en France et en 1993, la pièce sera diffusée sur RFI. Il y est question de deux fous, qui veulent s’évader en entraînant les autres à leur suite. Dans leur bouche, l’auteur a mis des mots de politiciens qui parlent. « Vive la République de mon trafic ! Quel dommage que la République n’accepte pas un roi ! Mais moi ! Moi, je serai un Président à vie. Par compensation ! Si on ne se prosterne pas devant moi, du moins aurais-je la satisfaction de voir tous ces gens me lécher les bottes ». Il faut reconnaître que depuis la fin de la première république de Madagascar en 1975, la grande ïle en est à sa quatrième république. Ce genre de gouvernement s’use vite sous les tropiques.
« Tisser » c’est tisser l’utopie, à travers les mémoires et les vies. « Tisser les mémoires. Tisser les vies. Tisser l'utopie ». Un enfant mort-né raconte la genèse du monde. Pour cela, il fait appel aux mythes qu’on ne lui a pas encore raconté. Et il décrit la quête de liberté, puis les dérives des régimes totalitaires et les luttes pour la libération ou les formes de résistance.
Il invoque Ralanitra-Nanahary, le principe mâle, que d’autres nomment Zanahary-Ambony, le Dieu d’en-haut. Mais il y a aussi Ratany, le principe femelle ou la Terre, que les autres appellent Zanahary-Ambany, le Dieu d’en-bas, femelle. Bagarre, comme il se doit, entre eux, ce qui fait que le soleil alla d’est en ouest. « Le Ciel recula pour ne pas brûler. / La Terre se retira pour ne pas ombrager. / Et l’Humanité fût ». C’est aussi simple et beau que cela. Suivent ensuite des vers « sous l’encre du Grand Césaire », « pains des mots et minerais secrets » avant de constater que l’on est chez « Les demoiselles d’Avignon » entre visages et masques.
C’est oublier les deux jeunes gens qui habitaient sur une île. « Zatovotsinataonjanahary, le Beau-jeune-homme-que-Dieu-n’a-pas-créé. L’autre se disait Zatovotsinataonolo, le Beau-jeune-homme-que-personne-n’a-créé ». Ce sont des jumeaux qui se ressemblent, comme il se doit et comme deux gouttes d’eau. Cependant, pour correspondre au mythe, l’un a identifié Dieu, le second a identifié la mère.
Et les luttes post-coloniales dans tout cela ? Il faudra bien y venir. Ne pas oublier que l’auteur est marqué par l’histoire de l’ile, de la grande révolution de 1947. L’arrivée des colonisateurs, qui imposent de plus leur religion, catholique de préférence, implique aussi la parte du folklore local et des traditions qui vont avec. « Et c’est toute l’histoire de l’Afrique qui est sous-jacente ? » « A quel endroit de notre tissu notre déchirure a-t-elle été engagée. La trace de la déchirure est-elle toujours nécessaire ? »
La vie est faite de toute une série de fibres, chacune a sa nature, sa force, son identité, sa faiblesse aussi. Unies entre elles, tisées elles forment un motif différent. Tisser, dans l’idée de l’auteur, c'est s’identifier à une fibre, accepter de se réunir à d'autres pour une existence différente, forcément plus forte et plus vaste.
J’ai succombé à ce récit dès la première phrase. J’ai su que j’allais éprouver une sorte de fascination qui resterait ancrée en moi pour toujours (je l’espère vivement).
TISSER vous happe dans sa toile en un tour de main. Magie, obsession hypnotisante, Raharimanana, grand orateur, oracle de son temps, narre avec une telle évidence, spontanéité et fascination de ce temps qui fût, qui est et qui sera.
Entre contes, mythes et réalité, il nous confesse le grand mal du monde. L’absence d’écoute des peuples quelques qu’ils soient et surtout ceux de l’Afrique. Il expose une vision panoramique de ces vies détruites par le colonialisme et la perte d’identités riches, culturelles et communautaires.
Au travers du prisme d’un enfant mort né, le flux va et vient entre aperçu du temps présent, légende, hypothèse, futur.
Raharimanana parle de la vie et de la mort, lien ténu et indivisible, il tisse ses vies au travers de ce filtre étonnant reliant une vision merveilleuse et horrifique.
TISSER c’est hurler et pleurer la vie. C’est donner un sens à l’héritage, à la mémoire, à la nature, à la femme, à l’amour.
Mémoire universelle du berceau de la vie.
TISSER chante une chanson mélancolique, douce, tendre où l’amour s’accorde avec la tristesse et la mort.
TISSER se chante, se crie, se chuchote. Poème reflétant une immensité où le plus infime est d’une beauté rare.
TISSER est sans contexte un voyage inédit. Un voyage au bout du monde où la liberté est chère et la vie un fruit défendu.
Lien : https://lesmisschocolatinebo..
TISSER vous happe dans sa toile en un tour de main. Magie, obsession hypnotisante, Raharimanana, grand orateur, oracle de son temps, narre avec une telle évidence, spontanéité et fascination de ce temps qui fût, qui est et qui sera.
Entre contes, mythes et réalité, il nous confesse le grand mal du monde. L’absence d’écoute des peuples quelques qu’ils soient et surtout ceux de l’Afrique. Il expose une vision panoramique de ces vies détruites par le colonialisme et la perte d’identités riches, culturelles et communautaires.
Au travers du prisme d’un enfant mort né, le flux va et vient entre aperçu du temps présent, légende, hypothèse, futur.
Raharimanana parle de la vie et de la mort, lien ténu et indivisible, il tisse ses vies au travers de ce filtre étonnant reliant une vision merveilleuse et horrifique.
TISSER c’est hurler et pleurer la vie. C’est donner un sens à l’héritage, à la mémoire, à la nature, à la femme, à l’amour.
Mémoire universelle du berceau de la vie.
TISSER chante une chanson mélancolique, douce, tendre où l’amour s’accorde avec la tristesse et la mort.
TISSER se chante, se crie, se chuchote. Poème reflétant une immensité où le plus infime est d’une beauté rare.
TISSER est sans contexte un voyage inédit. Un voyage au bout du monde où la liberté est chère et la vie un fruit défendu.
Lien : https://lesmisschocolatinebo..
Il y a des lectures dont on se dit : «Ca, ce n’est vraiment pas pour moi ». Tisser m’a fait cet effet-là. Pire. J’ai eu envie de le fuir très rapidement, et la seule raison qui m’a fait tenir, c’est que l’auteur est malgache, et allait me permettre de poursuivre mon tour du monde de la littérature ! A plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans le même état que lorsque je vais au théâtre voir des pièces d’avant-garde, et que mon esprit se perd à ne pas comprendre où veut en venir l’auteur. Je m’endors, je me lasse, je ne trouve pas d’intérêt et j’ai envie de quitter la salle. Ici, l’auteur donne la parole à un bébé mort-né, dont l’esprit rôde encore pour un temps sur cette terre. Et ce bébé, très lucide, oscille entre les récits de mythes et l’analyse sociologique, pour arriver de temps en temps à des conclusions (et celles-là sont les parties les plus compréhensibles, auxquelles je m’accrochais pour ne pas sombrer) sur le passé et le devenir de l’Afrique, les méfaits de la colonisation, la nécessité de revoir notre manière d’appréhender la Terre et nos relations aux autres, qu’ils soient du Nord ou du Sud. Quelques beaux passages, donc, mais que ce fut laborieux !
« Tisser, c’est se connaître comme fibre, et accepter de se lier à d’autres pour une existence plus vaste. Tisser les mémoires. Tisser les vies. Tisser l’utopie. »
Dans ce court texte hybride, où conte, poésie et essai se côtoient, Jean-Luc Raharimanana, à travers son narrateur un enfant mort-né, nous raconte le monde. « Je suis mort, l’ourlet de tous les vivants, le point de finition entre les générations. Imaginez-moi comme une fumée bleue évanescente, se brumant, dès qu’on l’aperçoit, je me déroule d’un recoin qu’on ne remarque pas, rappel d’azur et l’infini pressenti. » En convoquant les mythes et légendes malgaches, la conscience de cet enfant nous parle de la genèse de la civilisation. On y découvre deux entités : le Ciel et la Terre. Le Ciel est le Dieu d’en haut, le principe mâle et il se nomme Ralanitra. La Terre est le Dieu d’en-bas, le principe femelle et se nomme Ratany. En s’unissant, ils ont pu donner vie aux corps de toutes les espèces. « Tu as des statues qui n’ont pas de vie. J’ai de la vie qui n’a pas de corps. Unissons-nous. Je te donne la vie. Tu me donnes les corps ». Un point de départ pour aborder par la suite ces périodes douloureuses qui ont touché l’Afrique, telles que l’esclavage et la colonisation, mais il est également question d’aujourd’hui avec la mondialisation.
Il est difficile de résumer cet ouvrage. Un texte singulier dans lequel je me suis laissé porter et qui m’a parfois perdue. Une plume poétique et travaillée, exigeante mais sans contexte magnifique.
Tisser, c’est à la fois un plaidoyer politique et un récit de transmission. Transmettre l’Histoire, ne pas l’occulter. Comprendre et être fier de ses origines. Tisser, c’est un hommage à l’Afrique et sa grandeur !
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Dans ce court texte hybride, où conte, poésie et essai se côtoient, Jean-Luc Raharimanana, à travers son narrateur un enfant mort-né, nous raconte le monde. « Je suis mort, l’ourlet de tous les vivants, le point de finition entre les générations. Imaginez-moi comme une fumée bleue évanescente, se brumant, dès qu’on l’aperçoit, je me déroule d’un recoin qu’on ne remarque pas, rappel d’azur et l’infini pressenti. » En convoquant les mythes et légendes malgaches, la conscience de cet enfant nous parle de la genèse de la civilisation. On y découvre deux entités : le Ciel et la Terre. Le Ciel est le Dieu d’en haut, le principe mâle et il se nomme Ralanitra. La Terre est le Dieu d’en-bas, le principe femelle et se nomme Ratany. En s’unissant, ils ont pu donner vie aux corps de toutes les espèces. « Tu as des statues qui n’ont pas de vie. J’ai de la vie qui n’a pas de corps. Unissons-nous. Je te donne la vie. Tu me donnes les corps ». Un point de départ pour aborder par la suite ces périodes douloureuses qui ont touché l’Afrique, telles que l’esclavage et la colonisation, mais il est également question d’aujourd’hui avec la mondialisation.
Il est difficile de résumer cet ouvrage. Un texte singulier dans lequel je me suis laissé porter et qui m’a parfois perdue. Une plume poétique et travaillée, exigeante mais sans contexte magnifique.
Tisser, c’est à la fois un plaidoyer politique et un récit de transmission. Transmettre l’Histoire, ne pas l’occulter. Comprendre et être fier de ses origines. Tisser, c’est un hommage à l’Afrique et sa grandeur !
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Le nouveau livre de Raharimanana, publié sous les auspices de Rodney Saint-Eloi en sa maison de Mémoire d’encrier, n’est pas tout à fait un récit, ni un essai, ni un poème, mais il tient un peu de tout cela. On imagine bien ces pages portées à la scène. Parler de genre inclassable est devenu, en régime postmoderne, une facilité critique, mais ce qui fascine ici, c’est la manière dont ce texte s’inscrit dans un genre très défini, celui de l’essai-récit-discours post-colonial ; de W.E.B. Du Bois et Franz Fanon aux livres essentiels d’Ama Ata Aidoo, Our Sister Killjoy [1977] et de Shailja Patel, Migritude [2010].
Textes aussi poétiques que politiques, dans lesquels il est impossible de dissocier, de détisser la trame poétique de la trame politique : la parole poétique n’est pas là pour formuler un pré-pensé politique, et encore moins un quelconque prêt-à-penser. C’est dans la parole, le tissage de voix/phrases, que se forme le discours politique.
lire la suite suite ici : http://litteralutte.com/ecrire/?exec=article&id_article=37#
Lien : http://litteralutte.com/ecri..
Textes aussi poétiques que politiques, dans lesquels il est impossible de dissocier, de détisser la trame poétique de la trame politique : la parole poétique n’est pas là pour formuler un pré-pensé politique, et encore moins un quelconque prêt-à-penser. C’est dans la parole, le tissage de voix/phrases, que se forme le discours politique.
lire la suite suite ici : http://litteralutte.com/ecrire/?exec=article&id_article=37#
Lien : http://litteralutte.com/ecri..
Véritable expérience de lecture. Il y a de ces livres dont on a l'impression de ne jamais avoir rien lu de semblable ailleurs.
Assez irracontable et développant des réflexions puissantes, cette plongée dans l'inconnu vallait le coup.
Le principe est que le narrateur, esprit d'enfant mort-né, vit des fragments de vies des vivants. Chaque courte partie développe alors un mythe, une bribe d'histoire personnelle ou un concept philosophique qui s'entremêlent et se répondent.
La mythologie malgache telle que la dépeint Raharimanana est toute en dualité. Tout y est question d'équilibre et de lien.
Pour l'auteur, le mythe est ce qui lie au passé et aux autres. Nous avons toutes et tous des histoires qui au delà de fonder des groupes humains par un mythe fondateur commun, leur donnent du sens. Ainsi, toute amitié a son vécu, toute nation a son roman national, toute vérité a son histoire des sciences...
Le narrateur parle aussi du déchirement que représente l'arrachement à ses racines lorsque l'on perd ses mythes et de son Histoire. Car en effet, certains peuples n'ont pas ou plus de vestiges prouvant les civilisations d'où ils viennent. Vestiges qui d'ailleurs pas ne limitent pas aux constructions physiques, mais aussi à la culture immatérielle, la philosophie, la science ou la médecine.
Naturellement, il est donc beaucoup question de colonisation. Selon l'auteur, une idée continue d'être profondément ancrée dans les mœurs : le capitalisme, se considérant lui-même comme l'apogée, est perçu comme ce vers quoi les pays en voie de développement devraient se diriger.
La critique est faite au capitalisme d'asservir les peuples, allant même jusqu'à les tuer. La mère du narrateur par exemple, ouvrière dans une usine d'une multinationale, a dû avorter pour éviter de perdre son emploi. Cela m'évoque malheureusement de nombreuses images choquantes du monde réel (l'usine Camaïeu au Bangladesh construite au rabais pour économiser qui s'est effondrée sur les employées, ou plus récemment l'entreprise sud-coréenne SPC Group qui n'a pas fermé son usine alors qu'une ouvrière était tombée dans une broyeuse...).
Le narrateur s'excuse de dire « nous », car ce mot a évolué dans un sens qui exclue un « vous ». Il précise que ce « nous » concerne tous les humains, il raconte leur histoire telle qu'il l'a vécue lui-même à travers ses périgrinations de corps en corps. Mais à un moment, il souhaite parler de l'Afrique en particulier et ce « nous » devient spécifique, et donc au malheur du narrateur aussi excluant. J'ai trouvé le développement de cette idée très fort.
À travers l'exposé de ces idées philosophiques sur le rapport au passé, la politique et la place des femmes, le fil rouge reste « tisser ». Il s'agit sans doute de l'un des livres qui porte le mieux son titre. En effet, cette nasse de fils entremêlés forment un tout cohérent. Et ce n'est pas le « tissage » ou le « tissu », mais bien l'action « tisser » qui importe. Et l'auteur de filer cette métaphore.
Tisser est un savoir-faire qui se transmet, il est lié aux vêtements, aux apparences que l'on se donne (vêtements, langage, culture, sagesse, philosophie). Quand l'humain se dénude, enlève le tissu, il fait face à sa propre fragilité, qu'il ne doit pas oublier.
Les mythes tissent des liens entre humains. Mais tisser n'est pas spécifiquement humain, car l'araignée tisse pour se nourrir et le papillon pour se transformer.
Tisser c'est aussi devenu une industrie, qui en forçant des populations à s'habiller uniformément à l'occidentale, heurte leur identité. Cela affecte aussi à l'équilibre de la planète avec le désordre écologique auquel elle participe.
Si un fil manque, la toile risque de s'effilocher, mais aucun fil n'est plus important qu'un autre. Et lorsqu'il y a une déchirure dans un tissage, il faut d'abord l'identifier pour la réparer.
En conclusion, ce livre ne pourra pas plaire à tout le monde.
Personnellement, j'ai énormément apprécié découvrir cette forme de narration tissée de mythes, de philosophie, de poésie même parfois, de bribes de fictions et de sentiments vrais.
Cette lecture m'a enrichie de visions du monde provenant d'un autre vécu, d'une autre Histoire. Et même si je ne sais pas encore si j'adhère à toutes, cela a soulevé nombre de questionnements sur l'impact encore actuel que peut avoir le colonialisme sur les esprits. Sujet vaste, complexe, passionnant, et surtout important.
Assez irracontable et développant des réflexions puissantes, cette plongée dans l'inconnu vallait le coup.
Le principe est que le narrateur, esprit d'enfant mort-né, vit des fragments de vies des vivants. Chaque courte partie développe alors un mythe, une bribe d'histoire personnelle ou un concept philosophique qui s'entremêlent et se répondent.
La mythologie malgache telle que la dépeint Raharimanana est toute en dualité. Tout y est question d'équilibre et de lien.
Pour l'auteur, le mythe est ce qui lie au passé et aux autres. Nous avons toutes et tous des histoires qui au delà de fonder des groupes humains par un mythe fondateur commun, leur donnent du sens. Ainsi, toute amitié a son vécu, toute nation a son roman national, toute vérité a son histoire des sciences...
Le narrateur parle aussi du déchirement que représente l'arrachement à ses racines lorsque l'on perd ses mythes et de son Histoire. Car en effet, certains peuples n'ont pas ou plus de vestiges prouvant les civilisations d'où ils viennent. Vestiges qui d'ailleurs pas ne limitent pas aux constructions physiques, mais aussi à la culture immatérielle, la philosophie, la science ou la médecine.
Naturellement, il est donc beaucoup question de colonisation. Selon l'auteur, une idée continue d'être profondément ancrée dans les mœurs : le capitalisme, se considérant lui-même comme l'apogée, est perçu comme ce vers quoi les pays en voie de développement devraient se diriger.
La critique est faite au capitalisme d'asservir les peuples, allant même jusqu'à les tuer. La mère du narrateur par exemple, ouvrière dans une usine d'une multinationale, a dû avorter pour éviter de perdre son emploi. Cela m'évoque malheureusement de nombreuses images choquantes du monde réel (l'usine Camaïeu au Bangladesh construite au rabais pour économiser qui s'est effondrée sur les employées, ou plus récemment l'entreprise sud-coréenne SPC Group qui n'a pas fermé son usine alors qu'une ouvrière était tombée dans une broyeuse...).
Le narrateur s'excuse de dire « nous », car ce mot a évolué dans un sens qui exclue un « vous ». Il précise que ce « nous » concerne tous les humains, il raconte leur histoire telle qu'il l'a vécue lui-même à travers ses périgrinations de corps en corps. Mais à un moment, il souhaite parler de l'Afrique en particulier et ce « nous » devient spécifique, et donc au malheur du narrateur aussi excluant. J'ai trouvé le développement de cette idée très fort.
À travers l'exposé de ces idées philosophiques sur le rapport au passé, la politique et la place des femmes, le fil rouge reste « tisser ». Il s'agit sans doute de l'un des livres qui porte le mieux son titre. En effet, cette nasse de fils entremêlés forment un tout cohérent. Et ce n'est pas le « tissage » ou le « tissu », mais bien l'action « tisser » qui importe. Et l'auteur de filer cette métaphore.
Tisser est un savoir-faire qui se transmet, il est lié aux vêtements, aux apparences que l'on se donne (vêtements, langage, culture, sagesse, philosophie). Quand l'humain se dénude, enlève le tissu, il fait face à sa propre fragilité, qu'il ne doit pas oublier.
Les mythes tissent des liens entre humains. Mais tisser n'est pas spécifiquement humain, car l'araignée tisse pour se nourrir et le papillon pour se transformer.
Tisser c'est aussi devenu une industrie, qui en forçant des populations à s'habiller uniformément à l'occidentale, heurte leur identité. Cela affecte aussi à l'équilibre de la planète avec le désordre écologique auquel elle participe.
Si un fil manque, la toile risque de s'effilocher, mais aucun fil n'est plus important qu'un autre. Et lorsqu'il y a une déchirure dans un tissage, il faut d'abord l'identifier pour la réparer.
En conclusion, ce livre ne pourra pas plaire à tout le monde.
Personnellement, j'ai énormément apprécié découvrir cette forme de narration tissée de mythes, de philosophie, de poésie même parfois, de bribes de fictions et de sentiments vrais.
Cette lecture m'a enrichie de visions du monde provenant d'un autre vécu, d'une autre Histoire. Et même si je ne sais pas encore si j'adhère à toutes, cela a soulevé nombre de questionnements sur l'impact encore actuel que peut avoir le colonialisme sur les esprits. Sujet vaste, complexe, passionnant, et surtout important.
Pas toujours facile à lire, le parti pris de cette voix intérieure peut-être déroutant. Mais, après avoir connu Madagascar où j'ai vécu plusieurs années, ce roman prend une résonnance particulière de vérité brutale sur ces coutumes qui resteront à jamais nébuleuses à l'occidental.
J'en ai lu 10 pages. Je n'ai absolument rien compris. Je sais que Raharimanana peut être obscure parfois, mais là c'est le pompom.
Passons.
Passons.
beaucoup de violence
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Raharimanana
Lecteurs de Raharimanana (135)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Zombies
En quelle année est sortie le 1er film mettant en scène des Zombies " La Nuit des Morts-Vivants " ?
1962
1968
1970
1973
12 questions
72 lecteurs ont répondu
Thèmes :
zombies
, horreurCréer un quiz sur cet auteur72 lecteurs ont répondu