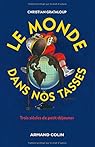Critiques de Christian Grataloup (37)
Agréable à lire, cet ouvrage bouscule bien de nos idées reçues, donne à réfléchir et contribue à nous faire penser autrement. Pari tenu.
Lien : https://www.lhistoire.fr/liv..
Lien : https://www.lhistoire.fr/liv..
Aujourd’hui je vais évoquer Géohistoire formidable essai roboratif de Christian Grataloup. Le sous-titre explicite est Une autre histoire des humains sur la Terre.
L’auteur est géographe mais n’a jamais considéré sa discipline comme indépendante des autres et notamment l’histoire. Le concept de Géohistoire est donc de raconter l’histoire non pas uniquement en se basant sur la chronologie et le prisme des préceptes historiques canoniques mais en convoquant constamment les apports de la géographie (et de quelques autres sciences sociales). Le rôle des vents, de la température, des courants marins sont par exemple pris en compte comme facteurs décisifs des faits historiques. Le résultat est absolument passionnant et déconstruit toutes les habitudes et les modes de pensée européo-centrés. Tout est disruptif et fondamentalement convainquant dans cette approche méthodologique qui décloisonne les chapelles théoriques. Christian Grataloup en huit chapitres précis avec une introduction qui pose les fondements de sa perspective retrace les grandes étapes de l’aventure humaine sur la Terre. Du néolithique à nos jours il raconte l’histoire de la planète avec ses peuplements, ses influences, ses dominations, ses flux principaux et ses isolements. Il est question de peuplement et de démographie avec les épisodes successifs de grandes migrations humaines. Le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs à celle d’agriculteurs-éleveurs sont au cœur d’un phénomène mondialisé qui survient à des époques proches dans des lieux fort éloignés. La découverte de l’Amérique constitue immanquablement un basculement majeur. L’effroi des désastres humains causés avec les pandémies et l’évolution drastique de la population mondiale est une façon de raconter l’histoire. Ailleurs il est question de la division du monde entre l’Espagne et le Portugal (traité de Tordesillas), des routes des épices, des voix maritimes et terrestres de circulation et d’échange. Résumer Géohistoire est un exercice compliqué et réducteur tant tout est intéressant et pertinent. L’auteur s’appuie sur les concepts d’axes et de mondes qui se comprennent aisément et étayent sa théorie pour développer cette histoire holistique. Géohistoire se dévore comme un roman, de nombreux faits historiques prennent une résonnance différentes par le biais de l’ajout de l’apport géographique. Géohistoire est illustré par une soixantaine de cartes en couleurs et des dizaines d’autres cartes thématiques. Ces supports sont souvent aussi informatifs que de longs chapitres. Il ne s’agit pas des représentations classiques avec l’Europe au centre, l’Amérique à gauche et l’Asie à droite. Ces décentrements sont indispensables pour sortir des modes de pensée classiques et admettre que d’autres points de vue sont tout autant valides.
Géohistoire est déconcertant et épatant. L’auteur invite à réfléchir autrement, à déconstruire des évidences et à adopter une focale différente, plus centré sur les lieux et les humains concernés pour narrer une histoire mondiale défaite autant que possible de préjugés qui biaisent la lecture. Un texte et des cartes utiles à mettre entre toutes les mains. Un livre magistral.
Voilà, je vous ai donc parlé de Géohistoire de Christian Grataloup paru aux éditions Les Arènes.
Lien : http://culture-tout-azimut.o..
L’auteur est géographe mais n’a jamais considéré sa discipline comme indépendante des autres et notamment l’histoire. Le concept de Géohistoire est donc de raconter l’histoire non pas uniquement en se basant sur la chronologie et le prisme des préceptes historiques canoniques mais en convoquant constamment les apports de la géographie (et de quelques autres sciences sociales). Le rôle des vents, de la température, des courants marins sont par exemple pris en compte comme facteurs décisifs des faits historiques. Le résultat est absolument passionnant et déconstruit toutes les habitudes et les modes de pensée européo-centrés. Tout est disruptif et fondamentalement convainquant dans cette approche méthodologique qui décloisonne les chapelles théoriques. Christian Grataloup en huit chapitres précis avec une introduction qui pose les fondements de sa perspective retrace les grandes étapes de l’aventure humaine sur la Terre. Du néolithique à nos jours il raconte l’histoire de la planète avec ses peuplements, ses influences, ses dominations, ses flux principaux et ses isolements. Il est question de peuplement et de démographie avec les épisodes successifs de grandes migrations humaines. Le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs à celle d’agriculteurs-éleveurs sont au cœur d’un phénomène mondialisé qui survient à des époques proches dans des lieux fort éloignés. La découverte de l’Amérique constitue immanquablement un basculement majeur. L’effroi des désastres humains causés avec les pandémies et l’évolution drastique de la population mondiale est une façon de raconter l’histoire. Ailleurs il est question de la division du monde entre l’Espagne et le Portugal (traité de Tordesillas), des routes des épices, des voix maritimes et terrestres de circulation et d’échange. Résumer Géohistoire est un exercice compliqué et réducteur tant tout est intéressant et pertinent. L’auteur s’appuie sur les concepts d’axes et de mondes qui se comprennent aisément et étayent sa théorie pour développer cette histoire holistique. Géohistoire se dévore comme un roman, de nombreux faits historiques prennent une résonnance différentes par le biais de l’ajout de l’apport géographique. Géohistoire est illustré par une soixantaine de cartes en couleurs et des dizaines d’autres cartes thématiques. Ces supports sont souvent aussi informatifs que de longs chapitres. Il ne s’agit pas des représentations classiques avec l’Europe au centre, l’Amérique à gauche et l’Asie à droite. Ces décentrements sont indispensables pour sortir des modes de pensée classiques et admettre que d’autres points de vue sont tout autant valides.
Géohistoire est déconcertant et épatant. L’auteur invite à réfléchir autrement, à déconstruire des évidences et à adopter une focale différente, plus centré sur les lieux et les humains concernés pour narrer une histoire mondiale défaite autant que possible de préjugés qui biaisent la lecture. Un texte et des cartes utiles à mettre entre toutes les mains. Un livre magistral.
Voilà, je vous ai donc parlé de Géohistoire de Christian Grataloup paru aux éditions Les Arènes.
Lien : http://culture-tout-azimut.o..
il existe des livres de géographie, des livres d'histoire, des livre de géopolitique, voici un livre de géohistoire qui nous explique les fondements de l'humanité et comment l'humain a investi le monde.
Au grès des périodes de glaciation, au grés des mouvements terrestres l'homme à conquit de nouveaux territoires et créer les nouvelles civilisations dont notre monde actuel est le fruit.
Tout au long de lecture, il renvoie vers l'Atlas situé au cœur du livre pour illustrer son analyse avec des cartes, des schémas et on comprend mieux comment l'homo sapiens dont les origines les plus ancienne le situe dans l'Eufrasie, a évolué vers l'agriculture, vers la domestication de son environnement et que les société se sont crées.
Au moment où les conflits se multiplient pour des revendications de territoire , ce livre nous éclaire et nous donne, peut être, des clefs pour comprendre le monde actuel, la répartitions des populations, des croyances et toutes ces différences qui engendre les guerres.
Un très bon complément aux différents Atlas que l'auteur a déjà publié sur notre monde.
Lecture un peu technique, j'ai dû parfois chercher des explicitons et des définitions mais une mine d'éclaircissements géographique et historiques.
Au grès des périodes de glaciation, au grés des mouvements terrestres l'homme à conquit de nouveaux territoires et créer les nouvelles civilisations dont notre monde actuel est le fruit.
Tout au long de lecture, il renvoie vers l'Atlas situé au cœur du livre pour illustrer son analyse avec des cartes, des schémas et on comprend mieux comment l'homo sapiens dont les origines les plus ancienne le situe dans l'Eufrasie, a évolué vers l'agriculture, vers la domestication de son environnement et que les société se sont crées.
Au moment où les conflits se multiplient pour des revendications de territoire , ce livre nous éclaire et nous donne, peut être, des clefs pour comprendre le monde actuel, la répartitions des populations, des croyances et toutes ces différences qui engendre les guerres.
Un très bon complément aux différents Atlas que l'auteur a déjà publié sur notre monde.
Lecture un peu technique, j'ai dû parfois chercher des explicitons et des définitions mais une mine d'éclaircissements géographique et historiques.
Resituer les questions d'aujourd'hui dans le temps et dans l'espace est toujours bénéfique à la compréhension de notre monde en nous aidant à nous libérer de nos évidences de pensée et à bouleverser nos points de vue. Le livre de M. Grataloup y contribue sans nul doute.
En quelques mots ce que j'en retiens :
La géo-histoire de la mondialisation commence au moment de l'apparition de l'homme, a priori dans l'est de l'Afrique, et de son expansion à la surface de la terre, entrainant la mise à distance et la séparation des groupes humains qui durant des millénaires ont ignoré leur existence respective... l'inverse de la mondialisation. D'ailleurs, le Monde n'existait pas vraiment.
La croissance démographique a conduit progressivement à réduire la distance géographique entre les hommes ( plus ou moins selon les régions) et à multiplier les échanges entre eux.
Pendant des millénaires également, les conditions matérielles de vie à la surface de la terre ne présentaient pas d'écart notable, même entre des civilisations qui s'ignoraient : entre les Mayas, les royaumes chinois, le royaume du Zimbabwe ou l’Europe médiévale .
Puis les choses ont changé, au bénéfice de l'Europe occidentale, partie prenante d'un vaste système-monde, allant de la Méditerranée au Japon et où les interrelations étaient déjà importantes. La date clé est celle de de 1492. Le fait clé a été la découverte de l’Amérique, c'est à dire d'un vaste espace très peu peuplé qui a constitué un réservoir de richesse et un terrain d'expansion pour les Européens, alors que ceux-ci étaient souvent dominés et contrecarrés dans leurs projets commerciaux que ce soit en Afrique ou en Asie.
A l'époque d'Henri le navigateur, un marin chinois ZHENG HE se lance aussi dans des expéditions maritimes, mais à bord de jonques conçues pour la navigation en régime des moussons, donc inaptes aux longues traversées vers l'Atlantique ou le Pacifique. Comme dit l'auteur " pour arriver, il fallait partir". Les marins chinois ne sont pas partis ... ils n'ont donc pas trouvé l'Amérique. La face du monde en aurait été changée. Les raisons évoquées par l'auteur sont climatiques techniques mais aussi politiques : les empereurs chinois, menacés par les Mongols, se sont mobilisés pour leur défense à l’intérieur des terres. Leur puissance leur a permis d'interdire toute tentative dissidente. A l'autre bout du système-monde, l'Europe était éclatée et divisée, permettant du coup aux initiatives individuelles de se développer, soutenues par tel roi ou tel autre ou encore par les cités état italiennes.
Les Européens de la fin du Moyen Age étaient devenus friands de produits qu'ils ne pouvaient cultiver chez eux; comme le sucre qu'ils partiront chercher au bout du monde ou qu'ils cultiveront en Amérique grâce à l'importation de main d’œuvre esclave. Ce fut la première colonisation qui permis un enrichissement massif et un bouleversement des modes de vie.
A partir du XIXème et de la révolution industrielle, la dissymétrie de développement et de richesse a conduit à la domination de l'Europe également en Afrique et sur une partie de l’Asie. Cette domination a conduit à une phase de mondialisation associée à la révolution industrielle qui se terminera dans les guerres et les atrocités du "court XXeme siècle", dans un monde où le système économique est mondial mais les nationalismes si virulents " qu'ils peuvent maintenir pendant 4 longues années des millions d'hommes dans l'enfer des tranchées "
Pour l'auteur, le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent de celui qui s'est achevé dans les guerres du XX ème siècle : avec des échanges économiques larges et des identités locales d'autant plus ancrées et revendicatrices que la dilution dans la mondialisation fait craindre la perte de soi ( au point qu'on reconstruit parfois le "soi" comme le montre l'auteur lorsqu'il explique la création des traditions vestimentaires, culturelles et et culinaires des régions françaises au cours XIXeme siècle).
Les mouvements vers la mondialisation sont eux divers : certains mouvements altermondialistes lorsqu'ils œuvrent pour une mondialisation différente mais aussi les firmes multinationales, les institutions ou certains mouvements islamistes qui sont aussi une contestation de la mondialisation occidentale prônant une autre échelle du monde transcendant les frontières.
Pour finir, l'auteur reconnait que sa propre analyse est forcément enserrée dans les cadres de pensée forgés par l'Occident et que ceux-ci ne sont pas universels....
Une lecture riche et passionnante qui brosse un tableau brillant de la mondialisation, avec les limites inévitables de la rapidité, certainement des simplifications. Une histoire du monde en 267 pages seulement... forcément ...
En quelques mots ce que j'en retiens :
La géo-histoire de la mondialisation commence au moment de l'apparition de l'homme, a priori dans l'est de l'Afrique, et de son expansion à la surface de la terre, entrainant la mise à distance et la séparation des groupes humains qui durant des millénaires ont ignoré leur existence respective... l'inverse de la mondialisation. D'ailleurs, le Monde n'existait pas vraiment.
La croissance démographique a conduit progressivement à réduire la distance géographique entre les hommes ( plus ou moins selon les régions) et à multiplier les échanges entre eux.
Pendant des millénaires également, les conditions matérielles de vie à la surface de la terre ne présentaient pas d'écart notable, même entre des civilisations qui s'ignoraient : entre les Mayas, les royaumes chinois, le royaume du Zimbabwe ou l’Europe médiévale .
Puis les choses ont changé, au bénéfice de l'Europe occidentale, partie prenante d'un vaste système-monde, allant de la Méditerranée au Japon et où les interrelations étaient déjà importantes. La date clé est celle de de 1492. Le fait clé a été la découverte de l’Amérique, c'est à dire d'un vaste espace très peu peuplé qui a constitué un réservoir de richesse et un terrain d'expansion pour les Européens, alors que ceux-ci étaient souvent dominés et contrecarrés dans leurs projets commerciaux que ce soit en Afrique ou en Asie.
A l'époque d'Henri le navigateur, un marin chinois ZHENG HE se lance aussi dans des expéditions maritimes, mais à bord de jonques conçues pour la navigation en régime des moussons, donc inaptes aux longues traversées vers l'Atlantique ou le Pacifique. Comme dit l'auteur " pour arriver, il fallait partir". Les marins chinois ne sont pas partis ... ils n'ont donc pas trouvé l'Amérique. La face du monde en aurait été changée. Les raisons évoquées par l'auteur sont climatiques techniques mais aussi politiques : les empereurs chinois, menacés par les Mongols, se sont mobilisés pour leur défense à l’intérieur des terres. Leur puissance leur a permis d'interdire toute tentative dissidente. A l'autre bout du système-monde, l'Europe était éclatée et divisée, permettant du coup aux initiatives individuelles de se développer, soutenues par tel roi ou tel autre ou encore par les cités état italiennes.
Les Européens de la fin du Moyen Age étaient devenus friands de produits qu'ils ne pouvaient cultiver chez eux; comme le sucre qu'ils partiront chercher au bout du monde ou qu'ils cultiveront en Amérique grâce à l'importation de main d’œuvre esclave. Ce fut la première colonisation qui permis un enrichissement massif et un bouleversement des modes de vie.
A partir du XIXème et de la révolution industrielle, la dissymétrie de développement et de richesse a conduit à la domination de l'Europe également en Afrique et sur une partie de l’Asie. Cette domination a conduit à une phase de mondialisation associée à la révolution industrielle qui se terminera dans les guerres et les atrocités du "court XXeme siècle", dans un monde où le système économique est mondial mais les nationalismes si virulents " qu'ils peuvent maintenir pendant 4 longues années des millions d'hommes dans l'enfer des tranchées "
Pour l'auteur, le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent de celui qui s'est achevé dans les guerres du XX ème siècle : avec des échanges économiques larges et des identités locales d'autant plus ancrées et revendicatrices que la dilution dans la mondialisation fait craindre la perte de soi ( au point qu'on reconstruit parfois le "soi" comme le montre l'auteur lorsqu'il explique la création des traditions vestimentaires, culturelles et et culinaires des régions françaises au cours XIXeme siècle).
Les mouvements vers la mondialisation sont eux divers : certains mouvements altermondialistes lorsqu'ils œuvrent pour une mondialisation différente mais aussi les firmes multinationales, les institutions ou certains mouvements islamistes qui sont aussi une contestation de la mondialisation occidentale prônant une autre échelle du monde transcendant les frontières.
Pour finir, l'auteur reconnait que sa propre analyse est forcément enserrée dans les cadres de pensée forgés par l'Occident et que ceux-ci ne sont pas universels....
Une lecture riche et passionnante qui brosse un tableau brillant de la mondialisation, avec les limites inévitables de la rapidité, certainement des simplifications. Une histoire du monde en 267 pages seulement... forcément ...
Passons sur l’académisme de la forme, rien d’original pour un essai scientifique et universitaire. Pour les habitués d’envolées lyriques, enterrez vos espérances, la prose de Christian Grataloup ne vise qu’à la clairvoyance et à la compréhension d’un sujet très à la mode : la mondialisation. Mais l’originalité de la recherche réside dans l’approche géohistorique de ce thème. En s’aidant des concepts et des principes propres à la géographie, l’auteur présente la construction sociale du Monde depuis l’origine de l’Humanité jusqu’à nos jours et expose l’ensemble des logiques spatiales et territoriales pouvant donner un sens à ce mouvement d’ensemble. Enfin, Christian Grataloup accentue l’originalité de sa recherche en essayant du mieux possible d’avoir une approche omnisciente du phénomène et en prenant de la distance avec les visions et les habitudes scientifiques trop souvent européocentrées. Des grands marchands antiques du Croissant fertile aux replis identitaires de l’Iran, des Grandes Découvertes à l’impérialisme américain, cet essai est, malgré son académisme, une belle échappée exploratrice.
Une approche originale où l'outil cartographique sert à restituer une grande variété de phénomènes internationaux actuels ou anciens de manière à en comprendre la logique géographique.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
De la dissémination des premiers hommes sur Terre jusqu'à l'usage d'Internet, en passant par la géographie du bonheur et le cycle du carbone, cet atlas historique et géographique aborde de nombreux sujets intéressant notre monde. Il n'est pas à proprement parler géopolitique mais, à travers tous ces thèmes et d'autres sujets sociétaux, donne d'autres clés de lecture de notre monde et des relations entre pays, autres que les habituels conflits de frontières ou de ressources ou les rapports de force.
Les cartes sont simples. Cela n'a rien d'une critique. Au contraire, loin des surcharges trop souvent constatées ailleurs, elles sont dépouillées afin d'être particulièrement lisibles. Tout en aplats de couleurs pastel et sans limites, elles sont très agréables à regarder. Je leur reprocherai seulement quelques couleurs trop proches parfois, difficiles à distinguer les unes des autres. Ces documents sont accompagnés de textes intéressants mais souvent trop courts (les thèmes sont traités sur une double page en général). Ce sont d'ailleurs souvent les quelques sujets développés sur quatre pages qui m'ont particulièrement passionné, notamment les sujets les plus originaux comme "Des sociétés sans animaux ?" ou "Qu'est-ce qu'un évènement mondial ?".
Un très bel ouvrage pour parcourir le monde avec un regard différent.
Les cartes sont simples. Cela n'a rien d'une critique. Au contraire, loin des surcharges trop souvent constatées ailleurs, elles sont dépouillées afin d'être particulièrement lisibles. Tout en aplats de couleurs pastel et sans limites, elles sont très agréables à regarder. Je leur reprocherai seulement quelques couleurs trop proches parfois, difficiles à distinguer les unes des autres. Ces documents sont accompagnés de textes intéressants mais souvent trop courts (les thèmes sont traités sur une double page en général). Ce sont d'ailleurs souvent les quelques sujets développés sur quatre pages qui m'ont particulièrement passionné, notamment les sujets les plus originaux comme "Des sociétés sans animaux ?" ou "Qu'est-ce qu'un évènement mondial ?".
Un très bel ouvrage pour parcourir le monde avec un regard différent.
Dès l’école, on nous inculque l’existence de cinq continents. Une notion arbitraire, invention humaine (pour ne pas dire occidentale) qui a toujours formaté notre vision du monde avec des effets réels comme, par exemple, les unions politiques et économiques (UE), les championnats sportifs,…
Le géohistorien Christian Grataloup revient dans cet ouvrage sur l’histoire de ces grands blocs territoriaux dont la formation à évoluer en fonction des visions religieuses, des découvertes scientifiques, des explorations,…
Bon ouvrage, instructif et bien illustré. Il sera peut-être un peu trop dense et complexe pour certains mais il mérite le coup d’oeil. Si le contenu est assez européocentré, l’auteur n’oublie pas de faire un tour d’horizon, notamment est-asiatique, des cartes et perceptions du monde d’autrefois.
A lire pour tous ceux intéressés un minimum par le sujet.
Le géohistorien Christian Grataloup revient dans cet ouvrage sur l’histoire de ces grands blocs territoriaux dont la formation à évoluer en fonction des visions religieuses, des découvertes scientifiques, des explorations,…
Bon ouvrage, instructif et bien illustré. Il sera peut-être un peu trop dense et complexe pour certains mais il mérite le coup d’oeil. Si le contenu est assez européocentré, l’auteur n’oublie pas de faire un tour d’horizon, notamment est-asiatique, des cartes et perceptions du monde d’autrefois.
A lire pour tous ceux intéressés un minimum par le sujet.
L'auteur remet en perspective le découpage du monde tel qu'on le connaît.
J'apprécie quand un auteur fait un pas de côté et s'interroge sur ce qui semble être une évidence.
Ici, l'évidence, c'est le découpage du monde en continents. Qu'est-ce qu'un continent ? Qui a inventé ce mot ? Quelle réalité recouvre-t-il ? Quelles évolutions de sens ce mot a-t-il connu ? L'auteur répond à toutes ses questions.
Même si ce documentaire date un peu, il reste d'actualité et permet de ne pas rester figer dans des préjugés.
De plus, le livre est richement illustré et assorti d'annexes très instructives.
La lecture est facile car Christian Grataloup ne jargonne pas.
J'apprécie quand un auteur fait un pas de côté et s'interroge sur ce qui semble être une évidence.
Ici, l'évidence, c'est le découpage du monde en continents. Qu'est-ce qu'un continent ? Qui a inventé ce mot ? Quelle réalité recouvre-t-il ? Quelles évolutions de sens ce mot a-t-il connu ? L'auteur répond à toutes ses questions.
Même si ce documentaire date un peu, il reste d'actualité et permet de ne pas rester figer dans des préjugés.
De plus, le livre est richement illustré et assorti d'annexes très instructives.
La lecture est facile car Christian Grataloup ne jargonne pas.
offert par pap noel 2010
Ce livre est passionnant, il montre que les continents, leurs représentations et découpages ne sont pas que géographiques mais surtout culturels, religieux, géopolitiques, philologiques...
Aussi les illustrations sont magnifiques et ne montrent pas uniquement des représentations européennes même si comme l'auteur le démontre, la représentation du monde est surtout une affaire européenne tant la domination de ce continent sur le reste du monde est importante jusqu'au XXe siècle !
Par contre je pense que ce livre est une tentative de vulgarisation mais qu'il nécessite quand même des connaissances de bases. En effet nombre de personnages historiques, écrivains, explorateurs, scientifiques, penseurs... sont évoqués. Si je connaissais la quasi totalité grâce à mes études, je doute que tout le monde ait les références et le contexte.
Bref, un livre magnifique qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs et a complété mes connaissances sur la cartographie, sujet qui m'intéresse au plus haut point.
Aussi les illustrations sont magnifiques et ne montrent pas uniquement des représentations européennes même si comme l'auteur le démontre, la représentation du monde est surtout une affaire européenne tant la domination de ce continent sur le reste du monde est importante jusqu'au XXe siècle !
Par contre je pense que ce livre est une tentative de vulgarisation mais qu'il nécessite quand même des connaissances de bases. En effet nombre de personnages historiques, écrivains, explorateurs, scientifiques, penseurs... sont évoqués. Si je connaissais la quasi totalité grâce à mes études, je doute que tout le monde ait les références et le contexte.
Bref, un livre magnifique qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs et a complété mes connaissances sur la cartographie, sujet qui m'intéresse au plus haut point.
Très bon livre, qui aborde l'histoire de la cartographie sous un angle original, celui de la définition des continents. Malheureusement C. Grataloup, bien que brillant dans l'analyse, tombe dans ses petits travers habituels, d'associations d'idées en association d'idées, de digression en digression, au final ça part dans tous les sens et on finit par s'y perdre...
Côté iconographie, sans être exceptionnelles l'ouvrage nous offre de belles reproductions de cartes.
Côté iconographie, sans être exceptionnelles l'ouvrage nous offre de belles reproductions de cartes.
Le petit déjeuner tel que nous l’entendons n’a pas toujours existé. Même le mot est récent. La vie moderne fait qu’il n’est plus forcément partagé en famille ne serait-ce qu’à cause de la contrainte du passage successif dans la salle de bain. Les changements dans la cuisson des repas : de la cheminée à la cuisinière et l’apparition des casseroles a aussi joué un rôle.
Les boissons que nous prenons tous, thé, café ou chocolat ont d’abord fait leur apparition sur les tables princières et d’autre privilégiés essentiellement au 18e pour atteindre les ouvriers au cours du 19e.
Le commerce du thé, du cacao et du café nécessitent la création de compagnies orientales et occidentales. La culture du café et du cacao s’est mondialisée, en restant toutefois dans les tropiques si bien que le caféier originaire de l’est de l’Afrique est maintenant surtout cultivé en Amérique du sud et celle du cacao né en Amérique pousse surtout en Afrique. Quant au thé sa culture est restée lié au monde chinois et accessoirement indien. Il a connu deux voies de diffusion, l’une terrestre sous le nom de chaï et maritime sous celui de té, bien qu’il s’écrive avec le même kanji prononcé différemment dans le nord et dans le sud de la Chine.
Ces boissons nécessitent des tasses, elles aussi venues de Chine surtout celles en porcelaine. Et chaque breuvage a eu sa verseuse,théière, cafetière, chocolatière ; et pour le café afin qu’il garde son arôme jusqu’à l’invention de l’emballage sous vide, le moulin à café.
Enfin il fallait du sucre dont le traitement fut mis au point en Inde un millénaire avant notre ère. Les différentes sociétés indienne, iranienne, égyptienne, marocaine qui ont produit du sucre ont toujours fait appel à l’esclavage. Lorsqu’au XIIIe siècle les Européens ont installé des plantations dans des îles méditerranéennes, ils l’ont fait avec des esclaves slaves ou circassiens. D’autres populations utilisaient des noirs.
Plus tard les Anglais inventèrent le coolie trade qui n’avait rien à envier à l’esclavage.
Le petit déjeuner européen s’est en grande partie mondialisé par le “élites” et les villes. Quelques pays comme la Chine résistent.
Une histoire sur un sujet original et passionnant.
Christian Grataloup applique à un thème original, le petit déjeuner, une grille de lecture, la géohistoire. Ce champ d'investigation croise la dimension géographique, ici « le monde dans nos tasses », et un cadre temporel, « trois siècles de petit déjeuner ».
Le premier repas de la journée est un sujet d'études peu abordé. Christian Grataloup en précise l'étymologie. le terme définit l'apparition d'une nouvelle forme de repas au XVIII ème siècle. Si le « déjeûner » implique une rupture du jeûne nocturne (en français, hindi… ) d'autres langues ( allemand…) ont une appellation qui marque le premier repas de la journée.
Mais l'usage a déplacé le mot dans le quotidien. le déjeuner remplace le dîner en milieu de journée, le petit déjeuner s'impose donc au lever.
Au XIXème siècle, le petit déjeuner européen concentre l'espace monde. Il s'affirme autour de trois boissons chaudes issues de cultures tropicales : le thé, le café et le chocolat. Boissons de luxe réservées à la noblesse et à la bourgeoisie aisée au XVIII ème siècle, elles se diffusent, avec la Révolution industrielle, dans les milieux urbains et ouvriers.
Thé, café, chocolat et le sucre s'invitent donc au petit déjeuner européen. Les pays industriels du Nord se fournissent dans le Sud producteur. Les états européens organisent des circuits marchands ; les compagnies des Indes Orientales ( VOC hollandaise, East India Company anglaise…) intensifient l'importation de thé, de café. le commerce transatlantique est moins risqué. Depuis le XVI ème siècle, c'est le domaine du sucre puis ceux du café et du cacao. Les échanges s'intensifient, les colonies s'étendent, la traite des Noirs procure la main d'oeuvre…
Christian Grataloup présente l'évolution de la culture du café, la boisson la plus internationalisée du petit déjeuner. D'origine africaine (Ethiopie), elle est transportée et cultivée en Amérique latine et aux Antilles. Tandis que le cacao, plante américaine, suit le chemin inverse. C'est en Afrique que la culture du cacaoyer s'intensifie. le chocolat associe le cacao (d'origine mexicaine) au sucre (d'origine asiatique). La culture du thé est, elle, multiséculaire, production et consommation restent surtout asiatiques. Quand le thé a la faveur des britanniques, la guerre de l'opium et « l'espionnage « (Robert Fortune) permettent l'extension de la culture aux mains du Royaume Uni.
L'élaboration des boissons matinales demande une préparation complexe, de nombreuses inventions techniques … La tasse, d'origine chinoise, est modifiée pour la consommation de café, de chocolat…. Objet monde, elle est transformée par l'industrie de la porcelaine, l'arrivée des mugs….Les multinationales élaborent des boissons plus faciles d'utilisation (chocolat en poudre, café soluble…). Elles étendent leur marché au monde. Ainsi le " modèle" du petit déjeuner européen est mondial. Les productions tropicales sont au coeur des rapports Nord/ Sud. le « continent breakfast » s'est installé autour du monde, mais des traditions demeurent. L'auteur en voit des changements récents. Ainsi, le brunch associe petit déjeuner et déjeuner. La consommation en circuit court et local rentre en contradiction avec le commerce équitable. le local emprunte un autre chemin que le tiers- mondisme.
Les sujets abordés sont nombreux et montrent une vaste culture. La synthèse est claire , la lecture est aisée. Un ensemble intéressant d'illustrations annotées complète l'ouvrage. Voilà un livre à recommander.
Le premier repas de la journée est un sujet d'études peu abordé. Christian Grataloup en précise l'étymologie. le terme définit l'apparition d'une nouvelle forme de repas au XVIII ème siècle. Si le « déjeûner » implique une rupture du jeûne nocturne (en français, hindi… ) d'autres langues ( allemand…) ont une appellation qui marque le premier repas de la journée.
Mais l'usage a déplacé le mot dans le quotidien. le déjeuner remplace le dîner en milieu de journée, le petit déjeuner s'impose donc au lever.
Au XIXème siècle, le petit déjeuner européen concentre l'espace monde. Il s'affirme autour de trois boissons chaudes issues de cultures tropicales : le thé, le café et le chocolat. Boissons de luxe réservées à la noblesse et à la bourgeoisie aisée au XVIII ème siècle, elles se diffusent, avec la Révolution industrielle, dans les milieux urbains et ouvriers.
Thé, café, chocolat et le sucre s'invitent donc au petit déjeuner européen. Les pays industriels du Nord se fournissent dans le Sud producteur. Les états européens organisent des circuits marchands ; les compagnies des Indes Orientales ( VOC hollandaise, East India Company anglaise…) intensifient l'importation de thé, de café. le commerce transatlantique est moins risqué. Depuis le XVI ème siècle, c'est le domaine du sucre puis ceux du café et du cacao. Les échanges s'intensifient, les colonies s'étendent, la traite des Noirs procure la main d'oeuvre…
Christian Grataloup présente l'évolution de la culture du café, la boisson la plus internationalisée du petit déjeuner. D'origine africaine (Ethiopie), elle est transportée et cultivée en Amérique latine et aux Antilles. Tandis que le cacao, plante américaine, suit le chemin inverse. C'est en Afrique que la culture du cacaoyer s'intensifie. le chocolat associe le cacao (d'origine mexicaine) au sucre (d'origine asiatique). La culture du thé est, elle, multiséculaire, production et consommation restent surtout asiatiques. Quand le thé a la faveur des britanniques, la guerre de l'opium et « l'espionnage « (Robert Fortune) permettent l'extension de la culture aux mains du Royaume Uni.
L'élaboration des boissons matinales demande une préparation complexe, de nombreuses inventions techniques … La tasse, d'origine chinoise, est modifiée pour la consommation de café, de chocolat…. Objet monde, elle est transformée par l'industrie de la porcelaine, l'arrivée des mugs….Les multinationales élaborent des boissons plus faciles d'utilisation (chocolat en poudre, café soluble…). Elles étendent leur marché au monde. Ainsi le " modèle" du petit déjeuner européen est mondial. Les productions tropicales sont au coeur des rapports Nord/ Sud. le « continent breakfast » s'est installé autour du monde, mais des traditions demeurent. L'auteur en voit des changements récents. Ainsi, le brunch associe petit déjeuner et déjeuner. La consommation en circuit court et local rentre en contradiction avec le commerce équitable. le local emprunte un autre chemin que le tiers- mondisme.
Les sujets abordés sont nombreux et montrent une vaste culture. La synthèse est claire , la lecture est aisée. Un ensemble intéressant d'illustrations annotées complète l'ouvrage. Voilà un livre à recommander.
Avec Le Monde dans nos tasses, Christian Grataloup a ainsi écrit un essai historique à la fois accessible et intelligent. Rédigé dans une langue claire, avec un minimum de notes, le livre est accompagné d’indications bibliographiques ramassées et d’un beau cahier d’illustrations.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
"La Géographie- Terre des Hommes", Revue de Géographie découverte à la médiathèque ce week-end, qui m'a attirée par la thématique sur l'histoire du vêtement à travers les âges et les pays.
Une manière très attractive d'aborder la Géographie, à travers un sujet spécifique, à chaque numéro , en abordant l'histoire des mentalités et des peuples. Une vision de la géographie plus attractive et dynamique...
Revue dont la maquette a changé au fil des publications. L'éditeur a opté pour un format plus petit et maniable. Des articles abondamment illustrés en couleurs.
Au sommaire de ce numéro:
-Les vêtements pour désirer le monde, entretien avec Claude Fauque
- Vêtement et mondialisation par Brice Gruet
-Tissus d'écume par Philippe Metzger
- Géopolitique de la mode par Gilles Fumey
- Petite géohistoire des étoffes par Gilles Fumey
-Se vêtir de peaux de bêtes par Jean-Robert Pitte
- Le textile dans la mondialisation malheureuse par Gilles Fumey, etc.
Thématique complétée par une sélection générale de publications récentes en géographie ainsi qu'une chronique plus longue sur "Claude Simon, géographe" (la chronique de Pierre-Yves péchoux.)
******Voir le lien suivant: http://www.socgeo.org/revue-la-geographie-n-1551/
Une manière très attractive d'aborder la Géographie, à travers un sujet spécifique, à chaque numéro , en abordant l'histoire des mentalités et des peuples. Une vision de la géographie plus attractive et dynamique...
Revue dont la maquette a changé au fil des publications. L'éditeur a opté pour un format plus petit et maniable. Des articles abondamment illustrés en couleurs.
Au sommaire de ce numéro:
-Les vêtements pour désirer le monde, entretien avec Claude Fauque
- Vêtement et mondialisation par Brice Gruet
-Tissus d'écume par Philippe Metzger
- Géopolitique de la mode par Gilles Fumey
- Petite géohistoire des étoffes par Gilles Fumey
-Se vêtir de peaux de bêtes par Jean-Robert Pitte
- Le textile dans la mondialisation malheureuse par Gilles Fumey, etc.
Thématique complétée par une sélection générale de publications récentes en géographie ainsi qu'une chronique plus longue sur "Claude Simon, géographe" (la chronique de Pierre-Yves péchoux.)
******Voir le lien suivant: http://www.socgeo.org/revue-la-geographie-n-1551/
Brillante histoire critique des représentations du Monde.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Historiographie
Sauveterre
54 livres
Auteurs proches de Christian Grataloup
Lecteurs de Christian Grataloup (256)Voir plus
Quiz
Voir plus
Petite charade littéraire 2
Mon premier est un aliment apprécié par les Asiatiques
riz
sorgho
mil
5 questions
34 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur34 lecteurs ont répondu