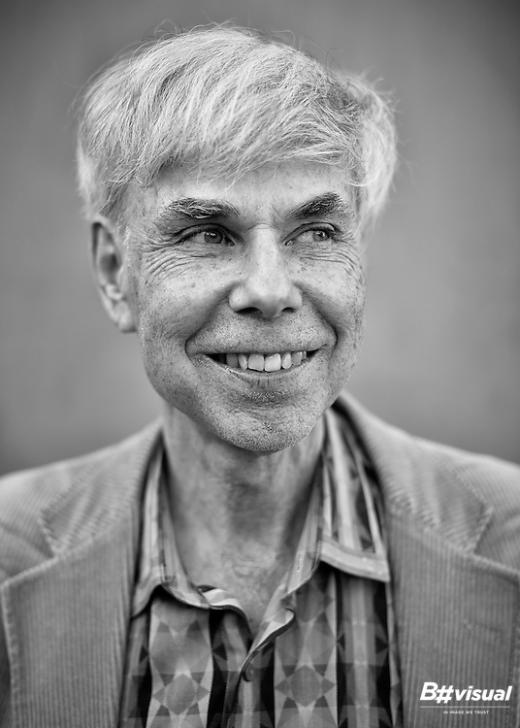Nationalité : États-Unis
Né(e) le : 15/02/1945
Ajouter des informations
Né(e) le : 15/02/1945
Biographie :
Douglas Richard Hofstadter est un universitaire américain. Il est connu surtout pour son ouvrage Gödel, Escher, Bach, les brins d'une guirlande éternelle, publié en 1979, et qui obtint le Prix Pulitzer en 1980. Ce livre, dont le titre est souvent abrégé en « GEB », a incité nombre d'étudiants à se lancer dans une carrière dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
Fils du prix Nobel de physique Robert Hofstadter, il a obtenu son doctorat en physique de l'université de l'Oregon en 1975. Il est actuellement (2005) professeur de sciences cognitives et d'informatique, professeur adjoint d'histoire et de philosophie des sciences, philosophie, littérature comparée et psychologie à l'université d'Indiana à Bloomington, où il dirige le Centre de Recherche sur les Concepts et la Cognition.
Hofstadter est multilingue, ayant passé une année à Genève dans sa jeunesse. Il a vécu en Suède au milieu des années 1960 et comprend le suédois. Il parle italien, anglais, français, allemand et partiellement russe — il a lui-même traduit certaines parties de GEB en russe. Dans son ouvrage Le Ton beau de Marot (écrit en mémoire de feue sa femme Carol), il se décrit comme étant « pi-lingue » (sachant parler 3,14159 langues) et « oligoglot » (parlant peu de langue).
Ses domaines d'intérêts comprennent les sujets relatifs à l'esprit, la créativité, la conscience, l'auto-référence, la traduction et les jeux mathématiques. À l'université de l'Indiana à Bloomington, il a été co-auteur, avec Melanie Mitchell et d'autres, d'un modèle de « perception cognitive de niveau supérieur », Copycat, ainsi que de plusieurs autres modèles cognitifs et de reconnaissance d'analogies.
Hofstadter semble ne pas publier beaucoup dans des périodiques académiques (à l'exception des publications du début de sa carrière de physicien, voir plus bas) ; il préfère en effet la liberté d'expression offerte par de plus grands ouvrages rassemblant ses idées. En conséquence, son influence sur l'informatique est plus subtile et difficile à retracer — ses travaux ont inspiré plusieurs projets de recherches, mais ne sont pas toujours cités et référencés formellement.
Lorsque Martin Gardner cessa d'écrire sa chronique Jeux Mathématiques (Mathematical Games) dans la revue Scientific American, Hoftstadter prit la relève avec une chronique intitulée Thèmes Métamagiques, dont la version anglaise Metamagical Themas est une anagramme de « Mathematical Games
+ Voir plusDouglas Richard Hofstadter est un universitaire américain. Il est connu surtout pour son ouvrage Gödel, Escher, Bach, les brins d'une guirlande éternelle, publié en 1979, et qui obtint le Prix Pulitzer en 1980. Ce livre, dont le titre est souvent abrégé en « GEB », a incité nombre d'étudiants à se lancer dans une carrière dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
Fils du prix Nobel de physique Robert Hofstadter, il a obtenu son doctorat en physique de l'université de l'Oregon en 1975. Il est actuellement (2005) professeur de sciences cognitives et d'informatique, professeur adjoint d'histoire et de philosophie des sciences, philosophie, littérature comparée et psychologie à l'université d'Indiana à Bloomington, où il dirige le Centre de Recherche sur les Concepts et la Cognition.
Hofstadter est multilingue, ayant passé une année à Genève dans sa jeunesse. Il a vécu en Suède au milieu des années 1960 et comprend le suédois. Il parle italien, anglais, français, allemand et partiellement russe — il a lui-même traduit certaines parties de GEB en russe. Dans son ouvrage Le Ton beau de Marot (écrit en mémoire de feue sa femme Carol), il se décrit comme étant « pi-lingue » (sachant parler 3,14159 langues) et « oligoglot » (parlant peu de langue).
Ses domaines d'intérêts comprennent les sujets relatifs à l'esprit, la créativité, la conscience, l'auto-référence, la traduction et les jeux mathématiques. À l'université de l'Indiana à Bloomington, il a été co-auteur, avec Melanie Mitchell et d'autres, d'un modèle de « perception cognitive de niveau supérieur », Copycat, ainsi que de plusieurs autres modèles cognitifs et de reconnaissance d'analogies.
Hofstadter semble ne pas publier beaucoup dans des périodiques académiques (à l'exception des publications du début de sa carrière de physicien, voir plus bas) ; il préfère en effet la liberté d'expression offerte par de plus grands ouvrages rassemblant ses idées. En conséquence, son influence sur l'informatique est plus subtile et difficile à retracer — ses travaux ont inspiré plusieurs projets de recherches, mais ne sont pas toujours cités et référencés formellement.
Lorsque Martin Gardner cessa d'écrire sa chronique Jeux Mathématiques (Mathematical Games) dans la revue Scientific American, Hoftstadter prit la relève avec une chronique intitulée Thèmes Métamagiques, dont la version anglaise Metamagical Themas est une anagramme de « Mathematical Games
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (4)
Voir plusAjouter une vidéo
L'analogie - Science Publique du 5 avril 2013 - Version intégrale .
Extraits de l'émission Science publique du 5 avril 2013 sur France Culture - "L'analogie structure-t-elle notre pensée ", avec Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander pour leur livre "L'analogie, coeur de la pensée" paru= chez Odile Jacob en février 2013 - Production : Michel Alberganti
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
Loi de Hofstadter : « Ça prend toujours plus de temps qu'on croit, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. »
Parfois, il semble que chaque nouvelle étape vers l'intelligence arificielle, plutôt que de produire quelque chose que tout le monde accorde à dénommer l'intelligence réelle, ne fait que révéler ce que l'intelligence réelle n'est pas.
Je me suis rendu compte que Gödel, Escher et Bach n'étaient que des ombres projetées dans différentes directions par une essence centrale. J'ai essayé de reconstruire cet objet central, et c'est ce livre. L'ouvrage exploite donc le concept d'analogie, mais aussi celui de paradoxe (et notamment les paradoxes de Zénon), de récursivité, d'infini, et de système formel. Ainsi, l'une des lectures du livre consiste en une analogie entre les systèmes formels et la manière dont se développe l'Univers (la question étant justement de savoir si l'Univers suit ou non des règles assimilables à celle d'un système formel). L'ouvrage questionne également le problème de la conscience, de la pensée humaine, et étudie la façon dont les particules élémentaires ont pu s'assembler pour former un être capable de s'intuitionner lui-même, mais aussi de s'extraire de la logique des systèmes formels (question qui est notamment étudiée par une comparaison entre l'homme et les machines douées d'intelligence artificielle).
[ Rabats en boucle ]
[…] le ravissement que procurait à l’enfant que j’étais l’acte effronté de refermer une boîte en carton en en glissant l’un sur l’autre les rabats dans un ordre cyclique. C’était toujours avec un frisson de délices que je réussissais ce pliage illicite et flirtais dangereusement avec les joies du paradoxe (cela produit en moi toujours un peu le même effet).
[…] le ravissement que procurait à l’enfant que j’étais l’acte effronté de refermer une boîte en carton en en glissant l’un sur l’autre les rabats dans un ordre cyclique. C’était toujours avec un frisson de délices que je réussissais ce pliage illicite et flirtais dangereusement avec les joies du paradoxe (cela produit en moi toujours un peu le même effet).
Dans les 24 chapitres qui précèdent, j'ai fait de mon mieux pour expliquer ce qu'est un "Je", ce qui signifie, forcément, que j'ai fait également de mon mieux pour expliquer ce qu'est le soi, l'âme, la lumière intérieure, le point de vue à la première personne, l'intériorité, l'intentionnalité et la conscience. Une gageure, certes, mais qui j'espère, ne m'a pas entraîné à trop divaguer. Cela dit, certains lecteurs y verront sans doute une histoire de fou - à dormir debout - par trop invraisemblable. Autant dire immédiatement que je sympathise avec eux, car je reconnais qu'il reste des questions dérangeantes en suspens.
Ce que les dictionnaires ne disent pas sur les concepts :
Pour aborder ce thème, il faut avoir une vision claire de la nature des concepts, dont il est facile – et quasiment inévitable – de sous-estimer la subtilité et la complexité, d'autant plus que cette tendance simplificatrice est renforcée par les dictionnaires, qui prétendent révéler toutes les nuances de sens d'un mot en les divisant en un certain nombre de sous-entrées. Par exemple, le mot « serviette » peut avoir une sous-entrée pour l'article de bain avec lequel on se sèche, une autre pour le morceau de tissu que l'on pose sur ses genoux pour protéger ses vêtements et avec lequel on s'essuie lorsque l'on mange et une autre pour le sac traditionnellement en cuir souple utilisé pour transporter des documents. Le dictionnaire révèle bien trois concepts assez différents abrités par le mot « serviette ». Et puis il s'arrête là, comme si chacun d'eux allait de soi et était indépendant des autres. Fort bien, mais cela signifie-t-il que chacun de ces trois sens est quant à lui, homogène et assez simple, et que les différents sens sont sans rapports les uns avec les autres ? Rien n'est moins vrai, parce que les sens sont souvent liés (c'est particulièrement clair pour la serviette de table et celle de bain) et surtout parce que chaque sens du mot constitue lui-même un gouffre sans fond.
Les dictionnaires donnent l'impression de disséquer les mots jusqu'à leurs atomes, alors qu'ils effleurent tout au plus leur surface.
Pour aborder ce thème, il faut avoir une vision claire de la nature des concepts, dont il est facile – et quasiment inévitable – de sous-estimer la subtilité et la complexité, d'autant plus que cette tendance simplificatrice est renforcée par les dictionnaires, qui prétendent révéler toutes les nuances de sens d'un mot en les divisant en un certain nombre de sous-entrées. Par exemple, le mot « serviette » peut avoir une sous-entrée pour l'article de bain avec lequel on se sèche, une autre pour le morceau de tissu que l'on pose sur ses genoux pour protéger ses vêtements et avec lequel on s'essuie lorsque l'on mange et une autre pour le sac traditionnellement en cuir souple utilisé pour transporter des documents. Le dictionnaire révèle bien trois concepts assez différents abrités par le mot « serviette ». Et puis il s'arrête là, comme si chacun d'eux allait de soi et était indépendant des autres. Fort bien, mais cela signifie-t-il que chacun de ces trois sens est quant à lui, homogène et assez simple, et que les différents sens sont sans rapports les uns avec les autres ? Rien n'est moins vrai, parce que les sens sont souvent liés (c'est particulièrement clair pour la serviette de table et celle de bain) et surtout parce que chaque sens du mot constitue lui-même un gouffre sans fond.
Les dictionnaires donnent l'impression de disséquer les mots jusqu'à leurs atomes, alors qu'ils effleurent tout au plus leur surface.
Raisins verts (début de la série de situations inspirée du renard et des raisins d’Esope)
A. ne veut pas que son fils aille à l’école du quartier et tente de l’inscrire dans une école réputée pour laquelle la sélection est dure. Son fils n’est pas admis. A. dit à qui veut l’entendre qu’il est finalement très content, car cela permettra à son fils de vivre la mixité sociale plutôt que de se retrouver coupé des réalités au milieu de gens arrogants et superficiels.
B., n’ayant pas réussi à acheter des billets d’avion au dernier moment sur Internet, renonce à partir en vacances. Il s’en dit soulagé, car tous les endroits intéressants sont surpeuplés en période de congé ; cela gâche le plaisir d’y aller.
[ la liste proposée est beaucoup plus longue ]
A. ne veut pas que son fils aille à l’école du quartier et tente de l’inscrire dans une école réputée pour laquelle la sélection est dure. Son fils n’est pas admis. A. dit à qui veut l’entendre qu’il est finalement très content, car cela permettra à son fils de vivre la mixité sociale plutôt que de se retrouver coupé des réalités au milieu de gens arrogants et superficiels.
B., n’ayant pas réussi à acheter des billets d’avion au dernier moment sur Internet, renonce à partir en vacances. Il s’en dit soulagé, car tous les endroits intéressants sont surpeuplés en période de congé ; cela gâche le plaisir d’y aller.
[ la liste proposée est beaucoup plus longue ]
Petit complément d'information concernant le ressenti de Douglas Richard Hofstadter sur le petit labyrinthe harmonique de Jean-Sébastien Bach.
"L'incompréhension met le doute en émoi."
Sonia Lahsaini
Un vrai labyrinthe, aucun repère susceptible de constituer une cohérence tout le long de cette substance déroutante, structurée uniquement par d'incessantes remises en questions.
Une matrice musicale discordance, nombre PI déconcertant presque stressant devant l'impossibilité d'en percevoir le sens.
Au risque de se perdre sans fil d'Ariane dans ce dédale mystérieux ne faisant de chaque composant de son ensemble, qu'une série de messages secrets sans aucunes affinités entre eux.
Chaque portion ne s'exprimant que pour elle même sans l'apport d'un acquis précédent, ne faisant de la totalité qu'une sorte de singularité transcendante qu'il suffit d'apprécier telle qu'elle se présente sans espoir de la décrypter.
"L'incompréhension met le doute en émoi."
Sonia Lahsaini
Un vrai labyrinthe, aucun repère susceptible de constituer une cohérence tout le long de cette substance déroutante, structurée uniquement par d'incessantes remises en questions.
Une matrice musicale discordance, nombre PI déconcertant presque stressant devant l'impossibilité d'en percevoir le sens.
Au risque de se perdre sans fil d'Ariane dans ce dédale mystérieux ne faisant de chaque composant de son ensemble, qu'une série de messages secrets sans aucunes affinités entre eux.
Chaque portion ne s'exprimant que pour elle même sans l'apport d'un acquis précédent, ne faisant de la totalité qu'une sorte de singularité transcendante qu'il suffit d'apprécier telle qu'elle se présente sans espoir de la décrypter.
La magnanimité d’Albert Schweitzer
Mon modèle personnel en matière de grandeur d’âme est le théologien, musicien, médecin, écrivain et humaniste Albert Schweitzer, né en 1875 dans le petit village de Kaysersberg en Alsace (qui faisait alors partie de l’Allemagne, bien que mon encyclopédie française préférée Le Petit Robert, parue exactement un siècle plus tard, en fasse un Français !), lequel doit sa célébrité mondiale à l’hôpital qu’il fonda en 1913 à Lambaréné en Afrique équatoriale française (dans le territoire du Gabon), où il exerça cinquante ans.
Schweitzer s’identifiait déjà aux autres à un très jeune âge, éprouvait pour eux de la pitié et de la compassion en voulant partager leurs souffrances. D’où lui venait cette généreuse empathie ? Qui peut le dire ? Toujours est-il qu’à six ans, à son tout premier jour d’école, Albert avait remarqué que ses parents l’avaient paré de vêtements plus recherchés que ceux de ses camarades, ce qui l’avait grandement perturbé. Dès lors, il exigea d’être habillé comme ses camarades d’école moins fortunés.
Un extrait du livre autobiographique de Schweitzer, Aus meiner Kindheit und Jugendzeit dépeint sur le vif la compassion qui imprégnait sa vie :
Aussi loin que je me souvienne, j’ai souffert de toutes les misères que je voyais autour de moi. Je n’ai jamais vraiment connu la simple joie de vivre juvénile et je crois que c’est le cas de bien des enfants, même s’ils donnent extérieurement une apparence de bonheur et d’insouciance.
La souffrance et la détresse que de pauvres animaux devaient endurer me tourmentaient particulièrement. Le spectacle d’un vieux cheval qui boitait tiré par un homme pendant qu’un autre lui donnait des coups de bâton sur le chemin de l’abattoir de Colmar m’a hanté pendant des semaines. Même avant d’aller à l’école, je n’arrivais pas à comprendre pourquoi, lors de la prière du soir, je n’étais censé prier que pour le sort des êtres humains. C’est ainsi que je prononçais secrètement les paroles d’une prière de mon cru : « Cher bon Dieu, protégez et bénissez tout ce qui respire, protégez-les du mal et laissez-les dormir doucement ».
La compassion de Schweitzer pour les animaux ne se limitait pas aux mammifères mais descendait tout le spectre animal jusqu’aux créatures inférieures comme les vers et les fourmis. (Je dis « descendait » et « inférieures » non pas pour indiquer un dédain quelconque, mais pour suggérer que Schweitzer, comme pratiquement tous les êtres humains, devait se figurer un « cône de conscience », vaguement semblable à « mon cône » personnel de la page 26. Une hiérarchie mentale de ce type peut tout aussi bien susciter un sentiment d’intérêt et de responsabilité qu’un regard dédaigneux.) Il fit un jour remarquer à un garçon de dix ans qui s’apprêtait à marcher sur une fourmi, « C’est ma fourmi à moi. Tu risques de lui casser les pattes ». Il avait l’habitude de ramasser le ver qu’il apercevait au milieu de la rue ou l’insecte qui se débattait dans une mare pour le déposer dans un champ ou sur une plante afin de lui donner une chance de survie. Comme il l’expliquait avec une certaine amertume : « À chaque fois que je vais au secours d’un insecte en détresse, je le fais pour expier un tant soit peu les crimes de l’humanité à l’encontre des animaux ».
Comme chacun sait, le principe directeur simple et néanmoins profond de Schweitzer était ce qu’il appelait « la vénération de la vie ». À l’occasion de son prix Nobel de la Paix en 1953, Schweitzer déclara dans son allocution :
L’esprit n’est pas mort, il vit dans la solitude. (…) Il est convaincu que la compassion, dans laquelle l’éthique prend sa racine, ne gagne sa véritable étendue et profondeur que si elle ne se limite pas aux hommes, mais s’étend à tous les êtres vivants.
L’anecdote qui suit, également extraite de Aus meiner Kindheit und Jugendzeit, est particulièrement révélatrice. C’était le printemps, à l’approche de Pâques. Le petit Albert, de sept ou huit ans, avait été invité par un camarade – presque littéralement un compagnon d’armes ! – à s’aventurer à la chasse aux oiseaux à l’aide de lance-pierres qu’ils venaient tous deux de confectionner. Des décennies plus tard, en revenant rétrospectivement sur ce tournant décisif de son existence, Schweitzer raconte :
C’était une invite exécrable, mais je n’ai pas osé refuser de peur qu’il ne se moque de moi. Nous nous sommes vite retrouvés près d’un arbre dénudé dont les branches étaient recouvertes d’oiseaux chantant gaiement au lever du jour, sans la moindre peur de nous. Mon compagnon, accroupi à la manière d’un Indien à l’affût, plaça un caillou dans la poche de cuir du lance-pierres et l’étira fortement. Obéissant au coup d’œil impérieux qu’il me lança, je fis de même, en luttant contre les violents sursauts de ma conscience tout en me jurant fermement de tirer en même temps que lui.
Au même instant, les cloches de l’église se mirent à sonner en se mêlant au chant des oiseaux au soleil. C’étaient le carillon matinal qui précédait d’une demi-heure la volée principale. Mais, pour moi, c’était une voix qui venait du Paradis. J’ai jeté mon lance-pierres de façon à effaroucher les oiseaux pour qu’ils se réfugient hors de portée du lance-pierres de mon copain, et me suis enfui à la maison.
Depuis, à chaque fois que les cloches de la semaine sainte se font entendre parmi les arbres encore dénudés du printemps, je me souviens avec gratitude du commandement qu’elles firent résonner dans mon cœur : « Tu ne tueras point ». À partir de ce jour, je me suis juré de me libérer de la peur des autres personnes. À chaque fois que mes convictions intimes étaient en jeu, je donnais moins de poids aux opinions de l’entourage. Et je faisais de mon mieux pour surmonter la crainte des moqueries de mes pairs.
Nous avons ici le conflit classique entre la pression des pairs et ses propres voix intérieures, ou selon l’expression habituelle (et celle de Schweitzer) sa propre conscience. Dans ce cas, heureusement, la conscience fut visiblement la gagnante. Ce qui entraîna une résolution pour la vie.
Mon modèle personnel en matière de grandeur d’âme est le théologien, musicien, médecin, écrivain et humaniste Albert Schweitzer, né en 1875 dans le petit village de Kaysersberg en Alsace (qui faisait alors partie de l’Allemagne, bien que mon encyclopédie française préférée Le Petit Robert, parue exactement un siècle plus tard, en fasse un Français !), lequel doit sa célébrité mondiale à l’hôpital qu’il fonda en 1913 à Lambaréné en Afrique équatoriale française (dans le territoire du Gabon), où il exerça cinquante ans.
Schweitzer s’identifiait déjà aux autres à un très jeune âge, éprouvait pour eux de la pitié et de la compassion en voulant partager leurs souffrances. D’où lui venait cette généreuse empathie ? Qui peut le dire ? Toujours est-il qu’à six ans, à son tout premier jour d’école, Albert avait remarqué que ses parents l’avaient paré de vêtements plus recherchés que ceux de ses camarades, ce qui l’avait grandement perturbé. Dès lors, il exigea d’être habillé comme ses camarades d’école moins fortunés.
Un extrait du livre autobiographique de Schweitzer, Aus meiner Kindheit und Jugendzeit dépeint sur le vif la compassion qui imprégnait sa vie :
Aussi loin que je me souvienne, j’ai souffert de toutes les misères que je voyais autour de moi. Je n’ai jamais vraiment connu la simple joie de vivre juvénile et je crois que c’est le cas de bien des enfants, même s’ils donnent extérieurement une apparence de bonheur et d’insouciance.
La souffrance et la détresse que de pauvres animaux devaient endurer me tourmentaient particulièrement. Le spectacle d’un vieux cheval qui boitait tiré par un homme pendant qu’un autre lui donnait des coups de bâton sur le chemin de l’abattoir de Colmar m’a hanté pendant des semaines. Même avant d’aller à l’école, je n’arrivais pas à comprendre pourquoi, lors de la prière du soir, je n’étais censé prier que pour le sort des êtres humains. C’est ainsi que je prononçais secrètement les paroles d’une prière de mon cru : « Cher bon Dieu, protégez et bénissez tout ce qui respire, protégez-les du mal et laissez-les dormir doucement ».
La compassion de Schweitzer pour les animaux ne se limitait pas aux mammifères mais descendait tout le spectre animal jusqu’aux créatures inférieures comme les vers et les fourmis. (Je dis « descendait » et « inférieures » non pas pour indiquer un dédain quelconque, mais pour suggérer que Schweitzer, comme pratiquement tous les êtres humains, devait se figurer un « cône de conscience », vaguement semblable à « mon cône » personnel de la page 26. Une hiérarchie mentale de ce type peut tout aussi bien susciter un sentiment d’intérêt et de responsabilité qu’un regard dédaigneux.) Il fit un jour remarquer à un garçon de dix ans qui s’apprêtait à marcher sur une fourmi, « C’est ma fourmi à moi. Tu risques de lui casser les pattes ». Il avait l’habitude de ramasser le ver qu’il apercevait au milieu de la rue ou l’insecte qui se débattait dans une mare pour le déposer dans un champ ou sur une plante afin de lui donner une chance de survie. Comme il l’expliquait avec une certaine amertume : « À chaque fois que je vais au secours d’un insecte en détresse, je le fais pour expier un tant soit peu les crimes de l’humanité à l’encontre des animaux ».
Comme chacun sait, le principe directeur simple et néanmoins profond de Schweitzer était ce qu’il appelait « la vénération de la vie ». À l’occasion de son prix Nobel de la Paix en 1953, Schweitzer déclara dans son allocution :
L’esprit n’est pas mort, il vit dans la solitude. (…) Il est convaincu que la compassion, dans laquelle l’éthique prend sa racine, ne gagne sa véritable étendue et profondeur que si elle ne se limite pas aux hommes, mais s’étend à tous les êtres vivants.
L’anecdote qui suit, également extraite de Aus meiner Kindheit und Jugendzeit, est particulièrement révélatrice. C’était le printemps, à l’approche de Pâques. Le petit Albert, de sept ou huit ans, avait été invité par un camarade – presque littéralement un compagnon d’armes ! – à s’aventurer à la chasse aux oiseaux à l’aide de lance-pierres qu’ils venaient tous deux de confectionner. Des décennies plus tard, en revenant rétrospectivement sur ce tournant décisif de son existence, Schweitzer raconte :
C’était une invite exécrable, mais je n’ai pas osé refuser de peur qu’il ne se moque de moi. Nous nous sommes vite retrouvés près d’un arbre dénudé dont les branches étaient recouvertes d’oiseaux chantant gaiement au lever du jour, sans la moindre peur de nous. Mon compagnon, accroupi à la manière d’un Indien à l’affût, plaça un caillou dans la poche de cuir du lance-pierres et l’étira fortement. Obéissant au coup d’œil impérieux qu’il me lança, je fis de même, en luttant contre les violents sursauts de ma conscience tout en me jurant fermement de tirer en même temps que lui.
Au même instant, les cloches de l’église se mirent à sonner en se mêlant au chant des oiseaux au soleil. C’étaient le carillon matinal qui précédait d’une demi-heure la volée principale. Mais, pour moi, c’était une voix qui venait du Paradis. J’ai jeté mon lance-pierres de façon à effaroucher les oiseaux pour qu’ils se réfugient hors de portée du lance-pierres de mon copain, et me suis enfui à la maison.
Depuis, à chaque fois que les cloches de la semaine sainte se font entendre parmi les arbres encore dénudés du printemps, je me souviens avec gratitude du commandement qu’elles firent résonner dans mon cœur : « Tu ne tueras point ». À partir de ce jour, je me suis juré de me libérer de la peur des autres personnes. À chaque fois que mes convictions intimes étaient en jeu, je donnais moins de poids aux opinions de l’entourage. Et je faisais de mon mieux pour surmonter la crainte des moqueries de mes pairs.
Nous avons ici le conflit classique entre la pression des pairs et ses propres voix intérieures, ou selon l’expression habituelle (et celle de Schweitzer) sa propre conscience. Dans ce cas, heureusement, la conscience fut visiblement la gagnante. Ce qui entraîna une résolution pour la vie.
De l’abîme à la cime - La magnanimité
Qu’en est-il de l’extrémité supérieure du spectre ? Cela ne vous étonnera guère si j’y range des individus dont le comportement est à l’exact opposé de celui des psychopathes dangereux. Il s’agit de personnages bienveillants tels que Mohandas Gandhi, Eleanor Roosevelt, Raoul Wallenberg, Jean Moulin, Mère Teresa, Martin Luther King et César Chávez – des individus extraordinaires dont la profonde empathie pour ceux qui souffrent les conduit à consacrer l’essentiel de leur existence à aider les autres, et cela par des méthodes non violentes. Je dirais de telles personnes qu’elles sont plus conscientes que les adultes normaux, c’est-à-dire qu’elles ont des âmes plus grandes.
Bien que je m’attarde rarement sur l’étymologie des mots, j’ai pris plaisir à faire remarquer, en préparant une conférence sur ce sujet il y a quelques années, que le mot « magnanimité », que nous considérons comme un synonyme de « générosité », signifiait en latin « avoir une grande âme » (animus, l’âme). Il m’a beaucoup plu de considérer ce mot familier sous la lumière de ce rayon X. (Puis, à mon étonnement, j’ai découvert en préparant l’index dément de ce livre, que « Mahatma » – le titre de respect que l’on donne habituellement à Gandhi – signifie également « grande âme » en sanskrit.) Une autre étymologie émouvante est celle de « compassion », venant des racines latines signifiant « souffrir avec ». Ces messages secrets parcourant les millénaires m’ont incité à pousser plus loin mon investigation.
Qu’en est-il de l’extrémité supérieure du spectre ? Cela ne vous étonnera guère si j’y range des individus dont le comportement est à l’exact opposé de celui des psychopathes dangereux. Il s’agit de personnages bienveillants tels que Mohandas Gandhi, Eleanor Roosevelt, Raoul Wallenberg, Jean Moulin, Mère Teresa, Martin Luther King et César Chávez – des individus extraordinaires dont la profonde empathie pour ceux qui souffrent les conduit à consacrer l’essentiel de leur existence à aider les autres, et cela par des méthodes non violentes. Je dirais de telles personnes qu’elles sont plus conscientes que les adultes normaux, c’est-à-dire qu’elles ont des âmes plus grandes.
Bien que je m’attarde rarement sur l’étymologie des mots, j’ai pris plaisir à faire remarquer, en préparant une conférence sur ce sujet il y a quelques années, que le mot « magnanimité », que nous considérons comme un synonyme de « générosité », signifiait en latin « avoir une grande âme » (animus, l’âme). Il m’a beaucoup plu de considérer ce mot familier sous la lumière de ce rayon X. (Puis, à mon étonnement, j’ai découvert en préparant l’index dément de ce livre, que « Mahatma » – le titre de respect que l’on donne habituellement à Gandhi – signifie également « grande âme » en sanskrit.) Une autre étymologie émouvante est celle de « compassion », venant des racines latines signifiant « souffrir avec ». Ces messages secrets parcourant les millénaires m’ont incité à pousser plus loin mon investigation.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Auteurs proches de Douglas Hofstadter
Quiz
Voir plus
.Le Passeur .
Pourquoi le livre ce nomme t-il "Le Passeur" ?
Car un homme fait passer les moment dur de la vie
Car c'est le nom du train qui transporte les migrants
C'est le nom de la personne qui transmet les souvenirs
on ne le sait pas
7 questions
101 lecteurs ont répondu
Thème : Le Passeur de
Lois LowryCréer un quiz sur cet auteur101 lecteurs ont répondu