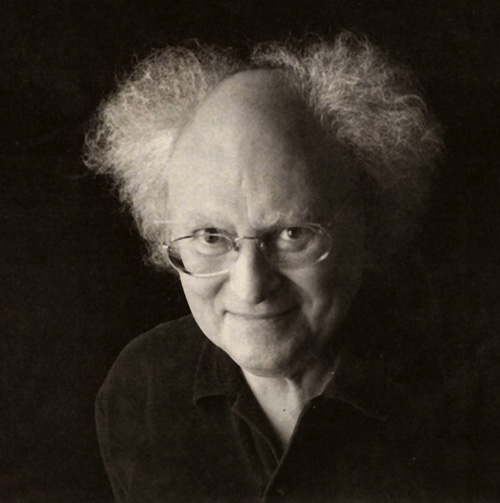Citations de Henri Meschonnic (153)
une ligne
c’est seulement une
phrase qui s’arrête puis une autre
la vie rime
avec la vie
nous sommes tous des rimes vivantes
qui cherchent
à finir leur phrase
il n’y a pas
de fin pour
dire
peut-être sans le savoir
nous ne sommes que les syllabes
de mots que nous commençons
mais nul n’a la phrase entière
le sens c’est seulement des bouts
de sens que nous sommes ce qui
manque
pour faire la phrase c’est chez
l’autre l’autre l’autre
c’est seulement une
phrase qui s’arrête puis une autre
la vie rime
avec la vie
nous sommes tous des rimes vivantes
qui cherchent
à finir leur phrase
il n’y a pas
de fin pour
dire
peut-être sans le savoir
nous ne sommes que les syllabes
de mots que nous commençons
mais nul n’a la phrase entière
le sens c’est seulement des bouts
de sens que nous sommes ce qui
manque
pour faire la phrase c’est chez
l’autre l’autre l’autre
13/
Le rythme du sens
Le sens du langage poétique s'est corporalisé. Explicitement déjà les tr
avaux de Jousse ** avaient fondé le sens sur le corps. Spire avait lié le rythme
au sens — « Pas de sens, pas de rythme, donc pas de poésie *" » — et le sens
à la « danse laryngo-buccale » **. Mais il restreignait le corps à la psychop
hysiologie, le rythme à l'émotion, la structure du vers à la réalisation indi
viduelle. La phonétique expérimentale, sans la phonologie, sans la psychan
alyse, sans une théorie d'ensemble du langage, bloquaient le vers et la poésie
à une conception ornementale, descriptive, émotionnaliste, liant le plaisir à
l'embellissement.
La tentative la plus récente qui lie le rythme, le sens et le corps est celle de J. Kristeva45. Le problème qui se pose ici est celui de la médiation
des « bases pulsionnelles de la phonation », de Fónagy, pour intégrer la
psychanalyse à une théorie du langage poétique. Cette médiation est ruineuse.
Elle révèle un des clivages épistémologiques les plus marquants de notre
moment culturel, entre la tension vers la grammaire universelle (la sémiotique étant le nouveau nom du signifié transcendantal) et le signifiant substantialisé coupé de la dénotation, où s'opèrent les permutations d'une kabbale
et qui est devenu le lieu d'une sous-rationalité compensatoire. Voilà pourquoi
ce besoin de Fónagy. La même tension se trouvait au xvnf siècle, entre le
côté de Leibniz et celui de Court de Gébelin. Ainsi les problèmes d'une
poétique du vers, par la conceptualisation du rythme qu'ils supposent, mettent
en jeu les tensions fondamentales du savoir moderne.
Il y a donc une nécessité de méthode à analyser ce dernier rapport entre
mètre, rythme et sens, avant de rassembler des éléments pour une théorie du
rythme dans la poésie française.
Pour les < grammairiens », le mètre réalise la langue. Dans la tradition
« formaliste », le poème est un conflit avec le mètre et la langue. J. Kristeva
se situe dans cette tradition. Mais elle scinde le mètre et la langue, — la
< contrainte grammaticale » mise du côté de Г « ego cartésien » (livre cité,
p. 215), la contrainte métrique posée comme « antérieure et postérieure à la
grammaire», et < utilisant des articulations sémiotiques pré-langagières »
(ibid., p. 215), c'est-à-dire les bases pulsionnelles de la phonation qui sont
données comme des « contraintes rythmiques » (p. 213). Contrainte métrique,
contrainte rythmique sont prises l'une pour l'autre. Le mètre et le rythme
sont confondus. Confusion qui apparaît encore dans la proposition : < On
peut concevoir maintenant le rythme non seulement comme une métrique
classique de versification, mais comme une propriété immanente au fonctio
nnement du langage » (p. 215). Confondus aussi le subliminal et l'inconscient,
en mettant les « schémas métriques » sur le même plan préconscient que le
« système de la langue » (p. 217), et sur le même plan que les allitérations
et les anagrammes de Saussure. Loin d'être préconscient, le niveau métrique
(césures, enjambements, etc.) est conscient, connu, reconnu. S'il peut devenir
sous-jacent comme tout le culturel qui nous imbibe (la venue du décasyllabe
racontée par Valéry pour Le cimetière marin), c'est à un niveau spécifique
de l'idéologie. N'étant pas sur le même plan que le syllabisme, les t ressources
musicales de la langue nationale » (p. 211) ne s'y opposent pas. Ce cadre
ne les a jamais empêchées de travailler. L'opposition du vers classique
au vers libre n'est pas de « contraintes prosodiques artificielles » (p. 217)
à une pratique plus naturelle. Il me semble qu'elle manifeste un nouveau
rapport, entre l'individu et la collectivité, et par là une crise de la société
et une crise de l'individu.
Le rythme «mis au < géno-texte », au « plus profond » (on ne peut
pas vérifier s'il est la с condition de la syntaxe ») est restreint au rythme
des timbres, appelé « rythme sémiotique ». L'élément accentuel duratif est
entièrement omis. La procédure est typiquement sémiotique, en ce qu'elle
fait la pétition de principe déjà reconnue, de confondre le sémantique et le émiotique dans le sémiotique seul, d'où la distinction ensuite est impossible.
On pourrait poser, au contraire, les problèmes du rythme et du mètre comme
une contradiction entre le sémantique et le sémiotique. La restriction au seul
rythme des timbres a pour but de privilégier l'inconscient. L'inconscient
ignorerait-il les répétitions accentuelles ? La connotation, coupée de la dénot
ation, devient une « dérive », une écoute flottante para-psychanalytique,
« musicalisant » le sens (p. 238). La référence à l'inconscient tient dans le
couple déplacement-condensation, opérant exclusivement à l'intérieur dés
« bases pulsionnelles de la phonation ». Sans revenir sur l'importance de
l'enjeu, joué mais manqué par Fónagy, on peut faire plusieurs remarques : sur
le lien établi entre le rythme allitératif qui с branche le sujet sur le procès
pulsionnel inconscient » (p. 212) et l'écriture automatique4* ;sur l'opposition à
la с langue nationale en tant que message communicatif » 4T — Joyce tran
sformé en modèle fait oublier la relation qu'on a avec sa langue, pour un
plurilinguisme qui transcende les langues ** ; il s'ensuit une politisation directe,
mécaniste, volontaire, du travail poétique sur les signifiants : Г « abandon
de la métrique » est relié au capitalisme (p. 218). La psychanalyse invoquée
est entraînée dans une rationalité mythique du langage comme onomatopée
(p. 222). Une postulation d'un polymorphisme sémantique est contredite par
la traduction en fait monosémique de l'expressivité 4>. Aux procédés analysés
déjà chez Grammont et Fónagy, s'ajoute une pratique du calembour métalinguistique lacanien. La spéculante de ce discours pseudo-scientifique lui
réserve une faible valeur de connaissance : il joue le rôle d'un fantasme M.
Le plan psychanalytique de la structure du vers et du langage poétique
est pourtant primordial. Il ne saurait être méconnu par quelques erreurs de
méthode, ou par une confusion avec une métaphysique du langage qui le
fausse. On remarque, une fois sorti de l'expressivité, que l'insistance mise
sur le vocalisme, le syllabisme ou le numérisme caractérise certaines tendances
métriques désémantisantes, — la « formElisation » de Lusson et Roubaud.
Alors que l'insistance sur le consonantisme mène à des analyses orientées vers
la théorie du sujet, une corporalisation du sens. La répétition est constitutive du moi, liant le plaisir au rythme. Alors le langage poétique n'est pas un
surplus au langage81.
L'unité de la poésie est le poème. Le vers n'en est qu'une sous-unité.
Une théorie du rythme dans le langage poétique doit contenir les éléments
linguistiques, psychanalytiques, culturels de l'écriture et de la lecture M. On se
propose, le lieu manquant ici, d'en développer ailleurs la logique et la
technique.
Le rythme du sens
Le sens du langage poétique s'est corporalisé. Explicitement déjà les tr
avaux de Jousse ** avaient fondé le sens sur le corps. Spire avait lié le rythme
au sens — « Pas de sens, pas de rythme, donc pas de poésie *" » — et le sens
à la « danse laryngo-buccale » **. Mais il restreignait le corps à la psychop
hysiologie, le rythme à l'émotion, la structure du vers à la réalisation indi
viduelle. La phonétique expérimentale, sans la phonologie, sans la psychan
alyse, sans une théorie d'ensemble du langage, bloquaient le vers et la poésie
à une conception ornementale, descriptive, émotionnaliste, liant le plaisir à
l'embellissement.
La tentative la plus récente qui lie le rythme, le sens et le corps est celle de J. Kristeva45. Le problème qui se pose ici est celui de la médiation
des « bases pulsionnelles de la phonation », de Fónagy, pour intégrer la
psychanalyse à une théorie du langage poétique. Cette médiation est ruineuse.
Elle révèle un des clivages épistémologiques les plus marquants de notre
moment culturel, entre la tension vers la grammaire universelle (la sémiotique étant le nouveau nom du signifié transcendantal) et le signifiant substantialisé coupé de la dénotation, où s'opèrent les permutations d'une kabbale
et qui est devenu le lieu d'une sous-rationalité compensatoire. Voilà pourquoi
ce besoin de Fónagy. La même tension se trouvait au xvnf siècle, entre le
côté de Leibniz et celui de Court de Gébelin. Ainsi les problèmes d'une
poétique du vers, par la conceptualisation du rythme qu'ils supposent, mettent
en jeu les tensions fondamentales du savoir moderne.
Il y a donc une nécessité de méthode à analyser ce dernier rapport entre
mètre, rythme et sens, avant de rassembler des éléments pour une théorie du
rythme dans la poésie française.
Pour les < grammairiens », le mètre réalise la langue. Dans la tradition
« formaliste », le poème est un conflit avec le mètre et la langue. J. Kristeva
se situe dans cette tradition. Mais elle scinde le mètre et la langue, — la
< contrainte grammaticale » mise du côté de Г « ego cartésien » (livre cité,
p. 215), la contrainte métrique posée comme « antérieure et postérieure à la
grammaire», et < utilisant des articulations sémiotiques pré-langagières »
(ibid., p. 215), c'est-à-dire les bases pulsionnelles de la phonation qui sont
données comme des « contraintes rythmiques » (p. 213). Contrainte métrique,
contrainte rythmique sont prises l'une pour l'autre. Le mètre et le rythme
sont confondus. Confusion qui apparaît encore dans la proposition : < On
peut concevoir maintenant le rythme non seulement comme une métrique
classique de versification, mais comme une propriété immanente au fonctio
nnement du langage » (p. 215). Confondus aussi le subliminal et l'inconscient,
en mettant les « schémas métriques » sur le même plan préconscient que le
« système de la langue » (p. 217), et sur le même plan que les allitérations
et les anagrammes de Saussure. Loin d'être préconscient, le niveau métrique
(césures, enjambements, etc.) est conscient, connu, reconnu. S'il peut devenir
sous-jacent comme tout le culturel qui nous imbibe (la venue du décasyllabe
racontée par Valéry pour Le cimetière marin), c'est à un niveau spécifique
de l'idéologie. N'étant pas sur le même plan que le syllabisme, les t ressources
musicales de la langue nationale » (p. 211) ne s'y opposent pas. Ce cadre
ne les a jamais empêchées de travailler. L'opposition du vers classique
au vers libre n'est pas de « contraintes prosodiques artificielles » (p. 217)
à une pratique plus naturelle. Il me semble qu'elle manifeste un nouveau
rapport, entre l'individu et la collectivité, et par là une crise de la société
et une crise de l'individu.
Le rythme «mis au < géno-texte », au « plus profond » (on ne peut
pas vérifier s'il est la с condition de la syntaxe ») est restreint au rythme
des timbres, appelé « rythme sémiotique ». L'élément accentuel duratif est
entièrement omis. La procédure est typiquement sémiotique, en ce qu'elle
fait la pétition de principe déjà reconnue, de confondre le sémantique et le émiotique dans le sémiotique seul, d'où la distinction ensuite est impossible.
On pourrait poser, au contraire, les problèmes du rythme et du mètre comme
une contradiction entre le sémantique et le sémiotique. La restriction au seul
rythme des timbres a pour but de privilégier l'inconscient. L'inconscient
ignorerait-il les répétitions accentuelles ? La connotation, coupée de la dénot
ation, devient une « dérive », une écoute flottante para-psychanalytique,
« musicalisant » le sens (p. 238). La référence à l'inconscient tient dans le
couple déplacement-condensation, opérant exclusivement à l'intérieur dés
« bases pulsionnelles de la phonation ». Sans revenir sur l'importance de
l'enjeu, joué mais manqué par Fónagy, on peut faire plusieurs remarques : sur
le lien établi entre le rythme allitératif qui с branche le sujet sur le procès
pulsionnel inconscient » (p. 212) et l'écriture automatique4* ;sur l'opposition à
la с langue nationale en tant que message communicatif » 4T — Joyce tran
sformé en modèle fait oublier la relation qu'on a avec sa langue, pour un
plurilinguisme qui transcende les langues ** ; il s'ensuit une politisation directe,
mécaniste, volontaire, du travail poétique sur les signifiants : Г « abandon
de la métrique » est relié au capitalisme (p. 218). La psychanalyse invoquée
est entraînée dans une rationalité mythique du langage comme onomatopée
(p. 222). Une postulation d'un polymorphisme sémantique est contredite par
la traduction en fait monosémique de l'expressivité 4>. Aux procédés analysés
déjà chez Grammont et Fónagy, s'ajoute une pratique du calembour métalinguistique lacanien. La spéculante de ce discours pseudo-scientifique lui
réserve une faible valeur de connaissance : il joue le rôle d'un fantasme M.
Le plan psychanalytique de la structure du vers et du langage poétique
est pourtant primordial. Il ne saurait être méconnu par quelques erreurs de
méthode, ou par une confusion avec une métaphysique du langage qui le
fausse. On remarque, une fois sorti de l'expressivité, que l'insistance mise
sur le vocalisme, le syllabisme ou le numérisme caractérise certaines tendances
métriques désémantisantes, — la « formElisation » de Lusson et Roubaud.
Alors que l'insistance sur le consonantisme mène à des analyses orientées vers
la théorie du sujet, une corporalisation du sens. La répétition est constitutive du moi, liant le plaisir au rythme. Alors le langage poétique n'est pas un
surplus au langage81.
L'unité de la poésie est le poème. Le vers n'en est qu'une sous-unité.
Une théorie du rythme dans le langage poétique doit contenir les éléments
linguistiques, psychanalytiques, culturels de l'écriture et de la lecture M. On se
propose, le lieu manquant ici, d'en développer ailleurs la logique et la
technique.
12/
L'excès de sens
La prosodie a été compensatoire de la métrique : en se chargeant de
sens. Une représentation encore moderne de la poésie semble lui faire jouer
dans notre culture un rôle d'anti-arbitraire du signe. Ce lien avec la langue,
qu'une métrique aussi postule, devient une procédure de denudation de la
nature du langage et de son origine. Et le langage étant lui-même déjà,
naturellement, cette transparence obscurcie aux choses, la poésie consisterait
à la retrouver. Il y a eu les « crédulités » paragrammatiques (Change 6, p. 89).
On découvre mieux aujourd'hui l'associationnisme de cette crédulité. Il importe
pour la poésie de défaire le fonctionnement de cette illusion, qui semble sans
cesse renaissante (on essayera plus loin de comprendre pourquoi) chez certains
théoriciens du langage poétique saisis par une hypertrophie du sens.
Comme le mètre l'était de la langue, la prosodie serait une imitation.
Mais une imitation des sensations et des sentiments. Pour éviter de tirer des
vers la signification, des sons, Grammont la tire de leur с nature » (Le vers
français, p. 203). Mais cette nature est à la fois le plan phonétique, articulatoire et les termes qui le désignent, qui sont métaphorisés puis réifiés :
réfèrent irréel créé par le métalangage. Voyelles « aiguës э : c'est « l'impres
sion de l'acuité » (ibid., p. 236), douleur, joie, etc., с d'où une méchanceté
que nous pouvons qualifier d'aiguë » (p. 247)... Une mimétique généralisée
semble surdéterminer les mots de sorte que le métalangage aussi, secondai
rement, mime le langage du texte : indice même de la preuve. La rationalité
qui manoeuvre ici (sa causalité mécaniste et magique) est une métaphysique
de l'origine onomatopéique du langage. L'expressivité est une subjectivité
pré-scientifique déguisé en positivisme. Epistémologiquement, elle est contem
poraine du xviiť siècle.
Elle a pris récemment une apparence à la psychanalyse, et renouvelé ses
termes linguistiques, chez Fónagy. La procédure reste celle de Grammont.
Le problème n'est pas ici celui de sa valeur scientifique, mais du fait socio
logique de la crédibilité qu'il suscite. Avec la vieille « magie du verbe »
où le « son » est à la fois séparé du sens et redondance du sens, cette
psychologisation des localisations articulatoires se donne pour évidence. Elle
se fonde sur une métaphysique régressive du signe qui l'aliène à lui-même en
19
le définissant comme absence de la chose : < Les signes linguistiques ne sont
perçus en tant que signes que par référence à d'autres objets. Ce qui revient
à dire que le signe ne peut fonctionner, ne peut exister, en tant que signe,
que s'il n'a pas d'existence propre38. » Le signe présenté comme négatif
de la chose, détermine la poésie comme tournée contre le langage, vers
les choses : leur imitation. Avec une réduction de la langue aux mots, qui
ne sont conçus comme mots que s'ils sont seuls. Sa psychologie est une
psychologie du comportement : « la poésie fait naître un sourire de satisfac
tion sur nos lèvres » (ibid., p. 110). L'essentiel est que la psychanalyse visée
est manquée. Car « dégager l'arrière-plan inconscient de l'acte phonatoire » 3T,
Г « investissement oral » (ouvrage cité, p. 106) des gestes de la bouche peut
sembler en effet la seule compréhension et rationalité nouvelle de l'expres
sivité des phonèmes. Mais ce travail qui commence en psychanalyse, avec les
travaux de Fr. Dolto M, n'a ici ni la technicité suffisante en psychanalyse ni
la rigueur linguistique qui doivent mutuellement se sous-tendre. On retrouve
le métaphorique déjà connu : « La tendresse se reflète dans une plus grande
fréquence des consonnes L, M M. » (Elle aime.) Et par rapport à des notions
vagues et subjectives (l'agressivité), à un manque de prudence méthodolog
ique *°, — la précaution théorique finale («il n'y a pas de correspondance
simple et exclusive entre une pulsion et un son donné » 41) ne fonctionne plus
que comme une dénégation.
L'excès de sens
La prosodie a été compensatoire de la métrique : en se chargeant de
sens. Une représentation encore moderne de la poésie semble lui faire jouer
dans notre culture un rôle d'anti-arbitraire du signe. Ce lien avec la langue,
qu'une métrique aussi postule, devient une procédure de denudation de la
nature du langage et de son origine. Et le langage étant lui-même déjà,
naturellement, cette transparence obscurcie aux choses, la poésie consisterait
à la retrouver. Il y a eu les « crédulités » paragrammatiques (Change 6, p. 89).
On découvre mieux aujourd'hui l'associationnisme de cette crédulité. Il importe
pour la poésie de défaire le fonctionnement de cette illusion, qui semble sans
cesse renaissante (on essayera plus loin de comprendre pourquoi) chez certains
théoriciens du langage poétique saisis par une hypertrophie du sens.
Comme le mètre l'était de la langue, la prosodie serait une imitation.
Mais une imitation des sensations et des sentiments. Pour éviter de tirer des
vers la signification, des sons, Grammont la tire de leur с nature » (Le vers
français, p. 203). Mais cette nature est à la fois le plan phonétique, articulatoire et les termes qui le désignent, qui sont métaphorisés puis réifiés :
réfèrent irréel créé par le métalangage. Voyelles « aiguës э : c'est « l'impres
sion de l'acuité » (ibid., p. 236), douleur, joie, etc., с d'où une méchanceté
que nous pouvons qualifier d'aiguë » (p. 247)... Une mimétique généralisée
semble surdéterminer les mots de sorte que le métalangage aussi, secondai
rement, mime le langage du texte : indice même de la preuve. La rationalité
qui manoeuvre ici (sa causalité mécaniste et magique) est une métaphysique
de l'origine onomatopéique du langage. L'expressivité est une subjectivité
pré-scientifique déguisé en positivisme. Epistémologiquement, elle est contem
poraine du xviiť siècle.
Elle a pris récemment une apparence à la psychanalyse, et renouvelé ses
termes linguistiques, chez Fónagy. La procédure reste celle de Grammont.
Le problème n'est pas ici celui de sa valeur scientifique, mais du fait socio
logique de la crédibilité qu'il suscite. Avec la vieille « magie du verbe »
où le « son » est à la fois séparé du sens et redondance du sens, cette
psychologisation des localisations articulatoires se donne pour évidence. Elle
se fonde sur une métaphysique régressive du signe qui l'aliène à lui-même en
19
le définissant comme absence de la chose : < Les signes linguistiques ne sont
perçus en tant que signes que par référence à d'autres objets. Ce qui revient
à dire que le signe ne peut fonctionner, ne peut exister, en tant que signe,
que s'il n'a pas d'existence propre38. » Le signe présenté comme négatif
de la chose, détermine la poésie comme tournée contre le langage, vers
les choses : leur imitation. Avec une réduction de la langue aux mots, qui
ne sont conçus comme mots que s'ils sont seuls. Sa psychologie est une
psychologie du comportement : « la poésie fait naître un sourire de satisfac
tion sur nos lèvres » (ibid., p. 110). L'essentiel est que la psychanalyse visée
est manquée. Car « dégager l'arrière-plan inconscient de l'acte phonatoire » 3T,
Г « investissement oral » (ouvrage cité, p. 106) des gestes de la bouche peut
sembler en effet la seule compréhension et rationalité nouvelle de l'expres
sivité des phonèmes. Mais ce travail qui commence en psychanalyse, avec les
travaux de Fr. Dolto M, n'a ici ni la technicité suffisante en psychanalyse ni
la rigueur linguistique qui doivent mutuellement se sous-tendre. On retrouve
le métaphorique déjà connu : « La tendresse se reflète dans une plus grande
fréquence des consonnes L, M M. » (Elle aime.) Et par rapport à des notions
vagues et subjectives (l'agressivité), à un manque de prudence méthodolog
ique *°, — la précaution théorique finale («il n'y a pas de correspondance
simple et exclusive entre une pulsion et un son donné » 41) ne fonctionne plus
que comme une dénégation.
11/
La métrique à la recherche du sens
Musicale par son origine, cherchant une rythmicité pure, la métrique ne
peut pas se débarrasser de la signification dans le langage, comme la peinture,
de la figurativité. Asémantique et traditionnelle, la métrique refuse le nouveau
parce que le nouveau est du sens. La seule sémantique que Grammont pouvait
admettre était celle de l'expression, le rythme « considéré comme moyen
d'expression » : mécanisme circulaire, paraphrastique — le rythme sémpnrl'édition de 1967 du Vers français, et de 1965 pour le Petit traité. Mais еЦ|а/ sont
inscrites dans le dialogue des notes avec le texte (note de 1922, p. 202 « un ''livre qui
était d'actualité il y a vingt ans, quand celui-ci a été fait »). A sa date, Le ч-ers français
est déjà rétrograde : il a le culte de Hugo pour sa virtuosité (p. 51, 6\, 69); déprécie
violemment Г « école décadente » (p. 39, 168, 200, 460) ; méconnut tout ce qui est
antérieur au XVIP s... Il est normatif et subjectif, distribue les bl&mes (p. 358), et les
approbations (p. 180).
35. « ... comme au temps de Fortunat » (Le vers français au XX* s., p. 310).
tisé par imitation du sens, d'où sort la notion même de son « expression ».
Dès Coleridge pourtant apparaît l'idée de l'interaction entre la forme métrique
et le sens. Le mètre n'existe pas plus hors des poèmes qu'aucune structure
abstraite. L'interprétation du mètre vient du sens du vers, de même que
l'interprétation du < son » vient du sens du mot. Finalement, la fonction du
mètre serait qu'il с symbolise la poésie э (ibid., p. 221) — ce qui le renvoie
à une fonction culturelle qui peut, variablement, être de médiation ou de
substitution, une icône d'après Peirce mais non un signe. La métrique tend
alors à s'intégrer dans une sémiotique. Le structuralisme de Jakobson avait
tendu à la dissoudre dans les concepts de la poétique en général, dans les
parallélismes. A travers tout son apport, ses études de poèmes, Jakobson a,
semble-t-il, privilégié une syntagmatique du langage poétique. Il ne pouvait
pas construire une paradigmatique du langage versifié, sans sujet et sans
histoire.
La métrique à la recherche du sens
Musicale par son origine, cherchant une rythmicité pure, la métrique ne
peut pas se débarrasser de la signification dans le langage, comme la peinture,
de la figurativité. Asémantique et traditionnelle, la métrique refuse le nouveau
parce que le nouveau est du sens. La seule sémantique que Grammont pouvait
admettre était celle de l'expression, le rythme « considéré comme moyen
d'expression » : mécanisme circulaire, paraphrastique — le rythme sémpnrl'édition de 1967 du Vers français, et de 1965 pour le Petit traité. Mais еЦ|а/ sont
inscrites dans le dialogue des notes avec le texte (note de 1922, p. 202 « un ''livre qui
était d'actualité il y a vingt ans, quand celui-ci a été fait »). A sa date, Le ч-ers français
est déjà rétrograde : il a le culte de Hugo pour sa virtuosité (p. 51, 6\, 69); déprécie
violemment Г « école décadente » (p. 39, 168, 200, 460) ; méconnut tout ce qui est
antérieur au XVIP s... Il est normatif et subjectif, distribue les bl&mes (p. 358), et les
approbations (p. 180).
35. « ... comme au temps de Fortunat » (Le vers français au XX* s., p. 310).
tisé par imitation du sens, d'où sort la notion même de son « expression ».
Dès Coleridge pourtant apparaît l'idée de l'interaction entre la forme métrique
et le sens. Le mètre n'existe pas plus hors des poèmes qu'aucune structure
abstraite. L'interprétation du mètre vient du sens du vers, de même que
l'interprétation du < son » vient du sens du mot. Finalement, la fonction du
mètre serait qu'il с symbolise la poésie э (ibid., p. 221) — ce qui le renvoie
à une fonction culturelle qui peut, variablement, être de médiation ou de
substitution, une icône d'après Peirce mais non un signe. La métrique tend
alors à s'intégrer dans une sémiotique. Le structuralisme de Jakobson avait
tendu à la dissoudre dans les concepts de la poétique en général, dans les
parallélismes. A travers tout son apport, ses études de poèmes, Jakobson a,
semble-t-il, privilégié une syntagmatique du langage poétique. Il ne pouvait
pas construire une paradigmatique du langage versifié, sans sujet et sans
histoire.
10/
La poésie moderne est l'échec de la métrique
Le métricien n'admet le changement qu'à l'intérieur de son système.
Il est de ceux qui ont le plus de mal à reconnaître la poésie moderne. On
semble plaisamment regretter la mort de l'alexandrin, juste au moment où il
atteignait la perfection. Mais on soutient qu'il « reste le véritable vers fran
çais » (Grammont, Petit traité..., p. 147), sans démêler les problèmes du
XIXe siècle de ceux du xx* siècle. C'est l'académisme. Rien n'a changé. Malgré
une с évolution normale,», et l'idée d'un с avenir de notre vers » (Le vers
français, p. 461), la nouveauté n'a produit « rien qui doive subsister ». Il
ès^ vrai que cela date de 1904, mais n'a jamais été corrigé. Cette dénégation
et \rp refus plongent dans un maurassisme qui condamnait chez Grammont,
en £$08, les tentatives « faites en général *par des étrangers ou de mauvais
plaisant» » (Petit traité, p. 146) *\ On reconnaît les qualificatifs qui tou33. Voir R. Tissot, Peinture et sculpture aux Etats-Unis, A. Colin. Voir art. de
J. Pierre, « L'hypeY?îuritanisme », La quinzaine littéraire. № 183, 15 mars 1974.
34. Le vers français est de 1904, le Petit traité de 1908. Ces dates n'apparaissent
plus dans les rééditions actuelles, elles sont remplacées par un copyright de 193? dans
chèrent Apollinaire. La fixation qui sacralise la langue caractérise un inves
tissement dans la langue-mère qui est exemplaire là où il y a langue sacrée
(l'arabe, l'hébreu). Guiraud remarque en effet que la structure métrique
« n'a, quoi qu'on en dise, pratiquement pas changé depuis les origines »
(livre cité, p. 64). Parce qu'elle est liée à la langue (ibid., p. 110). Etrange
raison. Car les changements phonologiques, morphologiques, syntaxiques de
la langue ont été considérables. Le passage à une prosodie proche de celle
du langage véhiculaire, sinon à celle-là même (non systématiquement, chez
Tardieu, Queneau) réduit le principe syllabique. On ne sait plus ce qu'il faut
compter, exactement. Ainsi s'accroîtrait le caractère accentuel du langage
versifié, avec modification de la notion d'intervalle entre les accents. Mais
un tel passage ne peut être que culturel autant que linguistique. Rapprochant le
langage versifié de renonciation, il le pose comme rapport entre le culturel
et l'individuel, et ses problèmes passent, de la métrique à laquelle ils échappent,
à une théorie globale du poétique. C'est pourquoi les métriciens sont dérout
és85.
D'un côté, ceux qui comptent les syllabes ou la place de la césure ;
de l'autre, ceux qui parlent de vision du monde. Leur opposition me semble
celle du prévisible à l'imprévisible. La métrique se voudrait science de la
prédicabilité du vers, elle ne peut que postuler sa continuité. Quant à ceux
qui privilégient la rupture et la différence — à une certaine limite, on a
là deux mythologies. Le rythme compris comme rupture a été confondu avec
l'émotion. La notion de rythme semble plus vulnérable que celle de mètre,
parce qu'elle est plus liée au sémantique qu'au sémiotique, à renonciation
qu'à la langue. Le vers, devenant par l'abandon des règles canoniques et le
passage à des constantes variables, une variable de variables, impose une
sémantisation de son étude. La théorie du langage poétique apparaît d'autant
plus scindée entre ceux qui renforcent l'opposition de la théorie à la pratique
et ceux qui la réduisent. Ceux qui renforcent cette opposition rendent imposs
ible son enseignement, ce dont ensuite ils s'étonnent, car ils ont creusé
l'incommunicabilité entre dedans et dehors, poème et lecteur, excluant ce
dernier.
La poésie moderne est l'échec de la métrique
Le métricien n'admet le changement qu'à l'intérieur de son système.
Il est de ceux qui ont le plus de mal à reconnaître la poésie moderne. On
semble plaisamment regretter la mort de l'alexandrin, juste au moment où il
atteignait la perfection. Mais on soutient qu'il « reste le véritable vers fran
çais » (Grammont, Petit traité..., p. 147), sans démêler les problèmes du
XIXe siècle de ceux du xx* siècle. C'est l'académisme. Rien n'a changé. Malgré
une с évolution normale,», et l'idée d'un с avenir de notre vers » (Le vers
français, p. 461), la nouveauté n'a produit « rien qui doive subsister ». Il
ès^ vrai que cela date de 1904, mais n'a jamais été corrigé. Cette dénégation
et \rp refus plongent dans un maurassisme qui condamnait chez Grammont,
en £$08, les tentatives « faites en général *par des étrangers ou de mauvais
plaisant» » (Petit traité, p. 146) *\ On reconnaît les qualificatifs qui tou33. Voir R. Tissot, Peinture et sculpture aux Etats-Unis, A. Colin. Voir art. de
J. Pierre, « L'hypeY?îuritanisme », La quinzaine littéraire. № 183, 15 mars 1974.
34. Le vers français est de 1904, le Petit traité de 1908. Ces dates n'apparaissent
plus dans les rééditions actuelles, elles sont remplacées par un copyright de 193? dans
chèrent Apollinaire. La fixation qui sacralise la langue caractérise un inves
tissement dans la langue-mère qui est exemplaire là où il y a langue sacrée
(l'arabe, l'hébreu). Guiraud remarque en effet que la structure métrique
« n'a, quoi qu'on en dise, pratiquement pas changé depuis les origines »
(livre cité, p. 64). Parce qu'elle est liée à la langue (ibid., p. 110). Etrange
raison. Car les changements phonologiques, morphologiques, syntaxiques de
la langue ont été considérables. Le passage à une prosodie proche de celle
du langage véhiculaire, sinon à celle-là même (non systématiquement, chez
Tardieu, Queneau) réduit le principe syllabique. On ne sait plus ce qu'il faut
compter, exactement. Ainsi s'accroîtrait le caractère accentuel du langage
versifié, avec modification de la notion d'intervalle entre les accents. Mais
un tel passage ne peut être que culturel autant que linguistique. Rapprochant le
langage versifié de renonciation, il le pose comme rapport entre le culturel
et l'individuel, et ses problèmes passent, de la métrique à laquelle ils échappent,
à une théorie globale du poétique. C'est pourquoi les métriciens sont dérout
és85.
D'un côté, ceux qui comptent les syllabes ou la place de la césure ;
de l'autre, ceux qui parlent de vision du monde. Leur opposition me semble
celle du prévisible à l'imprévisible. La métrique se voudrait science de la
prédicabilité du vers, elle ne peut que postuler sa continuité. Quant à ceux
qui privilégient la rupture et la différence — à une certaine limite, on a
là deux mythologies. Le rythme compris comme rupture a été confondu avec
l'émotion. La notion de rythme semble plus vulnérable que celle de mètre,
parce qu'elle est plus liée au sémantique qu'au sémiotique, à renonciation
qu'à la langue. Le vers, devenant par l'abandon des règles canoniques et le
passage à des constantes variables, une variable de variables, impose une
sémantisation de son étude. La théorie du langage poétique apparaît d'autant
plus scindée entre ceux qui renforcent l'opposition de la théorie à la pratique
et ceux qui la réduisent. Ceux qui renforcent cette opposition rendent imposs
ible son enseignement, ce dont ensuite ils s'étonnent, car ils ont creusé
l'incommunicabilité entre dedans et dehors, poème et lecteur, excluant ce
dernier.
9/
La combinatoire et la métrique generative
Cette universalité passe aujourd'hui par deux procédures, celle de la
combinatoire, celle de la métrique generative. On les analyse successive
ment, en essayant de découvrir leur rapport entre théorie et empirisme. A
travers leur rapport au vers, leur rapport au sens. On les a rapprochées, parce
qu'elles sont épistémologiquement parentes.
L'analyse mathématique du vers a commencé avec Le symbolisme, du
poète André Belyj (Moscou, 1910). Son objectivité s'arrêtait aux tableaux,
mais une tradition russe en est sortie, de TomacHevski à Kolmogorov {Mathé
matiques et poésie, Moscou, 1962). L'analyse statistique du nombre et de la
position des accents par vers et par poème, ou des effets allitératifs par
rapport à la fréquence des phonèmes dans une langue, sont des études de
constantes, de la redondance d'un système par rapport à un autre. Ainsi la
strophe est définie par Jiří Levy un « système de systèmes » **. A travers
14. Jiří Levy, « Die Théorie des Verses — ihre mathematischen Aspekte », dans
11
l'apport de la théorie de l'information se dégage une difficulté. La notion
de redondance contient ici une pétition de principe. Car on constate une
différence entre un texte et un contenu équivalent dans un « texte en prose
d'égale longueur > u. Or un tel texte ne peut pas exister, par la spécificité
même de la communication dans le langage poétique qu'il s'agit de définir.
Le présupposé théorique dissocie le contenu et la contrainte formelle. Cette
dernière est considérée comme un surplus.
Traiter les formes comme des nombres, c'est en éliminer le sens, ce que
fait explicitement l'Oulipo, « structurEliste » — : « les aspects sémantiques
n'étaient pas abordés, la signification étant abandonnée au bon plaisir de
chaque auteur et restant extérieure à toute préoccupation de structure » w.
L'insistance sur les contraintes, procédés, structures ; le volontarisme : « II n'y
a de littérature que volontaire », dit Queneau (p. 32) ; la confusion par là
entre dire et faire, nostalgie d'une performativité généralisée, jouent un
assez grand rôle dans l'expérimentation pour elle-même, pour être ici le
patron d'un rapport entre théorie et pratique. L'aléatoire est remplacé par
la combinatoire. Le paradoxe de la combinatoire est qu'elle élimine le risque.
C'est une sécurisation par la forme. Le reste : « Romantisme tout ça, psychol
ogie, bricolage » (p. 155). Tout en remettant à sa place, celle d'un travail
des formes, l'écriture « comme jeu » (p. 79).
On situe mieux, par ce rappel du rôle de l'Oulipo, la définition с non
psychologisante du rythme » 1T que donne P. Lusson : « Le rythme est la
combinatoire séquentielle hiérarchisée d'événements considérés sous le seul
aspect du même et du différent » (ibid., p. 33). C'est pour constituer une
théorie universelle. La volonté théorique, l'allure mathématique, couvrent
pourtant une confusion caractéristique de la combinatoire, entre sémantique
et psychologie, rejetant l'une pour l'autre, et l'adoption non critique d'une
théorie de base 18, parce qu'elle favorise la combinatoire. Il s'ensuit un certain
vague 19, et derrière le théorique un nouvel empirisme.
Jacques Roubaud est celui qui a le plus développé les opérations de la
combinatoire. L'importance de sa recherche pour la connaissance de la poésie,
et pour l'analyse de cette connaissance, justifie les questions qu'on peut lui
poser. Le travail vise à décrire et formaliser des systèmes fermés, par exemple
« une ' grammaire ' des formules de rimes, donnant des règles de ' cons
truction '... » 20, — décrire des « groupements combinatoires complexes, ind
épendamment de toute autre indication (prosodie, esthétique, etc.) »
La combinatoire et la métrique generative
Cette universalité passe aujourd'hui par deux procédures, celle de la
combinatoire, celle de la métrique generative. On les analyse successive
ment, en essayant de découvrir leur rapport entre théorie et empirisme. A
travers leur rapport au vers, leur rapport au sens. On les a rapprochées, parce
qu'elles sont épistémologiquement parentes.
L'analyse mathématique du vers a commencé avec Le symbolisme, du
poète André Belyj (Moscou, 1910). Son objectivité s'arrêtait aux tableaux,
mais une tradition russe en est sortie, de TomacHevski à Kolmogorov {Mathé
matiques et poésie, Moscou, 1962). L'analyse statistique du nombre et de la
position des accents par vers et par poème, ou des effets allitératifs par
rapport à la fréquence des phonèmes dans une langue, sont des études de
constantes, de la redondance d'un système par rapport à un autre. Ainsi la
strophe est définie par Jiří Levy un « système de systèmes » **. A travers
14. Jiří Levy, « Die Théorie des Verses — ihre mathematischen Aspekte », dans
11
l'apport de la théorie de l'information se dégage une difficulté. La notion
de redondance contient ici une pétition de principe. Car on constate une
différence entre un texte et un contenu équivalent dans un « texte en prose
d'égale longueur > u. Or un tel texte ne peut pas exister, par la spécificité
même de la communication dans le langage poétique qu'il s'agit de définir.
Le présupposé théorique dissocie le contenu et la contrainte formelle. Cette
dernière est considérée comme un surplus.
Traiter les formes comme des nombres, c'est en éliminer le sens, ce que
fait explicitement l'Oulipo, « structurEliste » — : « les aspects sémantiques
n'étaient pas abordés, la signification étant abandonnée au bon plaisir de
chaque auteur et restant extérieure à toute préoccupation de structure » w.
L'insistance sur les contraintes, procédés, structures ; le volontarisme : « II n'y
a de littérature que volontaire », dit Queneau (p. 32) ; la confusion par là
entre dire et faire, nostalgie d'une performativité généralisée, jouent un
assez grand rôle dans l'expérimentation pour elle-même, pour être ici le
patron d'un rapport entre théorie et pratique. L'aléatoire est remplacé par
la combinatoire. Le paradoxe de la combinatoire est qu'elle élimine le risque.
C'est une sécurisation par la forme. Le reste : « Romantisme tout ça, psychol
ogie, bricolage » (p. 155). Tout en remettant à sa place, celle d'un travail
des formes, l'écriture « comme jeu » (p. 79).
On situe mieux, par ce rappel du rôle de l'Oulipo, la définition с non
psychologisante du rythme » 1T que donne P. Lusson : « Le rythme est la
combinatoire séquentielle hiérarchisée d'événements considérés sous le seul
aspect du même et du différent » (ibid., p. 33). C'est pour constituer une
théorie universelle. La volonté théorique, l'allure mathématique, couvrent
pourtant une confusion caractéristique de la combinatoire, entre sémantique
et psychologie, rejetant l'une pour l'autre, et l'adoption non critique d'une
théorie de base 18, parce qu'elle favorise la combinatoire. Il s'ensuit un certain
vague 19, et derrière le théorique un nouvel empirisme.
Jacques Roubaud est celui qui a le plus développé les opérations de la
combinatoire. L'importance de sa recherche pour la connaissance de la poésie,
et pour l'analyse de cette connaissance, justifie les questions qu'on peut lui
poser. Le travail vise à décrire et formaliser des systèmes fermés, par exemple
« une ' grammaire ' des formules de rimes, donnant des règles de ' cons
truction '... » 20, — décrire des « groupements combinatoires complexes, ind
épendamment de toute autre indication (prosodie, esthétique, etc.) »
8/
La métrique n'a pas le sens
Le métricien vise au rythme pur. Cette pureté définit les opérations
où rythme et mètre s'échangent. L'accent mis sur la métrique rie peut que
désémantiser, car le mètre n'a pas de sens. La métrique est tournée vers une
étude des formes qui a pris des aspects historiques ou comparatistes. A la
recherche d'universaux spécifiques, elle devient nécessairement une méthodol
ogie de sa propre formalisation. Ainsi elle a pu se consacrer à opposer le
rythme iambique au rythme trochaïque ".
Un paradoxe de la métrique, pure opération de classement (il faut placer
à part les études sur l'origine des mètres), est qu'elle prépare le structuralisme
en étudiant les « modificateurs structuraux du vers » (Yanacrouse, qui est
l'initiale ; la clausule, qui est la finale ; la césure, pause obligatoire, — pour
8. Zirmunskij, Introduction to Metrics, éd. Mouton, 1966 (Ге éd. 1925), p. 71.
9. Principles of Literary Criticism, Londres, Routledge, 1963 (lre éd. 1924), p. 134.
10. The Founding of English Metre, Londres, Rôutledge, 1961, p. 9.
11. « Le rythme est un phénomène ' organique ' et ne peut être pleinement apprécié
que par une approche phénoménologique au poème » avec une note renvoyant explicit
ement à Heidegger. B. Hrushovski, « On Free Rhythms in Modem Poetry », dans Style in
Language, éd. by Th. A. Sebeok, M.I.T., 1968 (1" éd. 1960), p. 180.
12. Je renvoie à l'article « Maurice Blanchot ou l'écriture hors langage », Cahiers du
Chemin, n° 20, Gallimard, janvier 1974.
13. Temps fort initial : rythme-ou-mètre trochaïque, supposez l'omission d'une anacrouse, vous rétablissez un rythme iambique ; la réciproque est toujours vraie. Jeu sans
fin. Le mètre change selon le postulat.
10
mots Žírmunskij), et unités — métriques. c'est-à-dire la Elle position établit des donc mots, que les cette rapports position entre est limites un fait de
sémantique. La métrique n'a pas cessé, mais contre elle-même, de contribuer à
l'étude de la structuration spécifique du sens qui a lieu dans le langage versifié.
Il est vrai que la confusion entre les unités métriques (pieds — poly
syllabiques) et les unités linguistiques (mots, syntagmes avec leurs limites),
qui culmine dans l'usage fréquent en français du mot pied pour dire syllabe,
a plaqué sur les problèmes du vers français une pseudo-codification, où un
réfèrent irréel est le reflet d'une terminologie : les « iambes » et les « ana
pestes » du français — compensation peut-être à la croyance du xix* siècle
que le français n'a pas de rythme. Le français, n'étant pas une langue à
accent de mot, mais à accent de groupe, п'д pas de code métrique comme
l'anglais, l'allemand, le russe. Pas de pentamètre iambique. Ses accents sont
donc doubles : métriques (pour la sixième et douzième syllabes de l'alexandrin
classique, par exemple), rythmiques pour les autres, — rythmiques signifiant
ici linguistiques et non codifiés, ce qui les a longtemps rendus invisibles d'un
point de vue uniquement métrique. En même temps, la carence des études
métriques en France ne peut pas ne pas paraître liée au caractère linguistique
du rythme en français. La tradition a plutôt étudié ici les places de la césure,
ou l'enjambement, et surtout une typologie des rimes, liée à l'histoire même
de la poésie. Aux périodes de saturation des structures phoniques (Grands
rhétoriqueurs, Symbolisme) ont correspondu des développements de la tax
inomie prosodique (O. Brik, J. Romains-G. Chennevière).
Les questions que pose la métrique définissent un objet abstrait. Cette
abstraction a permis de distinguer la structure du vers de sa réalisation pho
nique individuelle, avec laquelle elle est confondue dans l'école acoustique
(Lote, Spire, la phonostylistique). Désocialisé (la diction est historique et
culturelle ; ses rapports avec la structure du vers, avec le formulaire, ne sont
que fragmentairement construits et connus), désémantisé, ce rapport entre
objet et méthode est lui-même un fait culturel qui a son historicité variable.
Mais la métrique se veut universelle.
La métrique n'a pas le sens
Le métricien vise au rythme pur. Cette pureté définit les opérations
où rythme et mètre s'échangent. L'accent mis sur la métrique rie peut que
désémantiser, car le mètre n'a pas de sens. La métrique est tournée vers une
étude des formes qui a pris des aspects historiques ou comparatistes. A la
recherche d'universaux spécifiques, elle devient nécessairement une méthodol
ogie de sa propre formalisation. Ainsi elle a pu se consacrer à opposer le
rythme iambique au rythme trochaïque ".
Un paradoxe de la métrique, pure opération de classement (il faut placer
à part les études sur l'origine des mètres), est qu'elle prépare le structuralisme
en étudiant les « modificateurs structuraux du vers » (Yanacrouse, qui est
l'initiale ; la clausule, qui est la finale ; la césure, pause obligatoire, — pour
8. Zirmunskij, Introduction to Metrics, éd. Mouton, 1966 (Ге éd. 1925), p. 71.
9. Principles of Literary Criticism, Londres, Routledge, 1963 (lre éd. 1924), p. 134.
10. The Founding of English Metre, Londres, Rôutledge, 1961, p. 9.
11. « Le rythme est un phénomène ' organique ' et ne peut être pleinement apprécié
que par une approche phénoménologique au poème » avec une note renvoyant explicit
ement à Heidegger. B. Hrushovski, « On Free Rhythms in Modem Poetry », dans Style in
Language, éd. by Th. A. Sebeok, M.I.T., 1968 (1" éd. 1960), p. 180.
12. Je renvoie à l'article « Maurice Blanchot ou l'écriture hors langage », Cahiers du
Chemin, n° 20, Gallimard, janvier 1974.
13. Temps fort initial : rythme-ou-mètre trochaïque, supposez l'omission d'une anacrouse, vous rétablissez un rythme iambique ; la réciproque est toujours vraie. Jeu sans
fin. Le mètre change selon le postulat.
10
mots Žírmunskij), et unités — métriques. c'est-à-dire la Elle position établit des donc mots, que les cette rapports position entre est limites un fait de
sémantique. La métrique n'a pas cessé, mais contre elle-même, de contribuer à
l'étude de la structuration spécifique du sens qui a lieu dans le langage versifié.
Il est vrai que la confusion entre les unités métriques (pieds — poly
syllabiques) et les unités linguistiques (mots, syntagmes avec leurs limites),
qui culmine dans l'usage fréquent en français du mot pied pour dire syllabe,
a plaqué sur les problèmes du vers français une pseudo-codification, où un
réfèrent irréel est le reflet d'une terminologie : les « iambes » et les « ana
pestes » du français — compensation peut-être à la croyance du xix* siècle
que le français n'a pas de rythme. Le français, n'étant pas une langue à
accent de mot, mais à accent de groupe, п'д pas de code métrique comme
l'anglais, l'allemand, le russe. Pas de pentamètre iambique. Ses accents sont
donc doubles : métriques (pour la sixième et douzième syllabes de l'alexandrin
classique, par exemple), rythmiques pour les autres, — rythmiques signifiant
ici linguistiques et non codifiés, ce qui les a longtemps rendus invisibles d'un
point de vue uniquement métrique. En même temps, la carence des études
métriques en France ne peut pas ne pas paraître liée au caractère linguistique
du rythme en français. La tradition a plutôt étudié ici les places de la césure,
ou l'enjambement, et surtout une typologie des rimes, liée à l'histoire même
de la poésie. Aux périodes de saturation des structures phoniques (Grands
rhétoriqueurs, Symbolisme) ont correspondu des développements de la tax
inomie prosodique (O. Brik, J. Romains-G. Chennevière).
Les questions que pose la métrique définissent un objet abstrait. Cette
abstraction a permis de distinguer la structure du vers de sa réalisation pho
nique individuelle, avec laquelle elle est confondue dans l'école acoustique
(Lote, Spire, la phonostylistique). Désocialisé (la diction est historique et
culturelle ; ses rapports avec la structure du vers, avec le formulaire, ne sont
que fragmentairement construits et connus), désémantisé, ce rapport entre
objet et méthode est lui-même un fait culturel qui a son historicité variable.
Mais la métrique se veut universelle.
7/
Le rythme et le mètre
La confusion entre le rythme et le mètre est la conséquence de cette
dépendance philosophique non analysée, qui piège les définitions dans une
circularité sans issue. Cette circularité tient dans la notion de régularité
appliquée au rythme. Le Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973) donne
à l'article Rythme : « On appelle rythme le retour régulier, dans la chaîne
parlée, d'impressions auditives analogues créées par divers éléments proso
diques. Dans l'alexandrin classique français, le rythme est créé (1) par la rime,
c'est-à-dire par la présence d'une douzième syllabe identique dans deux ou
plusieurs vers, accompagnée d'une retombée de la voix, et (2) par la césure,
c'est-à-dire la montée de la voix sur la sixième syllabe. » Cette définition du
rythme est la définition même du mètre (il n'y a pas d'article mètre), sans
parler de sa non-pertinence pour décrire l'alexandrin. Le Dictionnaire ency
clopédique des sciences du langage (Ducrot-Todorov, au Seuil, 1972), à l'ar
ticle Versification, prend ses distances par rapport à une définition qui ferait
du mètre une « succession parfaitement régulière des syllabes accentuées et
non accentuées », alors que le rythme serait la « réalisation de ce scheme
dans la langue > (p. 242) parce que cette répétition régulière « n'arrive
jamais » et que le problème demande donc un « degré d'abstraction » supér
ieur, que proposent Halle et Keyser (théorie qu'on analysera plus loin). Mais
6. Essai sur le rythme, Gallimard, 1952 (5* éd. ; lre, 1938).
7. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, p. 334.
rien ne remplace ce qu'on dénonce. On se trouve donc devant un vide définitionnel.
Une catégorisation logique fait du mètre chez Aristote une espèce du
genre rythme : « car il est évident que les mètres ne sont que des parties
des rythmes — та yá.p [летра 8ti (xópta twv fbu6[x&v есттц «pavepóv » (Poé
tique 1448 b). Mais cette évidence est inverse apparemment, pour ceux
qui font du rythme une actualisation du mètre. Pour Žirmunskij, « sans
mètre il n'y a pas de rythme » 8. On discerne ainsi deux courants opposés.
I. A. Richards est aristotélicien : le mètre est pour lui une « forme spécia
lisée du rythme » 9. Ce débat n'est pas formel, ou historique. Il met en jeu
le sens du message poétique tout entier. Il implique une théorie de la signi
fication. En termes aristotéliciens, J. Thompson 10 voit dans le mètre une
imitation « des éléments de base de notre langue et de leur ordre ». On rejoint
ici, par cette notion subjective-objective de travail du langage, d'auto-connais
sance du langage, la pensée heideggerienne ". Cette conjonction est essentielle
pour définir notre actualité u. A son insu ou non, peu importe, la métrique
generative touche à ce courant. Or les formalistes et Jakobson n'ont pas
cessé de s'opposer à la « théorie de l'adéquation absolue du vers à l'esprit
de la langue » (Questions de poétique, p. 40) à quoi ils opposaient la « violence
organisée exercée par la forme poétique sur la langue », ou le caractère
culturel des changements de métrique dans une même langue.
Il y a ceux qui partent du mètre pour y inclure le rythme, ceux qui
partent du rythme pour y inclure le mètre ; ceux qui lient les faits de rythme
ou mètre à la signification, ceux qui les abstraient de la signification.
Le rythme et le mètre
La confusion entre le rythme et le mètre est la conséquence de cette
dépendance philosophique non analysée, qui piège les définitions dans une
circularité sans issue. Cette circularité tient dans la notion de régularité
appliquée au rythme. Le Dictionnaire de linguistique (Larousse, 1973) donne
à l'article Rythme : « On appelle rythme le retour régulier, dans la chaîne
parlée, d'impressions auditives analogues créées par divers éléments proso
diques. Dans l'alexandrin classique français, le rythme est créé (1) par la rime,
c'est-à-dire par la présence d'une douzième syllabe identique dans deux ou
plusieurs vers, accompagnée d'une retombée de la voix, et (2) par la césure,
c'est-à-dire la montée de la voix sur la sixième syllabe. » Cette définition du
rythme est la définition même du mètre (il n'y a pas d'article mètre), sans
parler de sa non-pertinence pour décrire l'alexandrin. Le Dictionnaire ency
clopédique des sciences du langage (Ducrot-Todorov, au Seuil, 1972), à l'ar
ticle Versification, prend ses distances par rapport à une définition qui ferait
du mètre une « succession parfaitement régulière des syllabes accentuées et
non accentuées », alors que le rythme serait la « réalisation de ce scheme
dans la langue > (p. 242) parce que cette répétition régulière « n'arrive
jamais » et que le problème demande donc un « degré d'abstraction » supér
ieur, que proposent Halle et Keyser (théorie qu'on analysera plus loin). Mais
6. Essai sur le rythme, Gallimard, 1952 (5* éd. ; lre, 1938).
7. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, p. 334.
rien ne remplace ce qu'on dénonce. On se trouve donc devant un vide définitionnel.
Une catégorisation logique fait du mètre chez Aristote une espèce du
genre rythme : « car il est évident que les mètres ne sont que des parties
des rythmes — та yá.p [летра 8ti (xópta twv fbu6[x&v есттц «pavepóv » (Poé
tique 1448 b). Mais cette évidence est inverse apparemment, pour ceux
qui font du rythme une actualisation du mètre. Pour Žirmunskij, « sans
mètre il n'y a pas de rythme » 8. On discerne ainsi deux courants opposés.
I. A. Richards est aristotélicien : le mètre est pour lui une « forme spécia
lisée du rythme » 9. Ce débat n'est pas formel, ou historique. Il met en jeu
le sens du message poétique tout entier. Il implique une théorie de la signi
fication. En termes aristotéliciens, J. Thompson 10 voit dans le mètre une
imitation « des éléments de base de notre langue et de leur ordre ». On rejoint
ici, par cette notion subjective-objective de travail du langage, d'auto-connais
sance du langage, la pensée heideggerienne ". Cette conjonction est essentielle
pour définir notre actualité u. A son insu ou non, peu importe, la métrique
generative touche à ce courant. Or les formalistes et Jakobson n'ont pas
cessé de s'opposer à la « théorie de l'adéquation absolue du vers à l'esprit
de la langue » (Questions de poétique, p. 40) à quoi ils opposaient la « violence
organisée exercée par la forme poétique sur la langue », ou le caractère
culturel des changements de métrique dans une même langue.
Il y a ceux qui partent du mètre pour y inclure le rythme, ceux qui
partent du rythme pour y inclure le mètre ; ceux qui lient les faits de rythme
ou mètre à la signification, ceux qui les abstraient de la signification.
6/
Le rythme est un universel poétique. C'est là que ses définitions se
diluent jusqu'à le rendre coextensif à la poésie même. Il est alors insaisis
sable par aucun métalangage, car il est dit en termes & expérience, et au bord
de la désémantisation.
L'origine philosophique (généralement oubliée, dégradée, chez les métri4. Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot, p. 85.
5. S. Chatman, A Theory of Meter, éd. Mouton, 1965, p. 222-223.
ciens) du rythme comme harmonie et régularité apparaît chez Matila Ghyka e.
C'est la spéculation pythagoricienne sur les nombres, qui se rattache au
Timée, d'où une « esthétique mathématique » (p. 178). On retrouvera cette
fascination des nombres dans l'Oulipo, donnant au cosmique («le cosmos,
c'est-à-dire le bon ordre », dit le Gorgias, cité p. 77) la fascination qu'ailleurs
exerce le sacré. Le. primat du cosmique me semble un trait de l'archaïsme
fondamental, par rapport à l'historique. Il est remarquable que sa continuité
contemporaine soit mathématique. Cette imposition de Yordre (la contrainte —
formelle — est un maintien de l'ordre, une censure et négation du désordre ;
c'est pourquoi le métricien-mathématicien refusera le sujet et la psychanalyse),
ce primat des proportions sur le chaos, possession ainsi du continu par-delà
le discontinu, semble un détour du théologique : le discours du continu est le
discours du divin ou de l'unité. Le rythme est alors l'hypostase du retour,
il garantit l'identité du même. C'est pourquoi il rassure : selon Pius Servien,
les rythmes sont « les seuls amis de l'homme » (cité p. 182). L'établissement
de l'étymologie exacte du mot rythme par Benveniste n'a pas été sans consé
quence peut-être sur la place du concept. On est repassé de la « forme du
mouvement » chez Platon 7, où Aristote avait mis l'accent sur la mesure
des alternances, à la formulation de Démocrite, « configuration particulière
du mouvant » (livre cité, p. 333). Ce mouvement vers les présocratiques ne
se définit pas comme allant au devenir bergsonien mais comme la remontée
contre un courant dédialectiseur vers la conceptualisation d'une contradiction
incessante.
Le rythme est un universel poétique. C'est là que ses définitions se
diluent jusqu'à le rendre coextensif à la poésie même. Il est alors insaisis
sable par aucun métalangage, car il est dit en termes & expérience, et au bord
de la désémantisation.
L'origine philosophique (généralement oubliée, dégradée, chez les métri4. Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot, p. 85.
5. S. Chatman, A Theory of Meter, éd. Mouton, 1965, p. 222-223.
ciens) du rythme comme harmonie et régularité apparaît chez Matila Ghyka e.
C'est la spéculation pythagoricienne sur les nombres, qui se rattache au
Timée, d'où une « esthétique mathématique » (p. 178). On retrouvera cette
fascination des nombres dans l'Oulipo, donnant au cosmique («le cosmos,
c'est-à-dire le bon ordre », dit le Gorgias, cité p. 77) la fascination qu'ailleurs
exerce le sacré. Le. primat du cosmique me semble un trait de l'archaïsme
fondamental, par rapport à l'historique. Il est remarquable que sa continuité
contemporaine soit mathématique. Cette imposition de Yordre (la contrainte —
formelle — est un maintien de l'ordre, une censure et négation du désordre ;
c'est pourquoi le métricien-mathématicien refusera le sujet et la psychanalyse),
ce primat des proportions sur le chaos, possession ainsi du continu par-delà
le discontinu, semble un détour du théologique : le discours du continu est le
discours du divin ou de l'unité. Le rythme est alors l'hypostase du retour,
il garantit l'identité du même. C'est pourquoi il rassure : selon Pius Servien,
les rythmes sont « les seuls amis de l'homme » (cité p. 182). L'établissement
de l'étymologie exacte du mot rythme par Benveniste n'a pas été sans consé
quence peut-être sur la place du concept. On est repassé de la « forme du
mouvement » chez Platon 7, où Aristote avait mis l'accent sur la mesure
des alternances, à la formulation de Démocrite, « configuration particulière
du mouvant » (livre cité, p. 333). Ce mouvement vers les présocratiques ne
se définit pas comme allant au devenir bergsonien mais comme la remontée
contre un courant dédialectiseur vers la conceptualisation d'une contradiction
incessante.
5/Changement des idées sur le rythme
Les idées reçues peuvent varier, s'opposer, depuis le rythme ordreéquilibre-harmonie (sur fond de clarté, raison et génie de la langue), jusqu'au
rythme émotion-rupture (sur fond d'alchimie-métamorphose), elles consti
tuent ensemble un barrage à l'étude du rythme dans la poésie, par l'alliance
des subjectivismes et de la pression idéologique collective. Il est révélateur
1. La versification, P.U.F., p. 46.
2. Traité de versification française des origines à nos jours, Klincksieck, 1965.
3. Plaisir poétique et plaisir musculaire, Corti, 1949.
du domaine français que les livres de Grammont (de 1904 et 1908), aux
notions contestées et infirmées depuis cinquante ans, continuent d'être réédités,
alors que des ouvrages fondamentaux plus récents (Spire, Lote) sont épuisés,
et qu'aucune synthèse nouvelle n'est apparue. Ils perpétuent alors le fantôme
d'une érudition trompeuse qui sévit, répétant ses barres de mesure, ses
notions controuvées de vitesse du trimètre, d'isochronie (« La durée de
chaque hémistiche est la moitié de la durée totale ». Petit traité..., p. 51)
et qui répand comme une évidence : « Le rythme est constitué dans toute
versification par le retour à intervalles sensiblement égaux des temps marqués
ou accents rythmiques » {ibid., p. 49).
Si une telle notion, privilégiant le Même, a pu régner, on peut poser,
avant d'en arriver à son origine philosophique, que c'est peut-être par une
exigence d'universalité. Il ne pourrait y avoir qu'une théorie du rythme et
une seule pour tous les rythmes dans le temps et dans l'espace, cosmiques
et humains. On montre plus loin les implications de ce primat cosmique.
Il semble que le résultat empirique d'un tel présupposé soit de réduire le
linguistique à l'extra-linguistique, et plus particulièrement pour avoir un déno
minateur commun à la musique et à la poésie. Les difficultés de cette combinatoire universelle me paraissent devoir remettre ce présupposé lui-même
en question, et proposer qu'une théorie du rythme poétique ne cessera pas
pour autant d'être théorie si elle ne concerne que le langage. Les assimilations
à la musique virent inévitablement à la méconnaissance du linguistique, à
l'ineffable, au vitalisme, au métaphorisme subjectif. Elles réduisent le rythme
au mètre. Leur logique est nivellatrice et asémantique.
Le rythme est un universel anthropologique : « Socialement et individuel
lement, l'homme est un animal rythmique4. » Autant que par les psychanal
ystes, il est mis par les ethnologues en rapport avec le plaisir et с la joie
pour la joie » {ibid., p. 86). Son passé rituel et magique en fait un porteur
d'archaïsmes qu'il serait d'un rationalisme désuet de dénier. La répétition
peut passer pour ce qui reste du formulaire, et de « l'origine sociale de la
poésie » (Mauss, Œuvres, éd. Minuit, t. II, p. 252). Le rythme met le lecteur
d'accord. Le rythme, avec en lui le verbal et l'infra-verbal, dépasse la saisie
de la linguistique, et requiert, outre la psychanalyse, une théorie historique
et comparée du langage poétique dans toutes les cultures, où il semble bien
fonctionner de même. Mais le problème se pose de savoir si on peut trans
later, et comment, les notions de l'anthropologie, l'échelle de leur perti
nence, sans tomber dans le vague et le primitivisme du début du siècle,
le mythe d'une communion. subconsciente, la communal function que critique
Chatman5, mais avec laquelle on ne les confondra pas. Ce que le métricien
ne peut que reléguer au fatras, reste un problème posé pour une théorie
du sujet et de la lecture, et pour la poésie.
Les idées reçues peuvent varier, s'opposer, depuis le rythme ordreéquilibre-harmonie (sur fond de clarté, raison et génie de la langue), jusqu'au
rythme émotion-rupture (sur fond d'alchimie-métamorphose), elles consti
tuent ensemble un barrage à l'étude du rythme dans la poésie, par l'alliance
des subjectivismes et de la pression idéologique collective. Il est révélateur
1. La versification, P.U.F., p. 46.
2. Traité de versification française des origines à nos jours, Klincksieck, 1965.
3. Plaisir poétique et plaisir musculaire, Corti, 1949.
du domaine français que les livres de Grammont (de 1904 et 1908), aux
notions contestées et infirmées depuis cinquante ans, continuent d'être réédités,
alors que des ouvrages fondamentaux plus récents (Spire, Lote) sont épuisés,
et qu'aucune synthèse nouvelle n'est apparue. Ils perpétuent alors le fantôme
d'une érudition trompeuse qui sévit, répétant ses barres de mesure, ses
notions controuvées de vitesse du trimètre, d'isochronie (« La durée de
chaque hémistiche est la moitié de la durée totale ». Petit traité..., p. 51)
et qui répand comme une évidence : « Le rythme est constitué dans toute
versification par le retour à intervalles sensiblement égaux des temps marqués
ou accents rythmiques » {ibid., p. 49).
Si une telle notion, privilégiant le Même, a pu régner, on peut poser,
avant d'en arriver à son origine philosophique, que c'est peut-être par une
exigence d'universalité. Il ne pourrait y avoir qu'une théorie du rythme et
une seule pour tous les rythmes dans le temps et dans l'espace, cosmiques
et humains. On montre plus loin les implications de ce primat cosmique.
Il semble que le résultat empirique d'un tel présupposé soit de réduire le
linguistique à l'extra-linguistique, et plus particulièrement pour avoir un déno
minateur commun à la musique et à la poésie. Les difficultés de cette combinatoire universelle me paraissent devoir remettre ce présupposé lui-même
en question, et proposer qu'une théorie du rythme poétique ne cessera pas
pour autant d'être théorie si elle ne concerne que le langage. Les assimilations
à la musique virent inévitablement à la méconnaissance du linguistique, à
l'ineffable, au vitalisme, au métaphorisme subjectif. Elles réduisent le rythme
au mètre. Leur logique est nivellatrice et asémantique.
Le rythme est un universel anthropologique : « Socialement et individuel
lement, l'homme est un animal rythmique4. » Autant que par les psychanal
ystes, il est mis par les ethnologues en rapport avec le plaisir et с la joie
pour la joie » {ibid., p. 86). Son passé rituel et magique en fait un porteur
d'archaïsmes qu'il serait d'un rationalisme désuet de dénier. La répétition
peut passer pour ce qui reste du formulaire, et de « l'origine sociale de la
poésie » (Mauss, Œuvres, éd. Minuit, t. II, p. 252). Le rythme met le lecteur
d'accord. Le rythme, avec en lui le verbal et l'infra-verbal, dépasse la saisie
de la linguistique, et requiert, outre la psychanalyse, une théorie historique
et comparée du langage poétique dans toutes les cultures, où il semble bien
fonctionner de même. Mais le problème se pose de savoir si on peut trans
later, et comment, les notions de l'anthropologie, l'échelle de leur perti
nence, sans tomber dans le vague et le primitivisme du début du siècle,
le mythe d'une communion. subconsciente, la communal function que critique
Chatman5, mais avec laquelle on ne les confondra pas. Ce que le métricien
ne peut que reléguer au fatras, reste un problème posé pour une théorie
du sujet et de la lecture, et pour la poésie.
4/
La versification est-elle parvenue à définir le vers ? Suffit-il de poser
que le vers français est « syllabique, rimé et césure » (Guiraud, p. 1 1) ? Pour
Elwert 1 : « II n'y a qu'un seul critère : le compte des syllabes » (§ 154).
Pourtant il groupe les vers « d'après leur structure rythmique et leur rôle
historique » (ibid.). Lote écrivait : « La régularité métrique est un mythe
dont il serait temps de débarrasser les manuels ■» (cité par Spire3, p. 465).
Spire ajoutait : « Les syllabes d'un alexandrin, toutes différentes de durée,
d'intensité, de hauteur, de timbre, ne sont identiques que de nom > (Spire,
ibid.). Si on constate la stabilité du principe syllabique, c'est pour la corriger
par son insuffisance. La versification française serait donc syllabique et
« mi-accentuelle ». Quand on ne se satisfait plus d'une définition formelle,
on tombe dans des définitions sémantiques vagues : le vers est une « unité
d'attention... ».
Il semble donc que seule une conceptualisation d'ensemble du travail
du langage qui a lieu dans le poème puisse définir les unités de ce langage,
par l'examen de ses éléments linguistiques et non linguistiques, intégrés,
comme ils étaient intégrés chez Aristote, mais dans notre historicité.
La versification est-elle parvenue à définir le vers ? Suffit-il de poser
que le vers français est « syllabique, rimé et césure » (Guiraud, p. 1 1) ? Pour
Elwert 1 : « II n'y a qu'un seul critère : le compte des syllabes » (§ 154).
Pourtant il groupe les vers « d'après leur structure rythmique et leur rôle
historique » (ibid.). Lote écrivait : « La régularité métrique est un mythe
dont il serait temps de débarrasser les manuels ■» (cité par Spire3, p. 465).
Spire ajoutait : « Les syllabes d'un alexandrin, toutes différentes de durée,
d'intensité, de hauteur, de timbre, ne sont identiques que de nom > (Spire,
ibid.). Si on constate la stabilité du principe syllabique, c'est pour la corriger
par son insuffisance. La versification française serait donc syllabique et
« mi-accentuelle ». Quand on ne se satisfait plus d'une définition formelle,
on tombe dans des définitions sémantiques vagues : le vers est une « unité
d'attention... ».
Il semble donc que seule une conceptualisation d'ensemble du travail
du langage qui a lieu dans le poème puisse définir les unités de ce langage,
par l'examen de ses éléments linguistiques et non linguistiques, intégrés,
comme ils étaient intégrés chez Aristote, mais dans notre historicité.
3/
La poésie et le vers
Langage poétique, langage versifié : les deux termes nous confondent
plus qu'ils ne se confondent. Pourtant Aristote avait posé, mais déjà expl
icitement contre une opinion inverse et répandue, que le vers n'est pas
la poésie : « II est vrai que les gens, accolant au nom du vers le nom de
poésie... itXyjv oî áv6p
La poésie et le vers
Langage poétique, langage versifié : les deux termes nous confondent
plus qu'ils ne se confondent. Pourtant Aristote avait posé, mais déjà expl
icitement contre une opinion inverse et répandue, que le vers n'est pas
la poésie : « II est vrai que les gens, accolant au nom du vers le nom de
poésie... itXyjv oî áv6p
2/
La poétique et le langage poétique
La poétique a suivi, depuis les formalistes russes, un trajet qui a semblé
fondre la poéticité et la littérarité (voyez « Qu'est-ce que la poésie » de
Jakobson, dans Questions de poétique), élargissant la compréhension du poé
tique au-delà de la poésie, mais au bénéfice de la (plutôt d'une) poésie,
et en gardant un privilège de fait aux textes « poétiques ». D'où une indis
tinction nouvelle entre la poétique et le poétique, parallèle au travail même
de la littérature contemporaine, et culturelle-datée. Cet élargissement a permis
de poser les problèmes techniques du vers sur le terrain de la théorie du
langage. Ce gain épistémologique a eu pourtant deux conséquences qui déter
minent chacune un blocage réflexif : successivement l'inclusion de la poétique
dans la linguistique (chez Jakobson), inclusion d'abord nécessaire mais dont
les limitations ne peuvent plus nous, arrêter (l'absence du sujet et de l'his
toire) ; et l'inclusion plus récente de la poétique dans la sémiotique (Lotman,
Greimas, etc.), où le présupposé que la poésie se fait avec des signes —
le signe est l'unité de la sémiotique — est contredit empiriquement. Car le
poème serait traduisible dans sa propre langue, et il ne l'est pas. Cette
constatation simple produit un cercle vicieux, masqué par l'idéologie de la
science qui a remplacé l'ancien scientisme positiviste : le retour à une expli
cation de la poésie par la déviation, le surplus, qui nous reporte à la vieille
esthétique ornementale, formelle. Ainsi le formalisme se referme sur un
formalisme qui lui est antérieur, parce qu'il le contenait encore. Parallèle
ment, la philosophie a essentialisé la poésie, l'enfermant dans une auto
allégorie où elle est hors-langage tout en étant l'essence même du langage.
Ainsi la poésie échappe à tous les ordres, que ce soit l'ordre philosophique
ou l'ordre structural-sémiotique. Non qu'il s'agisse d'attraper la poésie, mais
de la comprendre et de l'enseigner comme pratique du langage. On a cru
la saisir dans l'émotion, puis dans la motivation. Mais la sémantique n'en est
plus à Empson ni à Valéry. Le structuralisme, n'ayant pas une théorie assez
puissante du sens (par absence d'une théorie de renonciation et de l'idéologie),
a besoin de la notion áf ambiguïté, qu'il nourrit de cohérence et de complexité
structurelle, mais cette notion a trois corrélats : l'immanentisme par clôture
du texte, l'essentialisme, enfin un phénoménologisme dégradé où réapparaît
le sujet censuré. Une telle notion a mené à une grammaire de la poésie.
La poétique et le langage poétique
La poétique a suivi, depuis les formalistes russes, un trajet qui a semblé
fondre la poéticité et la littérarité (voyez « Qu'est-ce que la poésie » de
Jakobson, dans Questions de poétique), élargissant la compréhension du poé
tique au-delà de la poésie, mais au bénéfice de la (plutôt d'une) poésie,
et en gardant un privilège de fait aux textes « poétiques ». D'où une indis
tinction nouvelle entre la poétique et le poétique, parallèle au travail même
de la littérature contemporaine, et culturelle-datée. Cet élargissement a permis
de poser les problèmes techniques du vers sur le terrain de la théorie du
langage. Ce gain épistémologique a eu pourtant deux conséquences qui déter
minent chacune un blocage réflexif : successivement l'inclusion de la poétique
dans la linguistique (chez Jakobson), inclusion d'abord nécessaire mais dont
les limitations ne peuvent plus nous, arrêter (l'absence du sujet et de l'his
toire) ; et l'inclusion plus récente de la poétique dans la sémiotique (Lotman,
Greimas, etc.), où le présupposé que la poésie se fait avec des signes —
le signe est l'unité de la sémiotique — est contredit empiriquement. Car le
poème serait traduisible dans sa propre langue, et il ne l'est pas. Cette
constatation simple produit un cercle vicieux, masqué par l'idéologie de la
science qui a remplacé l'ancien scientisme positiviste : le retour à une expli
cation de la poésie par la déviation, le surplus, qui nous reporte à la vieille
esthétique ornementale, formelle. Ainsi le formalisme se referme sur un
formalisme qui lui est antérieur, parce qu'il le contenait encore. Parallèle
ment, la philosophie a essentialisé la poésie, l'enfermant dans une auto
allégorie où elle est hors-langage tout en étant l'essence même du langage.
Ainsi la poésie échappe à tous les ordres, que ce soit l'ordre philosophique
ou l'ordre structural-sémiotique. Non qu'il s'agisse d'attraper la poésie, mais
de la comprendre et de l'enseigner comme pratique du langage. On a cru
la saisir dans l'émotion, puis dans la motivation. Mais la sémantique n'en est
plus à Empson ni à Valéry. Le structuralisme, n'ayant pas une théorie assez
puissante du sens (par absence d'une théorie de renonciation et de l'idéologie),
a besoin de la notion áf ambiguïté, qu'il nourrit de cohérence et de complexité
structurelle, mais cette notion a trois corrélats : l'immanentisme par clôture
du texte, l'essentialisme, enfin un phénoménologisme dégradé où réapparaît
le sujet censuré. Une telle notion a mené à une grammaire de la poésie.
FRAGMENTS D'UNE CRITIQUE DU RYTHME
Peut-on commencer par définir ?
Les tensions en tous sens circonscrivent la multiplicité des travaux sur
le vers. Ou ils sont techniques, et ils éludent les problèmes généraux du lan
gage dont ils présupposent une solution, ou ils sont perdus dans un vague
et dans des erreurs qui les déconsidèrent.
Après les travaux historiques et phonétiques du début du siècle, les
études pré-structuralistes des formalistes russes et les applications du struc
turalisme, les travaux les plus récents viennent surtout, d'une part des mathém
aticiens, de l'autre, de la linguistique generative, — et des deux domaines
soviétique et anglo-américain. A la relative carence théorique (et au retard
avec lequel ont été reçus, ici, les formalistes — à peu près le même retard
que pour la psychanalyse), correspond une carence grandissante de l'ense
ignement. Du secondaire au supérieur, les éléments du rythme, autant en
langue qu'en poésie, semblent de plus en plus délaissés. Comme on a cessé
un jour de faire faire de la poésie latine, on a pratiquement cessé de « faire >
de la versification. Cette désuétude est parente de celle qui a frappé la
rhétorique. Elle provient de l'inadéquation de l'enseignement de la langue
et de la littérature au mouvement contemporain de la littérature, et à celui
de la linguistique. Si celui-ci a fait beaucoup de chemin depuis Saussure et
la grammaire scolaire traditionnelle, tous deux n'ont pas encore réalisé leur
rencontre pour renouveler le rapport des deux enseignements. Ainsi le théo
rique et l'empirique sont coupés l'un de l'autre. Le secondaire attend des
formules pour enseigner un théorique dont il ne comprend pas la multip
licité. L'enseignement a besoin de discursivité, non de contradiction : il
n'est pas dialectique. Cette situation est déjà ancienne (voyez Valéry, Œuvres,
éd. Pléiade I, p. 1079). Elle caractérise notre civilisation actuelle : Lotman,
en U.R.S.S., s'en plaint aussi. Le structuralisme lui-même a déjà passé sa
phase productive, et ne montre plus que ses manques, autant pour la théorie
de la syntaxe que pour la théorie du sujet et de l'histoire. Un linguiste ne
peut plus se cacher qu'il échoue devant la poésie. Le désarroi se reconnaît
comme une « transition » vers ce qu'on ne connaît pas, et qui confronte
aujourd'hui les théories psychanalytiques avec celles du matérialisme histo
rique et dialectique. C'est le problème du rapport entre l'empirique et le
théorique, dans l'illusion que la théorie où nous sommes est plus théorique
que la précédente. On montre plus loin qu'il s'agit souvent d'un empirisme
qui s'est seulement déplacé
Peut-on commencer par définir ?
Les tensions en tous sens circonscrivent la multiplicité des travaux sur
le vers. Ou ils sont techniques, et ils éludent les problèmes généraux du lan
gage dont ils présupposent une solution, ou ils sont perdus dans un vague
et dans des erreurs qui les déconsidèrent.
Après les travaux historiques et phonétiques du début du siècle, les
études pré-structuralistes des formalistes russes et les applications du struc
turalisme, les travaux les plus récents viennent surtout, d'une part des mathém
aticiens, de l'autre, de la linguistique generative, — et des deux domaines
soviétique et anglo-américain. A la relative carence théorique (et au retard
avec lequel ont été reçus, ici, les formalistes — à peu près le même retard
que pour la psychanalyse), correspond une carence grandissante de l'ense
ignement. Du secondaire au supérieur, les éléments du rythme, autant en
langue qu'en poésie, semblent de plus en plus délaissés. Comme on a cessé
un jour de faire faire de la poésie latine, on a pratiquement cessé de « faire >
de la versification. Cette désuétude est parente de celle qui a frappé la
rhétorique. Elle provient de l'inadéquation de l'enseignement de la langue
et de la littérature au mouvement contemporain de la littérature, et à celui
de la linguistique. Si celui-ci a fait beaucoup de chemin depuis Saussure et
la grammaire scolaire traditionnelle, tous deux n'ont pas encore réalisé leur
rencontre pour renouveler le rapport des deux enseignements. Ainsi le théo
rique et l'empirique sont coupés l'un de l'autre. Le secondaire attend des
formules pour enseigner un théorique dont il ne comprend pas la multip
licité. L'enseignement a besoin de discursivité, non de contradiction : il
n'est pas dialectique. Cette situation est déjà ancienne (voyez Valéry, Œuvres,
éd. Pléiade I, p. 1079). Elle caractérise notre civilisation actuelle : Lotman,
en U.R.S.S., s'en plaint aussi. Le structuralisme lui-même a déjà passé sa
phase productive, et ne montre plus que ses manques, autant pour la théorie
de la syntaxe que pour la théorie du sujet et de l'histoire. Un linguiste ne
peut plus se cacher qu'il échoue devant la poésie. Le désarroi se reconnaît
comme une « transition » vers ce qu'on ne connaît pas, et qui confronte
aujourd'hui les théories psychanalytiques avec celles du matérialisme histo
rique et dialectique. C'est le problème du rapport entre l'empirique et le
théorique, dans l'illusion que la théorie où nous sommes est plus théorique
que la précédente. On montre plus loin qu'il s'agit souvent d'un empirisme
qui s'est seulement déplacé
VERS L’IDENTITÉ OU L’ALTÉRITÉ
Il y a donc le problème des apparences de renouvellements, le problème des différents types de trad-uction, et le problème majeur du défi : il n’y a jamais eu en français la réussite littéraire de la King James Version et de Luther. Et ce n’est pas la Bible du Rabbinat, de 1899, qui a révolutionné la traduction. Segond, protestant, est souvent plus proche de l’hébreu.
Le changement est venu d’une visée non confessionnelle, avec E1mond Fleg (1959, 1963), qui calqu-e l’hébreu, et inverse l’annexion en décentrement. C’est ce même calque, plus l’étymologisme (l’étymologie prise pour le sens) qui caractérise la version d’André Chouraqui (11974-1977 ; 1985), accueillie d’a-bord avec éloge. C’était le vieux littéralisme d’Aquila, traduisant le fam-eux début « au commencement » par « dans la tête » — avec Entête. Mais toujours aucune écoute d rythme, brouillé même au conraire, dans une poétisation apparente.
Quant à la Traduction œcuménique de la Bible, en 1965, elle visait une « fidélité exégétiquement fondée et non au sens littéral », simplement « un français correct ». Le « naturel », le « français courant » traduisant surtout le dualisme de l’équivalence dynamique et de l’équivalence formelle, c’est-à-dire du langage courant et du calque pris pour la poésie.
Ainsi on a cru distinguer trois types de traduction : l’une pour les lettrés (comme celle de Dhorme), une autre pour grand public (comme la Bible de Jérusalem), une dernière en langage basique — pour évangéliser. Plus une variante, censée poétique (celle de Chouraqui). Tout en notant entre elles une certaine homogénéisation.
Je dirais plutôt qu’il y a les traductions vers l’identité, et les traductions vers l’altérité. Toujours le piège du signe. Et rien de la spécificité du langage dans les psaumes : du Mallarmé.
C’est ce piège que je rejette, en cherchant à rendre le continu rythme-syntaxe-prosodie, la force, et cette spécificité, le dire plus que le dit. Ce qu’il fait. Et tout change. Il y aura toujours plusieurs manières d’entendre le langage, plusieurs manières de traduire. Selon qu’on croit qu’on traduit de la langue, ou un poème. Où périt le vieux motif qui veut que les traductions vieillissent : la King James Version n’est remplacée paf aucune des traductions plus récentes en anglais, elle tient, comme du Shakespeare.
Et on revient au défi majeur. Comme disait Claudel, qui n’aimait que la Vulgate, « toutes les traductions françaises me font mal au cœur ». Alors que chacun coure la belle course de faire au français ce que la King James Version a fait à l’anglais. Traduire est au pluriel, mais le poème est unique. Rien à voir avec la poétisation. Pour moi, il est dans son rythme. Alors, après Gloires, je me mets à la Genèse : « Au commencement... ».
Henri Meschonnic, Le Monde du 15-06-01.
oOo
Il y a donc le problème des apparences de renouvellements, le problème des différents types de trad-uction, et le problème majeur du défi : il n’y a jamais eu en français la réussite littéraire de la King James Version et de Luther. Et ce n’est pas la Bible du Rabbinat, de 1899, qui a révolutionné la traduction. Segond, protestant, est souvent plus proche de l’hébreu.
Le changement est venu d’une visée non confessionnelle, avec E1mond Fleg (1959, 1963), qui calqu-e l’hébreu, et inverse l’annexion en décentrement. C’est ce même calque, plus l’étymologisme (l’étymologie prise pour le sens) qui caractérise la version d’André Chouraqui (11974-1977 ; 1985), accueillie d’a-bord avec éloge. C’était le vieux littéralisme d’Aquila, traduisant le fam-eux début « au commencement » par « dans la tête » — avec Entête. Mais toujours aucune écoute d rythme, brouillé même au conraire, dans une poétisation apparente.
Quant à la Traduction œcuménique de la Bible, en 1965, elle visait une « fidélité exégétiquement fondée et non au sens littéral », simplement « un français correct ». Le « naturel », le « français courant » traduisant surtout le dualisme de l’équivalence dynamique et de l’équivalence formelle, c’est-à-dire du langage courant et du calque pris pour la poésie.
Ainsi on a cru distinguer trois types de traduction : l’une pour les lettrés (comme celle de Dhorme), une autre pour grand public (comme la Bible de Jérusalem), une dernière en langage basique — pour évangéliser. Plus une variante, censée poétique (celle de Chouraqui). Tout en notant entre elles une certaine homogénéisation.
Je dirais plutôt qu’il y a les traductions vers l’identité, et les traductions vers l’altérité. Toujours le piège du signe. Et rien de la spécificité du langage dans les psaumes : du Mallarmé.
C’est ce piège que je rejette, en cherchant à rendre le continu rythme-syntaxe-prosodie, la force, et cette spécificité, le dire plus que le dit. Ce qu’il fait. Et tout change. Il y aura toujours plusieurs manières d’entendre le langage, plusieurs manières de traduire. Selon qu’on croit qu’on traduit de la langue, ou un poème. Où périt le vieux motif qui veut que les traductions vieillissent : la King James Version n’est remplacée paf aucune des traductions plus récentes en anglais, elle tient, comme du Shakespeare.
Et on revient au défi majeur. Comme disait Claudel, qui n’aimait que la Vulgate, « toutes les traductions françaises me font mal au cœur ». Alors que chacun coure la belle course de faire au français ce que la King James Version a fait à l’anglais. Traduire est au pluriel, mais le poème est unique. Rien à voir avec la poétisation. Pour moi, il est dans son rythme. Alors, après Gloires, je me mets à la Genèse : « Au commencement... ».
Henri Meschonnic, Le Monde du 15-06-01.
oOo
Spécialiste du langage, Henri Meschonnic a fait partie des universitaires qui ont fondé l’université de Vincennes à l’époque structuraliste. Professeur admiré de ses étudiants, écrivain au style décapant, d’inspiration souvent rebelle, théoricien mondialement connu pour ses travaux sur la poétique, le rythme, le style, le signe et pour ses lectures critiques de la littérature (Hugo) ou de la philosophie (Heidegger, Spinoza), il s’est également imposé, comme créateur, par une dizaine d’ouvrages de poésie. Mais c’est dans les études et traductions bibliques qu’Henri Meschonnic a trouvé le domaine idéal pour combiner ses talents de linguiste et son inspiration de poète, avec deux publications chez Gallimard, Les Cinq Rouleaux (1970), Jona et le signifiant errant (1981), et plus récemment trois nouveaux titres chez Desclée de Brouwer : Gloires (trad. des Psaumes, 2001), Au Commencement (trad. de la Genèse, 2002) et Les Noms (trad. de l’Exode, 2003). Il s’est expliqué sur le sens et les présupposés de ce travail dans un essai au ton, comme toujours, très personnel (Un coup de Bible dans la philosophie, éd. Bayard, 2004).
Pierre-Marc de Biasi. Le christianisme a fait sien le message biblique et, pour l’essentiel, en Occident, c’est à travers des traductions chrétiennes que nous connaissons la Bible. Selon vous, faut-il y voir l’histoire d’une adaptation, d’un détournement ou d’une falsification ?
Henri Meschonnic. Je dirais plutôt une appropriation : c’est le thème du verus Israël, de la théologie chrétienne de la préfiguration. Quelle est l’idée ? L’ancien Israël, celui de l’Ancien Testament (vetus Israël) n’était que l’annonce d’une autre figure (la nouvelle Alliance instaurée par le Christ) qui est désormais le seul véritable Israël (verus Israël). Cette théorie repose sur ce qu’il faut appeler le paradigme théologique du signe. Le Nouveau Testament dit la vérité de l’Ancien, et l’Ancien Testament est maintenu dans la mesure où il préfigure le Nouveau : il est à la fois escamotable, escamoté et conservé. Exactement comme il advient dans le signe linguistique, où le sens accomplit la signification du son, en escamotant la part sonore du signe qui néanmoins subsiste, mais en devenant insignifiante après la révélation du sens. [...] Que font les traducteurs ? Ils considèrent qu’il y a de la forme et du contenu : d’une part du matériel phonologique, relativement accessoire, dont il serait vain de chercher à transposer la singularité, et d’autre part du sens, du contenu qui constituerait finalement l’enjeu essentiel du texte original, et derrière lequel la forme doit avoir la politesse de s’effacer. Évidemment, c’est plus simple, c’est raisonnable, mais est-ce vraiment cela, traduire ?
Un effacement dans lequel peuvent aussi se dissimuler des entreprises très peu innocentes, qui portent précisément sur le sens, par exemple pour confirmer cette fameuse thèse de la préfiguration. Car à force d’infléchir les contenus pour rendre plus visible ce verus Israël, on est facilement conduit à réprouver, puis à proscrire le verus Israël, c’est-àdire à légitimer l’antijudaïsme...
Oui, il s’agit d’un autre aspect du problème, mais dont les conséquences sont en effet très sérieuses. À cet égard, j’aime bien citer Isaïe 40, 3. Pendant des siècles, on a traduit, et l’on traduit encore :
« Une voix parle dans le désert. Ouvrez le chemin du Seigneur. »
Or, la coupe principale n’est pas du tout là, et le rythme montre à l’évidence qu’il faut traduire :
« Une voix appelle. Dans le désert, ouvrez le chemin. »De toute évidence, le message n’est pas celui de la préfiguration : une autre figure de Dieu (sous-entendu le Christ) viendra remplacer le Dieu de l’ancienne alliance. Non, il s’agit au contraire d’un fragment de mémoire qui porte sa date : celle du premier exil à Babylone, l’injonction du retour, la postulation d’un chemin qu’il s’agit de se frayer vers la Terre sainte à travers le désert. C’est aussi une injonction éternelle à aller vers le futur. Mais ce n’est pas l’annonce d’un Messie. Vous voyez que ce simple décalage de rythme nous fait changer complètement de sens, et non seulement de sens, mais littéralement d’eschatologie. Autre malentendu, qui ne tient pas cette fois à une méprise sur le rythme mais à la création d’un hapax : le fameux « Dieu des armées », En hébreu biblique, ce mot pluriel que l’on traduit par « armées » n’a nulle part ce sens : il désigne le soleil, la lune, les astres, le nombre infini des corps stellaires. Il faut traduire ; « Dieu des multitudes d’étoiles. » Pourquoi imaginer un hapax, un sens qui n’aurait qu’une occurrence ? Ce n’est pas innocent. Cela sert à opposer, comme Hegel le fait dans L’Esprit du christianisme et son destin, un christianisme conçu comme religion de l’amour, à un judaïsme martial et vindicatif comme religion primitive, pétrie de haine, de violence et de vengeance. Alors, en effet, le « Dieu des armées » participe insidieusement de cette image antijudaïque.
Mais comment un traducteur de la Bible pourrait-il échapper à l’emprise de ses propres convictions religieuses ? Par quel miracle ou quelle méthode pensez-vous avoir personnellement réussi à vous en libérer ?
Oui, en effet, les commentaires sont toujours plus ou moins religieux, y compris bien sûr lorsqu’ils s’abritent derrière des approches scientifiques, historiques ou philologiques : en réalité, ils relèvent même tous tacitement du théologique. Pour y voir clair, il n’y a pas d’autre solution que de révoquer en doute tout ce qui s’est dit, écrit et traduit, et de s’enfermer dans les limites strictes de son objet en se faisant attentif au moindre détail. Bref, il faut en revenir au signifiant du texte qui nous propose de différencier clairement trois dimensions à la fois complémentaires et distinctes : le sacré, le divin et le religieux. La Genèse, par exemple, nous offre un moyen très clair de comprendre ce qu’est le sacré au sens où, selon moi, il faut l’entendre. Le sacré est le fusionnel entre l’humain et le cosmique, avec la médiation des animaux. C’est le temps du conte, où les bêtes parlent. Le serpent parle à Ève. La question ne se pose pas de savoir en quelle langue. Notons que c’est un problème qui chiffonne saint Augustin dès le troisième verset de la Genèse ; en lisant : « Et Dieu a dit Qu’il y ait la lumière », Augustin se demande : « En quelle langue parlait Dieu ? » Mais la question n’a évidemment aucun sens. Dieu parle à ses créatures, le serpent parle à Ève : c’est ainsi et c’est la seule chose qui compte. De nombreux indices, négligés par tous les traducteurs, sont à comprendre comme les traces visibles du sacré, de cette fusion entre l’humain, les bêtes et le cosmos. Par exemple, pour parler des petits de la colombe, la Bible emploie un terme strictement réservé aux humains : « le fils » de la colombe. Ce sacré comme milieu fusionnel est intimement lié à du « divin », et cela dès le vingtième verset du premier chapitre. Mais si l’on s’en tient strictement au texte, ce divin n’implique aucune forme de religieux. Il coïncide simplement avec la création de la vie : la grouillante, la fourmillante, la puissance d’une énergie à exister qui s’incarne dans les créatures vivantes.
Pierre-Marc de Biasi. Le christianisme a fait sien le message biblique et, pour l’essentiel, en Occident, c’est à travers des traductions chrétiennes que nous connaissons la Bible. Selon vous, faut-il y voir l’histoire d’une adaptation, d’un détournement ou d’une falsification ?
Henri Meschonnic. Je dirais plutôt une appropriation : c’est le thème du verus Israël, de la théologie chrétienne de la préfiguration. Quelle est l’idée ? L’ancien Israël, celui de l’Ancien Testament (vetus Israël) n’était que l’annonce d’une autre figure (la nouvelle Alliance instaurée par le Christ) qui est désormais le seul véritable Israël (verus Israël). Cette théorie repose sur ce qu’il faut appeler le paradigme théologique du signe. Le Nouveau Testament dit la vérité de l’Ancien, et l’Ancien Testament est maintenu dans la mesure où il préfigure le Nouveau : il est à la fois escamotable, escamoté et conservé. Exactement comme il advient dans le signe linguistique, où le sens accomplit la signification du son, en escamotant la part sonore du signe qui néanmoins subsiste, mais en devenant insignifiante après la révélation du sens. [...] Que font les traducteurs ? Ils considèrent qu’il y a de la forme et du contenu : d’une part du matériel phonologique, relativement accessoire, dont il serait vain de chercher à transposer la singularité, et d’autre part du sens, du contenu qui constituerait finalement l’enjeu essentiel du texte original, et derrière lequel la forme doit avoir la politesse de s’effacer. Évidemment, c’est plus simple, c’est raisonnable, mais est-ce vraiment cela, traduire ?
Un effacement dans lequel peuvent aussi se dissimuler des entreprises très peu innocentes, qui portent précisément sur le sens, par exemple pour confirmer cette fameuse thèse de la préfiguration. Car à force d’infléchir les contenus pour rendre plus visible ce verus Israël, on est facilement conduit à réprouver, puis à proscrire le verus Israël, c’est-àdire à légitimer l’antijudaïsme...
Oui, il s’agit d’un autre aspect du problème, mais dont les conséquences sont en effet très sérieuses. À cet égard, j’aime bien citer Isaïe 40, 3. Pendant des siècles, on a traduit, et l’on traduit encore :
« Une voix parle dans le désert. Ouvrez le chemin du Seigneur. »
Or, la coupe principale n’est pas du tout là, et le rythme montre à l’évidence qu’il faut traduire :
« Une voix appelle. Dans le désert, ouvrez le chemin. »De toute évidence, le message n’est pas celui de la préfiguration : une autre figure de Dieu (sous-entendu le Christ) viendra remplacer le Dieu de l’ancienne alliance. Non, il s’agit au contraire d’un fragment de mémoire qui porte sa date : celle du premier exil à Babylone, l’injonction du retour, la postulation d’un chemin qu’il s’agit de se frayer vers la Terre sainte à travers le désert. C’est aussi une injonction éternelle à aller vers le futur. Mais ce n’est pas l’annonce d’un Messie. Vous voyez que ce simple décalage de rythme nous fait changer complètement de sens, et non seulement de sens, mais littéralement d’eschatologie. Autre malentendu, qui ne tient pas cette fois à une méprise sur le rythme mais à la création d’un hapax : le fameux « Dieu des armées », En hébreu biblique, ce mot pluriel que l’on traduit par « armées » n’a nulle part ce sens : il désigne le soleil, la lune, les astres, le nombre infini des corps stellaires. Il faut traduire ; « Dieu des multitudes d’étoiles. » Pourquoi imaginer un hapax, un sens qui n’aurait qu’une occurrence ? Ce n’est pas innocent. Cela sert à opposer, comme Hegel le fait dans L’Esprit du christianisme et son destin, un christianisme conçu comme religion de l’amour, à un judaïsme martial et vindicatif comme religion primitive, pétrie de haine, de violence et de vengeance. Alors, en effet, le « Dieu des armées » participe insidieusement de cette image antijudaïque.
Mais comment un traducteur de la Bible pourrait-il échapper à l’emprise de ses propres convictions religieuses ? Par quel miracle ou quelle méthode pensez-vous avoir personnellement réussi à vous en libérer ?
Oui, en effet, les commentaires sont toujours plus ou moins religieux, y compris bien sûr lorsqu’ils s’abritent derrière des approches scientifiques, historiques ou philologiques : en réalité, ils relèvent même tous tacitement du théologique. Pour y voir clair, il n’y a pas d’autre solution que de révoquer en doute tout ce qui s’est dit, écrit et traduit, et de s’enfermer dans les limites strictes de son objet en se faisant attentif au moindre détail. Bref, il faut en revenir au signifiant du texte qui nous propose de différencier clairement trois dimensions à la fois complémentaires et distinctes : le sacré, le divin et le religieux. La Genèse, par exemple, nous offre un moyen très clair de comprendre ce qu’est le sacré au sens où, selon moi, il faut l’entendre. Le sacré est le fusionnel entre l’humain et le cosmique, avec la médiation des animaux. C’est le temps du conte, où les bêtes parlent. Le serpent parle à Ève. La question ne se pose pas de savoir en quelle langue. Notons que c’est un problème qui chiffonne saint Augustin dès le troisième verset de la Genèse ; en lisant : « Et Dieu a dit Qu’il y ait la lumière », Augustin se demande : « En quelle langue parlait Dieu ? » Mais la question n’a évidemment aucun sens. Dieu parle à ses créatures, le serpent parle à Ève : c’est ainsi et c’est la seule chose qui compte. De nombreux indices, négligés par tous les traducteurs, sont à comprendre comme les traces visibles du sacré, de cette fusion entre l’humain, les bêtes et le cosmos. Par exemple, pour parler des petits de la colombe, la Bible emploie un terme strictement réservé aux humains : « le fils » de la colombe. Ce sacré comme milieu fusionnel est intimement lié à du « divin », et cela dès le vingtième verset du premier chapitre. Mais si l’on s’en tient strictement au texte, ce divin n’implique aucune forme de religieux. Il coïncide simplement avec la création de la vie : la grouillante, la fourmillante, la puissance d’une énergie à exister qui s’incarne dans les créatures vivantes.
Ce début de la Bible dans le légendaire est un texte très fort, et chargé. C’est pourquoi son écriture appelle des remarques nombreuses, et le déploiement des comparaisons avec d’autres versions, surtout les françaises, pour rendre compte à la fois du travail du poème et de ce qu’il devient dans les traductions du signe. Toujours la poétique du divin contre le marché du signe. Plus que jamais la visée est le poème.
Les notes, particulièrement copieuses par conséquent, ne sont là que pour faire partager l’atelier du poème et du traduire.
ARNULF RAINER
Né en 1929, l’artiste Arnulf Rainer se réapproprie des peintures ou photographies préexistantes en les recouvrant de traits, d’aplats, de traces issus de gestes vigoureux et violents. Sollicité en 1995 par l’éditeur Pattloch Verlag pour une nouvelle édition de la Bible, il a ainsi produit plus de quatre cents « peintures surajoutées ». S’emparant d’enluminures médiévales, de plafonds peints romans, d’oeuvres des peintres renaissants, de gravures de la Bible de Luther ou de Gustave Doré, il est intervenu sur ces « images préalables » pour en souligner ou en contredire le sens, les faire revivre ou disparaître sous la puissance de sa propre interprétation. Cent soixante de ces feuillets ont été réunis dons un volume édité par la fondation Sammlung Frieder Burda, accompagnés d’extraits du texte biblique et de commentaires analysant le rapport de l’oeuvre de Rainer ou texte et à l’image sur laquelle il a travaillé.
1 — « au commencement/ que Dieu a créé », berechit/bara elobim, le commencement de ce texte du commencement est au cas construit : c’est dire qu’il s’agit d’une subordonnée. Ce que j’accentue par « que... » plutôt que par « quand ». Comme l’explique aussitôt et en détail Rachi. Elle est suivie d’une incise, tout le verset 2. La principale n’arrive qu’au verset 3 : la première chose créée a été la lumière. Pas le ciel et la terre. C’est pourtant comme une proposition indépendante, et une succession d’indépendantes, que ce début a été traité traditionnellement — erreur canonique. Dans Le Maistre de Sacy : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». De même Ostervald, Cahen, Segond, Dhorme, la Bible de Jérusalem (1998), Fleg. Le Rabbinat avec le plus-que-parfait « Dieu avait créé », Chouraqui (985) avec l’imparfait « Entête Élohim créait » ne font que varier sur la même erreur. Grosjean l’aggrave « D’abord Dieu a fait le ciel et la terre » : La seule traduction française, à ma connaissance, à ne pas commencer par ce contresens cosmique est la TOB : « Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, 2 la terre était déserte [...]3 et Dieu dit... ». L’erreur avait commencé avec la Septante, en arkhê ëpoiêssen ho theos ton ouranon kai tên gûen. Jérôme enchaînait : In principio creavit Deus caelum et terram... De même Luther : Am anfang schuff gott Himmel und Erden. De même la King James Version : In the beginning Cod created the heaven and the earth. La traduction commençait mal.
L’italienne de Dario Disegni continue de même : « In principio Dio crea el cielo e la terra ». L’espagnole de Luis Alonso Schôkel aussi : « Al principio crea Dios el cielo y la tierra », Buber n’y a rien changé : « Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde ».
Ont corrigé, en 1962, la traduction américaine d’Orlinsky : « When God began to create the heaven
and the earth - the earth being unformed and void[...] God said, "Let there be light..." et la New English Bible de 1970 : " In the beginning of creation, when God made heaven and earth, the earth was without form and void [... ] ’’. Mais là le verset 2 devient la principale, et le 3 une indépendante : « God said[...] ».
Mais comme rechit ; « commencement, principe », vient de roch, « tête », Aquila avait déjà au IIe siècle traduit be-recbit par en tê kephalê, « dans la tête », ce que tête baissée a suivi Chouraqui, Entête.
Pour le sens de la préposition be-, il y a aussi eu bien des controverses. Isaac Albalag, au XIIIe siècle, rejette le sens temporel et, des trois sens (spatial, temporel, causal) retient le dernier : « par... » Ce que rappelle Maurice Ruben Hayoun, dans L’exégèse juive (P.U.P., Que Sais- Je ? 2000, p. 76). D’où le sens « par le principe, donc par la sagesse » (ibid.). Sens ésotérique. Mais c’est là un sens dérivé. Contenu dans le signifiant double, préposition « dans » et notion de « commencement ». Et pour Samson Raphaël
Hirsch, il s’agissait au contraire d’un « temps initial » (p. 109). Comme c’est le récit de la création du monde, la valeur cosmogonique est celle que je retiens.
Le monde dépend de la grammaire. « le ciel », hachchamaïm — « ciel » pour chamaïm, et pas « cieux », ce pluriel dit littéraire, parce qu’en hébreu il n’y a que la forme plurielle, qui ne s’oppose pas à un singulier. Non-marqué pour non-marqué. Tous les traducteurs disent « le ciel », sauf Ostervald, Segond, Dhorme, Fleg : « les cieux » ; et Chouraqui « les ciels » — terme de peinture en français. L’étymologie populaire voit dans ce mot le feu, ecb, et l’eau, maïm. De même, maïm, étant un pluriel sans singulier, je le rends par « l’eau » et non « les eaux ».
2 — « la terre », badrets. Je réserve « terre » à tirets, et « terre rouge » à adama, qui apparaît au verset 25.
— « vaine/et vide », tóhou/vavóhou. Audiblemenr un couple prosodique, en même temps que l’informe primordial. Le sens n’est ici que l’infirme du continu. Le Maistre de Sacy : « La terre était informe et toute nue ». Cahen « informe et en désordre » ; Ostervald, Segond : « informe et vide », Dhorme et la TOB « déserte et vide » ; le Rabbinat : « n’était que solitude et chaos » ; Grosjean : « sans forme et vide ». Seuls Fleg (« flot et chaos ») et la Bible de Jérusalem (.« vide et vague ») ont tenté de retrouver le couplage. Et Buber : « Irrsal und Wirrsal ». Chouraqui a simplement transcrit : « la terre était tohu-et-bohu », avec une note qui suggère que c’étaient des « noms de divinités du chaos primordial ? », ce que n’appuient guère les commentaires — et surtout l’expression fait contresens en français. Dans une première version je traduisais « boue et trouble ».
— « et l’ombre », ve’hOcheckh. Phrase nominale. J’ai choisi ombre pour la motivation colorée de sa voyelle. Les autres font des variations sur ténèbres : « les ténèbres couvraient » (Le Maistre de Sacy, la Bible de Jérusalem), « des ténèbres couvraient » (le Rabbinat), « il y avait des ténèbres » (Segond, Dhorme), « les ténèbres étaient à la surface » (Ostervald), « les ténèbres étaient sur la surface » (Cahen, Grosjean). Et ténèbre au singulier, propre à l’écriture artiste : « et la ténèbre à la surface » (TOB), « et ténèbre sur la face » (Fleg), « une ténèbre sur les faces » (Chouraqui),
— « gouffre », tehom — l’eau primordiale. Tous ont « l’abîme ». Seul Fleg, « gouffre ».
_ - « couve », mera’héfet. Participe présent de ra’haf. Rachi compare le souffle de Dieu à une « colombe planant au-dessus du nid [...]
3 — « et il y a eu la lumière », vayehi or. J’ai choisi le passé composé parce qu’il implique le conrinu du passé ancien au temps de celui qui parle. Le passé simple dit du révolu — or la lumière est toujours là, depuis. Passé simple chez Le Maistre de Sacy : « et la lumière fut faite » ; Ostervald, Cahen, Segond, le Rabbinat, la Bible de Jérusalem, la TOB : « et la lumière fut » ; Fleg : « et fut la lumière », Dhorme : « et il y eut de la lumière ». Grosjean seul a le passé continu au présent : « et il y a eu de la lumière ». Chouraqui a le présenr : « et c’est une lumière » - ce qui efface la valeur aspectuelle.
4 — « et Dieu a vu/la lumière/c’est bien », vayare elohim/ et-ahor/kitov. Double complément : il voit la lumière et il voit qu’elle est bonne. Deux momenrs successifs. La traduction courante les ramasse en un : « Et Dieu vit que la lumière était bonne » (Ostervald) - modèle de Le Maistre de Sacy, Segond, le Rabbinat, Dhorme, la Bible de Jérusalem, la TOB, Grosjean. Seuls Fleg et Chouraqui onr voulu transposer la syntaxe à deux temps ici de l’hébreu. Mais Fleg au prix d’un vulgarisme qui verse dans le comique involontaire : « Et Dieu vit la lumière, qu’elle est bonne » ; Chouraqui en forçant le tour vers un exclamatif : « Elohim voit la lumière : quel bien ! »
Les notes, particulièrement copieuses par conséquent, ne sont là que pour faire partager l’atelier du poème et du traduire.
ARNULF RAINER
Né en 1929, l’artiste Arnulf Rainer se réapproprie des peintures ou photographies préexistantes en les recouvrant de traits, d’aplats, de traces issus de gestes vigoureux et violents. Sollicité en 1995 par l’éditeur Pattloch Verlag pour une nouvelle édition de la Bible, il a ainsi produit plus de quatre cents « peintures surajoutées ». S’emparant d’enluminures médiévales, de plafonds peints romans, d’oeuvres des peintres renaissants, de gravures de la Bible de Luther ou de Gustave Doré, il est intervenu sur ces « images préalables » pour en souligner ou en contredire le sens, les faire revivre ou disparaître sous la puissance de sa propre interprétation. Cent soixante de ces feuillets ont été réunis dons un volume édité par la fondation Sammlung Frieder Burda, accompagnés d’extraits du texte biblique et de commentaires analysant le rapport de l’oeuvre de Rainer ou texte et à l’image sur laquelle il a travaillé.
1 — « au commencement/ que Dieu a créé », berechit/bara elobim, le commencement de ce texte du commencement est au cas construit : c’est dire qu’il s’agit d’une subordonnée. Ce que j’accentue par « que... » plutôt que par « quand ». Comme l’explique aussitôt et en détail Rachi. Elle est suivie d’une incise, tout le verset 2. La principale n’arrive qu’au verset 3 : la première chose créée a été la lumière. Pas le ciel et la terre. C’est pourtant comme une proposition indépendante, et une succession d’indépendantes, que ce début a été traité traditionnellement — erreur canonique. Dans Le Maistre de Sacy : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». De même Ostervald, Cahen, Segond, Dhorme, la Bible de Jérusalem (1998), Fleg. Le Rabbinat avec le plus-que-parfait « Dieu avait créé », Chouraqui (985) avec l’imparfait « Entête Élohim créait » ne font que varier sur la même erreur. Grosjean l’aggrave « D’abord Dieu a fait le ciel et la terre » : La seule traduction française, à ma connaissance, à ne pas commencer par ce contresens cosmique est la TOB : « Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, 2 la terre était déserte [...]3 et Dieu dit... ». L’erreur avait commencé avec la Septante, en arkhê ëpoiêssen ho theos ton ouranon kai tên gûen. Jérôme enchaînait : In principio creavit Deus caelum et terram... De même Luther : Am anfang schuff gott Himmel und Erden. De même la King James Version : In the beginning Cod created the heaven and the earth. La traduction commençait mal.
L’italienne de Dario Disegni continue de même : « In principio Dio crea el cielo e la terra ». L’espagnole de Luis Alonso Schôkel aussi : « Al principio crea Dios el cielo y la tierra », Buber n’y a rien changé : « Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde ».
Ont corrigé, en 1962, la traduction américaine d’Orlinsky : « When God began to create the heaven
and the earth - the earth being unformed and void[...] God said, "Let there be light..." et la New English Bible de 1970 : " In the beginning of creation, when God made heaven and earth, the earth was without form and void [... ] ’’. Mais là le verset 2 devient la principale, et le 3 une indépendante : « God said[...] ».
Mais comme rechit ; « commencement, principe », vient de roch, « tête », Aquila avait déjà au IIe siècle traduit be-recbit par en tê kephalê, « dans la tête », ce que tête baissée a suivi Chouraqui, Entête.
Pour le sens de la préposition be-, il y a aussi eu bien des controverses. Isaac Albalag, au XIIIe siècle, rejette le sens temporel et, des trois sens (spatial, temporel, causal) retient le dernier : « par... » Ce que rappelle Maurice Ruben Hayoun, dans L’exégèse juive (P.U.P., Que Sais- Je ? 2000, p. 76). D’où le sens « par le principe, donc par la sagesse » (ibid.). Sens ésotérique. Mais c’est là un sens dérivé. Contenu dans le signifiant double, préposition « dans » et notion de « commencement ». Et pour Samson Raphaël
Hirsch, il s’agissait au contraire d’un « temps initial » (p. 109). Comme c’est le récit de la création du monde, la valeur cosmogonique est celle que je retiens.
Le monde dépend de la grammaire. « le ciel », hachchamaïm — « ciel » pour chamaïm, et pas « cieux », ce pluriel dit littéraire, parce qu’en hébreu il n’y a que la forme plurielle, qui ne s’oppose pas à un singulier. Non-marqué pour non-marqué. Tous les traducteurs disent « le ciel », sauf Ostervald, Segond, Dhorme, Fleg : « les cieux » ; et Chouraqui « les ciels » — terme de peinture en français. L’étymologie populaire voit dans ce mot le feu, ecb, et l’eau, maïm. De même, maïm, étant un pluriel sans singulier, je le rends par « l’eau » et non « les eaux ».
2 — « la terre », badrets. Je réserve « terre » à tirets, et « terre rouge » à adama, qui apparaît au verset 25.
— « vaine/et vide », tóhou/vavóhou. Audiblemenr un couple prosodique, en même temps que l’informe primordial. Le sens n’est ici que l’infirme du continu. Le Maistre de Sacy : « La terre était informe et toute nue ». Cahen « informe et en désordre » ; Ostervald, Segond : « informe et vide », Dhorme et la TOB « déserte et vide » ; le Rabbinat : « n’était que solitude et chaos » ; Grosjean : « sans forme et vide ». Seuls Fleg (« flot et chaos ») et la Bible de Jérusalem (.« vide et vague ») ont tenté de retrouver le couplage. Et Buber : « Irrsal und Wirrsal ». Chouraqui a simplement transcrit : « la terre était tohu-et-bohu », avec une note qui suggère que c’étaient des « noms de divinités du chaos primordial ? », ce que n’appuient guère les commentaires — et surtout l’expression fait contresens en français. Dans une première version je traduisais « boue et trouble ».
— « et l’ombre », ve’hOcheckh. Phrase nominale. J’ai choisi ombre pour la motivation colorée de sa voyelle. Les autres font des variations sur ténèbres : « les ténèbres couvraient » (Le Maistre de Sacy, la Bible de Jérusalem), « des ténèbres couvraient » (le Rabbinat), « il y avait des ténèbres » (Segond, Dhorme), « les ténèbres étaient à la surface » (Ostervald), « les ténèbres étaient sur la surface » (Cahen, Grosjean). Et ténèbre au singulier, propre à l’écriture artiste : « et la ténèbre à la surface » (TOB), « et ténèbre sur la face » (Fleg), « une ténèbre sur les faces » (Chouraqui),
— « gouffre », tehom — l’eau primordiale. Tous ont « l’abîme ». Seul Fleg, « gouffre ».
_ - « couve », mera’héfet. Participe présent de ra’haf. Rachi compare le souffle de Dieu à une « colombe planant au-dessus du nid [...]
3 — « et il y a eu la lumière », vayehi or. J’ai choisi le passé composé parce qu’il implique le conrinu du passé ancien au temps de celui qui parle. Le passé simple dit du révolu — or la lumière est toujours là, depuis. Passé simple chez Le Maistre de Sacy : « et la lumière fut faite » ; Ostervald, Cahen, Segond, le Rabbinat, la Bible de Jérusalem, la TOB : « et la lumière fut » ; Fleg : « et fut la lumière », Dhorme : « et il y eut de la lumière ». Grosjean seul a le passé continu au présent : « et il y a eu de la lumière ». Chouraqui a le présenr : « et c’est une lumière » - ce qui efface la valeur aspectuelle.
4 — « et Dieu a vu/la lumière/c’est bien », vayare elohim/ et-ahor/kitov. Double complément : il voit la lumière et il voit qu’elle est bonne. Deux momenrs successifs. La traduction courante les ramasse en un : « Et Dieu vit que la lumière était bonne » (Ostervald) - modèle de Le Maistre de Sacy, Segond, le Rabbinat, Dhorme, la Bible de Jérusalem, la TOB, Grosjean. Seuls Fleg et Chouraqui onr voulu transposer la syntaxe à deux temps ici de l’hébreu. Mais Fleg au prix d’un vulgarisme qui verse dans le comique involontaire : « Et Dieu vit la lumière, qu’elle est bonne » ; Chouraqui en forçant le tour vers un exclamatif : « Elohim voit la lumière : quel bien ! »
En 1973, j’avais traduit tóhou vavóhou par « boue et remous ». Je m’étais fondé à l’époque sur des récits akkadiens et babyloniens. J’ai préféré, après lecture de tous les commentaires, « vaine et vide », pour le couplage et plus proche du sens, car il fallait rendre la notion de vide.
En 1535, Olivétan est le premier traducteur de la Bible en français à partir de l’hébreu. Jusqu’alors, tous avaient traduit à partir du latin. Mais traduire à partir l’hébreu ne suffit pas. Encore faut-il répondre au défi poétique. Olivétan dit : « indisposée et vide ». Le latin donne : « terra autem erat inanis et vacua ».
Philippe Sollers. — Vous traduisez par « vaine et vide ». Cette traduction tient bien. « Vaine » : le Waste land de T. S. Eliot, la terre vaine.
Henri Meschonnic. — Il y a d’autres tentatives du même ordre. Dans la Bible de Jérusalem, on, trouve « vide et vague ». Il y a une infinité de manières d’échouer et une infinité de manières de réussir, jamais une seule solution. Il faut faire en sorte que le programme de traduction contienne la prosodie et le rythme. Inanis et vacua ne donne que le sens des mots. L’autre problème est celui de la fin du premier jour, rom e’had, que je traduis par « jour un » et non pas par « premier jour ». Le signifiant est bien un adjectif cardinal et non pas ordinal. En revanche, dans la suite du texte, on a bien : deuxième, troisième, etc. J’ai suivi le commentaire célèbre de Rachi, du XIe siècle. Je ne fais pas mienne son explication, mais il justifie l’adjectif cardinal par le fait qu’au début Dieu est seul dans son univers.
Philippe Sollers. — C’est tout à fait juste.
Henri Meschonnic. — Mais c’est aussi parce que, au moment où cela se passe, la série n’a pas encore commencé. Cela ne peut donc pas être traduit par « premier ».
C’est le jour un. La plupart des traductions ont traduit par l’adjectif ordinal. Au verset 5, Lemaistre de Sacy : « et du soir et du matin se fit le premier jour ». Ils ont tous traduit par « premier jour ».
Philippe Sollers. — Ils sont très pressés qu’il y en ait d’autres.
Henri Meschonnic. — Oui. Mais pour le sixième jour, c’est une autre syntaxe qui se présente et j’ai traduit par « Jour, le sixième ». Il faut reconnaître que tout ce début n’est pas du langage ordinaire. C’est une cosmogonie. C’est une syntaxe très simple, par rapport à celle des Gloires. Mais le problème poétique est ailleurs, il est celui de l’atmosphère du divin. Je crois qu’elle est perdue avec la traduction de Jean Grosjean, qui en fait du français ordinaire, même si je comprends très bien pourquoi Jean Grosjean traduit ainsi : « C’était le premier jour », en ponctuant avec des « et voilà. »
Philippe Sollers. — Il y a là une dé-divinisation très grande. Cela me fait penser à quelqu’un, le vieux Joseph Haydn. Beethoven dirige son oeuvre La Création. Quand tout le monde s’est mis debout pour applaudir, il a levé les bras au ciel pour signifier que cela venait de là-haut.
En 1535, Olivétan est le premier traducteur de la Bible en français à partir de l’hébreu. Jusqu’alors, tous avaient traduit à partir du latin. Mais traduire à partir l’hébreu ne suffit pas. Encore faut-il répondre au défi poétique. Olivétan dit : « indisposée et vide ». Le latin donne : « terra autem erat inanis et vacua ».
Philippe Sollers. — Vous traduisez par « vaine et vide ». Cette traduction tient bien. « Vaine » : le Waste land de T. S. Eliot, la terre vaine.
Henri Meschonnic. — Il y a d’autres tentatives du même ordre. Dans la Bible de Jérusalem, on, trouve « vide et vague ». Il y a une infinité de manières d’échouer et une infinité de manières de réussir, jamais une seule solution. Il faut faire en sorte que le programme de traduction contienne la prosodie et le rythme. Inanis et vacua ne donne que le sens des mots. L’autre problème est celui de la fin du premier jour, rom e’had, que je traduis par « jour un » et non pas par « premier jour ». Le signifiant est bien un adjectif cardinal et non pas ordinal. En revanche, dans la suite du texte, on a bien : deuxième, troisième, etc. J’ai suivi le commentaire célèbre de Rachi, du XIe siècle. Je ne fais pas mienne son explication, mais il justifie l’adjectif cardinal par le fait qu’au début Dieu est seul dans son univers.
Philippe Sollers. — C’est tout à fait juste.
Henri Meschonnic. — Mais c’est aussi parce que, au moment où cela se passe, la série n’a pas encore commencé. Cela ne peut donc pas être traduit par « premier ».
C’est le jour un. La plupart des traductions ont traduit par l’adjectif ordinal. Au verset 5, Lemaistre de Sacy : « et du soir et du matin se fit le premier jour ». Ils ont tous traduit par « premier jour ».
Philippe Sollers. — Ils sont très pressés qu’il y en ait d’autres.
Henri Meschonnic. — Oui. Mais pour le sixième jour, c’est une autre syntaxe qui se présente et j’ai traduit par « Jour, le sixième ». Il faut reconnaître que tout ce début n’est pas du langage ordinaire. C’est une cosmogonie. C’est une syntaxe très simple, par rapport à celle des Gloires. Mais le problème poétique est ailleurs, il est celui de l’atmosphère du divin. Je crois qu’elle est perdue avec la traduction de Jean Grosjean, qui en fait du français ordinaire, même si je comprends très bien pourquoi Jean Grosjean traduit ainsi : « C’était le premier jour », en ponctuant avec des « et voilà. »
Philippe Sollers. — Il y a là une dé-divinisation très grande. Cela me fait penser à quelqu’un, le vieux Joseph Haydn. Beethoven dirige son oeuvre La Création. Quand tout le monde s’est mis debout pour applaudir, il a levé les bras au ciel pour signifier que cela venait de là-haut.
Le psaume 133 commence en chanson et est devenu une chanson populaire israélienne : « Vois qu’il est bon et qu’il est doux d’être frères aussi ensemble. » Il faut voir comment d’autres traducteurs s’y sont exercés. Ce n’est pas par arrogance ou par mauvais esprit, mais pour montrer que la petite symétrie, qui ressemblait déjà à une chansonnette, a disparu. Lemaistre de Sacy : « Ah ! que c’est une chose bonne et agréable que les frères soient unis ensemble. » C’est une phrase en prose. Il n’y a pas de métrique, mais c’est une autre rythmique. Ostervald : « Oh ! qu’il est bon et qu’il est doux que des frères demeurent unis ensemble. » Samuel Cahen : « Qu’il est beau, qu’il est agréable lorsque des frères demeurent ensemble ! », Le sens est toujours le même, mais la rythmique est tout autre. Segond : « Voici Ô qu’il est agréable, qu’il est doux de demeurer ensemble ». Le Rabbinat : « Ah ! qu’il est bon, qu’il est doux à des frères de vivre dans une étroite union ». La Bible de Jérusalem : « Voyez ! qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble ».
la Bible
le livre des écrivains
Texte fondateur de trois monothéismes révélés judaïsme, christianisme et islam — la Bible apparaît depuis le Moyen Âge comme le « Livre ». Matrice originelle de la littérature et de l’art en Occident, elle est source inépuisable d’images, de symboles, d’archétypes, mais aussi de formes narratives ou poétiques. La Bible représente, inspire, transmet bien au-delà de la croyance qu’elle établit et affirme. C’est cet « au-delà » qu’explorent aujourd’hui des écrivains venus d’horizons très divers : « au-delà » de la mort et du silence de Dieu, « au-delà » de la foi que les rédacteurs du texte biblique cherchaient à transmettre ; la Bible, dans sa langue forte et souvent violente, s’approche plus que tout autre de ce « sacré » que les êtres humains cherchent à atteindre même lorsqu’ils ne se déclarent plus croyants. Des écrivains se sont attachés à revenir aux sources, à apprendre l’araméen pour traduire le texte dont ils nourrissent leur propre travail d’écriture. Autant d’approches nouvelles de la Bible dont ce dossier La Bible, le livre des écrivains.
Le Magazine littéraire N°448, décembre 2005.
Dossier coordonné par Arlette Armel
Le même verbe peut signifier « habiter », « être assis », ou bien « être » tout simplement. Dhorme : « Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères d’habiter ensemble », Chouraqui : « Voici ! quel bien, quel agrément, d’habiter, frères, unis ainsi ! »
Benoît Chantre. — Redonnez-nous Meschonnic, que nous l’ayons en tête...
Philippe Sollers. — « Vois qu’il est bon / et qu’il est doux /// d’être frères aussi ensemble. » On peut être frères sans être aussi ensemble et sans habiter ensemble — [on peut se souvenir des père de Sollers : deux frères ont épousés deux soeurs et vivent dans des maisons contigües et symétriques...]
Henri Meschonnic. — L’essentiel, en l’occurrence, c’était deux choses : d’être frères, et d’être ensemble. Le problème ne résidait pas dans le sens. Bien des traducteurs savent l’hébreu certainement mieux que moi. Ce n’est pas un problème de langue, c’est un problème de rythme et de mode de signifier.
*
Quel tohu-bohu ?
Prenez le début de la Genèse. Ce ne sont pas les problèmes qui manquent au commencement du monde. Le mot « tohu-bohu », tóhou/vavóhou, est un couplage expressif. Ce n’est pas une onomatopée, cela n’imite rien. On trouve beaucoup d’expressions expressives dans la Bible. Le problème n’est donc pas celui du sens. Étant donné que nous sommes dans le récit d’une cosmogonie, il y a dans chacun des mots qui sont employés là comme une épaisseur de légendaire.
la Bible
le livre des écrivains
Texte fondateur de trois monothéismes révélés judaïsme, christianisme et islam — la Bible apparaît depuis le Moyen Âge comme le « Livre ». Matrice originelle de la littérature et de l’art en Occident, elle est source inépuisable d’images, de symboles, d’archétypes, mais aussi de formes narratives ou poétiques. La Bible représente, inspire, transmet bien au-delà de la croyance qu’elle établit et affirme. C’est cet « au-delà » qu’explorent aujourd’hui des écrivains venus d’horizons très divers : « au-delà » de la mort et du silence de Dieu, « au-delà » de la foi que les rédacteurs du texte biblique cherchaient à transmettre ; la Bible, dans sa langue forte et souvent violente, s’approche plus que tout autre de ce « sacré » que les êtres humains cherchent à atteindre même lorsqu’ils ne se déclarent plus croyants. Des écrivains se sont attachés à revenir aux sources, à apprendre l’araméen pour traduire le texte dont ils nourrissent leur propre travail d’écriture. Autant d’approches nouvelles de la Bible dont ce dossier La Bible, le livre des écrivains.
Le Magazine littéraire N°448, décembre 2005.
Dossier coordonné par Arlette Armel
Le même verbe peut signifier « habiter », « être assis », ou bien « être » tout simplement. Dhorme : « Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères d’habiter ensemble », Chouraqui : « Voici ! quel bien, quel agrément, d’habiter, frères, unis ainsi ! »
Benoît Chantre. — Redonnez-nous Meschonnic, que nous l’ayons en tête...
Philippe Sollers. — « Vois qu’il est bon / et qu’il est doux /// d’être frères aussi ensemble. » On peut être frères sans être aussi ensemble et sans habiter ensemble — [on peut se souvenir des père de Sollers : deux frères ont épousés deux soeurs et vivent dans des maisons contigües et symétriques...]
Henri Meschonnic. — L’essentiel, en l’occurrence, c’était deux choses : d’être frères, et d’être ensemble. Le problème ne résidait pas dans le sens. Bien des traducteurs savent l’hébreu certainement mieux que moi. Ce n’est pas un problème de langue, c’est un problème de rythme et de mode de signifier.
*
Quel tohu-bohu ?
Prenez le début de la Genèse. Ce ne sont pas les problèmes qui manquent au commencement du monde. Le mot « tohu-bohu », tóhou/vavóhou, est un couplage expressif. Ce n’est pas une onomatopée, cela n’imite rien. On trouve beaucoup d’expressions expressives dans la Bible. Le problème n’est donc pas celui du sens. Étant donné que nous sommes dans le récit d’une cosmogonie, il y a dans chacun des mots qui sont employés là comme une épaisseur de légendaire.
Mais ces habitudes de pensée font des pense-petit. Ce sont tous les effets en chaîne de ce que les linguistes appellent le signe, la série de ses dualismes : du son et du sens, pour les mots, ou du signifiant et du signifié (il n’y a que la terminologie qui change), de la forme et du contenu, de la chair et de l’esprit, de l’oral et de l’écrit (la vive voix et la lettre qui tue ou qui est morte), du langage poétique opposé au langage ordinaire, de la séparation entre l’affect et le concept comme entre l’individu et la société, entre l’identité et l’altérité, et finalement entre le langage et la vie. C’est la régie culturelle du discontinu, son anthropologie de la totalité.
On ne pense pas assez que sur le langage Saussure a montré qu’il n’y a que des points de vue. Le signe est donné et enseigné comme la nature - la vérité - du langage. Par lui-même, et dans ses limites, qu’il ne montre pas, puisqu’il se donne pour le langage, il n’est qu’une représentation du langage, avec son histoire, et ses limites.
De même que quand on croit opposer le langage et la vie (ce que fait toute une tradition, y compris Bergson avec son vitalisme), on ne sait pas qu’on oppose une représentation du langage à une représentation de la vie. J’y reviens plus loin.
Penser l’interaction langage-poème-art-éthique-politique permet de sortir de l’anthropologie de la totalité que produit le signe, dans la série de ses discontinus, pour penser le continu, et l’infini.
On peut alors lire autrement que selon les moyens jusqu’ici coutumiers ce qui a lieu chez un certain nombre de philosophes, et particulièrement chez Heidegger, hors des vulgarités de pensée, et penser, repenser, hors des catégories toutes faites et installées culturellement, qui permettent justement les facilités autant du pour que du contre. Qui ne sont pas symétriques. Celles du pour donnent dans l’ignoble, celles du contre dans la naïveté.
Si on ne pense pas la théorie du langage, selon l’interaction que j’ai dite, on ne pense pas et on ne sait pas qu’on ne pense pas. On vaque aux affaires courantes.
On ne pense pas assez que sur le langage Saussure a montré qu’il n’y a que des points de vue. Le signe est donné et enseigné comme la nature - la vérité - du langage. Par lui-même, et dans ses limites, qu’il ne montre pas, puisqu’il se donne pour le langage, il n’est qu’une représentation du langage, avec son histoire, et ses limites.
De même que quand on croit opposer le langage et la vie (ce que fait toute une tradition, y compris Bergson avec son vitalisme), on ne sait pas qu’on oppose une représentation du langage à une représentation de la vie. J’y reviens plus loin.
Penser l’interaction langage-poème-art-éthique-politique permet de sortir de l’anthropologie de la totalité que produit le signe, dans la série de ses discontinus, pour penser le continu, et l’infini.
On peut alors lire autrement que selon les moyens jusqu’ici coutumiers ce qui a lieu chez un certain nombre de philosophes, et particulièrement chez Heidegger, hors des vulgarités de pensée, et penser, repenser, hors des catégories toutes faites et installées culturellement, qui permettent justement les facilités autant du pour que du contre. Qui ne sont pas symétriques. Celles du pour donnent dans l’ignoble, celles du contre dans la naïveté.
Si on ne pense pas la théorie du langage, selon l’interaction que j’ai dite, on ne pense pas et on ne sait pas qu’on ne pense pas. On vaque aux affaires courantes.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Henri Meschonnic
Lecteurs de Henri Meschonnic (95)Voir plus
Quiz
Voir plus
Savez-vous la vérité sur l'affaire Harry Quebert ?
Que sont Harry et Marcus ?
père et fils
frères
amis
collègues de travail
24 questions
2486 lecteurs ont répondu
Thème : La Vérité sur l'affaire Harry Quebert de
Joël DickerCréer un quiz sur cet auteur2486 lecteurs ont répondu