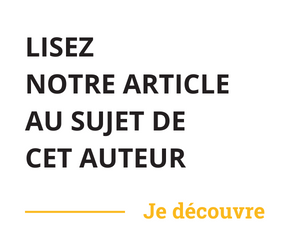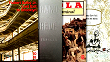Nationalité : Canada
Né(e) à : Chicoutimi, Québec , 1992
Ajouter des informations
Né(e) à : Chicoutimi, Québec , 1992
Biographie :
Kevin Lambert est un écrivain québécois.
Il est diplômé au département de Littératures de langue française de l'Université de Montréal avec une maîtrise en création littéraire et il y poursuit son doctorat en création littéraire. Il a travaillé notamment sur le processus créateur dans l’œuvre de Victor-Lévy Beaulieu.
Il est lauréat du Prix Pierre l'Hérault de la critique émergente 2017 pour son article "Peut-on écrire l'histoire littéraire à rebours?" du roman de Jean Basile "Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile" (paru dans la revue québécoise "Spirale").
En mars 2017, il publie son premier roman, "Tu aimeras ce que as tué". En 2018, lors de la rentrée littéraire québécoise, Kevin Lambert publie son deuxième roman, "Querelle de Roberval" aux éditions Héliotrope. Ce roman est publié en France en août 2019 sous le titre "Querelle" aux éditions Le Nouvel Attila.
En France, "Querelle" obtient le Prix Sade 2019 (ex-æquo avec Christophe Siébert) ; le roman est également finaliste pour le prix littéraire du Monde, finaliste pour le Grand prix du livre de Montréal et a été sélectionné pour le prix Wepler et pour le prix Médicis.
En 2022, il publie "Que notre joie demeure", un troisième roman issu de sa thèse de doctorat. Lambert y décrit le parcours d'une architecte de renommée internationale qui se fait accuser de la gentrification d'un quartier populaire montréalais après avoir accepté d'y réaliser le siège social d'une firme locale.
L'édition française de son roman, "Que notre joie demeure", publié chez Le Nouvel Attila, figure dans la première sélection du prix Goncourt 2023 et reçoit le prix Décembre ainsi que le prix Médicis 2023.
Kevin Lambert est également impliqué dans la scène littéraire québécoise. Il a été libraire à la librairie "Le Port de tête" à Montréal et participe aux revues "Liberté" et "Spirale", ainsi qu’à plusieurs émissions de Radio-Canada.
+ Voir plusKevin Lambert est un écrivain québécois.
Il est diplômé au département de Littératures de langue française de l'Université de Montréal avec une maîtrise en création littéraire et il y poursuit son doctorat en création littéraire. Il a travaillé notamment sur le processus créateur dans l’œuvre de Victor-Lévy Beaulieu.
Il est lauréat du Prix Pierre l'Hérault de la critique émergente 2017 pour son article "Peut-on écrire l'histoire littéraire à rebours?" du roman de Jean Basile "Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile" (paru dans la revue québécoise "Spirale").
En mars 2017, il publie son premier roman, "Tu aimeras ce que as tué". En 2018, lors de la rentrée littéraire québécoise, Kevin Lambert publie son deuxième roman, "Querelle de Roberval" aux éditions Héliotrope. Ce roman est publié en France en août 2019 sous le titre "Querelle" aux éditions Le Nouvel Attila.
En France, "Querelle" obtient le Prix Sade 2019 (ex-æquo avec Christophe Siébert) ; le roman est également finaliste pour le prix littéraire du Monde, finaliste pour le Grand prix du livre de Montréal et a été sélectionné pour le prix Wepler et pour le prix Médicis.
En 2022, il publie "Que notre joie demeure", un troisième roman issu de sa thèse de doctorat. Lambert y décrit le parcours d'une architecte de renommée internationale qui se fait accuser de la gentrification d'un quartier populaire montréalais après avoir accepté d'y réaliser le siège social d'une firme locale.
L'édition française de son roman, "Que notre joie demeure", publié chez Le Nouvel Attila, figure dans la première sélection du prix Goncourt 2023 et reçoit le prix Décembre ainsi que le prix Médicis 2023.
Kevin Lambert est également impliqué dans la scène littéraire québécoise. Il a été libraire à la librairie "Le Port de tête" à Montréal et participe aux revues "Liberté" et "Spirale", ainsi qu’à plusieurs émissions de Radio-Canada.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (15)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans Que notre joie demeure, Kevin Lambert explore la psyché de la classe dirigeante confrontée à la possibilité de perdre pied. Au sommet de leur discipline, ces individus se questionnent sur leurs privilèges et sur la légitimité de leur place dans un monde qu'ils ont contribué à façonner. Avec une prose vive et immersive, l'auteur dévoile les pensées secrètes de ses personnages tout en offrant un portrait clairvoyant de Montréal contemporain.
Podcasts (3)
Voir tous
Citations et extraits (96)
Voir plus
Ajouter une citation
De nos jours, la corruption et la paresse sont les deux seules affaires que le monde ont en tête quand on prononce le mot «syndicat» [...].
Si Proust s’est trompé quelque part, croit-elle, c’est précisément à ce sujet. Il a vu juste sur le passé mais s’est fourvoyé sur l’avenir. Toute la fin de la Recherche laisse planer l’idée d’une décrépitude, d’une déréliction des puissants, la Première Guerre mondiale aurait amorcé la lente agonie des aristocrates et des bourgeois qui se prennent pour des aristocrates, Marcel retrouve ses anciennes connaissances vieillies, maganées par la vie, ils ont perdu leur éclat d’antan, la mort se donne à lire sur les visages, on n’avait pas encore inventé les chirurgies esthétiques à l’époque, aujourd’hui le narrateur aurait retrouvé la Guermantes liftée, la peau lisse comme une vingtenaire, la Verdurin aurait des fesses brésiliennes, Charlus serait accro aux liposuccions, il arborerait fièrement des abdominaux de silicone et des implants pectoraux, le narrateur aurait probablement essayé tous les traitements d’extension du pénis sur le marché, Céline rigole, mais pense sérieusement que Proust s’est fourvoyé en imaginant le déclin d’une classe sociale plus pimpante que jamais. Les millionnaires sont plus nombreux aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été, Céline a vu leur nombre augmenter de manière impressionnante, surtout à Montréal, la ville n’a pas cessé de générer des fortunes, il y avait pas mal moins de riches à ses débuts, que des Anglais au centre-ville ou sur la montagne, Céline a été aux premières loges de l’apparition de richesses neuves, surtout à partir des années 1980, des populations ont commencé à se lancer sans gêne dans l’entrepreneuriat, de nouveaux visages sont apparus, leur argent n’a pas fini de mener le monde. Céline fait partie de la population qui s’est enrichie dans ce contexte favorable. Elle accepte de faire partie du groupe à condition de lui cracher dessus, elle n’adhère à aucune idéologie, à aucune communauté. Son plaisir est de faire rager les autres. Devant Nathan et Pierre-Moïse, Céline prétend mentir pour se divertir, pour se venger de ses ennemis, elle mène une entreprise strictement personnelle, faire chier celles et ceux qui la détestent l’enchante, son vice, ce qu’elle appelle son vice, est tout ce qui lui reste, elle en profite, l’exprime, le raffine. Elle se repaît dans la haine. Des connaissances lui envoient des messages de bêtises, l’accusent de traîtrise, les puissants sont fragiles, ils se sentent persécutés dès qu’on parle d’eux. Elle leur répond par des courriels effrontés, en citant une phrase de Shakespeare: «Hell is empty and all the devils are here. »
Bruegel représente selon Amalia le tissu de pulsions obscures et déroutantes qui travaillent chaque existence et constituent l'arrière-fond véritable de ce qu'on nomme "société", le monde est peuplé d'actes inintelligibles, une multitude d'existences inconnues vivent à leur propre rythme, fourmillent sans cohérence, le sens de nos vies, pense Amalia, ressemble à une course erratique vers une destination toujours changeante, nous vivons comme l'a montré Bruegel dans un théâtre aux gestes incompréhensibles, nos trajectoires rencontrent des bouleversements inimaginables, de violents surgissements dans nos vies régies par des rituels arbitraires. (p.330-331, Le Nouvel Attila)
S'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que les parasites qui n'en ont que pour leur portefeuille et qui nous gâchent tous la vie (...), c'est les opprimés amoureux de leur oppression, ceux qui sont tellement attachés à leur oppression qu'ils finissent par craindre que la domination disparaisse et qu'ils n'aient plus rien à dire. (p.291, Le Nouvel Attila)
Protégez-les, protégez-les des assauts qui leur sont portés, faites que nos bastions tiennent, que notre tendresse l'emporte sur les vilenies, faites que la beauté règne, protégez-nous, ô que notre joie demeure !
Un militant ne lit rien qui puisse mettre au défi sa vision simpliste du monde, surtout pas de littérature, trop affamé qu'il est de comptes rendus schématiques de l'expérience humaine, de rapports sociaux manichéens, les films les plus populaires aujourd'hui ne mettent-ils pas en scène des luttes héroïques contre les "forces du Mal" ? (p.232, Le Nouvel Attila)
Pierre-Moïse connait bien ce sentiment, personne ne vous demande de n’être ni trop gai ni trop noir, du moins pas directement, c’est une attente invisible, suivie d’un réflexe de survie qui pousse à rentrer dans le rang…
(Héliotrope, p.205)
(Héliotrope, p.205)
Marielle observe les œuvres d’art magnifiques, les tapis parfaitement entretenus, les sofas chics, les moulures anciennes et elle ne peut s’empêcher de croire que le secret des grandes fortunes est un crime oublié parce qu’il a été proprement fait.
(Héliotrope, p.274)
(Héliotrope, p.274)
Ce que nous portons en nous est trop grand et le monde est trop petit. La destruction est notre manière de bâtir.
Pour faire chier toutes les infirmières, tous les animateurs de pastorale qui venaient leur conter des peurs dans les classes de l’école secondaire, ils cultivent leur contagion. Ils ignorent quel virus flotte parmi leurs globules rouges et les essouffle, ils refusent de connaître le nom de la maladie qui les tuera peut-être, ils la vénèrent avec un respect distant, s’assurent de la porter fièrement en s’embrassant profond, en s’échangeant le sperme que le troisième fait lécher au bout de son majeur après avoir injecté dans l’anus du deuxième son doux poison. Parce qu’ils sont toxiques, les boys seront jamais aussi nuls que leurs parents, aussi pétasses que leurs cousines, aussi salauds que leurs grands frères. La maladie donne un sens à leurs baises, ils sont piégés, mortels; ils auront toujours cette arme contre les pulsions des vieillards de taverne qui, après leurs bouteilles de Wildcat, font rarement la différence entre les petits culs à branlette de la page centrale du Allô Police et celui du deuxième, venu ouvrir ses jambes dans la salle des machines à sous.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Kevin Lambert
Lecteurs de Kevin Lambert (656)Voir plus
Quiz
Voir plus
La vie devant soi quizz facile
Dans quelle ville se passe cette histoire ?
Marseille
Lyon
Paris
Toulouse
10 questions
495 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur495 lecteurs ont répondu