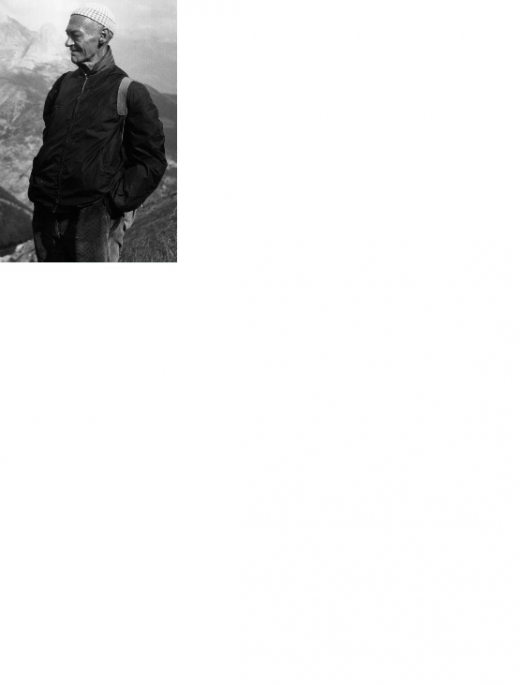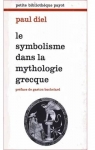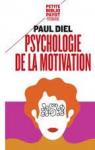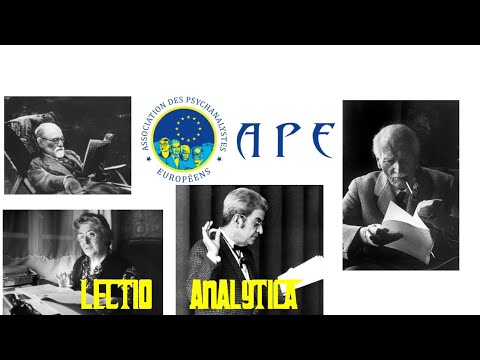Nationalité : France
Né(e) à : Vienne , le 11/07/1893
Mort(e) à : Paris , le 05/01/1972
Né(e) à : Vienne , le 11/07/1893
Mort(e) à : Paris , le 05/01/1972
Biographie :
Paul Diel, né à Vienne de mère allemande et de père inconnu , était un psychologue français d'origine autrichienne, philosophe de formation.
Notamment connu pour avoir fondé la psychologie de la motivation, qui est une théorie psychologique complète, il travailla beaucoup sur le symbolisme dans la mythologie grecque et les textes bibliques mais aussi sur l'éducation. Allant à contre courant de la psychologie officielle de son époque, Diel avec ténacité réhabilitera l'introspection en montrant qu'elle est une fonction naturelle dont la maturation donne son sens à l'évolution humaine (La peur et l'angoisse,1954).
Il fut acteur, romancier, poète avant de se tourner définitivement vers la psychologie. Ses travaux sont remarqués dès 1935 notamment par Einstein.
Diel va se réfugier en France en 1938 où il sera par la suite interné dans le camp de Gurs au Sud de la France en raison de sa nationalité étrangère. Après la libération en 1945, grâce aux recommandations d'Einstein et d'Irène Joliot-Curie, il entrera au CNRS comme psychothérapeute dans le laboratoire de psychologie de l'enfant dirigé par le bio-psychologue Henri Wallon.
Ses travaux sont actuellement poursuivis par l'Association de la Psychologie de la Motivation créée par Paul Diel en 1964 et par l'Association de Psychanalyse Introspective créée en 1994 par Jeanine Solotareff et Jacques de Saint-Georges.
+ Voir plusPaul Diel, né à Vienne de mère allemande et de père inconnu , était un psychologue français d'origine autrichienne, philosophe de formation.
Notamment connu pour avoir fondé la psychologie de la motivation, qui est une théorie psychologique complète, il travailla beaucoup sur le symbolisme dans la mythologie grecque et les textes bibliques mais aussi sur l'éducation. Allant à contre courant de la psychologie officielle de son époque, Diel avec ténacité réhabilitera l'introspection en montrant qu'elle est une fonction naturelle dont la maturation donne son sens à l'évolution humaine (La peur et l'angoisse,1954).
Il fut acteur, romancier, poète avant de se tourner définitivement vers la psychologie. Ses travaux sont remarqués dès 1935 notamment par Einstein.
Diel va se réfugier en France en 1938 où il sera par la suite interné dans le camp de Gurs au Sud de la France en raison de sa nationalité étrangère. Après la libération en 1945, grâce aux recommandations d'Einstein et d'Irène Joliot-Curie, il entrera au CNRS comme psychothérapeute dans le laboratoire de psychologie de l'enfant dirigé par le bio-psychologue Henri Wallon.
Ses travaux sont actuellement poursuivis par l'Association de la Psychologie de la Motivation créée par Paul Diel en 1964 et par l'Association de Psychanalyse Introspective créée en 1994 par Jeanine Solotareff et Jacques de Saint-Georges.
Source : Wikipédia
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Lectio Analytica - Paul Diel el le symbolisme de la mythologie grecque Association des Psychanalystes Européens
Citations et extraits (42)
Voir plus
Ajouter une citation
Le danger monstrueux dont parlent les mythes est la stagnation involutive. Le monstre, symboliquement représenté comme menace extérieure, est à la vérité le péril essentiel qui réside dans la psyché : l’imagination exaltée à l’égard de soi : la vanité. Elle incite à se croire la réalisation parfaite du sens évolutif. La vanité est la déformation de l’esprit par excellence. Elle est le contraire de la lucidité : l’aveuglement à l’égard de ses fautes.
La vaniteuse justification de soi, source d’actions coupables, est le mal secret qui ronge la vie, le monstre mythique qui ravage le monde et qui détruit les âmes (qui dévore les hommes). L’homme qui ose attaque ce monstre est, mythiquement parlant, le héros. Il ne vaincra pas sans être investi des armes symboliquement prêtées par la « divinité » et qui, pour être efficaces, ne peuvent être que clairement spirituelles à l’égard des motifs (contraire du refoulement vaniteux) et sa résultante, la pureté de l’activité (contraire de l’action coupable). Ainsi compris, le combat héroïque, symboliquement concentré dans les mythes en une confrontation unique avec le monstre, est à la vérité une lutte dont les péripéties s’étendent sur toute la vie de l’homme, et même sur la vie de tous les hommes, sur la vie tout court. Le héros mythique — selon la signification la plus profonde de son combat contre le monstre — est le représentant de la poussée évolutive, la personnification de l’élan spiritualisant. L’esprit idéalisé, la « divinité », devient — sur le plan symbolique — son père mythique dont il est le « fils » et l’ « envoyé ».
Ainsi, les mythes — prescience psychologique — ne contiennent pas seulement une compréhension du fonctionnement évolutif et involutif de la psyché, mais encore l’avertissement d’une lutte contre l’involution que l’homme, pour son propre bien essentiel, doit mener, afin de trouver la satisfaction, sens de la vie.
Ainsi, les mythes — prescience psychologique — ne contiennent pas seulement une compréhension du fonctionnement évolutif et involutif de la psyché, mais encore l’avertissement d’une lutte contre l’involution que l’homme, pour son propre bien essentiel, doit mener, afin de trouver la satisfaction, sens de la vie.
La justice inhérente à la vie ne peut être, ni surconsciemment prévue, ni consciemment comprise, sans que naisse dans la psyché humaine un sentiment d’effroi sacré, inspiré par la profondeur mystérieuse de l’existence évolutive et de la légalité qui la gouverne. C’est le sentiment religieux. La vision mythique a exprimé l’effroi sacré. Elle en personnifie la justice inhérente et en développe la légalité morale à partir de l’image personnifiante : « Divinité ».
Du sens de la vie découle la tâche sensée. L’âme prélogique l’aurait représentée par une image énigmatique. Trop facilement mécomprise, cette image, transformée en imagination exaltée, incite à croire que le sens de la vie ne peut se trouver qu’en dehors de la vie. La tâche sensée devient ainsi un devoir insensé, un moralisme opposé à la nature, imaginé comme suspendu dans les nuages, et qui n’inspire que crainte ou raillerie. Sera-t-il possible qu’un jour vienne où, devenue consciente d’elle-même et de son image, comprenant la secrète logique de la vie, la psyché créera une psychologie de la vie, réconciliant la morale avec la nature ?
L’art, lorsqu’il s’attache à son vrai but qui est de peindre l’image véridique de la vie, n’est qu’une prolongation de la vérité mythique, une illustration diffuse de la vérité concentrée dans les symboles mythiques.
Comprendre la pensée symbolique serait la seule solution pour tant d’esprits qui s’égarent, soit dans la croyance aux images, soit dans la dérision des images. La réconciliation entre les matérialistes, qui dénient toute signification au symbole mythique de la divinité, et les spiritualistes qui le considèrent comme une réalité, ne pourra se faire qu’autour de la compréhension du symbolisme. Cela implique de savoir que les symboles mythiques représentent des fonctions psychiques et que l’histoire mythique est une description extrêmement précise et nuancée du fonctionnement de la psyché. Seule une recherche méthodique permettrait de sortir de cette imprécision antiscientifique dans laquelle se trouvent actuellement les esprits qui s’appuient sur des théories psychologiques dépourvues de fondement biogénétique. L’homme de notre époque scientifique est, quant à sa vie intérieure, en grande partie sous l’emprise de croyances, autant dire : de superstitions, qu’elles soient spiritualistes ou matérialistes. Ayant perdu la compréhension surconsciente du symbolisme mythique, il risque de régresser jusqu’à une vision simpliste du monde, éliminant la dimension mystérieuse de la vie et son sens biologiquement immanent. L’effort pour comprendre le sens de la vie est voué à l’échec tant qu’on ne peut saisir toute la portée et l’importance de la pensée symbolique jusque dans la vie quotidienne où rêveries et symptômes psychopathiques se manifestent dans leur langage spécifique.
Faisant un détour par l’explication conceptuelle, la véritable compréhension des images symboliques reconduit à l’émotion qui fut à la source de ces symboles d’une si étonnante beauté et d’une compréhension si profonde de la vie et de son sens.
Faisant un détour par l’explication conceptuelle, la véritable compréhension des images symboliques reconduit à l’émotion qui fut à la source de ces symboles d’une si étonnante beauté et d’une compréhension si profonde de la vie et de son sens.
Dans le mythe chrétien, l’image du vin est employée dans sa signification positive ; il symbolise le sang, lui-même symbole de l’âme et de son expression spécifique, l’amour pour l’essentiel. Symboliquement, l’eau peut être esprit positif, la vérité qui coule de source, mais elle ne serait pas alors en opposition au vin. À Cana, l’eau a donc une signification négative ; de goût fade et sans saveur, elle symbolise la platitude de l’esprit. C’est donc l’esprit banal (l’eau) qui anime les convives et va se trouver transformée en enthousiasme spirituel (vin).
[…]
L’eau est donc changée en vin. La fadeur des conventions moralisantes est, grâce à la parole que Jésus dispense à ses auditeurs, remplacée par la nourriture de l’âme, capable de réveiller l’enthousiasme spirituel. L’homme Jésus, par son enseignement, se donne sans réserve, offrant son âme (vin) et réveillant de l’endormissement conventionnel l’âme de ceux qui l’écoutent.
[…]
L’eau est donc changée en vin. La fadeur des conventions moralisantes est, grâce à la parole que Jésus dispense à ses auditeurs, remplacée par la nourriture de l’âme, capable de réveiller l’enthousiasme spirituel. L’homme Jésus, par son enseignement, se donne sans réserve, offrant son âme (vin) et réveillant de l’endormissement conventionnel l’âme de ceux qui l’écoutent.
La lucidité consiste à démasquer les faux motifs subconscients afin d’assainir le psychisme et de lui permettre de trouver la joie, symbolisée par le « ciel » dans le mythe chrétien, par le nirvana dans le mythe hindou.
La connaissance du fonctionnement psychique s’acquiert donc introspectivement, et seulement ainsi, car aucune observation établie de l’extérieur ne peut permettre de conclure avec certitude sur les intentions profondes qui régissent la délibération intime.
Comment serait-il possible de parler d’un message mythique, qu’il soit païen ou chrétien (qui douterait que l’Évangile en soit un ?), jailli de l’âme humaine, sans connaître avec suffisamment de précision les sommets de l’âme humaine ? Mais comment serait-il possible de parler du message évangélique, refusé dans sa véritable signification par la quasi-totalité des hommes, sans connaître les abîmes de l’âme humaine ?
Ce qui s’oppose à cette proposition d’investigation du psychisme est la convention généralement admise que l’introspection apporte avec elle la morbidité. Or, l’introspection lucide, quoiqu’intuitive, est un phénomène naturel. Jésus et Bouddha se sont montrés des introspecteurs particulièrement lucides. L’introspection peut devenir méthodique lorsqu’elle est capable de trouver tous les liens analogiques liant l’ensemble des manifestations psychiques surconscientes et subconscientes et lorsqu’elle aboutit à définir les lois qui régissent la transformation des motifs surconscients en motifs subconscients et celle des motifs subconscients en motifs surconscients.
[…]
La condition préalable au déchiffrement des mythes est donc une connaissance rigoureuse, et jusque dans les moindres détails, non seulement des fonctions psychiques, mais de leur dynamisme, c’est-à-dire des lois qui régissent leur fonctionnement et leurs rapports.
[…]
La connaissance précise et détaillée du fonctionnement psychique, en permettant d’éclairer d’un façon évidente et cohérente l’énigme des mythes, montre que les mythes ont originairement la capacité d’exprimer le fonctionnement du psychisme humain et son dynamisme délibérant. Le mythe est donc une prescience du fonctionnement psychique.
La connaissance du fonctionnement psychique s’acquiert donc introspectivement, et seulement ainsi, car aucune observation établie de l’extérieur ne peut permettre de conclure avec certitude sur les intentions profondes qui régissent la délibération intime.
Comment serait-il possible de parler d’un message mythique, qu’il soit païen ou chrétien (qui douterait que l’Évangile en soit un ?), jailli de l’âme humaine, sans connaître avec suffisamment de précision les sommets de l’âme humaine ? Mais comment serait-il possible de parler du message évangélique, refusé dans sa véritable signification par la quasi-totalité des hommes, sans connaître les abîmes de l’âme humaine ?
Ce qui s’oppose à cette proposition d’investigation du psychisme est la convention généralement admise que l’introspection apporte avec elle la morbidité. Or, l’introspection lucide, quoiqu’intuitive, est un phénomène naturel. Jésus et Bouddha se sont montrés des introspecteurs particulièrement lucides. L’introspection peut devenir méthodique lorsqu’elle est capable de trouver tous les liens analogiques liant l’ensemble des manifestations psychiques surconscientes et subconscientes et lorsqu’elle aboutit à définir les lois qui régissent la transformation des motifs surconscients en motifs subconscients et celle des motifs subconscients en motifs surconscients.
[…]
La condition préalable au déchiffrement des mythes est donc une connaissance rigoureuse, et jusque dans les moindres détails, non seulement des fonctions psychiques, mais de leur dynamisme, c’est-à-dire des lois qui régissent leur fonctionnement et leurs rapports.
[…]
La connaissance précise et détaillée du fonctionnement psychique, en permettant d’éclairer d’un façon évidente et cohérente l’énigme des mythes, montre que les mythes ont originairement la capacité d’exprimer le fonctionnement du psychisme humain et son dynamisme délibérant. Le mythe est donc une prescience du fonctionnement psychique.
Tristesse et gaieté sont des sentiments dus au penchant du tempérament et déclenchés accidentellement par l'évènement extérieur. Angoisse et joie par contre sont des états d'âme durables. Elles indiquent la valeur ou la non-valeur vitale de l'individu, car elles sont essentiellement consécutives à la nature positive ou négative du travail intrapsychique.
Vivre, c'est sentir. Sentir c'est osciller entre un état d'insatisfaction et un état de satisfaction. Ces états opposés se manifestent au niveau humain sous la forme de sentiments clairement différenciés : angoisse et joie.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le regard de Méduse
Pecosa
56 livres

Le monde Grec
tourniereric2002
42 livres
Auteurs proches de Paul Diel
Lecteurs de Paul Diel (98)Voir plus
Quiz
Voir plus
Brel et les femmes ... en chansons
Ma mère arrête tes prières Ton Jacques retourne en enfer …....... m'est revenue Bougnat apporte-nous du vin Celui des noces et des festins …........ m'est revenue Toi la servante toi la Maria Va tendre mon grand lit de draps …....... m'est revenue Amis ne comptez plus sur moi Je crache au ciel encore une fois Ma belle …...... puisque te v'là te v'là
Clotilde
Mathilde
Brunhilde
Bathilde
11 questions
168 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chanson
, poésie
, jacques brelCréer un quiz sur cet auteur168 lecteurs ont répondu