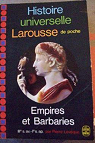Nationalité : France
Né(e) à : Chambéry , le 11/08/1921
Mort(e) à : Paris , le 05/03/2004
Né(e) à : Chambéry , le 11/08/1921
Mort(e) à : Paris , le 05/03/2004
Biographie :
Pierre Lévêque, né à Chambéry le 11 août 1921 et décédé le 5 mars 2004, est un historien de la Grèce antique et helléniste.
Fils d'un ingénieur, il passe son enfance dans le port de Bordeaux. La lecture de La Cité grecque de Gustave Glotz le pousse vers des études littéraires : il est reçu en 1940 à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm puis à l'agrégation de lettres en 1944. Membre de l'École française d'Athènes de 1947 à 1952, il étudie en Grèce la statuaire archaïque de Délos et fouille le site de Thasos. Il soutient en 1955, sous la direction d'André Aymard, sa thèse majeure, consacrée à Pyrrhus, roi d'Épire — la mineure était consacrée au poète athénien Agathon, sous la direction de Louis Séchan.
Il obtient ensuite un poste d'assistant à la Sorbonne puis à Lyon (1951). Il devient maître de conférences à l'université de Montpellier (1955) avant d'être nommé professeur, en 1957, à l'université de Besançon, où il demeure toute sa carrière. Il y gagne le surnom de « doyen rouge », en raison de son militantisme communiste. Il y crée en 1968 un Centre d'histoire ancienne, devenu ensuite une unité du CNRS sous le nom d'« Analyses des formations sociales de l'Antiquité », puis l'Institut des sciences de l'Antiquité, et en 1970 le Groupe international de recherches sur l'esclavage antique.
+ Voir plusPierre Lévêque, né à Chambéry le 11 août 1921 et décédé le 5 mars 2004, est un historien de la Grèce antique et helléniste.
Fils d'un ingénieur, il passe son enfance dans le port de Bordeaux. La lecture de La Cité grecque de Gustave Glotz le pousse vers des études littéraires : il est reçu en 1940 à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm puis à l'agrégation de lettres en 1944. Membre de l'École française d'Athènes de 1947 à 1952, il étudie en Grèce la statuaire archaïque de Délos et fouille le site de Thasos. Il soutient en 1955, sous la direction d'André Aymard, sa thèse majeure, consacrée à Pyrrhus, roi d'Épire — la mineure était consacrée au poète athénien Agathon, sous la direction de Louis Séchan.
Il obtient ensuite un poste d'assistant à la Sorbonne puis à Lyon (1951). Il devient maître de conférences à l'université de Montpellier (1955) avant d'être nommé professeur, en 1957, à l'université de Besançon, où il demeure toute sa carrière. Il y gagne le surnom de « doyen rouge », en raison de son militantisme communiste. Il y crée en 1968 un Centre d'histoire ancienne, devenu ensuite une unité du CNRS sous le nom d'« Analyses des formations sociales de l'Antiquité », puis l'Institut des sciences de l'Antiquité, et en 1970 le Groupe international de recherches sur l'esclavage antique.
Source : Wikipedia
Ajouter des informations
étiquettes
Video et interviews (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Le bréviaire des tyrans ; 3
Roland AUGUET s'entretient avec l'historien Pierre LEVEQUE à propos des rapports entre la tyrannie et la monarchie . (3ème entretien d'une série de 5). La tyrannie ne disparaît pas avec l'époque hellénistique. Elle est cependant de plus en plus concurrencée par une forme de gouvernement nouvelle, la monarchie hellénistique. à 02'13 : Pierre LEVEQUE évoque les tyrannies qui subsistent....
Citations et extraits (9)
Ajouter une citation
Histoire universelle Larousse de poche (3) : Empires et barbaries IIIe s. av. - Ie s. ap.
Pierre Lévêque
Pierre Lévêque
La puissance romaine se fonde non moins sur l'étendue des territoires annexés, le "Nomen Romanum" qui couvre toute l'Italie centrale, soit environ huit-cent kilomètres carrés. Usant d'une politique habile, et qui fut toujours la leur, les romains n'ont pas accordé le même statut à toutes les terres conquises. Les habitants des colonies romaines, chapelets de postes fortifiés le long des côtes, et des anciennes cités vaincues devenues "Municipe" sont citoyens romains de plein droit et comme tels répartis entre les tribus rustiques.
Cependant certains des habitants des "Municipe" , les "aerarii" sont des citoyens sans droit de suffrage. Les cités du Latium jouissent du droit latin, qui est un droit de cité inférieur aussi octroyé aux colonies latines, peuplées de colons pris dans la basse plèbe ou parmi les alliés.
Les autres alliés ont des statuts très différents les uns des autres selon les clauses du traité par lequel ils se sont remis à Rome, mais ils doivent, en tous cas, d'après les stipulations de ce traité, un contingent déterminé de soldats et parfois de marins et un impôt (le vectigal) qui est comme la location de "l'ager publicus" qui leur a été laissé...
(extrait du chapitre 3 "la puissance romaine)
Cependant certains des habitants des "Municipe" , les "aerarii" sont des citoyens sans droit de suffrage. Les cités du Latium jouissent du droit latin, qui est un droit de cité inférieur aussi octroyé aux colonies latines, peuplées de colons pris dans la basse plèbe ou parmi les alliés.
Les autres alliés ont des statuts très différents les uns des autres selon les clauses du traité par lequel ils se sont remis à Rome, mais ils doivent, en tous cas, d'après les stipulations de ce traité, un contingent déterminé de soldats et parfois de marins et un impôt (le vectigal) qui est comme la location de "l'ager publicus" qui leur a été laissé...
(extrait du chapitre 3 "la puissance romaine)
Histoire universelle Larousse de poche (3) : Empires et barbaries IIIe s. av. - Ie s. ap.
Pierre Lévêque
Pierre Lévêque
L'écrivain grec Pausanias (II° siècle de notre ère) rapporte qu'un certain Euphémos de Carie fut poussé par la tempête bien au delà des colonnes d'Héraclès (détroit de Gibraltar) jusqu'à une île de peaux-rouges à queue de cheval, aux moeurs d'une déplorable lubricité : les Antilles, selon toute vraisemblance.
Comme quoi l'Amérique devrait en fait s'appeler Euphémie !
Un proconsul romain du 1er siècle avant Jésus-Christ reçut en présent de la tribu gauloise des "Boïens" des "indiens" jetés par la mer sur les côtes de Germanie, mais on discute pour savoir si ces malheureux venaient d'Asie ou d'Amérique.
Certains modernes pensent que des celtes ont aussi précédé les vikings et le hardi génois sur les routes de l'Atlantique, au reste sans alléguer comme preuves que de vagues similitudes.....
(extrait de l'avant-propos inséré en début de l'édition de poche parue en 1968)
Comme quoi l'Amérique devrait en fait s'appeler Euphémie !
Un proconsul romain du 1er siècle avant Jésus-Christ reçut en présent de la tribu gauloise des "Boïens" des "indiens" jetés par la mer sur les côtes de Germanie, mais on discute pour savoir si ces malheureux venaient d'Asie ou d'Amérique.
Certains modernes pensent que des celtes ont aussi précédé les vikings et le hardi génois sur les routes de l'Atlantique, au reste sans alléguer comme preuves que de vagues similitudes.....
(extrait de l'avant-propos inséré en début de l'édition de poche parue en 1968)
Dès le premier survol, l'histoire grecque apparaît non comme un développement continu, ainsi que c'est le cas de manière si frappante dans la progressive montée de la puissance romaine, mais comme une succession de pulsations où se révèle un impérialisme tantôt politique et tantôt marchand.
L'Afrique du Nord est très loin d'être entièrement dans la mouvance de Carthage, qui ne domine que la bordure côtière et le bloc compact de son plat pays (en gros la Tunisie actuelle).
Auguste semble bien avoir reçu dès 27 une puissance globale et totale sur l’État, qui fait véritablement de lui un homme à part.
Les Âges Sombres sont des siècles de pauvreté et de désordre. Mais peu à peu se constituent des collectivités organisées, les royaumes dits homériques, d'où émergent les cités vers 800. Le monde hellénique connaît alors un second apogée caractérisé par l'expansion coloniale et par d'innombrables créations. (page 47 - Chapitre II)
Vers 2000 avant notre ère, l'arrivée en Grèce des premiers Grecs bouleverse les structures en place. Bientôt, des palais puissamment fortifiés, de riches tombeaux témoignent du remarquable développement et du raffinement de cette nouvelle civilisation palatiale que les rois de Mécènes sortent à son apogée. (page 13 - Chapitre I)
A la fin du VIe siècle, la Grèce connaît une première forme de démocratie. Mais cet élan progressiste, né dans l'Athènes de Clisthène, se heurte à une redoutable épreuve extérieure - les attaques des Grands Rois de Perse, Darius et Xerxès - et à la rivalité chronique entre cités grecques. (page 89 - chapitre III)
Les combats mythiques, ou élevés à la hauteur du mythe comme ceux de l'Iliade, sont bien souvent représentés par les artistes.
Ils symbolisent les affrontements entre cités qui ont si durement marqué la civilisation grecque où la guerre est endémique et où la paix n'est jamais qu'une trêve.
(page 96)
Ils symbolisent les affrontements entre cités qui ont si durement marqué la civilisation grecque où la guerre est endémique et où la paix n'est jamais qu'une trêve.
(page 96)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Lévêque
Lecteurs de Pierre Lévêque (104)Voir plus
Quiz
Voir plus
Livres et Films
Quel livre a inspiré le film "La piel que habito" de Pedro Almodovar ?
'Double peau'
'La mygale'
'La mue du serpent'
'Peau à peau'
10 questions
7093 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Cinéma et littérature
, films
, adaptation
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur cet auteur7093 lecteurs ont répondu