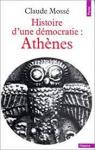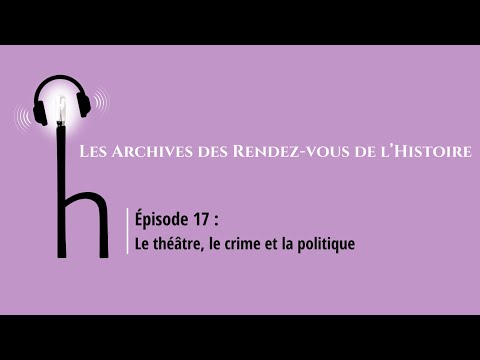Né(e) à : Paris , le 24/12/1924
Mort(e) à : Draveil , le 12/12/2022
Claude Mossé est une historienne française, spécialiste de l'histoire de la Grèce antique.
En 1947, elle fut reçue première à l'agrégation d’histoire, ex-aequo avec Jean Poperen, futur dirigeant du Parti socialiste. La même année, elle est nommée au lycée de jeunes filles de Rennes.
Assistante d'histoire antique à la faculté des lettres de Rennes à partir de 1950, elle est attachée de recherche au CNRS de 1956 à 1958. Elle est nommée maître de conférences à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand en 1959, où elle obtient un doctorat d’État la même année, avec une thèse consacrée au "Déclin de la cité grecque au IVe siècle av. J.-C.".
En octobre 1968, elle s'engage comme professeur dans le projet d'université expérimentale de Vincennes, devenue Université de Paris VIII. Elle y continue sa carrière, jusqu'à l'éméritat.
Elle faisait partie de cette petite équipe de l"'école d'histoire ancienne français" avec Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. Elle a formé des historiens comme Alain Schnapp.
Claude Mossé a écrit une vingtaine d'ouvrages, principalement sur la Grèce classique (Ve siècle av. J.-C. et IVe siècle av. J.-C.) et la période hellénistique (de la fin du IVe siècle av. J.-C. à la conquête romaine).
Elle est également l'auteur d'un roman policier historique, "Meurtres sur l'Agora" (1995), qui se passe à Athènes en 349 avant notre ère. Ses œuvres sont traduites dans différentes langues (anglais, espagnol, allemand, italien).
[PODCAST] Au théâtre, le crime politique trouve son illustration dans la tragédie. de l'antiquité jusqu'à nos jours, les mises en scènes successives dotent les drames d'antan d'un sens nouveau. Retrouvez l'épisode sur toutes les plateformes de podcast : https://urlz.fr/pZag Modérateurs : Sylvain BELLENGER, historien de l'art, alors directeur du château et conservateur des musées De BloisMaurice SARTRE, professeur d'Histoire ancienne à l'université de Tours. Participant·e·s : Gérard FONTAINE, philosophe spécialiste d'esthétique et d'opéra Gildas LE BOTERF, alors directeur de la Scène nationale de la Halle aux grains Claude MOSSÉ, historienne spécialiste de la cité grecque à l'âge classique Anne UBERSFELD, historienne du théâtre Débat issue de la première édition des Rendez-vous de l'histoire, en 1998, sur le thème "Crime et Pouvoir". © Sylvain Bellenger, Gérard Fontaine, Gildas le Boterf, Claude Mossé, Maurice Sartre, Anne Ubersfeld, 1998. Nous cherchons à entrer en contact avec les ayants droit de Gildas le Boterf, Claude Mossé et Anne Ubersfeld : écrivez-nous à l'adresse archives@rdv-histoire.com si vous avez des informations. Voix du générique : Michel Hagnerelle (2006), Michaelle Jean (2016), Michelle Perrot (2002) https://rdv-histoire.com/
Que tout citoyen qui a des vues à proposer sur la législature monte à la tribune."
Le chemin que suivirent les Sumériens pour occuper le sud du pays est en revanche moins connu. Peut-être venaient-ils d'Asie centrale, du Caucase et d'Arménie et sont-ils descendus à travers la Mésopotamie en suivant l'Euphrate et le Tigre, le long desquels on a trouvé, à Assour par exemple, des traces de leur première culture.
C'est à cela sans doute que sont sensibles les hommes d'aujourd'hui, comme l'avaient déjà été ceux qui, à travers les siècles, trouvèrent dans la démocratie athénienne le modèle à opposer à toutes les tyrannies et à toutes les oppressions. La liberté, l'égalité auxquelles les Athéniens attachaient tant de prix, dont ils faisaient le symbole de leur politeia, allaient être les mots d'ordre de tous ceux qui souhaitaient se débarrasser de l'absolutisme monarchique ou de l'oppression étrangère. On sait de quel prestige Athènes jouissait auprès des hommes qui firent la Révolution française. Le XIXè siècle, qui vit triompher en Europe la révolution bourgeoise démocratique, fut aussi celui où les études athéniennes connurent le plus grand développement. Et pour ne parler que de la France, encore dans les premières décennies du XXè siècle, Clemenceau pouvait s'identifier à Démosthène, tandis que l'historien Glotz parlait du "socialisme" de Périclès. Mais précisément le développement des mouvements socialistes allaient porter un coup très dur à la "démocratie" athénienne. Et tandis que les historiens libéraux, pour continuer à défendre Athènes, s'ingéniaient à démontrer que l'esclavage n'y avait jamais connu qu'un faible développement, ceux qui se réclamaient du socialisme (F. Engels, le premier) dénonçaient le caractère parasitaire et oppresseur de la démocratie athénienne, et rejoignaient curieusement dans une même critique de l'Athènes de Périclès et de Démosthène, les partisans des régimes autoritaires.
Peut-on aujourd'hui, en ces années 70 du XXè siècle, où s'écroule un monde que d'aucuns croyaient immuable, où une jeunesse révoltée d'un bout du monde à l'autre conteste la culture "bourgeoise", accorder encore quelque importance aux Athéniens? Et leur histoire peut-elle encore nous apporter quelque enseignement? Il n'est peut-être pas possible de répondre à de telles questions. Il reste que la civilisation qui est née il y a 2000 ans au bord de la mer Égée a su, en moins de deux siècles, élaborer une pensée critique et politique dont les résonances se prolongent jusqu'à nous et que les Athéniens ont leur place dans l'histoire des hommes qui feront le monde de demain.

Polars antiques
Pecosa
37 livres

La bibliothèque d'Alexandre
Oliv
40 livres
« Pour la fin du monde, prends ta valise 🎶 » Facile !!
Un père et son fils errent dans un monde dévasté. Livre de Cormac Mc Carthy, 2006 :
63 lecteurs ont répondu