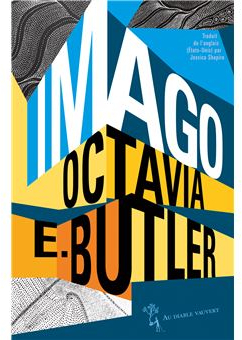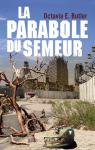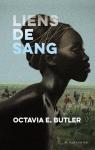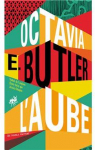Critiques filtrées sur 4 étoiles
En 1989, Octavia Butler met un point final à sa trilogie Xenogenesis avec son ultime volume : Imago. Après L'Aube et L'Initiation, l'autrice américaine replonge dans son étrange univers où le premier contact tourne au jeu de domination entre Humains et Oankalis.
Dans le précédent volume, nous avions pu suivre Akin, un hybride des deux races, et ainsi poser notre regard sur ce qu'il restait des derniers humains refusant le troc génétique proposé par les extra-terrestres.
Ces opposants, loin d'être aussi mauvais qu'on aurait pu le croire de prime abord, arrivent finalement à faire valoir leur point de vue en passant suffisamment de temps avec Akin qui se retrouve lui-même à plaider leur cause en faveur d'une nouvelle société humaine capable de se reproduire et de se gouverner. Mais pour la Terre, c'est déjà trop tard et c'est sur Mars que la nouvelle humanité tentera sa chance.
Quelques années plus tard, Octavia Butler imagine une dernière aventure dans les coins les plus reculés de notre planète en sursis…
Après Lilith et Akin, nous changeons encore de point de vue avec l'arrivée de Jodahs qui fait lui aussi partie de la grande famille déjà présente dans les volumes précédents mais qui a pourtant une particularité bien à lui qui le rend unique.
En effet, les enfants hybrides nés d'humains subissent une métamorphose en deux étapes pour arriver à l'âge adulte et où leurs corps changent parfois radicalement. Jodahs est à l'aube de ce bouleversement mais il prend vite conscience qu'il ne sera ni mâle ni femelle… il sera Ooloi !
L'Ooloi, comme nous le savons maintenant depuis les débuts de la saga Xenogenesis, sont un troisième sexe dans la race Oankali qui joue un rôle clé et extrêmement particulier car ce sont eux qui servent de trait d'union pour les « trouples » formés par les géniteurs de cette étrange race extra-terrestre. Ce sont également eux qui manipulent le mieux les gènes et remanient les corps à leur portée. Un Ooloi n'est donc pas un Oankali comme les autres. Et c'est justement la toute première fois qu'un hybride né d'humain comme Jodahs se destine à devenir Ooloi !
Le risque semble énorme tant les pulsions humaines et la Contradiction qui les a anéanti tantôt pourraient causer d'énormes dommages à tout ce que les Oankalis ont construit jusque maintenant. C'est pour cette raison qu'on pense d'abord envoyer Jodahs en orbite dans le vaisseau-mère vivant des extra-terrestres mais sa famille refuse et choisit l'exil dans les profondeurs de la jungle terrienne.
Comment Jodahs va-t-il pouvoir devenir adulte et contrôler ses nouvelles capacités hors du commun dans de telles circonstances ?
Survie en milieu hostile au programme de ce dernier chapitre de la trilogie Xenogenesis mais aussi, et surtout, une vraie immersion dans la tête d'u personnage complètement étranger au genre humain qui regarde le monde d'une façon radicalement différente. Jodahs goûte et transforme ce qu'il touche, regardant ce qu'il reste des opposants désormais acculés dans les coins les plus reculés de la planète pour survivre selon leurs voeux.
Avant tout, et davantage encore que les deux précédents, Imago est un roman sur la transformation physique et la modification corporel.
C'est un passage à l'âge adulte unique en son genre que présente Octavia Butler, trifouillant la chair de ses extraterrestres plus répugnants et attirants que jamais. On sent encore parfaitement toute l'ambivalence qui peut habiter les êtres humains qui les côtoient, d'un côté terrifié par ces tentacules grouillants et cette tendance tenace du tactile qui les habite, de l'autre fasciné par le discours profondément intelligent et bienveillant qui en émane. Nous suivrons ici les transformations de Jodahs avec une grande minutie, presque paralysé d'effroi et de curiosité, surtout lorsqu'il exprime ses nécessités de besoins physiques avec les humains, ces étranges créatures si délicieusement addictives.
On retrouve de nouveau l'originalité dans la description du mode de vie et des règles qui régissent l'espèce Oankali, ainsi que l'imagination formidable de l'américaine pour en faire une race à part avec ses coutumes et ses familles qui semblent s'étendre à l'infinie et où l'inceste n'existe pas.
La frontière du dérangeant est vite franchi à nouveau et plonge dans les derniers niveaux de l'ambiguïté au fur et à mesure que Jodahs découvre ses capacités nouvelles…et qu'il se trouve de nouveaux partenaires humains.
Pour ce dernier volet, Octavia Butler pousse jusqu'au bout le malaise qui enveloppe le lecteur depuis le tout début.
Véritable jonglage amoral autour du concept de domination, la trilogie Xenogenesis est à la fois effroyable et brillante dès lors qu'il s'agit de montrer l'emprise et la cohabitation des races.
Ce qui dérange profondément à la lecture d'Imago, c'est qu'on observe de l'intérieur cette avidité impossible à réfréner pour le contact humain et la relation physique, mais que ceux-ci ne sont jamais clairs.
En effet, les Oolois (et donc Jodahs) modifient les réactions/perceptions de leurs partenaires par des phéromones et autres substances biochimiques douteuses.
Dès lors, difficile de croire que les réactions humaines et leurs envies soudaines de s'accoupler avec des êtres aussi répugnants physiquement soit tout à fait naturelles. On pourrait rapidement crier à l'horreur… mais c'est sans compter sur la bienveillance de tous les instants des Oankalis qui, non content d'avoir sauver la race humaine, se prennent à vouloir la perfectionner, soignent les malades et les difformes, donnent du plaisir à volonté autour d'eux et prônent un pacifisme total.
Les extra-terrestres ne sont pas là pour détruire la civilisation terrienne mais pour la rendre meilleure.
Et si vous n'êtes pas d'accord, le choix est simple : l'exil ou la stérilité.
Si l'on peut logiquement être déçu que ce dernier volume ne nous emmène pas sur Mars et qu'il stagne sur une planète Terre régénérée comme dans le volume précédent, on note qu'Octavia Butler pousse encore plus loin son questionnement sur l'assimilation. Où s'arrête la bienveillance du colon et où commence l'invasion et l'esclavage qui ne dit pas son nom ?
L'envoi vers Mars des humains qui ne veulent pas adhérer à ce nouveau mode de pensée fait écho au renvoi des esclaves noirs américains vers le Liberia, acheté en son temps de façon bienveillante par l'American Colonization Society, pour permettre aux « pauvres esclaves noirs » de rejoindre leur terre natale… Bienveillance quand tu nous tiens !
Le malaise se poursuit donc jusqu'à la dernière page et jamais le lecteur ne sera certain des véritables sentiments des humains qui passent beaucoup trop rapidement de la haine à la camaraderie… voire plus si affinités !
Octavia Butler démontre une nouvelle fois que les grands principes s'écroulent dans le brouillard du réel et que les rapports entre dominants et dominés sont bien plus inextricables qu'on ne voudrait le croire…
Malgré la redites, ce dernier volume de la trilogie Xenogenesis est un bonheur de réflexions philosophiques et de body-horror light, le tout dans une atmosphère étrange qui file une furieuse envie de s'enfuir en quatrième vitesse au lecteur. Assez loin en tout cas de ces bienveillants mais particulièrement envahissants extra-terrestres atteints d'un sacré syndrome du sauveur.
Une conclusion qui laisse des traces.
Lien : https://justaword.fr/imago-d..
Dans le précédent volume, nous avions pu suivre Akin, un hybride des deux races, et ainsi poser notre regard sur ce qu'il restait des derniers humains refusant le troc génétique proposé par les extra-terrestres.
Ces opposants, loin d'être aussi mauvais qu'on aurait pu le croire de prime abord, arrivent finalement à faire valoir leur point de vue en passant suffisamment de temps avec Akin qui se retrouve lui-même à plaider leur cause en faveur d'une nouvelle société humaine capable de se reproduire et de se gouverner. Mais pour la Terre, c'est déjà trop tard et c'est sur Mars que la nouvelle humanité tentera sa chance.
Quelques années plus tard, Octavia Butler imagine une dernière aventure dans les coins les plus reculés de notre planète en sursis…
Après Lilith et Akin, nous changeons encore de point de vue avec l'arrivée de Jodahs qui fait lui aussi partie de la grande famille déjà présente dans les volumes précédents mais qui a pourtant une particularité bien à lui qui le rend unique.
En effet, les enfants hybrides nés d'humains subissent une métamorphose en deux étapes pour arriver à l'âge adulte et où leurs corps changent parfois radicalement. Jodahs est à l'aube de ce bouleversement mais il prend vite conscience qu'il ne sera ni mâle ni femelle… il sera Ooloi !
L'Ooloi, comme nous le savons maintenant depuis les débuts de la saga Xenogenesis, sont un troisième sexe dans la race Oankali qui joue un rôle clé et extrêmement particulier car ce sont eux qui servent de trait d'union pour les « trouples » formés par les géniteurs de cette étrange race extra-terrestre. Ce sont également eux qui manipulent le mieux les gènes et remanient les corps à leur portée. Un Ooloi n'est donc pas un Oankali comme les autres. Et c'est justement la toute première fois qu'un hybride né d'humain comme Jodahs se destine à devenir Ooloi !
Le risque semble énorme tant les pulsions humaines et la Contradiction qui les a anéanti tantôt pourraient causer d'énormes dommages à tout ce que les Oankalis ont construit jusque maintenant. C'est pour cette raison qu'on pense d'abord envoyer Jodahs en orbite dans le vaisseau-mère vivant des extra-terrestres mais sa famille refuse et choisit l'exil dans les profondeurs de la jungle terrienne.
Comment Jodahs va-t-il pouvoir devenir adulte et contrôler ses nouvelles capacités hors du commun dans de telles circonstances ?
Survie en milieu hostile au programme de ce dernier chapitre de la trilogie Xenogenesis mais aussi, et surtout, une vraie immersion dans la tête d'u personnage complètement étranger au genre humain qui regarde le monde d'une façon radicalement différente. Jodahs goûte et transforme ce qu'il touche, regardant ce qu'il reste des opposants désormais acculés dans les coins les plus reculés de la planète pour survivre selon leurs voeux.
Avant tout, et davantage encore que les deux précédents, Imago est un roman sur la transformation physique et la modification corporel.
C'est un passage à l'âge adulte unique en son genre que présente Octavia Butler, trifouillant la chair de ses extraterrestres plus répugnants et attirants que jamais. On sent encore parfaitement toute l'ambivalence qui peut habiter les êtres humains qui les côtoient, d'un côté terrifié par ces tentacules grouillants et cette tendance tenace du tactile qui les habite, de l'autre fasciné par le discours profondément intelligent et bienveillant qui en émane. Nous suivrons ici les transformations de Jodahs avec une grande minutie, presque paralysé d'effroi et de curiosité, surtout lorsqu'il exprime ses nécessités de besoins physiques avec les humains, ces étranges créatures si délicieusement addictives.
On retrouve de nouveau l'originalité dans la description du mode de vie et des règles qui régissent l'espèce Oankali, ainsi que l'imagination formidable de l'américaine pour en faire une race à part avec ses coutumes et ses familles qui semblent s'étendre à l'infinie et où l'inceste n'existe pas.
La frontière du dérangeant est vite franchi à nouveau et plonge dans les derniers niveaux de l'ambiguïté au fur et à mesure que Jodahs découvre ses capacités nouvelles…et qu'il se trouve de nouveaux partenaires humains.
Pour ce dernier volet, Octavia Butler pousse jusqu'au bout le malaise qui enveloppe le lecteur depuis le tout début.
Véritable jonglage amoral autour du concept de domination, la trilogie Xenogenesis est à la fois effroyable et brillante dès lors qu'il s'agit de montrer l'emprise et la cohabitation des races.
Ce qui dérange profondément à la lecture d'Imago, c'est qu'on observe de l'intérieur cette avidité impossible à réfréner pour le contact humain et la relation physique, mais que ceux-ci ne sont jamais clairs.
En effet, les Oolois (et donc Jodahs) modifient les réactions/perceptions de leurs partenaires par des phéromones et autres substances biochimiques douteuses.
Dès lors, difficile de croire que les réactions humaines et leurs envies soudaines de s'accoupler avec des êtres aussi répugnants physiquement soit tout à fait naturelles. On pourrait rapidement crier à l'horreur… mais c'est sans compter sur la bienveillance de tous les instants des Oankalis qui, non content d'avoir sauver la race humaine, se prennent à vouloir la perfectionner, soignent les malades et les difformes, donnent du plaisir à volonté autour d'eux et prônent un pacifisme total.
Les extra-terrestres ne sont pas là pour détruire la civilisation terrienne mais pour la rendre meilleure.
Et si vous n'êtes pas d'accord, le choix est simple : l'exil ou la stérilité.
Si l'on peut logiquement être déçu que ce dernier volume ne nous emmène pas sur Mars et qu'il stagne sur une planète Terre régénérée comme dans le volume précédent, on note qu'Octavia Butler pousse encore plus loin son questionnement sur l'assimilation. Où s'arrête la bienveillance du colon et où commence l'invasion et l'esclavage qui ne dit pas son nom ?
L'envoi vers Mars des humains qui ne veulent pas adhérer à ce nouveau mode de pensée fait écho au renvoi des esclaves noirs américains vers le Liberia, acheté en son temps de façon bienveillante par l'American Colonization Society, pour permettre aux « pauvres esclaves noirs » de rejoindre leur terre natale… Bienveillance quand tu nous tiens !
Le malaise se poursuit donc jusqu'à la dernière page et jamais le lecteur ne sera certain des véritables sentiments des humains qui passent beaucoup trop rapidement de la haine à la camaraderie… voire plus si affinités !
Octavia Butler démontre une nouvelle fois que les grands principes s'écroulent dans le brouillard du réel et que les rapports entre dominants et dominés sont bien plus inextricables qu'on ne voudrait le croire…
Malgré la redites, ce dernier volume de la trilogie Xenogenesis est un bonheur de réflexions philosophiques et de body-horror light, le tout dans une atmosphère étrange qui file une furieuse envie de s'enfuir en quatrième vitesse au lecteur. Assez loin en tout cas de ces bienveillants mais particulièrement envahissants extra-terrestres atteints d'un sacré syndrome du sauveur.
Une conclusion qui laisse des traces.
Lien : https://justaword.fr/imago-d..
En une mobilisation quasi-totale des motifs de la science-fiction, une formidable fresque politique et philosophique du métissage et de l'impérialisme « bienveillant » – et de ce que s'y joue de nos préjugés.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/05/06/note-de-lecture-la-trilogie-xenogenesis-octavia-butler/
Pas de note de lecture proprement dite pour « L'Aube », « L'Initiation » et « Imago », les trois ouvrages composant ensemble la trilogie Xenogenesis d'Octavia Butler, publiés en 1987-1989 et traduits chez Au Diable Vauvert par Jessica Shapiro en 2022-2024 (comblant ainsi enfin un manque essentiel dans l'exposition de l'oeuvre de la grande autrice afro-américaine dans notre pays) : ils font en effet l'objet d'un petit article de ma part dans le Monde des Livres daté du vendredi 3 mai 2024 (à lire ici). Comme j'en ai pris l'habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l'article lui-même (et l'occasion de quelques citations des textes, bien sûr).
⏰ Il aura fallu quasiment trente-cinq ans pour que cette série pourtant fondamentale d'une autrice qui ne l'est pas moins soit enfin traduite en français. Saluons donc ici le travail opiniâtre des éditions Au Diable Vauvert qui, depuis qu'elles s'affairent autour de l'oeuvre d'Octavia Butler, avec la publication en 2003 de « La parabole du semeur » (1993), sont bien en voie de mettre fin à des décennies d'un ahurissant mélange de silence et de n'importe quoi éditorial (ouvrages parus dans un joyeux désordre, traductions incomplètes ou fautives, omissions de certains tomes au sein de cycles en plusieurs volumes, etc.) qui avait longtemps caractérisé leurs prédécesseurs.
🧑🧑🧒🧒 Cette trilogie est fondamentale pour saisir la puissance heuristique du métissage et de l'hybridation, au sens génétique cher à la science-fiction d'abord, mais encore davantage au sens philosophique et historique qui fait pousser de si nets cris d'orfraie à tous les tenants des « chocs des civilisations » et autres lectures à sens unique de l'Histoire – et de ce qu'on peut en déduire. Cet aspect étant celui que je souligne le plus dans l'article du Monde des Livres sus-cité, je ne l'évoquerai pas davantage ici.
🫥 Octavia Butler est sans aucun doute l'une des inspiratrices voire des « fondatrices » (si le mot avait vraiment un sens en la matière) de ce mouvement littéraire et extra-littéraire que l'on appelle aujourd'hui l'afrofuturisme. Toutefois, si des textes tels que « Liens de sang » (1979) ou « Novice » (2005), ou naturellement ceux des deux « Paraboles », celle du « Semeur » (1993) et celle des « Talents » (1998), reflètent très directement le pas de côté afro-américain qui peut être introduit pour notre plus grand bénéfice collectif dans notre compréhension de ce qui se joue aujourd'hui entre passé et futur, la trilogie « Xenogenesis » – comme, d'une autre manière, celle du « Patternist » (1976-1984) qui la précédait en écriture – est plus indirecte dans ce domaine, projetant la métaphore de la domination esclavagiste à un haut degré philosophique d'universalité englobante, et d'une puissance à mon sens accrue, si elle est sans doute moins immédiatement spectaculaire.
🇺🇳 Si la trilogie « Xenogenesis » mobilise de manière intense les ressources de la psychologie humaine individuelle et collective (au long cours : l'étagement réalisé en la matière par les trois volumes est tout à fait spectaculaire), tout particulièrement lorsqu'elle est confrontée rationnellement comme irrationnellement à la notion même d'humanité, ainsi que celles de la philosophie (avec une étonnante touche spinoziste d'intellection de la nécessité qui se fait jour à plusieurs reprises dans l'évolution de la relation entre survivants humains et « envahisseurs-sauveteurs » oankali), c'est certainement dans son approche en profondeur de l'impérialisme bienveillant qu'elle exprime toute sa puissante saveur. On pourra ainsi la lire avec vif intérêt en parallèle et/ou en comparaison du cycle de l'Élévation de David Brin, du cycle de la Culture de Iain M. Banks et du cycle « Canopus dans Argo : Archives » de Doris Lessing, par exemple.
👽 La trilogie « Xenogenesis » est sans doute l'une des oeuvres de science-fiction qui mobilise de la manière la plus exhaustive l'ensemble ou presque des motifs « traditionnels » de la science-fiction pour composer – c'est bien de circonstance – un rarissime melting pot : space opera, post-apocalyptique, transmissions dynastiques, premier contact extra-terrestre, guerre entre communautés, exploration du système solaire,… Excusez du peu ! Elle illustre ainsi avec éclat – comme tant d'autres oeuvres majeures (songez ne serait-ce qu'au « Cycle du Nouveau Soleil » de Gene Wolfe , au « Orbitor » de Mircea Cǎrtǎrescu – et peut-être plus encore à son « Solénoïde » -, à l'« Abattoir 5 » de Kurt Vonnegut ou à l'ensemble du post-exotisme d'Antoine Volodine et de ses hétéronymes) la vanité fréquente des micro-classifications en genres, sous-genres et sous-sous-genres à l'intérieur du vaste ensemble des littératures de l'imaginaire (ce qui n'enlève rien, notons-le, aux précieuses qualités d'un ouvrage tel que le « Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire » d'Apophis, un peu paradoxalement).
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/05/06/note-de-lecture-la-trilogie-xenogenesis-octavia-butler/
Pas de note de lecture proprement dite pour « L'Aube », « L'Initiation » et « Imago », les trois ouvrages composant ensemble la trilogie Xenogenesis d'Octavia Butler, publiés en 1987-1989 et traduits chez Au Diable Vauvert par Jessica Shapiro en 2022-2024 (comblant ainsi enfin un manque essentiel dans l'exposition de l'oeuvre de la grande autrice afro-américaine dans notre pays) : ils font en effet l'objet d'un petit article de ma part dans le Monde des Livres daté du vendredi 3 mai 2024 (à lire ici). Comme j'en ai pris l'habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l'article lui-même (et l'occasion de quelques citations des textes, bien sûr).
⏰ Il aura fallu quasiment trente-cinq ans pour que cette série pourtant fondamentale d'une autrice qui ne l'est pas moins soit enfin traduite en français. Saluons donc ici le travail opiniâtre des éditions Au Diable Vauvert qui, depuis qu'elles s'affairent autour de l'oeuvre d'Octavia Butler, avec la publication en 2003 de « La parabole du semeur » (1993), sont bien en voie de mettre fin à des décennies d'un ahurissant mélange de silence et de n'importe quoi éditorial (ouvrages parus dans un joyeux désordre, traductions incomplètes ou fautives, omissions de certains tomes au sein de cycles en plusieurs volumes, etc.) qui avait longtemps caractérisé leurs prédécesseurs.
🧑🧑🧒🧒 Cette trilogie est fondamentale pour saisir la puissance heuristique du métissage et de l'hybridation, au sens génétique cher à la science-fiction d'abord, mais encore davantage au sens philosophique et historique qui fait pousser de si nets cris d'orfraie à tous les tenants des « chocs des civilisations » et autres lectures à sens unique de l'Histoire – et de ce qu'on peut en déduire. Cet aspect étant celui que je souligne le plus dans l'article du Monde des Livres sus-cité, je ne l'évoquerai pas davantage ici.
🫥 Octavia Butler est sans aucun doute l'une des inspiratrices voire des « fondatrices » (si le mot avait vraiment un sens en la matière) de ce mouvement littéraire et extra-littéraire que l'on appelle aujourd'hui l'afrofuturisme. Toutefois, si des textes tels que « Liens de sang » (1979) ou « Novice » (2005), ou naturellement ceux des deux « Paraboles », celle du « Semeur » (1993) et celle des « Talents » (1998), reflètent très directement le pas de côté afro-américain qui peut être introduit pour notre plus grand bénéfice collectif dans notre compréhension de ce qui se joue aujourd'hui entre passé et futur, la trilogie « Xenogenesis » – comme, d'une autre manière, celle du « Patternist » (1976-1984) qui la précédait en écriture – est plus indirecte dans ce domaine, projetant la métaphore de la domination esclavagiste à un haut degré philosophique d'universalité englobante, et d'une puissance à mon sens accrue, si elle est sans doute moins immédiatement spectaculaire.
🇺🇳 Si la trilogie « Xenogenesis » mobilise de manière intense les ressources de la psychologie humaine individuelle et collective (au long cours : l'étagement réalisé en la matière par les trois volumes est tout à fait spectaculaire), tout particulièrement lorsqu'elle est confrontée rationnellement comme irrationnellement à la notion même d'humanité, ainsi que celles de la philosophie (avec une étonnante touche spinoziste d'intellection de la nécessité qui se fait jour à plusieurs reprises dans l'évolution de la relation entre survivants humains et « envahisseurs-sauveteurs » oankali), c'est certainement dans son approche en profondeur de l'impérialisme bienveillant qu'elle exprime toute sa puissante saveur. On pourra ainsi la lire avec vif intérêt en parallèle et/ou en comparaison du cycle de l'Élévation de David Brin, du cycle de la Culture de Iain M. Banks et du cycle « Canopus dans Argo : Archives » de Doris Lessing, par exemple.
👽 La trilogie « Xenogenesis » est sans doute l'une des oeuvres de science-fiction qui mobilise de la manière la plus exhaustive l'ensemble ou presque des motifs « traditionnels » de la science-fiction pour composer – c'est bien de circonstance – un rarissime melting pot : space opera, post-apocalyptique, transmissions dynastiques, premier contact extra-terrestre, guerre entre communautés, exploration du système solaire,… Excusez du peu ! Elle illustre ainsi avec éclat – comme tant d'autres oeuvres majeures (songez ne serait-ce qu'au « Cycle du Nouveau Soleil » de Gene Wolfe , au « Orbitor » de Mircea Cǎrtǎrescu – et peut-être plus encore à son « Solénoïde » -, à l'« Abattoir 5 » de Kurt Vonnegut ou à l'ensemble du post-exotisme d'Antoine Volodine et de ses hétéronymes) la vanité fréquente des micro-classifications en genres, sous-genres et sous-sous-genres à l'intérieur du vaste ensemble des littératures de l'imaginaire (ce qui n'enlève rien, notons-le, aux précieuses qualités d'un ouvrage tel que le « Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire » d'Apophis, un peu paradoxalement).
Lien : https://charybde2.wordpress...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Octavia E. Butler (19)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les plus grands classiques de la science-fiction
Qui a écrit 1984
George Orwell
Aldous Huxley
H.G. Wells
Pierre Boulle
10 questions
4946 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science-fictionCréer un quiz sur ce livre4946 lecteurs ont répondu