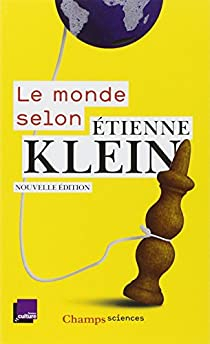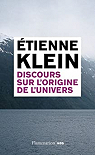Citations sur Le monde selon Etienne Klein (26)
Cette question, c'est celle de l'origine : d'où venons-nous ? Et d'abord, d'où vient qu'il y a un univers et non pas rien ? Tout cela pourrait nous laisser indifférents (...).
En réalité, c'est tout le contraire qui se passe : la question de l'origine de l'univers nous passionne. Nous avons beau savoir qu'elle relève du mystère le plus profond, cela n'empêche : dès qu'un discours prétend nous éclairer sur elle, nous tendons l'oreille comme si nous espérions encore pouvoir entendre l'écho du tout premier signal.
Certains nous parlent de création ex nihilo, expression fort curieuse puisqu'elle suggère qu'un méli-mélo de néant et d'être aurait déclenché l'univers. Mais par quel mécanisme le néant pourrait-il avoir cessé d'être le néant ? On ne se bouscule guère pour le dire.
D'autres expliquent qu'au tout début il y avait ceci ou cela. Mais un début qui fait suite à quelque chose qui l'a précédé, est-ce vraiment le début ?
D'autres encore évoquent un cause première, c'est-à-dire une cause qui serait elle-même dépourvue de cause. Mais quel sens pouvait bien avoir le mot cause quand rien n'existait encore ?
D'autres enfin nous parlent du chaos primordial comme s'ils s'y sentaient chez eux. Du coup leurs propos ne sont jamais très ordonnés et pour cause...
En réalité, c'est tout le contraire qui se passe : la question de l'origine de l'univers nous passionne. Nous avons beau savoir qu'elle relève du mystère le plus profond, cela n'empêche : dès qu'un discours prétend nous éclairer sur elle, nous tendons l'oreille comme si nous espérions encore pouvoir entendre l'écho du tout premier signal.
Certains nous parlent de création ex nihilo, expression fort curieuse puisqu'elle suggère qu'un méli-mélo de néant et d'être aurait déclenché l'univers. Mais par quel mécanisme le néant pourrait-il avoir cessé d'être le néant ? On ne se bouscule guère pour le dire.
D'autres expliquent qu'au tout début il y avait ceci ou cela. Mais un début qui fait suite à quelque chose qui l'a précédé, est-ce vraiment le début ?
D'autres encore évoquent un cause première, c'est-à-dire une cause qui serait elle-même dépourvue de cause. Mais quel sens pouvait bien avoir le mot cause quand rien n'existait encore ?
D'autres enfin nous parlent du chaos primordial comme s'ils s'y sentaient chez eux. Du coup leurs propos ne sont jamais très ordonnés et pour cause...
En d'autres termes, "la vitesse de la lumière" demeure toujours cohérente avec son anagramme : elle "limite les rêves au-delà". p108
A priori, raisonner et imaginer se présentent comme deux dynamiques contraires. Le savant se doit de résister à la pente imaginative du langage pour élaborer rigoureusement ses concepts. Le poète, lui, doit échapper à la structure simplement logique du langage pour produire des métaphores inouïes. En réalité, explique Gaston Bachelard, la raison scientifique et l'imagination poétique agissent de conserve, puisqu'elles ont en commun de mettre l'esprit en branle, de ne pas se satisfaire des évidences premières, et de défier le sens commun. p32
Tous les hommes politiques parlent de changement, sans toujours dire ce qu'ils entendent par ce mot. Il serait profitable, que de temps à autre, leurs discours s'inspirent de ce que les physiciens ont compris, notamment à propos de cette articulation subtile entre les idées de changement et d'invariance. Pour nous qui les écoutons, cela sonnerait comme un joli changement. Mieux comme une révolution. 19 septembre 2012. p19
Il y a quelques décennies, en effet, s’est produit un événement très important : le retournement des poussettes. Avant, l’enfant était transporté dans un face-à-face rassurant, qui le plaçait dans un rapport affectif permettant sourires, grimaces, gestes de tendresses ou de menaces, échange de paroles avec la personne qui le poussait, en général sa mère. Désormais, l’enfant est face au vide, son regard ne rencontre que des passants anonymes, il est laissé à sa solitude, « ouvert sur le monde », disent ceux qui veulent louer cette pratique, et non plus prisonnier du cercle familial, mais en réalité livré à l’inconnu, qui, comme chacun sait, est source potentielle d’angoisse.
La science s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent l’opinion ; de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion pense mal ; elle ne pense pas ; elle traduit des besoins en connaissances. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire
Le lendemain matin, sa femme met un nez dehors de la tente et a la grande surprise de voir son mari courir autour de la tente en étant poursuivi par un lion. Évidemment, elle s'inquiète, mais il lui répond calmement: ne t'inquiète pas pour moi, chérie, le danger est plus apparent que réel, car j'ai deux tours d'avance.
Mais voyager dans le temps, est-ce voyager dans le passé ou plutôt dans le futur ?
Voyager dans le passé suppose que le passé existe encore, ce qui peut se concevoir, mais aussi se discuter. Le passé est-il encore vraiment là, et si oui, où est-il ? Et s'il est quelque part, nous est-il accessible ? Transposées dans le champs de la littérature, ces questions reviennent à se demander où placer le curseur sur une règle dont les deux extrémités représentent, pour l'une, les œuvres de Scott Fitzgerald, pour l' autre, celles de Marcel Proust. Le premier considérait que le passé n'est nulle part, que chaque instant à peine vécu tombe dans un gouffre sans fond, bref que les bonheurs enfouis sont perdus à jamais, et tout cela est forcément déchirant ; l'impossibilité d'un recours ou d'un retour au passé est d'ailleurs la marque la plus tragique de la détresse ordinaire de l'homme.
Proust prétend au contraire qu'on peut partir à la recherche du temps perdu et des bonheurs passés grâce à un travail de purification de la mémoire.
[...]
Si c'est dans le futur qu'on souhaite voyager, même problème : l'avenir est-il déjà là, quelque part à attendre sagement que nous le rejoignons, ou bien n'existe-t-il pas encore ? Dans cette dernière hypothèse, voyager dans le futur serait prendre le risque d'atterrir dans le néant... Et oui, pour voyager dans le temps en toute sécurité, il faudrait pouvoir s'assurer que le passé ou le futur existent en même temps que le présent, c'est-à-dire que tous les moments du temps cohabitent quelque part. Or, la conception ordinaire du temps exclut que des instants différents, ou des moments qui ne se chevauchent pas puissent coexister ensemble...
Voyager dans le passé suppose que le passé existe encore, ce qui peut se concevoir, mais aussi se discuter. Le passé est-il encore vraiment là, et si oui, où est-il ? Et s'il est quelque part, nous est-il accessible ? Transposées dans le champs de la littérature, ces questions reviennent à se demander où placer le curseur sur une règle dont les deux extrémités représentent, pour l'une, les œuvres de Scott Fitzgerald, pour l' autre, celles de Marcel Proust. Le premier considérait que le passé n'est nulle part, que chaque instant à peine vécu tombe dans un gouffre sans fond, bref que les bonheurs enfouis sont perdus à jamais, et tout cela est forcément déchirant ; l'impossibilité d'un recours ou d'un retour au passé est d'ailleurs la marque la plus tragique de la détresse ordinaire de l'homme.
Proust prétend au contraire qu'on peut partir à la recherche du temps perdu et des bonheurs passés grâce à un travail de purification de la mémoire.
[...]
Si c'est dans le futur qu'on souhaite voyager, même problème : l'avenir est-il déjà là, quelque part à attendre sagement que nous le rejoignons, ou bien n'existe-t-il pas encore ? Dans cette dernière hypothèse, voyager dans le futur serait prendre le risque d'atterrir dans le néant... Et oui, pour voyager dans le temps en toute sécurité, il faudrait pouvoir s'assurer que le passé ou le futur existent en même temps que le présent, c'est-à-dire que tous les moments du temps cohabitent quelque part. Or, la conception ordinaire du temps exclut que des instants différents, ou des moments qui ne se chevauchent pas puissent coexister ensemble...
C'est au siècle des lumières que s'est forgé l'idée de progrès et avec elle l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie. Mon ami Jacques Perry-Salkow (1) m'a d'ailleurs soufflé que "l'idée de progrès" a une anagramme renversante qui est "le degré d'espoir". p53
(1) Anagramme à la folie, Paris, Equateurs, 2013
(1) Anagramme à la folie, Paris, Equateurs, 2013
Les physiciens savent qu'ils ignorent la nature des éléments principaux du mobilier ontologique de l'univers : ils ont constaté que la matière telle qu'ils la connaissent ne constitue qu'une part très faible du contenu de l'univers, et que tout le reste leur échappe. En somme, ce qu'ils ont appris leur permet de dire qu'ils en savent moins qu'avant, quand ils croyaient savoir. Apprendre va de pair avec désapprendre. p49
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Étienne Klein (56)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)
Présent - 1ère personne du pluriel :
Nous savons.
Nous savonnons (surtout à Marseille).
10 questions
414 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science
, savoir
, conjugaison
, humourCréer un quiz sur ce livre414 lecteurs ont répondu