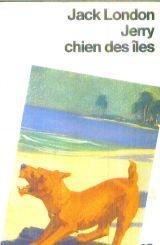>
Critique de Erik35
DANS L'ENFER DES HOMMES
Les aventures de Jerry forment, avec celles de son frère jumeau Michaël - dans le posthume Michaël chien de cirque -, un genre de Sans Famille américain. Comme dans le fameux roman d'Hector Malot, Jerry, chiot de race terrier irlandais, mène une destinée misérable.
Après avoir été cédé légitimement par son éleveur, le jeune animal va en effet connaitre un nombre considérable d'aventures et, surtout, de mésaventures. Son premier propriétaire, le capitaine van Horn, mène une véritable existence de négrier à la recherche de recrues bon marché et corvéables à merci, vendues à prix d'or pour trois années d'enfer dans les plantations de coprah de l'archipel. Pour ce faire, il navigue entre les îles les plus sauvages, les plus reculées et les plus dangereuse de l'Archipel des Salomon, où les autochtones, qu'ils soient "broussards" de l'intérieur ou "hommes d'eau salée" des villages côtiers, pratiquent encore assidûment le cannibalisme rituel et la réduction des crânes.
C'est ainsi que le malheureux Jerry se retrouve entre les mains de ces terribles "sauvages" après que ces derniers auront investi par ruse - grâce à l'intelligence dénuée de scrupule de leur Roi - et entièrement massacré (puis ingurgité) l'équipage et son skipper (surnom sous lequel Jerry reconnaissait son maître). On apprendra un peu plus loin que la tête de ce dernier fait désormais partie de la macabre collection du chef de ce village, Somo, en compagnie de celle, entre autres "personnalités" du célèbre explorateur français, La Pérouse, dont l'histoire sait qu'il disparut corps et bien dans ces parages infernaux.
Dès lors, Jerry passera de main en main dans sa misérable vie de petit chien de blanc élevé avec amour au milieu d'un clan d'aborigènes pas toujours tous bienveillants. Il réussira tout de même à échapper à sa condition probable d'animal comestible grâce à l'amitié (sans véritable retour) d'un jeune garçon, qui accomplira pour se faire un acte totalement tabou pour lequel il risque rien moins que la mise à mort par ses semblables ; il se trouvera par la suite pris en charge par le "docteur sorcier" Agno sur ordre express du Chef Bashti, qui songe en faire un mâle reproducteur afin que Jerry apporte toutes ses qualités combatives aux canidés locaux, pleutres, lâches et sans grande intelligence. Mais celui qui sert de premier ministre au chef va se servir du pauvre Jerry pour assouvir sa soif de vengeance de n'être toujours que l'éternel second. Il va piéger notre espiègle animal et lui faire accomplir un tabou inexcusable et irréparable autrement que par la mort (et la dégustation post-mortem...).
Heureusement pour notre héros à quatre pattes, un autre docteur sorcier du nom de Nalassu, moins en vue mais craint et vénéré, malgré sa cécité, va le sauver in extremis des griffes d'Agno. A force de patience et d'une tendresse à laquelle le chien n'était plus trop habitué depuis son rapt par les indigènes, le vieillard va lui enseigner une manière de langage, entremêlant tonalités d'aboiements très diverses, coups de pattes et autres petits coups de tête qu'ils seront les deux seuls à connaître et à comprendre pour assurer au mieux la garde et la survie de cet ancien guerrier dont la tête est réclamée par une famille entière d'ennemis de la brousse !
A la fin des fins, Jerry sera sauvé par un couple (très identifiable à celui de London lui-même et de son épouse Charmian, bien que très idéalisé) dont le yacht croisait dans les parages et après qu'un navire de Sa Gracieuse Majesté, par mesure de rétorsion contre le massacre du Capitaine van Horn et de son équipage, aura bombardé le village de Somo : un malheureux hasard fit tomber l'un des obus tirés pile sur la hutte du vieux sorcier Nalassu, le pulvérisant littéralement.
Ainsi, tout est bien qui fini pour le mieux pour ce petit chien courageux, sans peur mais si longtemps sans maître digne de ce nom...
Jerry, chien des îles fait parti des ouvrages de Jack London très souvent proposé, largement condensé, à un public jeunesse. Des aventures d'un petit héros à poils et à museau, quoi de mieux comme histoire pour édifier le jeune public.
Pour autant, l'oeuvre intégrale n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains.
D'abord, et bien malheureusement, parce que ce, par ailleurs, fort sympathique Jerry, chien des îles n'échappe pas à cette veine péniblement raciste de cet auteur pourtant défenseur du faible face à la surpuissance de l'argent, féministe convaincu, bon connaisseur des peuples indiens d'Amérique du nord, admirateur des traditions autochtones d'Hawaï, patron de ranch apprécié et respectueux de ses employés (au grand dam des autres propriétaires terriens de Sonoma) et l'un des premiers grands défenseurs de la cause animale contre l'imbécillité violente de certains humains. Pourtant, London est invariablement raciste, et surtout dès lors qu'il s'agit des "nègres", qu'ils soient les enfants des esclaves importés aux USA comme du bétail d'Afrique sub-saharienne ou qu'ils soient de ces populations indigènes des îles océaniennes qu'il découvrit lors de ses nombreux voyages dans le Pacifique.
Notre petit et adorable chien "pense" - même si London met toujours un tas de circonlocutions dès lors qu'il fait "réfléchir" son héros à truffe - donc exactement comme un colonisateur blanc de son temps. D'autant plus, nous explique-t-il, que le jeune Jerry a été dressé à détester les hommes à peau noire, à leur grogner dessus, à les chasser s'il le faut ! En l'espèce, London nous montre-là ni plus ni moins que les habitudes horribles et insupportables de racisme, de supériorité malveillante et de haine que nombre de coloniaux avaient sur place. On peut même dire que l'écrivain, sous couvert de défense animale, nous dépeint par le menu cette société totalement déséquilibrée où, par la seule force disproportionnée des armes en concurrence et en jouant machiavéliquement des haines et des volontés d'enrichissement des potentats locaux, les blancs (ici, la couronne britannique. Ailleurs, l'Allemagne, la France ou la Hollande), pourtant peu nombreux, ont imposé leur loi d'airain (Le Talon de Fer, aurait pu écrire London à ce sujet) à toute une population émaillée sur des milliers d'îles et d'îlots.
Ensuite, toujours sous le prétexte charmant (et sincère) de l'histoire d'un compagnon à patte, le californien, vieillissant, souffrant, épuisé par ses excès d'alcool, son auto-médication contre la douleur plus qu'hasardeuse, en grande partie à base d'opium, ses moments de dépression intense (qui ne se sont pas arrangés depuis que lui et son épouse savent qu'ils n'auront jamais d'enfant ensemble. Drame auquel s'ajoute celui, terrible, de ce qui devait être l'autre oeuvre de sa vie : la maison du loup, qui brûlera dans d'étranges circonstances quelques jours avant son installation définitive, en 1913), des demi-succès et même certains échecs littéraires), tous ces éléments se sur-ajoutant les uns aux autres semble avoir fait de notre jadis vaillant gaillard un homme obnubilé par la mort.
La mort est absolument partout dans cet ouvrage - par ailleurs mineur, soyons honnête, dans l'oeuvre de l'auteur -. Qu'elle soit accidentelle, simplement évoquée, tragique (presque invariablement), due à l'envahisseur colonial ou à l'indigène forcément cannibale (les évocations ou scènes de cannibalisme, bien que sans grand détail, sont légion dans ce roman) ; qu'elle soit le fruit d'étranges mais profondes réflexions métaphysiques, principalement dans la bouche du Roi Bashti, sorte de Hamlet océanien à ses heures de grand désarroi face à sa mort inéluctable en raison de son très grand âge ; qu'elle s'insinue dans les souvenirs incertains de Jerry : la mort est là, partout, omniprésente, obsédante, sans réponse. N'oublions pas que, à l'instar de ce Roi aborigène, London était athée et ne croyait guère aux esprits, même si l'un de ses chefs-d'oeuvre, le vagabond des étoiles, fait appel à une certaine forme de spiritisme.
Alors, bien sur, il y a notre petit Jerry, un mignon et intrépide petit terrier sans famille et sans maître. Mais si London souhaitait faire apparaître une chose qui semblait parfaitement farfelue et stupide à l'époque, à savoir, qu'il existe une psychologie et une intelligence propres à l'animal, en écrivant la première partie de cette manière de diptyque -le second volet étant donc consacré plus spécifiquement aux violence et aux diverses barbaries que l'être humain est capable de faire subir à ses compagnons animaux -, il en déroute tellement la trame que l'on sent assez vite que c'est loin d'être le seul message qu'il a à nous délivrer. Ce qu'il a par ailleurs toujours fait dans la plupart de ses textes qu'il ne faut surtout jamais se contenter de lire sans recul ni recherche de second degré.
Un roman pas aussi évident qu'il y parait. Certainement pas à conseiller à des plus jeunes dans sa version complète. A ne pas ouvrir si l'on ne se sent pas apte à dépasser les réflexions les plus sombres et abjectes de l'auteur. Un texte intéressant, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution de Jack London, appréhender cet homme incommensurablement complexe et ambigu qui allait décéder une année après la rédaction de cette histoire animalière - et tellement emplie de considérations humaines - et avant de l'avoir vu édité.
Ultime tentative aussi, d'un écrivain à bout de souffle : un rappel émouvant autant qu'inopérant - trop de mièvrerie dans les trois derniers chapitres, trop de fausse candeur, trop de rose bonbon - à son immense succès, Croc-Blanc, le petit Jerry parvenant à sauver, in extremis, ses sauveurs de la dernière heure en déjouant les sombres et meurtriers calculs d'un îlien échappé de prison et mis à prix. Deux chiens amoureux de leurs maîtres. Deux sauvetages. La ressemblance s'arrête malheureusement là.
Il se trouve beaucoup d'enfer dans ce livre. Beaucoup d'enfer dans le regard porté à ses semblables, d'une autre "race" ou de celle dont il se réclamait si souvent, trop souvent. le pire des enfers, ce n'était peut-être pas les autres, - comme le supposait Jean-Paul Sartre- , pour ce bon vieux Jack. Non : l'enfer, c'était peut-être devenu lui-même.
Les aventures de Jerry forment, avec celles de son frère jumeau Michaël - dans le posthume Michaël chien de cirque -, un genre de Sans Famille américain. Comme dans le fameux roman d'Hector Malot, Jerry, chiot de race terrier irlandais, mène une destinée misérable.
Après avoir été cédé légitimement par son éleveur, le jeune animal va en effet connaitre un nombre considérable d'aventures et, surtout, de mésaventures. Son premier propriétaire, le capitaine van Horn, mène une véritable existence de négrier à la recherche de recrues bon marché et corvéables à merci, vendues à prix d'or pour trois années d'enfer dans les plantations de coprah de l'archipel. Pour ce faire, il navigue entre les îles les plus sauvages, les plus reculées et les plus dangereuse de l'Archipel des Salomon, où les autochtones, qu'ils soient "broussards" de l'intérieur ou "hommes d'eau salée" des villages côtiers, pratiquent encore assidûment le cannibalisme rituel et la réduction des crânes.
C'est ainsi que le malheureux Jerry se retrouve entre les mains de ces terribles "sauvages" après que ces derniers auront investi par ruse - grâce à l'intelligence dénuée de scrupule de leur Roi - et entièrement massacré (puis ingurgité) l'équipage et son skipper (surnom sous lequel Jerry reconnaissait son maître). On apprendra un peu plus loin que la tête de ce dernier fait désormais partie de la macabre collection du chef de ce village, Somo, en compagnie de celle, entre autres "personnalités" du célèbre explorateur français, La Pérouse, dont l'histoire sait qu'il disparut corps et bien dans ces parages infernaux.
Dès lors, Jerry passera de main en main dans sa misérable vie de petit chien de blanc élevé avec amour au milieu d'un clan d'aborigènes pas toujours tous bienveillants. Il réussira tout de même à échapper à sa condition probable d'animal comestible grâce à l'amitié (sans véritable retour) d'un jeune garçon, qui accomplira pour se faire un acte totalement tabou pour lequel il risque rien moins que la mise à mort par ses semblables ; il se trouvera par la suite pris en charge par le "docteur sorcier" Agno sur ordre express du Chef Bashti, qui songe en faire un mâle reproducteur afin que Jerry apporte toutes ses qualités combatives aux canidés locaux, pleutres, lâches et sans grande intelligence. Mais celui qui sert de premier ministre au chef va se servir du pauvre Jerry pour assouvir sa soif de vengeance de n'être toujours que l'éternel second. Il va piéger notre espiègle animal et lui faire accomplir un tabou inexcusable et irréparable autrement que par la mort (et la dégustation post-mortem...).
Heureusement pour notre héros à quatre pattes, un autre docteur sorcier du nom de Nalassu, moins en vue mais craint et vénéré, malgré sa cécité, va le sauver in extremis des griffes d'Agno. A force de patience et d'une tendresse à laquelle le chien n'était plus trop habitué depuis son rapt par les indigènes, le vieillard va lui enseigner une manière de langage, entremêlant tonalités d'aboiements très diverses, coups de pattes et autres petits coups de tête qu'ils seront les deux seuls à connaître et à comprendre pour assurer au mieux la garde et la survie de cet ancien guerrier dont la tête est réclamée par une famille entière d'ennemis de la brousse !
A la fin des fins, Jerry sera sauvé par un couple (très identifiable à celui de London lui-même et de son épouse Charmian, bien que très idéalisé) dont le yacht croisait dans les parages et après qu'un navire de Sa Gracieuse Majesté, par mesure de rétorsion contre le massacre du Capitaine van Horn et de son équipage, aura bombardé le village de Somo : un malheureux hasard fit tomber l'un des obus tirés pile sur la hutte du vieux sorcier Nalassu, le pulvérisant littéralement.
Ainsi, tout est bien qui fini pour le mieux pour ce petit chien courageux, sans peur mais si longtemps sans maître digne de ce nom...
Jerry, chien des îles fait parti des ouvrages de Jack London très souvent proposé, largement condensé, à un public jeunesse. Des aventures d'un petit héros à poils et à museau, quoi de mieux comme histoire pour édifier le jeune public.
Pour autant, l'oeuvre intégrale n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains.
D'abord, et bien malheureusement, parce que ce, par ailleurs, fort sympathique Jerry, chien des îles n'échappe pas à cette veine péniblement raciste de cet auteur pourtant défenseur du faible face à la surpuissance de l'argent, féministe convaincu, bon connaisseur des peuples indiens d'Amérique du nord, admirateur des traditions autochtones d'Hawaï, patron de ranch apprécié et respectueux de ses employés (au grand dam des autres propriétaires terriens de Sonoma) et l'un des premiers grands défenseurs de la cause animale contre l'imbécillité violente de certains humains. Pourtant, London est invariablement raciste, et surtout dès lors qu'il s'agit des "nègres", qu'ils soient les enfants des esclaves importés aux USA comme du bétail d'Afrique sub-saharienne ou qu'ils soient de ces populations indigènes des îles océaniennes qu'il découvrit lors de ses nombreux voyages dans le Pacifique.
Notre petit et adorable chien "pense" - même si London met toujours un tas de circonlocutions dès lors qu'il fait "réfléchir" son héros à truffe - donc exactement comme un colonisateur blanc de son temps. D'autant plus, nous explique-t-il, que le jeune Jerry a été dressé à détester les hommes à peau noire, à leur grogner dessus, à les chasser s'il le faut ! En l'espèce, London nous montre-là ni plus ni moins que les habitudes horribles et insupportables de racisme, de supériorité malveillante et de haine que nombre de coloniaux avaient sur place. On peut même dire que l'écrivain, sous couvert de défense animale, nous dépeint par le menu cette société totalement déséquilibrée où, par la seule force disproportionnée des armes en concurrence et en jouant machiavéliquement des haines et des volontés d'enrichissement des potentats locaux, les blancs (ici, la couronne britannique. Ailleurs, l'Allemagne, la France ou la Hollande), pourtant peu nombreux, ont imposé leur loi d'airain (Le Talon de Fer, aurait pu écrire London à ce sujet) à toute une population émaillée sur des milliers d'îles et d'îlots.
Ensuite, toujours sous le prétexte charmant (et sincère) de l'histoire d'un compagnon à patte, le californien, vieillissant, souffrant, épuisé par ses excès d'alcool, son auto-médication contre la douleur plus qu'hasardeuse, en grande partie à base d'opium, ses moments de dépression intense (qui ne se sont pas arrangés depuis que lui et son épouse savent qu'ils n'auront jamais d'enfant ensemble. Drame auquel s'ajoute celui, terrible, de ce qui devait être l'autre oeuvre de sa vie : la maison du loup, qui brûlera dans d'étranges circonstances quelques jours avant son installation définitive, en 1913), des demi-succès et même certains échecs littéraires), tous ces éléments se sur-ajoutant les uns aux autres semble avoir fait de notre jadis vaillant gaillard un homme obnubilé par la mort.
La mort est absolument partout dans cet ouvrage - par ailleurs mineur, soyons honnête, dans l'oeuvre de l'auteur -. Qu'elle soit accidentelle, simplement évoquée, tragique (presque invariablement), due à l'envahisseur colonial ou à l'indigène forcément cannibale (les évocations ou scènes de cannibalisme, bien que sans grand détail, sont légion dans ce roman) ; qu'elle soit le fruit d'étranges mais profondes réflexions métaphysiques, principalement dans la bouche du Roi Bashti, sorte de Hamlet océanien à ses heures de grand désarroi face à sa mort inéluctable en raison de son très grand âge ; qu'elle s'insinue dans les souvenirs incertains de Jerry : la mort est là, partout, omniprésente, obsédante, sans réponse. N'oublions pas que, à l'instar de ce Roi aborigène, London était athée et ne croyait guère aux esprits, même si l'un de ses chefs-d'oeuvre, le vagabond des étoiles, fait appel à une certaine forme de spiritisme.
Alors, bien sur, il y a notre petit Jerry, un mignon et intrépide petit terrier sans famille et sans maître. Mais si London souhaitait faire apparaître une chose qui semblait parfaitement farfelue et stupide à l'époque, à savoir, qu'il existe une psychologie et une intelligence propres à l'animal, en écrivant la première partie de cette manière de diptyque -le second volet étant donc consacré plus spécifiquement aux violence et aux diverses barbaries que l'être humain est capable de faire subir à ses compagnons animaux -, il en déroute tellement la trame que l'on sent assez vite que c'est loin d'être le seul message qu'il a à nous délivrer. Ce qu'il a par ailleurs toujours fait dans la plupart de ses textes qu'il ne faut surtout jamais se contenter de lire sans recul ni recherche de second degré.
Un roman pas aussi évident qu'il y parait. Certainement pas à conseiller à des plus jeunes dans sa version complète. A ne pas ouvrir si l'on ne se sent pas apte à dépasser les réflexions les plus sombres et abjectes de l'auteur. Un texte intéressant, ne serait-ce que pour comprendre l'évolution de Jack London, appréhender cet homme incommensurablement complexe et ambigu qui allait décéder une année après la rédaction de cette histoire animalière - et tellement emplie de considérations humaines - et avant de l'avoir vu édité.
Ultime tentative aussi, d'un écrivain à bout de souffle : un rappel émouvant autant qu'inopérant - trop de mièvrerie dans les trois derniers chapitres, trop de fausse candeur, trop de rose bonbon - à son immense succès, Croc-Blanc, le petit Jerry parvenant à sauver, in extremis, ses sauveurs de la dernière heure en déjouant les sombres et meurtriers calculs d'un îlien échappé de prison et mis à prix. Deux chiens amoureux de leurs maîtres. Deux sauvetages. La ressemblance s'arrête malheureusement là.
Il se trouve beaucoup d'enfer dans ce livre. Beaucoup d'enfer dans le regard porté à ses semblables, d'une autre "race" ou de celle dont il se réclamait si souvent, trop souvent. le pire des enfers, ce n'était peut-être pas les autres, - comme le supposait Jean-Paul Sartre- , pour ce bon vieux Jack. Non : l'enfer, c'était peut-être devenu lui-même.