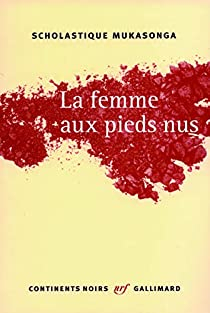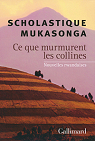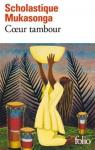Ce livre est un hommage à Stefania et à travers elle, à toutes les femmes rwandaises qui survivaient pour sauver leurs enfants d'une mort quasi-imminente. Dans cette courte autobiographie, Scholastique Mukasonga
nous plongé dans la vie des déportés Tutsi à Nyamata. Comment étaient conçues les maisons, comment étaient réparties les tâches dans la famille. Elle raconte l'éducation, les relations de voisinage, la médecine, les mariages, la beauté rwandaise, le pain, l'agriculture tel un art...
Elle évoque également la place de la colonisation : l'école, la messe, les prêtres, les prénoms chrétiens, le "progrès", ceux qu'on appelle les "évolués". Elle évoque également, les incursions et les exactions des soldats Hutus...
C'est vraiment très beau. Je recommande cette lecture si on souhaite lire sur le Rwanda d'avant 1994.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
nous plongé dans la vie des déportés Tutsi à Nyamata. Comment étaient conçues les maisons, comment étaient réparties les tâches dans la famille. Elle raconte l'éducation, les relations de voisinage, la médecine, les mariages, la beauté rwandaise, le pain, l'agriculture tel un art...
Elle évoque également la place de la colonisation : l'école, la messe, les prêtres, les prénoms chrétiens, le "progrès", ceux qu'on appelle les "évolués". Elle évoque également, les incursions et les exactions des soldats Hutus...
C'est vraiment très beau. Je recommande cette lecture si on souhaite lire sur le Rwanda d'avant 1994.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Un roman féministe
Publié en 2008 j'ai découvert ce roman récemment au hasard d'un échange avec l'autrice elle-même à l'occasion du prix Simone de Beauvoir qu'elle a reçu en 2021. C'est peu de dire que ce récit m'a touchée. C'est peut-être de tous les livres que j'ai lus de Scholatique Mukasonga, celui que je préfère. Livre "linceul", livre tombeau consacré à la mère, il est aussi le livre des femmes : mères, soeurs, tantes, voisines, amies. Hommage à la mère, Stefania, femme forte, mère protectrice, nourricière, curatrice, libre dans sa condition de déportée. Mais au delà de ça, c'est un livre de la féminité qui s'interroge sur l'image de la femme et sur sa représentation. C'est aussi un récit qui brise les tabous de la sexualité féminine, évoquant coutumes et mariages (réussis et manqués). Récit aussi de la terrible condition des femmes par temps de guerre, récit du viol, arme de destruction massive parce qu'il broie l'individu et démembre la structure sociale, met à mal la collectivité. Comment ne pas penser aux prix Nobel Denis Mukwege
dans ces pages qui évoquent le viol ? "les viols. Personne ne voulait en parler. Personne ne pouvait en parler. Il n'y avait rien dans la coutume qui permettait de faire face à cette catastrophe qui bouleversait les familles" . Pour lire des extraits cliquez sur mon adresse web.
Lien : https://twitter.com/claire_t..
Publié en 2008 j'ai découvert ce roman récemment au hasard d'un échange avec l'autrice elle-même à l'occasion du prix Simone de Beauvoir qu'elle a reçu en 2021. C'est peu de dire que ce récit m'a touchée. C'est peut-être de tous les livres que j'ai lus de Scholatique Mukasonga, celui que je préfère. Livre "linceul", livre tombeau consacré à la mère, il est aussi le livre des femmes : mères, soeurs, tantes, voisines, amies. Hommage à la mère, Stefania, femme forte, mère protectrice, nourricière, curatrice, libre dans sa condition de déportée. Mais au delà de ça, c'est un livre de la féminité qui s'interroge sur l'image de la femme et sur sa représentation. C'est aussi un récit qui brise les tabous de la sexualité féminine, évoquant coutumes et mariages (réussis et manqués). Récit aussi de la terrible condition des femmes par temps de guerre, récit du viol, arme de destruction massive parce qu'il broie l'individu et démembre la structure sociale, met à mal la collectivité. Comment ne pas penser aux prix Nobel Denis Mukwege
dans ces pages qui évoquent le viol ? "les viols. Personne ne voulait en parler. Personne ne pouvait en parler. Il n'y avait rien dans la coutume qui permettait de faire face à cette catastrophe qui bouleversait les familles" . Pour lire des extraits cliquez sur mon adresse web.
Lien : https://twitter.com/claire_t..
La femme aux pieds nus, c'est Stefania, la mère de l'auteur. Stefania et toute sa famille ont été déplacés, cantonnés dans une région du Rwanda, et quelques années après, seule l'auteur et un de ses frères survivront au génocide. Ceci, l'auteur l'a déjà raconté, (même si oui, cela ne peut jamais être trop raconté, en espérant aussi que cela serve de leçon à l'avenir), et ici, elle dessine surtout le portrait de sa mère, le portrait de toutes les Mères-courage du Rwanda, pour reprendre son expression, et de leur peur, hélas si réaliste; de leurs efforts désespérés pour tenter de bâtir une vie à leurs enfants dans cette région inconnue, en repartant de rien dans le plus grand dénuement.
Il y a dans ce livre une immense tristesse et une immense tendresse et nul n'en ressort indemne.
Il y a dans ce livre une immense tristesse et une immense tendresse et nul n'en ressort indemne.
Un hommage aux mères tutsies, et surtout Stefania, celle dont la fille a écrit ce livre. Des mères qui nourrissent, soignent, protègent, cultivent la terre, bâtissent les "inzus" (il ne faut pas dire "huttes"), arrangent les mariages, prient les dieux des ancêtres autant que la Vierge Marie. Les mères qui restent le pivot de ces populations tutsies, déportées par les hutus, l'ethnie dominante (des dominateurs qui deviendront, 30 ans plus tard, des assassins sans limites).
Le style est simple, descriptif, l'ensemble prend bien vite la forme d'un répertoire des traditions tutsies, ce qui est instructif en soi mais sans beaucoup d'émotion (à l'exception des rappels sur le destin tragique que connaîtront ces femmes et beaucoup de leurs enfants).
Un livre à lire pour découvrir un autre monde.
Le style est simple, descriptif, l'ensemble prend bien vite la forme d'un répertoire des traditions tutsies, ce qui est instructif en soi mais sans beaucoup d'émotion (à l'exception des rappels sur le destin tragique que connaîtront ces femmes et beaucoup de leurs enfants).
Un livre à lire pour découvrir un autre monde.
Très bel hommage à sa mère à laquelle elle n'a pu dire correctement au revoir, en déposant un pagne sur son corps. L'auteure nous dépeint également joliment des éclats de vie du Rwanda, et esquisse de belles images de son enfance rwandaise d'avant le genocide.
J'ai lu il y a peu de temps « j'ai cru qu'il enlevaient toute trace de toi » ♥️. Il aborde le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.
Mais ici, dans - La femme aux pieds nus - nous ne sommes pas face à un roman, à une fiction. Nous faisons frontalement face à la réalité.
« 𝘑𝘦 𝘯'𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢 𝘮è𝘳𝘦. 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘯'é𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳. 𝘓𝘦𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘶 𝘴'𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢𝘷𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘥é𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳é ».
Le ton est donné. Je passe de la découverte du génocide rwandais avec un roman/fiction, à une plongée même au coeur de l'horreur véritable.
Mukasonga a une écriture sans nul doute magnifique. Comment l'imaginer après de telles horreurs ? Ce récit est un hommage à sa mère, à ses racines, à son pays : « 𝘔𝘢𝘮𝘢𝘯, 𝘫𝘦 𝘯'é𝘵𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘯'𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 - 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘥'𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 - 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘳 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥é. 𝘌𝘵 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘶𝘷𝘳𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘩𝘳𝘢𝘴𝘦𝘴, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘢𝘩𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘤𝘦𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘦𝘯𝘵 ».
Ce livre est une autobiographie, un témoignage nécessaire - pour que chacun prenne conscience des horreurs se déroulant dans le monde. Tout en douceur et en vérité, il nous livre un récit dur mais d'une infinie beauté.
Mais ici, dans - La femme aux pieds nus - nous ne sommes pas face à un roman, à une fiction. Nous faisons frontalement face à la réalité.
« 𝘑𝘦 𝘯'𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢 𝘮è𝘳𝘦. 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘯'é𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳. 𝘓𝘦𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘶 𝘴'𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢𝘷𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘥é𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳é ».
Le ton est donné. Je passe de la découverte du génocide rwandais avec un roman/fiction, à une plongée même au coeur de l'horreur véritable.
Mukasonga a une écriture sans nul doute magnifique. Comment l'imaginer après de telles horreurs ? Ce récit est un hommage à sa mère, à ses racines, à son pays : « 𝘔𝘢𝘮𝘢𝘯, 𝘫𝘦 𝘯'é𝘵𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘯'𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 - 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘥'𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 - 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘳 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥é. 𝘌𝘵 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘶𝘷𝘳𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘩𝘳𝘢𝘴𝘦𝘴, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘢𝘩𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘤𝘦𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘦𝘯𝘵 ».
Ce livre est une autobiographie, un témoignage nécessaire - pour que chacun prenne conscience des horreurs se déroulant dans le monde. Tout en douceur et en vérité, il nous livre un récit dur mais d'une infinie beauté.
Après ma lecture de Notre-Dame du Nil, qui m'avait en partie frustrée par le rythme assez lent et l'histoire plutôt décousue, j'avais envie de découvrir d'autres écrits de Scholastique Mukasonga, sous un prisme plus biographique que romancé.
Je me suis donc lancée dans La femme aux pieds nus, hommage cathartique à la mère de l'auteur, assassinée durant le génocide rwandais. Dans ce court ouvrage, on y découvre la vie quotidienne d'une femme forcée à quitter la région qui l'a vue naître pour échapper à une ethnie régnante méprisante. Les préoccupations peuvent paraître sommaires, mais exigent du temps et de l'énergie : recherche de nourriture, culture d'un petit champ, entretien d'un jardin de plantes médicinales, respect de la coutume et de la religion. Mais aussi crainte incessante face aux exactions des soldats du gouvernement, qui pillent et violent leurs compatriotes tutsis qu'ils considèrent comme des moins que rien : leurs jours au Rwanda sont comptés.
Le texte est parsemé de kinyarwanda, et Scholastique Mukasongo excelle à nous faire revivre sa jeunesse, mais aussi à poser un regard objectif sur les paradoxes de son peuple et de ses moeurs : croyances ancestrales entremêlées à l'enseignement catholique, héritage colonial et méfiance envers les blancs, mais aussi sur la condition féminine, et sur la souplesse nécessaire lorsqu'il s'agit de recueillir les jeunes femmes violées à la grossesse inavouable.
Une très belle ode à une mère dédiée corps et âme à ses enfants, profondément attachée à ce qu'elle appelle son pays, et dans lequel elle ne reviendra jamais, et tentant de concilier le respect des coutumes et l'enchaînement tragique des évènements qui ont vu le massacre progressif d'un peuple.
Je me suis donc lancée dans La femme aux pieds nus, hommage cathartique à la mère de l'auteur, assassinée durant le génocide rwandais. Dans ce court ouvrage, on y découvre la vie quotidienne d'une femme forcée à quitter la région qui l'a vue naître pour échapper à une ethnie régnante méprisante. Les préoccupations peuvent paraître sommaires, mais exigent du temps et de l'énergie : recherche de nourriture, culture d'un petit champ, entretien d'un jardin de plantes médicinales, respect de la coutume et de la religion. Mais aussi crainte incessante face aux exactions des soldats du gouvernement, qui pillent et violent leurs compatriotes tutsis qu'ils considèrent comme des moins que rien : leurs jours au Rwanda sont comptés.
Le texte est parsemé de kinyarwanda, et Scholastique Mukasongo excelle à nous faire revivre sa jeunesse, mais aussi à poser un regard objectif sur les paradoxes de son peuple et de ses moeurs : croyances ancestrales entremêlées à l'enseignement catholique, héritage colonial et méfiance envers les blancs, mais aussi sur la condition féminine, et sur la souplesse nécessaire lorsqu'il s'agit de recueillir les jeunes femmes violées à la grossesse inavouable.
Une très belle ode à une mère dédiée corps et âme à ses enfants, profondément attachée à ce qu'elle appelle son pays, et dans lequel elle ne reviendra jamais, et tentant de concilier le respect des coutumes et l'enchaînement tragique des évènements qui ont vu le massacre progressif d'un peuple.
Dans un article paru dans le Monde (06.09.2019) j'ai appris l'origine de son nom : « Mukasonga. Votre prénom rwandais est devenu un nom de famille en France. Il vient du cri de ras-le-bol poussé par mon père à ma naissance. Mukasonga est un prénom qui signifie en kinyarwanda : « Encore une fille ! »J'arrivais après deux filles, ce qui n'est pas la meilleure place dans une fratrie. Au Rwanda, avoir une fille est souhaité à deux places bien précises : au rang d'aînée, pour qu'elle aide la maman au quotidien, et comme petite dernière, car on espère qu'elle deviendra le bâton de vieillesse des parents. En kinyarwanda, « muka » signifie « femme de » et « songa » désigne le point culminant de la colline ».
Roman autobiographique, hommage à sa famille, en particulier à sa mère Stefania, aux disparus du Rwanda et tout particulièrement de Nyamata. C'est un devoir de mémoire si je puis dire. Dans ce livre elle nous parle de sa mère et de sa préoccupation première : tout faire pour protéger et cacher ses enfants en cas d'attaque, assurer la survie de ses enfants.
Dans ce roman elle nous décrit la vie dans les camps, les travaux des champs, la culture et les multiples utilisations du sorgho blanc ou rouge,( la bière, les montures de lunettes, les poupées,), le respect des traditions ancestrales, la peur des soldats, la perdurance des valeurs fondamentales, les plantes médicinales, les recettes et les formules pour soigner; l'importance des voisins et des voisines, la culture locale, les traditions relatives au mariage. L'importance donnée aux vaches, au pain.. La façon dont Stefania a construit son « inzu » pour vivre comme avant. Elle nous parle du rôle de la mère dans la famille traditionnelle, la façon de vivre, les coutumes, les croyances, la communication avec les esprits. Elle fait revivre le Rwanda d'avant le génocide, à une époque où la guerre entre les Tutsis et les Hutu était déclarée, ses souvenirs d'enfance. C'est aussi la transmission orale faite par sa mère à ses enfants, comme c'était la coutume. Elle souligne la qualité de conteuse, de passeuse d'histoire de sa mère. Sa mère étant une « marieuse réputée», elle explique aussi les traditions relatives au mariage et au choix de l'épouse ; les critères de beauté sont extrêmement intéressants (la vache est la référence) et j'ai aussi adoré le passage sur l'importance des pieds.
C'est aussi la description de la façon dont les blancs se conduisent ; si tu ne te convertis pas au catholicisme, pas de prénom chrétien et donc… pas d'école.
Malgré le thème dur et dramatique, c'est une vie familiale qui transpire l'amour que nous transmet une survivante. Superbe témoignage qui a de plus un caractère particulier car elle emploie les mots de là-bas et que cela crée toute l'ambiance... Acheter le kalifuma chez le magendu… (pour info : le kalifuma ou Mirabilis jalapa ou la Belle de nuit a des propriétés antispasmodiques anti-fongique, antibactérien, antimicrobien et anti-virale)
Lien : https://www.cathjack.ch/word..
Roman autobiographique, hommage à sa famille, en particulier à sa mère Stefania, aux disparus du Rwanda et tout particulièrement de Nyamata. C'est un devoir de mémoire si je puis dire. Dans ce livre elle nous parle de sa mère et de sa préoccupation première : tout faire pour protéger et cacher ses enfants en cas d'attaque, assurer la survie de ses enfants.
Dans ce roman elle nous décrit la vie dans les camps, les travaux des champs, la culture et les multiples utilisations du sorgho blanc ou rouge,( la bière, les montures de lunettes, les poupées,), le respect des traditions ancestrales, la peur des soldats, la perdurance des valeurs fondamentales, les plantes médicinales, les recettes et les formules pour soigner; l'importance des voisins et des voisines, la culture locale, les traditions relatives au mariage. L'importance donnée aux vaches, au pain.. La façon dont Stefania a construit son « inzu » pour vivre comme avant. Elle nous parle du rôle de la mère dans la famille traditionnelle, la façon de vivre, les coutumes, les croyances, la communication avec les esprits. Elle fait revivre le Rwanda d'avant le génocide, à une époque où la guerre entre les Tutsis et les Hutu était déclarée, ses souvenirs d'enfance. C'est aussi la transmission orale faite par sa mère à ses enfants, comme c'était la coutume. Elle souligne la qualité de conteuse, de passeuse d'histoire de sa mère. Sa mère étant une « marieuse réputée», elle explique aussi les traditions relatives au mariage et au choix de l'épouse ; les critères de beauté sont extrêmement intéressants (la vache est la référence) et j'ai aussi adoré le passage sur l'importance des pieds.
C'est aussi la description de la façon dont les blancs se conduisent ; si tu ne te convertis pas au catholicisme, pas de prénom chrétien et donc… pas d'école.
Malgré le thème dur et dramatique, c'est une vie familiale qui transpire l'amour que nous transmet une survivante. Superbe témoignage qui a de plus un caractère particulier car elle emploie les mots de là-bas et que cela crée toute l'ambiance... Acheter le kalifuma chez le magendu… (pour info : le kalifuma ou Mirabilis jalapa ou la Belle de nuit a des propriétés antispasmodiques anti-fongique, antibactérien, antimicrobien et anti-virale)
Lien : https://www.cathjack.ch/word..
Peinture tendre de cette femme aux pieds nus, mère protectrice, figure fière, généreuse, qui essaie avec ténacité de retrouver un semblant de vie normale dans une région ingrate du Rwanda, après avoir été exilée de sa région natale où elle avait maison traditionnelle et troupeau. L'auteur nous offre le témoignage d' une tranche de cette vie communautaire harmonieuse que vinrent anéantir les massacres, la haine et les cris surgissant comme une apocalypse.
L'auteur rend hommage à sa mère, Stefania, une paysanne rwandaise à qui elle avait promis de recouvrir son corps d'un pagne à sa mort. Elle n'a pu le faire, sa mère étant victime du génocide tutsi en 1994 avec nombre de membres de sa famille. Elle lui dédie ce récit dans lequel elle conte son enfance.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Femme, femme, femme.
palamede
21 livres

Le Rwanda, 20 ans après
Bibalice
10 livres

Auteures africaines
Majuscaux
25 livres
Autres livres de Scholastique Mukasonga (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'homme au tabouret d'or !
Qui est Katabolonga ?
Le fils du roi Tsongor
Le frère du roi Tsongor
Le père du roi Tsongor
Le cousin du roi Tsongor
Le porteur du tabouret d'or
L'oncle du roi Tsongor
Le petit-fils du roi Tsongor
15 questions
594 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, afrique
, fantastique
, apparitionsCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu