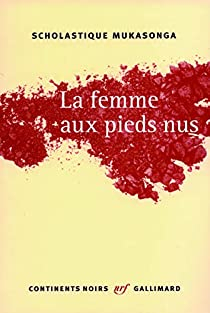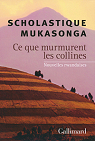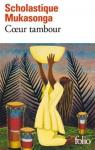J'ai vraiment apprécié ce livre à messages emboîtés. « La femme aux pieds nus », de Scholastique MUKANSONGA (lu en Ed. : Folio, n°5382) nous ouvre d'abord à la réalité de la vie rurale et ancestrale des Tutsis avant que ne commence leur exil forcé, au sein de leur propre pays. On est confronté à des pratiques agraires, culinaires qui nous semblent « tellement dépassées » … mais que nous serions incapables de reproduire nous-mêmes. On y découvre des techniques de construction, de gestion des espaces sociaux et les conventions qui les régissent. On y découvre la valeur du pain, de la voisine, du labeur, du partage des tâches. Et puis, on plonge au coeur des relations familiales, des croyances, fondées ou pas qui aident à vivre et des rôles tenus par ces mères-courage que représente cette femme aux pieds nus.
À un deuxième niveau, on découvre combien les mouvements ethniques de déportation mettent à mal la stabilité de ces us et coutumes. Combien ce mode de vie est nié, écrasé, méprisé par les pouvoirs qui se mettent en place, parfois en connivence, pour chasser les Tutsis et les conduire à l'extermination génocidaire que l'on sait. Ce pouvoir, il est tenu par les blancs qui ne peuvent admettre que leur modèle de société n'est pas nécessairement adapté aux colonies, par les militaires qui règnent par les armes, la peur, les viols et les massacres qu'ils s'autorisent et dont ils se félicitent. Mais aussi, parfois, par la religion qui s'impose au lieu de se proposer et qui, tout en étant vecteur de modernité (pas nécessairement positive), allume les moteurs de la peur, de la culpabilité et le spectre du châtiment éternel.
Au-delà du documentaire et des questions qu'il pose sur les prises du pouvoir, ce livre ouvre le lecteur à une réflexion plus large sur la répétition de l'Histoire des peuples expulsés, déportés, meurtris et amputés de leurs racines. Malgré les « plus jamais ça ! » des après- guerres, il y a encore tant d'exactions dans notre monde. Un livre qui jamais n'appelle à la violence, à la vengeance mais qui rappelle qu'on doit prendre conscience, se souvenir, faire mémoire. Seul chemin d'accès à un avenir capable de pouvoir tendre une main vers l'autre, une main sans machette, sans gourdin, sans poignard, bombe ou roquette. Une vraie main humaine, désarmée, désarmante !
À un deuxième niveau, on découvre combien les mouvements ethniques de déportation mettent à mal la stabilité de ces us et coutumes. Combien ce mode de vie est nié, écrasé, méprisé par les pouvoirs qui se mettent en place, parfois en connivence, pour chasser les Tutsis et les conduire à l'extermination génocidaire que l'on sait. Ce pouvoir, il est tenu par les blancs qui ne peuvent admettre que leur modèle de société n'est pas nécessairement adapté aux colonies, par les militaires qui règnent par les armes, la peur, les viols et les massacres qu'ils s'autorisent et dont ils se félicitent. Mais aussi, parfois, par la religion qui s'impose au lieu de se proposer et qui, tout en étant vecteur de modernité (pas nécessairement positive), allume les moteurs de la peur, de la culpabilité et le spectre du châtiment éternel.
Au-delà du documentaire et des questions qu'il pose sur les prises du pouvoir, ce livre ouvre le lecteur à une réflexion plus large sur la répétition de l'Histoire des peuples expulsés, déportés, meurtris et amputés de leurs racines. Malgré les « plus jamais ça ! » des après- guerres, il y a encore tant d'exactions dans notre monde. Un livre qui jamais n'appelle à la violence, à la vengeance mais qui rappelle qu'on doit prendre conscience, se souvenir, faire mémoire. Seul chemin d'accès à un avenir capable de pouvoir tendre une main vers l'autre, une main sans machette, sans gourdin, sans poignard, bombe ou roquette. Une vraie main humaine, désarmée, désarmante !
Un vibrant hommage à une mère courage écrit à la perfection, mon second roman de Schoslatisque Mukasonga.
« Ce livre est le linceul dont je n'ai pu parer ma mère. C'est aussi le bonheur déchirant de la faire revivre, elle qui, jusqu'au bout traquée, voulut nous sauver en déjouant pour nous la sanglante terreur du quotidien. C'est, au seuil de l'horrible génocide, son histoire, c'est notre histoire. »
***************************
« Quand je mourrai, quand vous me verrez morte, il faudra recouvrir mon corps. Personne ne doit voir, il ne faut pas laisser voir le corps d'une mère. C'est vous mes filles qui devez le recouvrir, c'est à vous seules que cela revient… »
Scholastique Mukasonga n'a pas pu recouvrir le corps de sa mère, ses restes ont disparus. On l'a froidement assassinée, démembrée à coup de machettes en avril 1994, lors du génocide des Tutsis au Rwanda. En faisant revivre ses secrets, elle nous livre ici le témoignage touchant de la femme aux pieds nus, Stefania, cette femme courageuse dont la mission première fut de protéger ses enfants. Sachant que le seul asile était de franchir la frontière du Burundi, elle élaborait pour eux des plans d'évasion, des cachettes où se dissimuler, explorant chaque jour le chemin de brousse menant à la frontière. Quelques provisions étaient soigneusement préparées pour la fuite, lorsqu'il serait temps de partir et que la menace serait si grande qu'ils n'auraient pas même le temps de se dire adieu. Car ils partiraient seuls, ses parents ayant choisi de mourir au Rwanda, sur la terre de leur enfance…
Ce récit extrêmement émouvant est marqué au fer rouge par cette période sombre de l'histoire d'un génocide qui a tué plus de 800 000 innocents au nom d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais. Les soldats ont pris les armes, ils ont saccagé, pillé et terrorisé. Ils ont violé des milliers de femmes et laissé derrière elles des images de terreur qui hanteront à jamais le cauchemar des survivantes. Stefania et sa famille ont été déportées à Nyamata, où 50 000 Tutsis ont été assassinés sur la commune. Les « maisons de Tripoli » (cases des déplacés) étaient alignées, Stefania rêvait encore d'y construire l'inzu (sa maison). Les militaires du camp de Gako, établis aux frontières du Burundi, y faisaient irruption à tout moment de la nuit. Sous mes yeux de femme occidentalisée, et au regard de ma sensibilité face aux injustices planétaires et à toutes formes de mépris et de haine, qu'elles passent par les guerres, les génocides, les famines ou les exodes, je n'arriverai jamais à comprendre toute cette violence humaine…
« Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur la page du cahier, tissant et retissant le linceul de ton corps absent. »
Dans ce tableau noir de la déportation, des persécutions et de l'exil, Mukasonka a aussi tenu à nous peindre l'Afrique de son enfance, celui des odeurs, des saveurs et des richesses de la savane. Comme une manière de tamiser l'horreur de souvenirs tendres, une sorte de rappel qui s'éveille à la mémoire d'une enfant blessée dans ce qu'elle a de plus fondamental, l'amour à sa mère disparue. Elle partage avec nous les rites et traditions, les vertus des plantes médicinales, l'heure des contes, à la nuit tombée, la moisson, les rires, les chants et les danses. Sous les caféiers, les femmes s'adonnaient à ce précieux rituel du lavage de pieds dans l'herbe fraîche de rosée, goûtant le jus sucré et doux comme le miel du sorgho. Si ce récit est triste, les pages sont parfumées de l'odeur du manioc, des haricots fraîchement cueillis, des patates douces, des bananiers et des calebasses de bière. Au village, les mères venaient chaque jour rendre visite à Stefania, une marieuse réputée qui trouvait un homme à leurs filles. Elle était respectée de tous.
Ce récit est un vibrant hommage à cette mère, Stefania, et à toutes les femmes du Rwanda. Dans la brousse hostile, aucune guerre ne sera jamais arrivée à détruire en elles leur courage, leur instinct de survie, leur fierté, l'entraide et la solidarité. Ces femmes sont un modèle. Je n'oublierai jamais leur histoire…
«Le Rwanda aujourd'hui, c'est le pays des Mères-Courage»
Je dédie cette lecture à A-M Habyalimana, femme-courage et amie de toujours. À son père et son frère Jean-Luc qui ont trouvé la mort durant le génocide.
Lien : http://www.lamarreedesmots.c..
***************************
« Quand je mourrai, quand vous me verrez morte, il faudra recouvrir mon corps. Personne ne doit voir, il ne faut pas laisser voir le corps d'une mère. C'est vous mes filles qui devez le recouvrir, c'est à vous seules que cela revient… »
Scholastique Mukasonga n'a pas pu recouvrir le corps de sa mère, ses restes ont disparus. On l'a froidement assassinée, démembrée à coup de machettes en avril 1994, lors du génocide des Tutsis au Rwanda. En faisant revivre ses secrets, elle nous livre ici le témoignage touchant de la femme aux pieds nus, Stefania, cette femme courageuse dont la mission première fut de protéger ses enfants. Sachant que le seul asile était de franchir la frontière du Burundi, elle élaborait pour eux des plans d'évasion, des cachettes où se dissimuler, explorant chaque jour le chemin de brousse menant à la frontière. Quelques provisions étaient soigneusement préparées pour la fuite, lorsqu'il serait temps de partir et que la menace serait si grande qu'ils n'auraient pas même le temps de se dire adieu. Car ils partiraient seuls, ses parents ayant choisi de mourir au Rwanda, sur la terre de leur enfance…
Ce récit extrêmement émouvant est marqué au fer rouge par cette période sombre de l'histoire d'un génocide qui a tué plus de 800 000 innocents au nom d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais. Les soldats ont pris les armes, ils ont saccagé, pillé et terrorisé. Ils ont violé des milliers de femmes et laissé derrière elles des images de terreur qui hanteront à jamais le cauchemar des survivantes. Stefania et sa famille ont été déportées à Nyamata, où 50 000 Tutsis ont été assassinés sur la commune. Les « maisons de Tripoli » (cases des déplacés) étaient alignées, Stefania rêvait encore d'y construire l'inzu (sa maison). Les militaires du camp de Gako, établis aux frontières du Burundi, y faisaient irruption à tout moment de la nuit. Sous mes yeux de femme occidentalisée, et au regard de ma sensibilité face aux injustices planétaires et à toutes formes de mépris et de haine, qu'elles passent par les guerres, les génocides, les famines ou les exodes, je n'arriverai jamais à comprendre toute cette violence humaine…
« Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur la page du cahier, tissant et retissant le linceul de ton corps absent. »
Dans ce tableau noir de la déportation, des persécutions et de l'exil, Mukasonka a aussi tenu à nous peindre l'Afrique de son enfance, celui des odeurs, des saveurs et des richesses de la savane. Comme une manière de tamiser l'horreur de souvenirs tendres, une sorte de rappel qui s'éveille à la mémoire d'une enfant blessée dans ce qu'elle a de plus fondamental, l'amour à sa mère disparue. Elle partage avec nous les rites et traditions, les vertus des plantes médicinales, l'heure des contes, à la nuit tombée, la moisson, les rires, les chants et les danses. Sous les caféiers, les femmes s'adonnaient à ce précieux rituel du lavage de pieds dans l'herbe fraîche de rosée, goûtant le jus sucré et doux comme le miel du sorgho. Si ce récit est triste, les pages sont parfumées de l'odeur du manioc, des haricots fraîchement cueillis, des patates douces, des bananiers et des calebasses de bière. Au village, les mères venaient chaque jour rendre visite à Stefania, une marieuse réputée qui trouvait un homme à leurs filles. Elle était respectée de tous.
Ce récit est un vibrant hommage à cette mère, Stefania, et à toutes les femmes du Rwanda. Dans la brousse hostile, aucune guerre ne sera jamais arrivée à détruire en elles leur courage, leur instinct de survie, leur fierté, l'entraide et la solidarité. Ces femmes sont un modèle. Je n'oublierai jamais leur histoire…
«Le Rwanda aujourd'hui, c'est le pays des Mères-Courage»
Je dédie cette lecture à A-M Habyalimana, femme-courage et amie de toujours. À son père et son frère Jean-Luc qui ont trouvé la mort durant le génocide.
Lien : http://www.lamarreedesmots.c..
Ce livre m'a beaucoup plu car il est à la fois émouvant mais aussi très simple, il est compréhensible et c'est ce qui en fait un livre entraînant. A travers son récit l'auteur nous permet découvrir le Rwanda. Durant la lecture nous voyageons sans jamais quitter notre position, c'est une vraie découverte avec : les traditions, les fruits et légumes typiquement Africain, mais aussi le vocabulaire Rwandais, le voyage est prolifique. Connaissant les origines de l'auteur, lexique est assez curieux car ce livre est de fait adressé au Rwandais. Mais malgré ses quelques problèmes de lexique le rythme et la construction des phrases restent tout à fait lisible.
L'une de mes phrase fétiche : "Ouvre les Yeux et, désormais, que tu saches quel est ton chemin.
L'une de mes phrase fétiche : "Ouvre les Yeux et, désormais, que tu saches quel est ton chemin.
Un livre d'amour né dans la violence.
« La femme aux pieds nus », c'est la mère de Scholastique Mukasonga, Stefania, morte sous la lame des Hutus lors du génocide de 1994 au Rwanda. L'auteur revient sur ses souvenirs d'enfance et rend hommage à sa mère à travers la description de leur vie quotidienne.
Leur vie, à l'époque décrite, c'est celle dans le Bugesera, cette région insalubre où les Tutsis, rescapés des massacres ethniques qui avaient déferlé en vagues successives sur le pays depuis 1959, ont été déportés au début des années 1960, lorsque les Hutus ont pris le pouvoir. A Gitagata, la vie n'est pas facile. La terre n'est guère propice à la culture, les habitants sont privés d'élevage faute de posséder une vache et les jeunes miliciens hutus sont toujours à l'affût pour les persécuter, voire pire. La première préoccupation de Stefania est d'ailleurs de protéger ses enfants. Toujours aux aguets, elle imagine toutes sortes de stratagèmes pour les cacher, que ce soit dans la maison ou dans la brousse. Sauver les enfants, rien n'est plus important. Les brimades, les arrestations et les saccages sont monnaie courante. Mais il faut survivre quoiqu'il arrive.
Stefania, c'est cette mère qui ne s'est jamais avouée vaincue. Relogée dans la maison de Tripolo, ce logis des Blancs fait de tôles et d'angles droits, elle décide de rebâtir son inzu, cette hutte de chaume et de bambou toute en rondeurs. Au coeur de sa maison, elle veille sur sa famille en effectuant chaque jour les mêmes gestes : souffler sur les braises avant l'aube pour raviver le feu, balayer la maison et la cour avec un faisceau d'herbes fines, surveiller la potée de haricots qui cuit lentement sur les trois pierres du foyer. C'est également dans ce lieu qu'elle raconte et transmet à ses enfants tout son savoir ancestral. Ainsi, en mémoire de sa mère, Scholastique Mukasonga nous fait partager cette vie traditionnelle à la campagne, celle des femmes rwandaises : la longue culture du sorgho et la fabrication de sa bière, ou encore le soin apporté aux plantes médicinales, tâche réservée aux femmes dans leur petit potager. le dimanche, à l'heure des réunions entre femmes, dans l'ikigo, l'arrière-cour qui est le domaine des femmes, les discussions vont bon train. Stefania, marieuse réputée, apporte son avis sur les qualités et défauts des jeunes filles bonnes à marier, sur les grossesses qui tardent à venir chez les jeunes couples. C'est le moment aussi où l'on commente les signes du progrès qui arrivent jusqu'à Gitagata : les toilettes de Félicité, le port des caleçons chez les jeunes filles ou encore le kanta qui garde les cheveux bien noirs. Si la modernité se répand, il reste cependant des rites traditionnels qui eux seuls peuvent effacer les atrocités commises sur les jeunes filles tutsies. le viol, utilisé systématiquement lors du génocide par les hutus, était déjà la menace qui planait sur les jeunes filles tutsies dans les années 1960. Mais là aussi, en invoquant les Esprits, les femmes savent conjurer le mauvais sort.
Stefania et les autres femmes, ce sont ces « gardiennes de la vie », pour qui solidarité et entraide ne sont pas de vains mots.
Dans cette société rwandaise traditionnelle, tout repose sur les relations entre les voisins, sur des usages de politesse, de respect et de solidarité. Tout le monde se connaît, du plus jeune au plus vieux. On travaille ensemble dans les champs, on partage les repas de famille, on célèbre en communauté les événements heureux et malheureux. Et c'est toujours dans cette proximité quotidienne que le génocide de 1994 s'est produit. Les politiques et les militaires se sont appuyés sur ces relations de voisinage pour trouver les tueurs idéaux. Galvanisé par des discours de haine, le voisin est devenu le bourreau. Et c'est également de ce fait que de nombreux tribunaux populaires, les gacacas, ont vu le jour au lendemain du génocide. Tu as tué ton voisin, alors ton juge sera ton voisin. Ton avocat sera ton voisin. le procureur sera ton voisin.
Stefania, son mari et ses enfants sont ainsi morts assassinés chez eux. Scholastique Mukasonga n'était pas là. Ses mots servent aujourd'hui à faire son deuil. Ils servent également à faire revivre sa mère, ces femmes, ces hommes et ces enfants qui partageaient autrefois des pratiques et des histoires. Que Madame Mukasonga se rassure. Comme sa mère, elle a réussi à transmettre à son lecteur une autre vision du Rwanda que celle du génocide. Un Rwanda rempli des couleurs des pagnes des jeunes filles, des rires des enfants au milieu du sorgho, de l'odeur des pipes et du bruit des femmes qui discutent, discutent, discutent…
Leur vie, à l'époque décrite, c'est celle dans le Bugesera, cette région insalubre où les Tutsis, rescapés des massacres ethniques qui avaient déferlé en vagues successives sur le pays depuis 1959, ont été déportés au début des années 1960, lorsque les Hutus ont pris le pouvoir. A Gitagata, la vie n'est pas facile. La terre n'est guère propice à la culture, les habitants sont privés d'élevage faute de posséder une vache et les jeunes miliciens hutus sont toujours à l'affût pour les persécuter, voire pire. La première préoccupation de Stefania est d'ailleurs de protéger ses enfants. Toujours aux aguets, elle imagine toutes sortes de stratagèmes pour les cacher, que ce soit dans la maison ou dans la brousse. Sauver les enfants, rien n'est plus important. Les brimades, les arrestations et les saccages sont monnaie courante. Mais il faut survivre quoiqu'il arrive.
Stefania, c'est cette mère qui ne s'est jamais avouée vaincue. Relogée dans la maison de Tripolo, ce logis des Blancs fait de tôles et d'angles droits, elle décide de rebâtir son inzu, cette hutte de chaume et de bambou toute en rondeurs. Au coeur de sa maison, elle veille sur sa famille en effectuant chaque jour les mêmes gestes : souffler sur les braises avant l'aube pour raviver le feu, balayer la maison et la cour avec un faisceau d'herbes fines, surveiller la potée de haricots qui cuit lentement sur les trois pierres du foyer. C'est également dans ce lieu qu'elle raconte et transmet à ses enfants tout son savoir ancestral. Ainsi, en mémoire de sa mère, Scholastique Mukasonga nous fait partager cette vie traditionnelle à la campagne, celle des femmes rwandaises : la longue culture du sorgho et la fabrication de sa bière, ou encore le soin apporté aux plantes médicinales, tâche réservée aux femmes dans leur petit potager. le dimanche, à l'heure des réunions entre femmes, dans l'ikigo, l'arrière-cour qui est le domaine des femmes, les discussions vont bon train. Stefania, marieuse réputée, apporte son avis sur les qualités et défauts des jeunes filles bonnes à marier, sur les grossesses qui tardent à venir chez les jeunes couples. C'est le moment aussi où l'on commente les signes du progrès qui arrivent jusqu'à Gitagata : les toilettes de Félicité, le port des caleçons chez les jeunes filles ou encore le kanta qui garde les cheveux bien noirs. Si la modernité se répand, il reste cependant des rites traditionnels qui eux seuls peuvent effacer les atrocités commises sur les jeunes filles tutsies. le viol, utilisé systématiquement lors du génocide par les hutus, était déjà la menace qui planait sur les jeunes filles tutsies dans les années 1960. Mais là aussi, en invoquant les Esprits, les femmes savent conjurer le mauvais sort.
Stefania et les autres femmes, ce sont ces « gardiennes de la vie », pour qui solidarité et entraide ne sont pas de vains mots.
Dans cette société rwandaise traditionnelle, tout repose sur les relations entre les voisins, sur des usages de politesse, de respect et de solidarité. Tout le monde se connaît, du plus jeune au plus vieux. On travaille ensemble dans les champs, on partage les repas de famille, on célèbre en communauté les événements heureux et malheureux. Et c'est toujours dans cette proximité quotidienne que le génocide de 1994 s'est produit. Les politiques et les militaires se sont appuyés sur ces relations de voisinage pour trouver les tueurs idéaux. Galvanisé par des discours de haine, le voisin est devenu le bourreau. Et c'est également de ce fait que de nombreux tribunaux populaires, les gacacas, ont vu le jour au lendemain du génocide. Tu as tué ton voisin, alors ton juge sera ton voisin. Ton avocat sera ton voisin. le procureur sera ton voisin.
Stefania, son mari et ses enfants sont ainsi morts assassinés chez eux. Scholastique Mukasonga n'était pas là. Ses mots servent aujourd'hui à faire son deuil. Ils servent également à faire revivre sa mère, ces femmes, ces hommes et ces enfants qui partageaient autrefois des pratiques et des histoires. Que Madame Mukasonga se rassure. Comme sa mère, elle a réussi à transmettre à son lecteur une autre vision du Rwanda que celle du génocide. Un Rwanda rempli des couleurs des pagnes des jeunes filles, des rires des enfants au milieu du sorgho, de l'odeur des pipes et du bruit des femmes qui discutent, discutent, discutent…
La femme aux pieds nus n'est autre que Stéfania, la mère de l'auteur, massacrée comme tant d'autres lors du génocide rwandais de 1994. le génocide n'est pas le thème central de ce livre, mais il est sous-jacent à chaque page, la présence des militaires et des jeunes hutus est menaçante et fait vivre la famille dans une tension constante.
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". de nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". de nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
Superbe histoire. Scholastique Mukasonga nous raconte sa jeunesse au Rwanda, durant la période du génocide des Tutsi. le livre nous place dans un monde que nous ne connaissons pas, la vie de tous les jours chez ses réfugiés, leurs usages, leurs traditions, leurs façons de vivre. C'est une partie de la vie de l'écrivain que nous découvrons.
Vingt-sept membres de la famille de l'écrivaine ont été massacrés pendant le génocide rwandais. Stefania, sa mère tutsie, était des victimes et ce livre rend un hommage magnifique à cette femme africaine contrainte à l'exil avec sa famille à Nyamata, sous la perpétuelle menace des soldats hutus du camp Gako. Nous sommes dans la région inhospitalière du Bugesera, là où sont déportés les tutsis du nord depuis les massacres ethniques qui les ravagèrent en vagues successives depuis 1959.
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu'il avait droit au premier des droits de l'homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu'il avait droit au premier des droits de l'homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
Stéfania, quelle mère, quel exemple, tous les gestes du quotidien deviennent des instants d'une beauté pure. Livre exceptionnel, merci Sholastique Mukasonga
Les Dernières Actualités
Voir plus

Femme, femme, femme.
palamede
21 livres

Le Rwanda, 20 ans après
Bibalice
10 livres

Auteures africaines
Majuscaux
25 livres
Autres livres de Scholastique Mukasonga (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'homme au tabouret d'or !
Qui est Katabolonga ?
Le fils du roi Tsongor
Le frère du roi Tsongor
Le père du roi Tsongor
Le cousin du roi Tsongor
Le porteur du tabouret d'or
L'oncle du roi Tsongor
Le petit-fils du roi Tsongor
15 questions
594 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, afrique
, fantastique
, apparitionsCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu