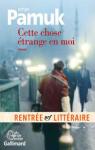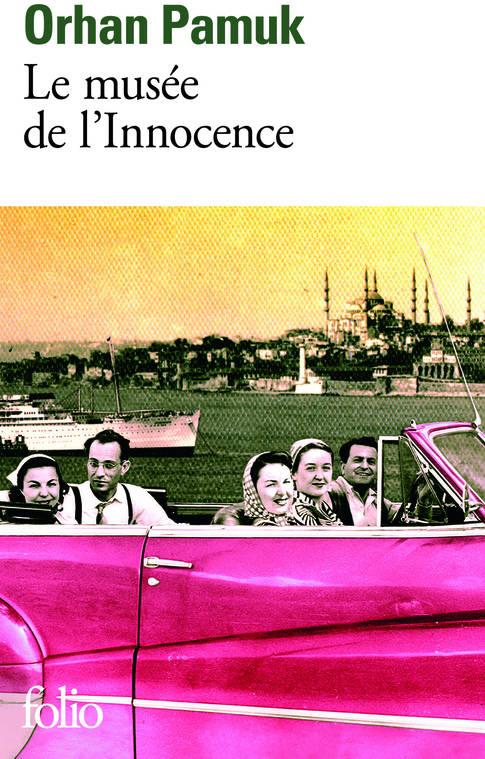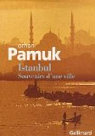Prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk est né et vit à Istanbul, point de rencontre de l'Orient et de l'Occident, carrefour d'influences culturelles qui ne sont pas vraiment compatibles et dont il est un observateur critique avisé. Pour Les nuits de la peste, son dernier roman, il a imaginé une épidémie de peste en 1901 à Mingher, une île fictive de la Méditerranée orientale, au sein de l'Empire ottoman.
Un gros pavé de sept cents pages, tellement riche et foisonnant qu'il est difficile de le définir ! Essayons d'y voir clair et commençons par le coeur du sujet.
Sur l'île de Mingher, les références spirituelles sont partagées entre l'islam et le christianisme orthodoxe. Une partie des habitants est tentée par la modernité et la libre entreprise, l'autre partie est attachée aux traditions et à la soumission. le Gouverneur, nommé par le Sultan, n'a pas la tâche facile pour répondre en même temps à la raison et aux croyances, pour accompagner les initiatives des uns et respecter le fatalisme des autres. Quand toutefois apparaissent les premiers indices d'une épidémie de peste, la dénégation est unanime : « il n'y a pas de peste chez nous ». le clivage ne se manifeste qu'ensuite ; dans la frange la moins éduquée de la population, on se demande si les médecins, formés en Occident, n'ont pas importé eux-mêmes le bacille ! La suspicion s'étend lors de la mise en place de mesures sanitaires – quarantaine, isolement des malades, destruction d'effets contaminés, fermetures –, chaque groupe y voyant une stratégie complotiste d'un groupe adverse. Contestations, rebellions, violences ; la répression se veut implacable, la tension devient extrême.
Mais à la surprise des observateurs, l'épidémie joue un rôle déclencheur dans la destinée de Mingher. L'auteur a imaginé que face à l'incapacité de l'Empire à endiguer l'épidémie, les institutions basculent : un militaire laïque prend le pouvoir, déclare l'indépendance de Mingher, mais ne parvient pas à améliorer la situation sanitaire ; le théologien islamique qui prend sa place fait encore pire. Puis, dans l'île qu'un blocus isole du reste du monde, s'installe peu à peu un sentiment national autour d'une légende mythologique « minghérienne », dans laquelle finissent par se reconnaître tous les corps sociaux… Un sentiment national assez puissant pour devenir un jour absurde et excessif…
La fiction s'accompagne d'un aperçu documentaire sur un Empire ottoman en déclin, proche de sa chute : bureaucratie ubuesque, pouvoir absolu d'un sultan à bout de souffle, insignifiance d'une famille de princes trop gâtés pour être capables de quoi que ce soit et vanités de princesses plus subtiles qu'il n'y parait, mais recluses dans leurs palais.
Une exception : par la justesse d'observations transcrites dans sa vaste correspondance, la princesse Pakizê, nièce du sultan au pouvoir, marque les événements et leur récit de son empreinte. Élevée à Istanbul, intronisée à Arkaz (capitale de Mingher), puis réfugiée à Hong Kong avant de finir ses jours à Genève, elle mène avec son mari, le docteur Nuri, une longue histoire d'amour, dont l'harmonie tranche avec d'autres, brisées tragiquement.
Réunir dans un même livre le récit des aventures surprenantes d'une princesse-sultane, une spectaculaire fresque sociopolitique et une saga historique authentique constitue une véritable prouesse littéraire. Ajoutons que les péripéties racontées sont l'occasion pour le lecteur de contempler les beautés naturelles de l'île, de respirer l'atmosphère des avenues élégantes et des faubourgs populaires d'Arkaz ; la profusion de détails est telle qu'on en oublie que Mingher n'existe pas. Ajoutons encore que Pamuk fait mine de céder ses talents de conteur et la fluidité de sa plume à une narratrice qui réserve quelques surprises dans le dernier chapitre.
Ma critique, écrite après avoir refermé le livre, pourrait sembler dithyrambique. Je n'oublie pourtant pas l'ennui parfois ressenti au cours de ma lecture, la difficulté à lire plus de dix pages à la suite, l'impression d'errer péniblement sans savoir où j'en étais ni où j'allais. Comment l'expliquer ? Peut-être ai-je été anémié par l'extrême chaleur de ce mois d'août… Et si, tout simplement, lire Les nuits de la peste méritait de prendre tout son temps. Orhan Pamuk lui-même a bien mis cinq ans à l'écrire !
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Un gros pavé de sept cents pages, tellement riche et foisonnant qu'il est difficile de le définir ! Essayons d'y voir clair et commençons par le coeur du sujet.
Sur l'île de Mingher, les références spirituelles sont partagées entre l'islam et le christianisme orthodoxe. Une partie des habitants est tentée par la modernité et la libre entreprise, l'autre partie est attachée aux traditions et à la soumission. le Gouverneur, nommé par le Sultan, n'a pas la tâche facile pour répondre en même temps à la raison et aux croyances, pour accompagner les initiatives des uns et respecter le fatalisme des autres. Quand toutefois apparaissent les premiers indices d'une épidémie de peste, la dénégation est unanime : « il n'y a pas de peste chez nous ». le clivage ne se manifeste qu'ensuite ; dans la frange la moins éduquée de la population, on se demande si les médecins, formés en Occident, n'ont pas importé eux-mêmes le bacille ! La suspicion s'étend lors de la mise en place de mesures sanitaires – quarantaine, isolement des malades, destruction d'effets contaminés, fermetures –, chaque groupe y voyant une stratégie complotiste d'un groupe adverse. Contestations, rebellions, violences ; la répression se veut implacable, la tension devient extrême.
Mais à la surprise des observateurs, l'épidémie joue un rôle déclencheur dans la destinée de Mingher. L'auteur a imaginé que face à l'incapacité de l'Empire à endiguer l'épidémie, les institutions basculent : un militaire laïque prend le pouvoir, déclare l'indépendance de Mingher, mais ne parvient pas à améliorer la situation sanitaire ; le théologien islamique qui prend sa place fait encore pire. Puis, dans l'île qu'un blocus isole du reste du monde, s'installe peu à peu un sentiment national autour d'une légende mythologique « minghérienne », dans laquelle finissent par se reconnaître tous les corps sociaux… Un sentiment national assez puissant pour devenir un jour absurde et excessif…
La fiction s'accompagne d'un aperçu documentaire sur un Empire ottoman en déclin, proche de sa chute : bureaucratie ubuesque, pouvoir absolu d'un sultan à bout de souffle, insignifiance d'une famille de princes trop gâtés pour être capables de quoi que ce soit et vanités de princesses plus subtiles qu'il n'y parait, mais recluses dans leurs palais.
Une exception : par la justesse d'observations transcrites dans sa vaste correspondance, la princesse Pakizê, nièce du sultan au pouvoir, marque les événements et leur récit de son empreinte. Élevée à Istanbul, intronisée à Arkaz (capitale de Mingher), puis réfugiée à Hong Kong avant de finir ses jours à Genève, elle mène avec son mari, le docteur Nuri, une longue histoire d'amour, dont l'harmonie tranche avec d'autres, brisées tragiquement.
Réunir dans un même livre le récit des aventures surprenantes d'une princesse-sultane, une spectaculaire fresque sociopolitique et une saga historique authentique constitue une véritable prouesse littéraire. Ajoutons que les péripéties racontées sont l'occasion pour le lecteur de contempler les beautés naturelles de l'île, de respirer l'atmosphère des avenues élégantes et des faubourgs populaires d'Arkaz ; la profusion de détails est telle qu'on en oublie que Mingher n'existe pas. Ajoutons encore que Pamuk fait mine de céder ses talents de conteur et la fluidité de sa plume à une narratrice qui réserve quelques surprises dans le dernier chapitre.
Ma critique, écrite après avoir refermé le livre, pourrait sembler dithyrambique. Je n'oublie pourtant pas l'ennui parfois ressenti au cours de ma lecture, la difficulté à lire plus de dix pages à la suite, l'impression d'errer péniblement sans savoir où j'en étais ni où j'allais. Comment l'expliquer ? Peut-être ai-je été anémié par l'extrême chaleur de ce mois d'août… Et si, tout simplement, lire Les nuits de la peste méritait de prendre tout son temps. Orhan Pamuk lui-même a bien mis cinq ans à l'écrire !
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
« La princesse Pakizê et son mari, tels deux héros de ces romans de détectives dont raffolait le sultan, déployèrent beaucoup d'énergie et d'intelligence pour essayer de résoudre l'énigme du meurtre de Bonkowski Pacha. Parfois, à cause de la haine qu'elle avait de son oncle, la logique de la princesse sultane se laissait égarer par ses sentiments, chose tout à fait indigne de Sherlock Holmes, et elle était alors certaine, à l'instinct mais certaine, que c'était son oncle, le malveillant Abdülhamid, qui avait fait assassiner Bonkowski Pacha. Et quand son mari écartait son hypothèse au motif que, non, impossible, et la preuve c'est que votre oncle nous a engagés comme détectives, elle trouvait son raisonnement stupide, humiliant, et à la fin le fit savoir. »
Le personnage de cette princesse Pakizê est au coeur de ce roman foisonnant. Son père a brièvement été sultan de l'empire ottoman, avant d'être renversé par son frère, le sultan Abdülhamid. Leur famille est depuis tenue en semi-captivité au palais. Nous sommes en 1901. Pakizê a été mariée par le sultan à un certain Docteur Nuri, spécialiste de la peste, au physique ingrat. Contre toute attente, c'est une bonne pioche car ces deux-là deviennent vite inséparables. Alors qu'ils se dirigent vers la Chine pour participer à un congrès, le bateau qui transporte la délégation ottomane est déroutée vers l'île de Mingher, une île (imaginaire) située non loin de Rhodes. Un foyer de peste y a été détecté et les deux plus fameux médecins de l'empire y sont déjà. Mais l'un deux, Bonkowski Pacha est assassiné.
Ohran Pamuk sait dérouler patiemment le fil de ses intrigues, avec lenteur souvent et ici, il faut bien le dire, avec aussi beaucoup de redites imposées par le sujet. Comme c'était pour moi une lecture de vacances, j'ai pris tout le temps nécessaire pour m'imprégner de ce roman. J'ai réellement l'impression d'avoir arpenté les rues d'Arkaz dans tous les sens, en compagnie des nombreux protagonistes de cette satire. Pour cela, je me suis souvent référé à la carte d'Arkaz placée au début.
Sur cette île, où musulmans et chrétiens grecs ont des populations équivalentes, tout est explosif. La peste sera un révélateur terrible de toutes ces tensions et ces manoeuvres politiques. Un nationalisme minghérien verra le jour : les autochtones y parlent une langue ancienne tout à fait originale.
J'ai été séduit par ce roman, à la construction astucieuse, malgré son côté étouffant. Au fur et à mesure de la progression de la peste, beaucoup voudraient fuir cette île et leurs responsabilités. Mais ce ne sera pas possible…
Le personnage de cette princesse Pakizê est au coeur de ce roman foisonnant. Son père a brièvement été sultan de l'empire ottoman, avant d'être renversé par son frère, le sultan Abdülhamid. Leur famille est depuis tenue en semi-captivité au palais. Nous sommes en 1901. Pakizê a été mariée par le sultan à un certain Docteur Nuri, spécialiste de la peste, au physique ingrat. Contre toute attente, c'est une bonne pioche car ces deux-là deviennent vite inséparables. Alors qu'ils se dirigent vers la Chine pour participer à un congrès, le bateau qui transporte la délégation ottomane est déroutée vers l'île de Mingher, une île (imaginaire) située non loin de Rhodes. Un foyer de peste y a été détecté et les deux plus fameux médecins de l'empire y sont déjà. Mais l'un deux, Bonkowski Pacha est assassiné.
Ohran Pamuk sait dérouler patiemment le fil de ses intrigues, avec lenteur souvent et ici, il faut bien le dire, avec aussi beaucoup de redites imposées par le sujet. Comme c'était pour moi une lecture de vacances, j'ai pris tout le temps nécessaire pour m'imprégner de ce roman. J'ai réellement l'impression d'avoir arpenté les rues d'Arkaz dans tous les sens, en compagnie des nombreux protagonistes de cette satire. Pour cela, je me suis souvent référé à la carte d'Arkaz placée au début.
Sur cette île, où musulmans et chrétiens grecs ont des populations équivalentes, tout est explosif. La peste sera un révélateur terrible de toutes ces tensions et ces manoeuvres politiques. Un nationalisme minghérien verra le jour : les autochtones y parlent une langue ancienne tout à fait originale.
J'ai été séduit par ce roman, à la construction astucieuse, malgré son côté étouffant. Au fur et à mesure de la progression de la peste, beaucoup voudraient fuir cette île et leurs responsabilités. Mais ce ne sera pas possible…
Il y a des livres vis-à-vis desquels je ressens une forme de loyauté aussi pesante que révérente. Malgré la langueur qui me saisissait systématiquement après trois ou quatre pages, malgré mon incapacité à mémoriser le nom de tous les personnages, et l'impression persistante que, de toute manière, ça n'avait pas beaucoup d'importance car tous finiraient par voir leur statut social cul par-dessus tête voire mourir de la peste, Les nuits de la peste m'ont imposé cette déférente aliénation tout le temps, interminable, qu'a duré ma lecture.
Il faut dire que les circonstances de cette lecture ont compris de longues journées de chaleur suivies d'une véritable canicule ainsi que le passage d'une septième vague de coronavirus. Quoi de mieux qu'une telle analogie de contexte pour goûter l'ambiance fin du monde de cette fictive île méditerranéenne aux prises avec la peste, me suis-je dit ? D'ailleurs, j'ai fini par voir dans le réel qui m'environnait un facteur de démultiplication du cadre romanesque. Ainsi, se renforçant l'un et l'autre, la pandémie fictive faisait grandir les conséquences du covid bien réel dans la représentation que j'en avais tandis que la fournaise qui cramait mon petit jardin accentuait la dimension apocalyptique des descriptions des Nuits de la peste. Un effet réalité augmentée sans lunette ni technologie associée en quelque sorte. Tout à fait saisissant.
Outre l'effet de réel (un peu trop prononcé pour votre serviteur), Les Nuits de la peste ont pour elles aussi l'invention séduisante du cadre romanesque : une île méditerranéenne qui n'existe que dans l'imagination de son auteur mais dont la situation géographique exacerbe tous les enjeux géopolitiques tant du côté des appétits européens colonisateurs que de l'effondrement de l'empire ottoman : délicieuse dystopie dont on savoure d'avance les leçons philosophico politiques. Une épidémie dont la puissance aveugle remet au goût du jour les terreurs ancestrales, emporte n'importe quelle société quelle que soit le ferment cardinal de sa culture, son modernisme ou sa religiosité, vers l'anarchie et la violence. Une narratrice historienne que l'on découvre plus attachée à ses personnages que son rôle initial voulait le faire croire. Une fille de sultan déchu, un médecin progressiste mais amoureux, un gouverneur intransigeant mais perspicace, quelques religieux fanatiques, pharmacien, cochers, soldats, toute une faune pittoresque et charmante, contenant un milliard de potentiel romanesque…
Alors, à quoi attribuer cet ennui presqu'indifférent à son objet, cette forme de fatalisme accablé qui me faisait mollement tourner les pages ? Je crois sérieusement que si l'on prenait n'importe quelle page de ce roman et qu'on en analysait les qualités littéraires, on aurait, à chaque fois, un petit bijou. C'est ce qui m'a fait tenir dans ma lecture aussi : ce livre est constitué de milliers d'extraits tous aussi charmants, spirituels, justes et joliment écrits les uns que les autres. Une fois la dernière page enfin parcourue, j'ai bien pu constater aussi que la structure globale se tenait et que tous les épisodes par lesquels passaient les personnages constituaient, finalement, une fresque chamarrée et pleine de rebondissements. Pourtant, le nez sur chacune de ces péripéties, j'ai eu le sentiment de m'enliser. Malgré les procédés pleins d'ironique intertextualité où la narratrice souligne la grandeur de telle action, le sublime de tel geste, les appels à considérer tel ou tel passages à la lumière que l'Histoire lui conférerait ensuite, l'impression qui a persisté est celle d'une vague impuissance de laquelle ni le fanatisme religieux ni l'hygiénisme, ni la rationalité occidentale ni la science politique ancestrale pas plus que la narration ne parvenait à imprimer un quelconque relief. Finalement, je suis bien contente d'en avoir fini. de la chaleur étouffante et de ce livre que je n'ai pas su comprendre et apprécier malgré tous mes efforts.
Il faut dire que les circonstances de cette lecture ont compris de longues journées de chaleur suivies d'une véritable canicule ainsi que le passage d'une septième vague de coronavirus. Quoi de mieux qu'une telle analogie de contexte pour goûter l'ambiance fin du monde de cette fictive île méditerranéenne aux prises avec la peste, me suis-je dit ? D'ailleurs, j'ai fini par voir dans le réel qui m'environnait un facteur de démultiplication du cadre romanesque. Ainsi, se renforçant l'un et l'autre, la pandémie fictive faisait grandir les conséquences du covid bien réel dans la représentation que j'en avais tandis que la fournaise qui cramait mon petit jardin accentuait la dimension apocalyptique des descriptions des Nuits de la peste. Un effet réalité augmentée sans lunette ni technologie associée en quelque sorte. Tout à fait saisissant.
Outre l'effet de réel (un peu trop prononcé pour votre serviteur), Les Nuits de la peste ont pour elles aussi l'invention séduisante du cadre romanesque : une île méditerranéenne qui n'existe que dans l'imagination de son auteur mais dont la situation géographique exacerbe tous les enjeux géopolitiques tant du côté des appétits européens colonisateurs que de l'effondrement de l'empire ottoman : délicieuse dystopie dont on savoure d'avance les leçons philosophico politiques. Une épidémie dont la puissance aveugle remet au goût du jour les terreurs ancestrales, emporte n'importe quelle société quelle que soit le ferment cardinal de sa culture, son modernisme ou sa religiosité, vers l'anarchie et la violence. Une narratrice historienne que l'on découvre plus attachée à ses personnages que son rôle initial voulait le faire croire. Une fille de sultan déchu, un médecin progressiste mais amoureux, un gouverneur intransigeant mais perspicace, quelques religieux fanatiques, pharmacien, cochers, soldats, toute une faune pittoresque et charmante, contenant un milliard de potentiel romanesque…
Alors, à quoi attribuer cet ennui presqu'indifférent à son objet, cette forme de fatalisme accablé qui me faisait mollement tourner les pages ? Je crois sérieusement que si l'on prenait n'importe quelle page de ce roman et qu'on en analysait les qualités littéraires, on aurait, à chaque fois, un petit bijou. C'est ce qui m'a fait tenir dans ma lecture aussi : ce livre est constitué de milliers d'extraits tous aussi charmants, spirituels, justes et joliment écrits les uns que les autres. Une fois la dernière page enfin parcourue, j'ai bien pu constater aussi que la structure globale se tenait et que tous les épisodes par lesquels passaient les personnages constituaient, finalement, une fresque chamarrée et pleine de rebondissements. Pourtant, le nez sur chacune de ces péripéties, j'ai eu le sentiment de m'enliser. Malgré les procédés pleins d'ironique intertextualité où la narratrice souligne la grandeur de telle action, le sublime de tel geste, les appels à considérer tel ou tel passages à la lumière que l'Histoire lui conférerait ensuite, l'impression qui a persisté est celle d'une vague impuissance de laquelle ni le fanatisme religieux ni l'hygiénisme, ni la rationalité occidentale ni la science politique ancestrale pas plus que la narration ne parvenait à imprimer un quelconque relief. Finalement, je suis bien contente d'en avoir fini. de la chaleur étouffante et de ce livre que je n'ai pas su comprendre et apprécier malgré tous mes efforts.
Ah, l'île de Mingher, "perle de la méditerranée orientale", elle a tant inspiré les peintres et les poètes ! N'écoutez pas les horribles matérialistes qui prétendent qu'elle n'existe que dans l'imagination d'Orhan Pamuk, ils ont évidemment raison, mais cette contrée fictive et paradisiaque est tellement vivante dans Les nuits de la peste qu'il suffit de se laisser porter par les mots du Prix Nobel turc pour la découvrir dans ses plus intimes fragrances. L'écrivain, non sans malice, a choisi une (fausse) historienne comme narratrice de l'année 1901 dans ce territoire de l'empire ottoman vacillant, soudain frappé par la peste. Nullement influencé par la pandémie du Covid, puisque le début de son écriture est antérieur, le roman est une fresque monumentale et détaillée d'une tragédie sanitaire qui embrase une communauté où cohabitent tant bien que mal musulmans et chrétiens. le livre, qui est censé se baser sur les écrits d'une fille d'un sultan déchu, par ailleurs épouse d'un médecin dépêché sur place, peut être rattaché à de multiples genres : récit historique sur la déchéance de la Sublime Porte, "l'homme malade de l'Europe", roman policier placé sous l'aile de Sherlock Holmes, ouvrage politique dont on s'amusera à relever les réflexions on ne plus actuelles sur le nationalisme et l'exercice du pouvoir en temps de crise et même roman sentimental, avec plusieurs couples tendrement liés alors que la mort rôde. Ce livre-fleuve, qui abonde en digressions et décrit un nombre de personnages presque aussi élevé qu'un roman de Tolstoï (référence évidente) n'est pas exempt de quelques longueurs, notamment dans sa première partie, mais il peut s'agir aussi d'un léger coup de "moins bien" d'un lecteur assailli par une narration tellement féconde et généreuse. Quant à savoir démêler le vrai du faux dans cette épopée à la fois grandiose et dérisoire, comme le sont toutes les entreprises humaines, c'est tout bonnement mission impossible, et peu importe, car c'est un vrai plaisir que de suivre Pamuk, dans ses orientales et romanesques arabesques.
Lien : https://cinephile-m-etait-co..
Lien : https://cinephile-m-etait-co..
Comme la rose de Mingher qui s'épanouit dans ses pages, ce roman est délicatement sensuel, subtil dans ses nuances, enivrant et complexe dans sa composition.
1901, on débarque à Mingher, île de Méditerrannée tout droit sortie de l'imagination malicieuse du conteur Pahmuk, aux côtés de deux spécialistes des épidémies et d'une princesse ottomane, nièce du sultan Abduhlamid II. C'est lui qui les a missionnés afin de combattre l'épidémie de peste qui se répand inexorablement dans les corps et les coeurs des Minghériens.
C'est le point de départ d'un récit fabuleux et envoûtant, pris en charge par une narratrice-historienne qui s'appuie sur les lettres de la princesse pour reconstituer l'histoire de Mingher, et à travers elle les derniers soubresauts de l'Empire ottoman. Ou quand une pandémie devient le révélateur des luttes de pouvoir entre les communautés religieuses de l'île et souffle sur les braises de l'indépendance.
Grâce à une narration étourdissante qui n'hésite pas à dévoiler les ressorts de l'intrigue, et à faire entrer en résonance passé et présent, l'auteur turc compose une oeuvre protéiforme, tour à tour roman policier, conte oriental, ou récit politique avec un sens de l'intrigue époustouflant.
Il parvient à nous faire parcourir ces nuits silencieuses des villes confinées, décrivant la peur de la contagion, le déni des uns et la paranoïa des autres, les mesures sanitaires, le chagrin des survivants, et la maladie, impitoyable qui balaie les uns après les autres les personnages les plus emblématiques de l'histoire sans distinction d'aucune sorte. Les similitudes avec une récente pandémie sont troublantes évidemment.
Et puis Pahmuk ne laisse rien au hasard, il élabore tout un monde avec minutie et une force d'évocation rare : c'est comme si j'avais parcouru Mingher, ses rues, ses geôles, je suis entrée dans l'intimité des amoureux, l'arrière-boutique des pharmacies, j'ai vu les corps chaulés et senti le parfum de l'eau de rose de Mingher. J'ai fait un fabuleux voyage.
1901, on débarque à Mingher, île de Méditerrannée tout droit sortie de l'imagination malicieuse du conteur Pahmuk, aux côtés de deux spécialistes des épidémies et d'une princesse ottomane, nièce du sultan Abduhlamid II. C'est lui qui les a missionnés afin de combattre l'épidémie de peste qui se répand inexorablement dans les corps et les coeurs des Minghériens.
C'est le point de départ d'un récit fabuleux et envoûtant, pris en charge par une narratrice-historienne qui s'appuie sur les lettres de la princesse pour reconstituer l'histoire de Mingher, et à travers elle les derniers soubresauts de l'Empire ottoman. Ou quand une pandémie devient le révélateur des luttes de pouvoir entre les communautés religieuses de l'île et souffle sur les braises de l'indépendance.
Grâce à une narration étourdissante qui n'hésite pas à dévoiler les ressorts de l'intrigue, et à faire entrer en résonance passé et présent, l'auteur turc compose une oeuvre protéiforme, tour à tour roman policier, conte oriental, ou récit politique avec un sens de l'intrigue époustouflant.
Il parvient à nous faire parcourir ces nuits silencieuses des villes confinées, décrivant la peur de la contagion, le déni des uns et la paranoïa des autres, les mesures sanitaires, le chagrin des survivants, et la maladie, impitoyable qui balaie les uns après les autres les personnages les plus emblématiques de l'histoire sans distinction d'aucune sorte. Les similitudes avec une récente pandémie sont troublantes évidemment.
Et puis Pahmuk ne laisse rien au hasard, il élabore tout un monde avec minutie et une force d'évocation rare : c'est comme si j'avais parcouru Mingher, ses rues, ses geôles, je suis entrée dans l'intimité des amoureux, l'arrière-boutique des pharmacies, j'ai vu les corps chaulés et senti le parfum de l'eau de rose de Mingher. J'ai fait un fabuleux voyage.
« Les nuits de la peste » raconte les événements qui se sont déroulés lors de l'épidémie de peste apparue en 1901 sur l'île fictive de Mingher, une province ottomane dirigée par le Gouverneur Sami Pacha, où cohabitent chrétiens et musulmans.
Le navire « Aziziye », en route vers la Chine pour y conduire le jeune couple composé de la princesse Pakizê, nièce du sultan Abdülhamid II, et de son nouvel époux, le docteur Nuri, s'arrête près de Mingher pour y débarquer l'éminent professeur Bonkowski Pacha, dépêché par le Sultan pour contrôler l'épidémie de peste qui sévit depuis quelques temps sur l'île.
Alors qu'il reprend sa route vers la Chine, le navire doit bien vite faire demi-tour …
C'est un roman dense et complexe. Il faut déjà pas mal de pages pour se familiariser avec le nombre important de personnages, leur histoire et le contexte politique.
J'avoue qu'il m'est arrivé de trouver certains passages assez lents. Toutefois, je me suis aperçue par la suite que tous ces détails et informations étaient essentiels à cette fiction qui passe pour une réalité historique comme nous l'annonce d'ailleurs l'auteur d'entrée de jeu : « Ceci est à la fois un roman historique et une histoire en forme de roman »; C'est donc en toute connaissance de cause que nous assistons aux bouleversements et rebondissements de l'histoire de l'île.
Là où le génie de Pamuk réside encore davantage est dans sa capacité à faire de l'île imaginaire de Mingher un endroit tellement réel pour le lecteur, un personnage à part entière.
J'ai terminé ce roman avec le sentiment d'être moi-même Minghérienne et d'avoir réellement vécu l'histoire. Ce sentiment a sans doute été renforcé par les similitudes avec la pandémie que nous vivons actuellement.
Une formidable aventure. J'espère découvrir d'autres romans de cet auteur.
Le navire « Aziziye », en route vers la Chine pour y conduire le jeune couple composé de la princesse Pakizê, nièce du sultan Abdülhamid II, et de son nouvel époux, le docteur Nuri, s'arrête près de Mingher pour y débarquer l'éminent professeur Bonkowski Pacha, dépêché par le Sultan pour contrôler l'épidémie de peste qui sévit depuis quelques temps sur l'île.
Alors qu'il reprend sa route vers la Chine, le navire doit bien vite faire demi-tour …
C'est un roman dense et complexe. Il faut déjà pas mal de pages pour se familiariser avec le nombre important de personnages, leur histoire et le contexte politique.
J'avoue qu'il m'est arrivé de trouver certains passages assez lents. Toutefois, je me suis aperçue par la suite que tous ces détails et informations étaient essentiels à cette fiction qui passe pour une réalité historique comme nous l'annonce d'ailleurs l'auteur d'entrée de jeu : « Ceci est à la fois un roman historique et une histoire en forme de roman »; C'est donc en toute connaissance de cause que nous assistons aux bouleversements et rebondissements de l'histoire de l'île.
Là où le génie de Pamuk réside encore davantage est dans sa capacité à faire de l'île imaginaire de Mingher un endroit tellement réel pour le lecteur, un personnage à part entière.
J'ai terminé ce roman avec le sentiment d'être moi-même Minghérienne et d'avoir réellement vécu l'histoire. Ce sentiment a sans doute été renforcé par les similitudes avec la pandémie que nous vivons actuellement.
Une formidable aventure. J'espère découvrir d'autres romans de cet auteur.
Je ne vous apprends rien si je vous dis que 'Les nuits de la peste' est un roman très dense. Mais je précise que malgré quelques longueurs, il est passionnant et le dépaysement y est garanti.
Orhan Pamuk place l'intrigue sur l'île imaginaire de Mingher, où une épidémie de peste va mettre à rude épreuve les services sanitaires, les autorités et les habitants.
On trouve dans ce roman tous les ingrédients qui nous font passer de très bons moments de lecture : des personnages intéressants et attachants, le côté historique, des réflexions sur la nature humaine, quelques situations drôles pour le lecteur ( voir la citation) et moins drôles. On trouve aussi des réflexions qui nous font penser à la situation du Covid. ( le livre a été écrit avant la pandémie).
Si la quantité des pages ne vous fait pas peur, n'hésitez pas !
Le talent de l'auteur se trouve dans chaque page, dans la manière de raconter l'histoire, dans la richesse des descriptions : " de la plus grande et plus célèbre ville de Mingher, Arkaz, on distinguait maintenant les collines, les toits, les murs roses, les maisons, et même les points verts des palmiers. Témoignant de son passé vénitien, byzantin et ottoman, trois coupoles se détachèrent lentement sur le tissu de la cité. Elles étaient toutes sur la même ligne, à l'est la coupole de l'église Saint - Antoine ( catholique) et celle de Hagia Triada ( orthodoxe), et sur les hauteurs de la partie occidentale de la ville, légèrement plus basse, celle de la Yeni Djami, la plus grande de toutes les mosquées. le regard des passagers qui approchaient de la ville était absorbé par la rondeur volumineuse de ces trois coupoles dont les peintres occidentaux avaient tant de fois immortalisé les marquantes silhouettes."
Je rajoute que les surprises ne manquent pas, que ce soit dans le choix du narrateur ou même dans l'intrigue policière entre autres...
Une belle découverte.
Orhan Pamuk place l'intrigue sur l'île imaginaire de Mingher, où une épidémie de peste va mettre à rude épreuve les services sanitaires, les autorités et les habitants.
On trouve dans ce roman tous les ingrédients qui nous font passer de très bons moments de lecture : des personnages intéressants et attachants, le côté historique, des réflexions sur la nature humaine, quelques situations drôles pour le lecteur ( voir la citation) et moins drôles. On trouve aussi des réflexions qui nous font penser à la situation du Covid. ( le livre a été écrit avant la pandémie).
Si la quantité des pages ne vous fait pas peur, n'hésitez pas !
Le talent de l'auteur se trouve dans chaque page, dans la manière de raconter l'histoire, dans la richesse des descriptions : " de la plus grande et plus célèbre ville de Mingher, Arkaz, on distinguait maintenant les collines, les toits, les murs roses, les maisons, et même les points verts des palmiers. Témoignant de son passé vénitien, byzantin et ottoman, trois coupoles se détachèrent lentement sur le tissu de la cité. Elles étaient toutes sur la même ligne, à l'est la coupole de l'église Saint - Antoine ( catholique) et celle de Hagia Triada ( orthodoxe), et sur les hauteurs de la partie occidentale de la ville, légèrement plus basse, celle de la Yeni Djami, la plus grande de toutes les mosquées. le regard des passagers qui approchaient de la ville était absorbé par la rondeur volumineuse de ces trois coupoles dont les peintres occidentaux avaient tant de fois immortalisé les marquantes silhouettes."
Je rajoute que les surprises ne manquent pas, que ce soit dans le choix du narrateur ou même dans l'intrigue policière entre autres...
Une belle découverte.
Lecture au long cours : pavé de 683 pages !
Ce roman-fleuve commence comme un roman policier :le pharmacien-chimiste Bonkovski Pacha, envoyé par le Sultan pour endiguer l'épidémie de peste sur l'île de Mingher, est assassiné. le Docteur Nuri et son épouse Pakizê , en route vers la Chine pour un congrès sanitaire international, est rappelé en secret pour élucider ce meurtre. Abdülhamid, le Sultan, grand lecteur de Sherlock Holmes a missionné ce dernier pour résoudre cette énigme en utilisant les méthodes du célèbre détective tandis que Sami Pacha, le gouverneur a plutôt tendance à obtenir des aveux par la torture.
La narratrice, une historienne, plus d'un siècle après les faits reconstitue l'histoire de la peste de Mingher qui a proclamé son indépendance. Elle utilise les lettres de la Princesse Pakizê, présente sur l'île et témoin de l'histoire. La princesse, fille du Sultan Mourad V, déposé par Abdülhamid, a vécu recluse avec les pachas et sultans dans le sérail d'Istanbul. Orhan Pamuk nous raconte aussi la vie à Istanbul pour la famille règnante. L'empire Ottoman, au tournant du XXème siècle est "l'homme malade", l'Empire se délite en guerres des Balkans, et luttes des Grecs de la Mer Egée (1897 la Crète est rattachée à la Grèce), la carte de l'Empire que le Sultan fait afficher est de plus en plus périmée...Les grandes puissances sont en embuscade.
En même temps, sur d'autres rivages Mustapha Kemal étudie à l'école militaire de Monastir (c'est moi qui fait le parallèle, l'auteur n'y fait aucune référence). Ce gros roman peut être lu comme un roman historique, d'ailleurs la narratrice racontera l'histoire jusqu'au XXIème siècle.
C'est aussi l'histoire d'une épidémie de peste, maladie terrifiante puisque très létale et très contagieuse. Yersin, en Chine, (1894) a déjà mis en évidence la transmission par les puces des rats. Nous allons assister à toutes les phases de l'épidémie (un peu comme la Peste de Camus, et beaucoup comme récemment avec le Covid). D'abord l'incrédulité, puis des mesures pour limiter la contagion, fumigations, désinfections pièges à rats, enfin les confinements et quarantaines, mise à l'isolement de familles entières, hôpitaux saturés, et les révoltes des religieux, le fatalisme...
C'est aussi l'essor de l'identité nationale de Mingher. Au plus fort de l'épidémie, le major proclame l'indépendance. Tout un roman va se construire autour du personnage. Renaissance d'une langue locale (originaire de la mer d'Aral???) . Hagiographie, enrôlement de la jeunesse des école dans ce roman national. En filigrane, on devine certaines analogies. Introduction de l'idée de laïcité, pour éviter les conflits confessionnels entre musulmans et orthodoxes et aussi pour promouvoir les mesures sanitaires scientifiques face aux pratiques superstitieuses.
"Les eaux de la rivière Arkaz étincelaient sous le pont comme un diamant vert du paradis, en contrebas s'étendait le Vieux Bazar, et de l'autre côté, c'était la Forteresse, et les cachots sur lesquels il avait veillé toute sa vie. Il pleura en silence un moment. Puis la fatigue l'arrêta. Sous la lueur orange du soleil, la Forteresse semblait plus rose que jamais."
Pour construire ce roman foisonnant, Pamuk a imaginé une île, il l'a décrit avec pittoresque. L'arrivée dans le port est grandiose. Il décrit des quartiers populaires, des rues modernes avec des commerces, des agences de voyage, des bâtiments officiels. On pense à Rhodes, à toutes les îles du Dodécanèse (la 13ème?) avec ses ruines byzantines, ses fortifications vénitiennes, puis ottomanes, son phare arabe. Peuplée pour moitié de Turcs musulmans et de Grecs orthodoxes. Certaines communautés sont absentes, un seul arménien, un peintre qui ne vit pas sur l'île, pas de Juifs... Ces absents m'interrogent.
Nous nous promenons avec grand plaisir dans le landau blindé dans les criques rocheuses ou dans les vergers des belles villas bourgeoises. Cela sent le crottin, les plantes méditerranéennes, mais aussi le lysol souvent, et les cadavres parfois. le lecteur est immergé dans cette île merveilleuse de Mingher, il aimerait qu'elle existe pour y passer des vacances.
Peut-on imaginer, entre les lignes, des allusions à la Turquie contemporaine?
Lien : https://netsdevoyages.car.bl..
Ce roman-fleuve commence comme un roman policier :le pharmacien-chimiste Bonkovski Pacha, envoyé par le Sultan pour endiguer l'épidémie de peste sur l'île de Mingher, est assassiné. le Docteur Nuri et son épouse Pakizê , en route vers la Chine pour un congrès sanitaire international, est rappelé en secret pour élucider ce meurtre. Abdülhamid, le Sultan, grand lecteur de Sherlock Holmes a missionné ce dernier pour résoudre cette énigme en utilisant les méthodes du célèbre détective tandis que Sami Pacha, le gouverneur a plutôt tendance à obtenir des aveux par la torture.
La narratrice, une historienne, plus d'un siècle après les faits reconstitue l'histoire de la peste de Mingher qui a proclamé son indépendance. Elle utilise les lettres de la Princesse Pakizê, présente sur l'île et témoin de l'histoire. La princesse, fille du Sultan Mourad V, déposé par Abdülhamid, a vécu recluse avec les pachas et sultans dans le sérail d'Istanbul. Orhan Pamuk nous raconte aussi la vie à Istanbul pour la famille règnante. L'empire Ottoman, au tournant du XXème siècle est "l'homme malade", l'Empire se délite en guerres des Balkans, et luttes des Grecs de la Mer Egée (1897 la Crète est rattachée à la Grèce), la carte de l'Empire que le Sultan fait afficher est de plus en plus périmée...Les grandes puissances sont en embuscade.
En même temps, sur d'autres rivages Mustapha Kemal étudie à l'école militaire de Monastir (c'est moi qui fait le parallèle, l'auteur n'y fait aucune référence). Ce gros roman peut être lu comme un roman historique, d'ailleurs la narratrice racontera l'histoire jusqu'au XXIème siècle.
C'est aussi l'histoire d'une épidémie de peste, maladie terrifiante puisque très létale et très contagieuse. Yersin, en Chine, (1894) a déjà mis en évidence la transmission par les puces des rats. Nous allons assister à toutes les phases de l'épidémie (un peu comme la Peste de Camus, et beaucoup comme récemment avec le Covid). D'abord l'incrédulité, puis des mesures pour limiter la contagion, fumigations, désinfections pièges à rats, enfin les confinements et quarantaines, mise à l'isolement de familles entières, hôpitaux saturés, et les révoltes des religieux, le fatalisme...
C'est aussi l'essor de l'identité nationale de Mingher. Au plus fort de l'épidémie, le major proclame l'indépendance. Tout un roman va se construire autour du personnage. Renaissance d'une langue locale (originaire de la mer d'Aral???) . Hagiographie, enrôlement de la jeunesse des école dans ce roman national. En filigrane, on devine certaines analogies. Introduction de l'idée de laïcité, pour éviter les conflits confessionnels entre musulmans et orthodoxes et aussi pour promouvoir les mesures sanitaires scientifiques face aux pratiques superstitieuses.
"Les eaux de la rivière Arkaz étincelaient sous le pont comme un diamant vert du paradis, en contrebas s'étendait le Vieux Bazar, et de l'autre côté, c'était la Forteresse, et les cachots sur lesquels il avait veillé toute sa vie. Il pleura en silence un moment. Puis la fatigue l'arrêta. Sous la lueur orange du soleil, la Forteresse semblait plus rose que jamais."
Pour construire ce roman foisonnant, Pamuk a imaginé une île, il l'a décrit avec pittoresque. L'arrivée dans le port est grandiose. Il décrit des quartiers populaires, des rues modernes avec des commerces, des agences de voyage, des bâtiments officiels. On pense à Rhodes, à toutes les îles du Dodécanèse (la 13ème?) avec ses ruines byzantines, ses fortifications vénitiennes, puis ottomanes, son phare arabe. Peuplée pour moitié de Turcs musulmans et de Grecs orthodoxes. Certaines communautés sont absentes, un seul arménien, un peintre qui ne vit pas sur l'île, pas de Juifs... Ces absents m'interrogent.
Nous nous promenons avec grand plaisir dans le landau blindé dans les criques rocheuses ou dans les vergers des belles villas bourgeoises. Cela sent le crottin, les plantes méditerranéennes, mais aussi le lysol souvent, et les cadavres parfois. le lecteur est immergé dans cette île merveilleuse de Mingher, il aimerait qu'elle existe pour y passer des vacances.
Peut-on imaginer, entre les lignes, des allusions à la Turquie contemporaine?
Lien : https://netsdevoyages.car.bl..
Entre avril et novembre 1901, dans une île imaginaire située en Méditerranée orientale, une épidémie de peste se déclare, venant sans doute de Chine ou d'Inde et transmise par les pèlerins de retour du hadj. Habitée, à l'instar de Chypre, de Rhodes et de Crète, par des Grecs orthodoxes et des musulmans, Mingher est encore provisoirement une province ottomane, et le sultan Abdülhamid II, sous pression des puissances occidentales soucieuses d'endiguer l'épidémie, y envoie successivement son Inspecteur général de l'Administration sanitaire, le célèbre chimiste Bonkowski Pacha (accompagné de son assistant le Dr. Élias), puis l'épidémiologiste Dr. Nuri Pacha, gendre impérial car à peine marié à Pakizê Sultane, fille du sultan détrôné Mourad V et donc nièce d'Abdülhamid, laquelle suit son époux. le dessein impérial est-il uniquement de vaincre le bacille ? Ce n'est pas l'avis de Pakizê – personnage lui aussi imaginaire – dont la correspondance abondante avec sa soeur Hatidjê – personnage historique au contraire – constitue prétendument le matériau de ce roman historique dont l'autrice, en 2017, serait une certaine Mîna Mingherli, historienne spécialiste de Mingher et arrière-petite-fille de Pakizê.
Dans le contexte de la description de l'épidémie de peste et des politiques sanitaires relatives, s'agencent des crimes mystérieux et des événements politiques majeurs – subversions, complots, révolutions – qui caractérisent parfaitement le climat de ces dernières décennies de souveraineté ottomane durant lesquelles les territoires périphériques se détachent rapidement du pouvoir central, alors que les tentatives de réforme s'avèrent vaines. Une dynamique entre trois forces profondes se développe dialectiquement : la volonté réformatrice, modernisatrice, occidentalisante d'Abdülhamid et des hauts fonctionnaires qui lui sont fidèles – tempérée néanmoins par les ingérences occidentales et par sa propre paranoïa, éléments qui le poussent, ainsi que son administration, à des comportements contradictoires et ambivalents – ; la résistance conservatrice de l'islam réactionnaire, incarné notamment par les confréries religieuses, leurs couvents et leurs cheikhs ; enfin un nationalisme naissant qui se nourrit des rivalités ethno-religieuses et socio-économiques entre chrétiens et musulmans et qui finira par triompher. La gestion de l'épidémie, notamment les mesures sanitaires de quarantaine, de cordon sanitaire, de confinement et les modalités des obsèques des pestiférés, constitue à la fois l'emblème de cette dialectique et le catalyseur de la dynamique des événements politiques. de même que les complots, empoisonnements, pendaisons et bannissements qui ont lieu dans l'île, l'influence d'Istanbul et celle des puissances sur la scène internationale, par le truchement des consuls et du blocus naval imposé, interviennent dans cette intrigue « médico-politico-barbouzeuse » qui conviendrait parfaitement à une adaptation cinématographique.
D'autant plus que, bien que le couple Nuri-Pakizê – et leur complicité amoureuse et conjugale – représente les personnages principaux du récit, se succèdent, au fil des pages de cette immense fresque dont le rythme s'accélère à la fin, d'autres héros qui font figure, provisoirement, de personnages les plus importants : l'inspecteur sanitaire Bonkowski, le gouverneur Sami Pacha (et sa maîtresse grecque Malika), le major Kâmil bientôt Commandant Kâmil et sa jeune épouse Zeynep, le bandit Ramiz et le cheikh Hamdullah secondé par l'intrigant Nimetullah Feutre Pointu, le fourbe Mazhar Efendi, l'homme des renseignements... et enfin la narratrice. En effet, après 79 chap. et 630 p. (dans la version française), qui retracent les quelques mois de la peste et de la révolution de 1901à Mingher, une sorte d'annexe de 50 p. intitulée « Des années plus tard » brosse rapidement la suite de l'histoire de l'île imaginaire jusqu'à l'époque contemporaine, croisée avec la biographie de la narratrice – dont on découvre enfin la parenté avec Nuri et Pakizê – : cette partie fournit de savants et intelligents clins d'oeil à l'histoire de la Turquie au cours des dernières décennies et même des rapports compliqués que celle-ci entretient avec ses intellectuels...
Pamuk affirme qu'il avait commencé à préparer ce roman bien avant la pandémie de Covid : nous savons – et ce texte le démontre sans l'ombre d'un doute – que l'auteur consacre un temps remarquablement long à la préparation documentaire de ses ouvrages, qui sont tous des monuments d'érudition et de polysémie. Il a affirmé aussi avec humour que l'événement sanitaire mondial a plutôt desservi son roman, dans lequel la romance et l'optimisme ne sont pas absents : cette espièglerie peut faire planer le doute que l'affirmation précédente soit aussi une espiègle antiphrase ou une ironique contre-vérité...
Je me permets également d'exprimer un petit regret : pour la première fois Gallimard ne s'est plus valu des service de l'admirable Valérie Gay-Aksoy, traductrice « attitrée » d'Orhan Pamuk en français. Bien que le jeune polyglotte Julien Lapeyre de Cabanes nous livre ici une version très élégante, malgré quelques imperfections et contresens que j'ai pu relever (car j'ai lu le livre simultanément avec mon épouse qui le lisait dans le texte), je pense que c'est par manque d'expérience (ou de culture) que Julien a inventé le système de distinguer les Grecs ottomans des Grecs de Grèce par une omission de majuscule : Valérie aurait sans doute su que, dans la littérature savante, on opère cette distinction en désignant les derniers par le terme d'Hellènes, sans contrevenir par une invention fantaisiste à la norme précise du français concernant les majuscules/minuscules des substantifs/adjectifs de nationalité.
Dans le contexte de la description de l'épidémie de peste et des politiques sanitaires relatives, s'agencent des crimes mystérieux et des événements politiques majeurs – subversions, complots, révolutions – qui caractérisent parfaitement le climat de ces dernières décennies de souveraineté ottomane durant lesquelles les territoires périphériques se détachent rapidement du pouvoir central, alors que les tentatives de réforme s'avèrent vaines. Une dynamique entre trois forces profondes se développe dialectiquement : la volonté réformatrice, modernisatrice, occidentalisante d'Abdülhamid et des hauts fonctionnaires qui lui sont fidèles – tempérée néanmoins par les ingérences occidentales et par sa propre paranoïa, éléments qui le poussent, ainsi que son administration, à des comportements contradictoires et ambivalents – ; la résistance conservatrice de l'islam réactionnaire, incarné notamment par les confréries religieuses, leurs couvents et leurs cheikhs ; enfin un nationalisme naissant qui se nourrit des rivalités ethno-religieuses et socio-économiques entre chrétiens et musulmans et qui finira par triompher. La gestion de l'épidémie, notamment les mesures sanitaires de quarantaine, de cordon sanitaire, de confinement et les modalités des obsèques des pestiférés, constitue à la fois l'emblème de cette dialectique et le catalyseur de la dynamique des événements politiques. de même que les complots, empoisonnements, pendaisons et bannissements qui ont lieu dans l'île, l'influence d'Istanbul et celle des puissances sur la scène internationale, par le truchement des consuls et du blocus naval imposé, interviennent dans cette intrigue « médico-politico-barbouzeuse » qui conviendrait parfaitement à une adaptation cinématographique.
D'autant plus que, bien que le couple Nuri-Pakizê – et leur complicité amoureuse et conjugale – représente les personnages principaux du récit, se succèdent, au fil des pages de cette immense fresque dont le rythme s'accélère à la fin, d'autres héros qui font figure, provisoirement, de personnages les plus importants : l'inspecteur sanitaire Bonkowski, le gouverneur Sami Pacha (et sa maîtresse grecque Malika), le major Kâmil bientôt Commandant Kâmil et sa jeune épouse Zeynep, le bandit Ramiz et le cheikh Hamdullah secondé par l'intrigant Nimetullah Feutre Pointu, le fourbe Mazhar Efendi, l'homme des renseignements... et enfin la narratrice. En effet, après 79 chap. et 630 p. (dans la version française), qui retracent les quelques mois de la peste et de la révolution de 1901à Mingher, une sorte d'annexe de 50 p. intitulée « Des années plus tard » brosse rapidement la suite de l'histoire de l'île imaginaire jusqu'à l'époque contemporaine, croisée avec la biographie de la narratrice – dont on découvre enfin la parenté avec Nuri et Pakizê – : cette partie fournit de savants et intelligents clins d'oeil à l'histoire de la Turquie au cours des dernières décennies et même des rapports compliqués que celle-ci entretient avec ses intellectuels...
Pamuk affirme qu'il avait commencé à préparer ce roman bien avant la pandémie de Covid : nous savons – et ce texte le démontre sans l'ombre d'un doute – que l'auteur consacre un temps remarquablement long à la préparation documentaire de ses ouvrages, qui sont tous des monuments d'érudition et de polysémie. Il a affirmé aussi avec humour que l'événement sanitaire mondial a plutôt desservi son roman, dans lequel la romance et l'optimisme ne sont pas absents : cette espièglerie peut faire planer le doute que l'affirmation précédente soit aussi une espiègle antiphrase ou une ironique contre-vérité...
Je me permets également d'exprimer un petit regret : pour la première fois Gallimard ne s'est plus valu des service de l'admirable Valérie Gay-Aksoy, traductrice « attitrée » d'Orhan Pamuk en français. Bien que le jeune polyglotte Julien Lapeyre de Cabanes nous livre ici une version très élégante, malgré quelques imperfections et contresens que j'ai pu relever (car j'ai lu le livre simultanément avec mon épouse qui le lisait dans le texte), je pense que c'est par manque d'expérience (ou de culture) que Julien a inventé le système de distinguer les Grecs ottomans des Grecs de Grèce par une omission de majuscule : Valérie aurait sans doute su que, dans la littérature savante, on opère cette distinction en désignant les derniers par le terme d'Hellènes, sans contrevenir par une invention fantaisiste à la norme précise du français concernant les majuscules/minuscules des substantifs/adjectifs de nationalité.
En 1901, la charmante île de Mingher, « perle des eaux méditerranéennes de l'Empire Ottoman et célébrée dans le Levant pour son marbre rose » est ravagée par une épidémie.
Rapidement deux spécialistes sont dépêchés sur place par le sultan Abdulamind II : le docteur Nuri, époux de la princesse Pakize, et le docteur Bonkowski.
Les spécialistes confirment que la maladie funeste et infectieuse qui touche l'île est bien la peste. La seule solution : la quarantaine. Mais dans cette île où jusque là les communautés orthodoxes, musulmanes et catholiques vivaient en paix, le protocole sanitaire imposé est exhausteur de tension et se heurte de plein fouet aux croyances religieuses. Bonkowski en fera les frais et sera assassiné.
Le sultan, amateur de Sherlock Holmes, demande alors au docteur Nuri de résoudre ce crime…
Dénonciations, amours clandestines, tentative d'assassinat, bubons, trahison, emprisonnement, le chaos règne sur Mingher, secouée par la maladie et une crise politique sans précédent, prémices de la chute de l'empire Ottoman.
Oran Pamuk décrit une île imaginaire, d'une beauté à vous couper le souple, à la croisée des mers d'Europe et d'Asie, entre Grèce et Turquie.
A travers la plume de Pakize, qui relate l'histoire à sa soeur au fil de ses lettres, le lecteur, souvent interpellé, suit le destin de Mingher et de ses habitants.
C'est un roman extrêmement dense, labyrinthique par moment, et d'une grande beauté. Est ce que j'ai aimé ? Tout autant que j'ai détesté. Je me suis débattue avec certains passages, très (trop) fournis. J'ai été subjuguée par d'autres. Je suis sortie de cette lecture épuisée mais contente d'être allée au bout. Oran Pamuk livre un message important : toute situation de crise peut devenir le déclencheur d'une révolution politique.
Un roman qui résonne beaucoup avec l'actualité …
Rapidement deux spécialistes sont dépêchés sur place par le sultan Abdulamind II : le docteur Nuri, époux de la princesse Pakize, et le docteur Bonkowski.
Les spécialistes confirment que la maladie funeste et infectieuse qui touche l'île est bien la peste. La seule solution : la quarantaine. Mais dans cette île où jusque là les communautés orthodoxes, musulmanes et catholiques vivaient en paix, le protocole sanitaire imposé est exhausteur de tension et se heurte de plein fouet aux croyances religieuses. Bonkowski en fera les frais et sera assassiné.
Le sultan, amateur de Sherlock Holmes, demande alors au docteur Nuri de résoudre ce crime…
Dénonciations, amours clandestines, tentative d'assassinat, bubons, trahison, emprisonnement, le chaos règne sur Mingher, secouée par la maladie et une crise politique sans précédent, prémices de la chute de l'empire Ottoman.
Oran Pamuk décrit une île imaginaire, d'une beauté à vous couper le souple, à la croisée des mers d'Europe et d'Asie, entre Grèce et Turquie.
A travers la plume de Pakize, qui relate l'histoire à sa soeur au fil de ses lettres, le lecteur, souvent interpellé, suit le destin de Mingher et de ses habitants.
C'est un roman extrêmement dense, labyrinthique par moment, et d'une grande beauté. Est ce que j'ai aimé ? Tout autant que j'ai détesté. Je me suis débattue avec certains passages, très (trop) fournis. J'ai été subjuguée par d'autres. Je suis sortie de cette lecture épuisée mais contente d'être allée au bout. Oran Pamuk livre un message important : toute situation de crise peut devenir le déclencheur d'une révolution politique.
Un roman qui résonne beaucoup avec l'actualité …
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Orhan Pamuk (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Tête de Turc !
De quelle pièce de Molière cette réplique est-elle extraite ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Ah maudite galère ! Traître de Turc à tous les diables !
Le bourgeois gentilhomme
Monsieur de Pourceaugnac
Les Fourberies de Scapin
La jalousie du barbouillé
10 questions
62 lecteurs ont répondu
Thèmes :
turquie
, turc
, littérature
, cinema
, humour
, Appréciation
, évocationCréer un quiz sur ce livre62 lecteurs ont répondu