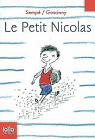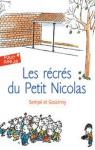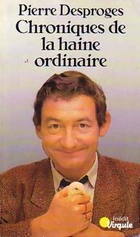Octave Pradels
Gustave Fraipont (Illustrateur)
Ajouter la description de l’éditeur
Vous pouvez également contribuer à la description collective rédigée par les membres de Babelio.
Contribuer à la description collective
Gustave Fraipont (Illustrateur)
174 pages
MARPON C. et E. FLAMMARION (20/07/1891)
/5
1 notes
MARPON C. et E. FLAMMARION (20/07/1891)
Résumé :
Nous n’avons pas encore dans notre base la description de l’éditeur (quatrième de couverture)
Ajouter la description de l’éditeur
Vous pouvez également contribuer à la description collective rédigée par les membres de Babelio.
Contribuer à la description collective
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Quelle discipline plus essentielle et plus ingrate que l'humour ? Toujours présent à toutes les époques de l'Histoire mais souvent trop contextuel à une époque pour pouvoir lui survivre, l'humour commença à devenir une véritable institution sous la IIIème République. Avant cela, il était essentiellement le privilège élogieux de quelques lettrés spirituels ou le fond de commerce de quelques saltimbanques de quartier. La libération quasi-totale de la presse sous Napoléon III encouragea les oeuvres d'une multitude de chroniqueurs, éditorialistes, chansonniers, écrivains dont seuls les plus prestigieux et les plus intemporels ont encore droit à la postérité : Courteline, Alphonse Allais, Tristan Bernard, et dans une moindre mesure Pierre Véron et Eugène Chavette, ce dernier grâce à son toujours populaire « Guillotiné par Persuasion ».
À côté de ce peu d'élus, beaucoup d'appelés dont les oeuvres sont tombées définitivement dans l'oubli, et malheureusement sans que ce soit pour autant une injustice : la IIIème République voit la première banalisation d'un humour contestataire qui n'est pas toujours lui-même républicain. Il oppose aux devoirs de citoyens de la propagande républicaine une légèreté et une frivolité qui encourageait l'égoïsme, l'amoralité et le repli sur soi. Mais cet hédonisme militant portait souvent les couleurs de la naïveté, pratiquée par des humoristes élitistes peut au fait des réalités du monde. On peut aujourd'hui trouver un tel humour attendrissant, car il porte en lui la mentalité de toute une époque. Mais il est quasiment impossible d'en rire encore, tant la catharsis nécessaire est impossible à reproduire dans le contexte du siècle actuel.
C'est le cas d'Octave Pradels qui était à la base un parolier de chansons et un auteur et interprète de petites scénettes rimées, qui furent pour la plupart reprises dans des recueils comme celui-ci. Sa spécialité : ce qu'il appelle la "gauloiserie" ou la "gaudriole", en fait des textes volontiers salaces et lubriques, mais tout en allusions, en suggestions, et avec toutefois un fond de morale un peu puritaine, brocardant notamment les mariages d'argent ou d'intérêts, et les jeunes filles qui épousent des vieillards. Sur bien des plans, Octave Pradels est directement à l'origine de l'humour populiste et gaulois de Patrick Sébastien, et de la tradition chansonnière et festive qui l'ont précédée.
Malgré la permanence de ce type d'humour, ces différentes incarnations vieillissent souvent sur la forme, précisément parce qu'elles évitent toutes la crudité la plus totale, et que les euphémismes auxquels elles recourent, ou la forme d'hypocrisie qu'elles adoptent, dépendent totalement de la pruderie de leur époque. Lorsque celle-ci évolue, cet humour perd totalement ce qui en assurait sa subversion doucereuse.
« Les Desserts Gaulois » est une parfaite illustration de cet humour singulièrement daté, mais aussi de l'esprit général très borné d'Octave Pradels. L'illustration de couverture, par Gustave Fraipont (qui signe également de très nombreuses gravures les titres de chaque scénette) en dit déjà long sur la mentalité ici présente : on voit Octave Pradels, debout, hilare, déclamer ses gauloiseries devant deux jeunes femmes assises qui dissimulent derrière leurs éventails leurs sourires complices à ces plaisanteries fort inconvenantes. Il est important de noter que la position des éventails est soigneusement étudiée pour ne pas dissimuler tout à fait à l'humoriste leurs visages rougissants. Au second plan, une foule béate de spectateurs permet de cautionner la démarche de Pradels, que l'on pourrait juger immorale et impolie sans cela. Au tout premier plan, un étrange bouquet constitué de roses et de bouteilles de champagne suggère que tout cela se passe entre des gens riches, et donc de haute moralité.
Le recueil en lui-même brasse volontiers toutes ces idées, à la fois lubriques et réactionnaires, et d'autant plus réactionnaires que cela permet de s'autoriser une lubricité "de bon aloi" qui est largement déployée dans les 28 scénettes que rassemble ce recueil.
C'est néanmoins le seul écrit en prose, apparemment ajouté au dernier moment en guise de préface, car il n'est pas inclus dans le sommaire, qui se révèle le texte le plus essentiel de ce volume. Il s'agit d'un discours inaugural, « Causerie sur la Gaudriole », prononcé le 18 décembre 1890 au Théâtre d'Application, pour le lancement des « Soirées Gauloises » initiées par Octave Pradels. Cet essai de 23 pages est assez essentiel pour comprendre l'état d'esprit de cette forme d'humour populaire au moment qui précède ce qui deviendra son âge d'or, au tournant du XXème siècle.
Les « Soirées Gauloises » d'Octave Pradels connaîtront un franc-succès jusqu'à ce que Pradels rejoigne, quelques années plus tard, le Théâtre des Capucines, un monument de l'activité théâtrale fin-de-siècle, où furent joués pour la première fois nombre d'opéras comiques et d'opérettes, et dont Pradels finit par être nommé directeur en 1899. La Première Guerre Mondiale mit fin à cet âge d'or de la gaudriole, et le Théâtre des Capucines parvint à vivoter des vaudevilles de Feydeau jusqu'en 1973, où il fut remplacé par l'actuel cinéma qui porte son nom.
Le recueil se termine par ce qui était alors le morceau de roi le plus populaire de Pradels : l'interprétation avec l'accent anglais des Fables de la Fontaine, la version écrite reproduisant fidèlement les anglicismes typographiques qu'il fallait jouer à l'oral. Ce sont à la fois les scénettes les plus célèbres de Pradels (car aussi parmi les rares à être tous publics), et les plus incompréhensibles pour un lecteur contemporain. Il faut prendre en compte qu'en 1891, l'accent anglais sonnait pour nombre de français de manière aussi exotique que l'accent chinois. Alors très autocentrée sur sa culture, la société française n'était pas acclimatée à entendre souvent de l'anglais, et jugeait cette langue avant tout comme un babil aux sonorités comiques, particulièrement quand il en subsistait des traces dans une prononciation de la langue française. À la même époque, les Fables de la Fontaine étaient un passage obligé des études scolaires. Il n'y avait donc pas d'oeuvres poétiques qui soient aussi viscéralement françaises, populaires dans toutes les couches de la société et intimement liées aux souvenirs collectifs de la scolarité. Soumettre donc ces textes immuables au très "barbare" accent anglais plongeait donc assez facilement les gens dans une hilarité face à l'absurde. Mais évidemment, six ou sept générations plus tard, alors que nous avons tous grandi dans un monde formaté à la langue anglaise, rien de ce qui faisait rire nos ancêtres n'est en mesure de nous arracher encore un sourire. Cela ne choque pas, cela ne dérange pas, c'est juste que l'on ne voit pas ce qu'il y a là de drôle. Pourtant, ces interprétations "à l'anglaise" des Fables de la Fontaine furent à ce point populaires qu'il m'est arrivé de les croiser dans des ouvrages d'autres auteurs, avec ou sans la citation d'Octave Pradels comme auteur.
Enfin, nous terminerons en disséquant cette intrigante allusion aux "desserts" dans le titre du recueil. Que viennent faire ici les desserts ? Et bien, c'est là aussi très fortement lié aux habitudes sociales du XIXème siècle, où l'on raffolait des dîners de famille, souvent organisés dans des propriétés ou des maisons de campagne, car l'exode rural en était seulement à ses débuts. Même si bien des gens du terroir avaient déjà émigré dans les grandes villes, en profitant de l'accessibilité rendue possible par l'expansion du chemin de fer, la plupart des familles avaient conservé les maisons rurales de leurs parents ou grands-parents, lesquelles étaient suffisamment vastes pour pouvoir organiser des dîners rassemblant tous les membres épars d'une même famille. S'il était souvent bienvenu de discuter de politique ou des intérêts familiaux pendant le repas, une fois le dessert consommé, alors que chacun entrait dans la douce satisfaction de la digestion qui détend les esprits, il était de bon ton qu'un des membres de la famille fasse une petite performance humoristique, celui ou celle qui avait le plus de talent de comédien ou très souvent également les enfants de la famille auxquels on faisait réciter quelques poésies gentiment rigolotes ou jouer quelques scènes théâtrales agrémentées de costumes improvisés ou d'accessoires cocasses. C'était aussi dans ces moments-là que l'on pouvait interpréter une fable De La Fontaine avec un accent anglais caricatural.
Ce n'est donc pas pour les desserts, mais pour les moments conviviaux venant après le dessert que le recueil d'Octave Pradels offrait à chacun une vingtaine de petites scénettes rimées que l'on pouvait apprendre par coeur et déclamer à la fin des repas, ce qui fut sans doute bien pratiqué, car Octave Pradels a signé cinq ou six recueils semblables dans les années 1880 et 1890.
Muni de ces nécessaires connaissances historiques, on peut réellement apprécier « Les Desserts Gaulois » comme un témoignage appréciable de la société bourgeoise et/ou de la classe moyenne du XIXème siècle. On n'en rira guère, mais il est attendrissant de se pencher sur cette époque lointaine et plutôt heureuse, et en plus, qui s'amusait de bien peu de choses. Octave Pradels est l'un des inévitables visages de la Belle-Époque, son humour s'adressait directement à ses lecteurs en les plongeant dans leur vie quotidienne, s'appuyant sur un certain bon sens à la française, qui s'est toujours préoccupé de libertinage discret et de moralisme appuyé, suivant cette logique qui veut que l'on se trouve toujours de bonnes excuses à soi-même et aucune à autrui. Néanmoins, l'intérêt de l'oeuvre de Pradels est avant tout historique, et sans doute un peu poétique du fait de la forme rimée. Cependant, même les plus indécrottables amateurs d'humour populaire se sentiront assez peu mis en joie par cette oeuvre un peu obsessionnelle sur le plan thématique, mais trop frileuse et surtout trop soucieuse de se justifier en permanence.
À côté de ce peu d'élus, beaucoup d'appelés dont les oeuvres sont tombées définitivement dans l'oubli, et malheureusement sans que ce soit pour autant une injustice : la IIIème République voit la première banalisation d'un humour contestataire qui n'est pas toujours lui-même républicain. Il oppose aux devoirs de citoyens de la propagande républicaine une légèreté et une frivolité qui encourageait l'égoïsme, l'amoralité et le repli sur soi. Mais cet hédonisme militant portait souvent les couleurs de la naïveté, pratiquée par des humoristes élitistes peut au fait des réalités du monde. On peut aujourd'hui trouver un tel humour attendrissant, car il porte en lui la mentalité de toute une époque. Mais il est quasiment impossible d'en rire encore, tant la catharsis nécessaire est impossible à reproduire dans le contexte du siècle actuel.
C'est le cas d'Octave Pradels qui était à la base un parolier de chansons et un auteur et interprète de petites scénettes rimées, qui furent pour la plupart reprises dans des recueils comme celui-ci. Sa spécialité : ce qu'il appelle la "gauloiserie" ou la "gaudriole", en fait des textes volontiers salaces et lubriques, mais tout en allusions, en suggestions, et avec toutefois un fond de morale un peu puritaine, brocardant notamment les mariages d'argent ou d'intérêts, et les jeunes filles qui épousent des vieillards. Sur bien des plans, Octave Pradels est directement à l'origine de l'humour populiste et gaulois de Patrick Sébastien, et de la tradition chansonnière et festive qui l'ont précédée.
Malgré la permanence de ce type d'humour, ces différentes incarnations vieillissent souvent sur la forme, précisément parce qu'elles évitent toutes la crudité la plus totale, et que les euphémismes auxquels elles recourent, ou la forme d'hypocrisie qu'elles adoptent, dépendent totalement de la pruderie de leur époque. Lorsque celle-ci évolue, cet humour perd totalement ce qui en assurait sa subversion doucereuse.
« Les Desserts Gaulois » est une parfaite illustration de cet humour singulièrement daté, mais aussi de l'esprit général très borné d'Octave Pradels. L'illustration de couverture, par Gustave Fraipont (qui signe également de très nombreuses gravures les titres de chaque scénette) en dit déjà long sur la mentalité ici présente : on voit Octave Pradels, debout, hilare, déclamer ses gauloiseries devant deux jeunes femmes assises qui dissimulent derrière leurs éventails leurs sourires complices à ces plaisanteries fort inconvenantes. Il est important de noter que la position des éventails est soigneusement étudiée pour ne pas dissimuler tout à fait à l'humoriste leurs visages rougissants. Au second plan, une foule béate de spectateurs permet de cautionner la démarche de Pradels, que l'on pourrait juger immorale et impolie sans cela. Au tout premier plan, un étrange bouquet constitué de roses et de bouteilles de champagne suggère que tout cela se passe entre des gens riches, et donc de haute moralité.
Le recueil en lui-même brasse volontiers toutes ces idées, à la fois lubriques et réactionnaires, et d'autant plus réactionnaires que cela permet de s'autoriser une lubricité "de bon aloi" qui est largement déployée dans les 28 scénettes que rassemble ce recueil.
C'est néanmoins le seul écrit en prose, apparemment ajouté au dernier moment en guise de préface, car il n'est pas inclus dans le sommaire, qui se révèle le texte le plus essentiel de ce volume. Il s'agit d'un discours inaugural, « Causerie sur la Gaudriole », prononcé le 18 décembre 1890 au Théâtre d'Application, pour le lancement des « Soirées Gauloises » initiées par Octave Pradels. Cet essai de 23 pages est assez essentiel pour comprendre l'état d'esprit de cette forme d'humour populaire au moment qui précède ce qui deviendra son âge d'or, au tournant du XXème siècle.
Les « Soirées Gauloises » d'Octave Pradels connaîtront un franc-succès jusqu'à ce que Pradels rejoigne, quelques années plus tard, le Théâtre des Capucines, un monument de l'activité théâtrale fin-de-siècle, où furent joués pour la première fois nombre d'opéras comiques et d'opérettes, et dont Pradels finit par être nommé directeur en 1899. La Première Guerre Mondiale mit fin à cet âge d'or de la gaudriole, et le Théâtre des Capucines parvint à vivoter des vaudevilles de Feydeau jusqu'en 1973, où il fut remplacé par l'actuel cinéma qui porte son nom.
Le recueil se termine par ce qui était alors le morceau de roi le plus populaire de Pradels : l'interprétation avec l'accent anglais des Fables de la Fontaine, la version écrite reproduisant fidèlement les anglicismes typographiques qu'il fallait jouer à l'oral. Ce sont à la fois les scénettes les plus célèbres de Pradels (car aussi parmi les rares à être tous publics), et les plus incompréhensibles pour un lecteur contemporain. Il faut prendre en compte qu'en 1891, l'accent anglais sonnait pour nombre de français de manière aussi exotique que l'accent chinois. Alors très autocentrée sur sa culture, la société française n'était pas acclimatée à entendre souvent de l'anglais, et jugeait cette langue avant tout comme un babil aux sonorités comiques, particulièrement quand il en subsistait des traces dans une prononciation de la langue française. À la même époque, les Fables de la Fontaine étaient un passage obligé des études scolaires. Il n'y avait donc pas d'oeuvres poétiques qui soient aussi viscéralement françaises, populaires dans toutes les couches de la société et intimement liées aux souvenirs collectifs de la scolarité. Soumettre donc ces textes immuables au très "barbare" accent anglais plongeait donc assez facilement les gens dans une hilarité face à l'absurde. Mais évidemment, six ou sept générations plus tard, alors que nous avons tous grandi dans un monde formaté à la langue anglaise, rien de ce qui faisait rire nos ancêtres n'est en mesure de nous arracher encore un sourire. Cela ne choque pas, cela ne dérange pas, c'est juste que l'on ne voit pas ce qu'il y a là de drôle. Pourtant, ces interprétations "à l'anglaise" des Fables de la Fontaine furent à ce point populaires qu'il m'est arrivé de les croiser dans des ouvrages d'autres auteurs, avec ou sans la citation d'Octave Pradels comme auteur.
Enfin, nous terminerons en disséquant cette intrigante allusion aux "desserts" dans le titre du recueil. Que viennent faire ici les desserts ? Et bien, c'est là aussi très fortement lié aux habitudes sociales du XIXème siècle, où l'on raffolait des dîners de famille, souvent organisés dans des propriétés ou des maisons de campagne, car l'exode rural en était seulement à ses débuts. Même si bien des gens du terroir avaient déjà émigré dans les grandes villes, en profitant de l'accessibilité rendue possible par l'expansion du chemin de fer, la plupart des familles avaient conservé les maisons rurales de leurs parents ou grands-parents, lesquelles étaient suffisamment vastes pour pouvoir organiser des dîners rassemblant tous les membres épars d'une même famille. S'il était souvent bienvenu de discuter de politique ou des intérêts familiaux pendant le repas, une fois le dessert consommé, alors que chacun entrait dans la douce satisfaction de la digestion qui détend les esprits, il était de bon ton qu'un des membres de la famille fasse une petite performance humoristique, celui ou celle qui avait le plus de talent de comédien ou très souvent également les enfants de la famille auxquels on faisait réciter quelques poésies gentiment rigolotes ou jouer quelques scènes théâtrales agrémentées de costumes improvisés ou d'accessoires cocasses. C'était aussi dans ces moments-là que l'on pouvait interpréter une fable De La Fontaine avec un accent anglais caricatural.
Ce n'est donc pas pour les desserts, mais pour les moments conviviaux venant après le dessert que le recueil d'Octave Pradels offrait à chacun une vingtaine de petites scénettes rimées que l'on pouvait apprendre par coeur et déclamer à la fin des repas, ce qui fut sans doute bien pratiqué, car Octave Pradels a signé cinq ou six recueils semblables dans les années 1880 et 1890.
Muni de ces nécessaires connaissances historiques, on peut réellement apprécier « Les Desserts Gaulois » comme un témoignage appréciable de la société bourgeoise et/ou de la classe moyenne du XIXème siècle. On n'en rira guère, mais il est attendrissant de se pencher sur cette époque lointaine et plutôt heureuse, et en plus, qui s'amusait de bien peu de choses. Octave Pradels est l'un des inévitables visages de la Belle-Époque, son humour s'adressait directement à ses lecteurs en les plongeant dans leur vie quotidienne, s'appuyant sur un certain bon sens à la française, qui s'est toujours préoccupé de libertinage discret et de moralisme appuyé, suivant cette logique qui veut que l'on se trouve toujours de bonnes excuses à soi-même et aucune à autrui. Néanmoins, l'intérêt de l'oeuvre de Pradels est avant tout historique, et sans doute un peu poétique du fait de la forme rimée. Cependant, même les plus indécrottables amateurs d'humour populaire se sentiront assez peu mis en joie par cette oeuvre un peu obsessionnelle sur le plan thématique, mais trop frileuse et surtout trop soucieuse de se justifier en permanence.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Octave Pradels (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Compléter les titres
Orgueil et ..., de Jane Austen ?
Modestie
Vantardise
Innocence
Préjugé
10 questions
20431 lecteurs ont répondu
Thèmes :
humourCréer un quiz sur ce livre20431 lecteurs ont répondu