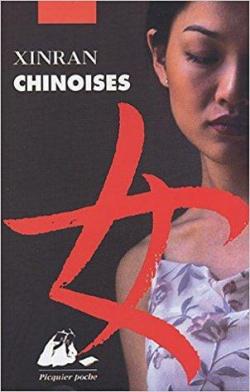Citations sur Chinoises (147)
De 1966 à 1976, les plus noires années de la Révolution culturelle, il n’y
avait presque rien dans la coupe ni la couleur qui distinguait les vêtements
des femmes de ceux des hommes. Les objets spécifiquement féminins
étaient rares. Le maquillage, les beaux vêtements et les bijoux n’existaient
que dans des romans interdits. Mais les Chinois de cette époque avaient
beau être révolutionnaires, ils ne pouvaient tous résister à l’appel de la
nature. Une personne pouvait être « révolutionnaire » sous bien des aspects,
il suffisait qu’elle succombe aux désirs sexuels « capitalistes » pour être
traînée sur le devant de la scène publique et mise au banc des prévenus. De
désespoir, certains attentaient à leur vie. D’autres se faisaient passer pour
des modèles de vertu mais abusaient de ceux, hommes et femmes, que l’on
réformait, faisant de leur soumission sexuelle « un test de loyauté ». La
majorité des gens qui ont traversé cette époque ont souffert d’interdits
sexuels, surtout les femmes. Les maris, en pleine maturité, étaient
emprisonnés ou envoyés dans des centres de rééducation, parfois pendant
vingt ans, et leurs femmes étaient contraintes de subir un état de veuvage de
leur vivant.
Maintenant que l’on essaie de mesurer les torts que la Révolution
culturelle a causés à la société chinoise, les dommages faits à l’instinct
sexuel sont un facteur à prendre en compte. Les Chinois disent que « dans
chaque famille, il y a un livre qu’il vaut mieux ne pas lire à haute voix ». Il
y a beaucoup de familles chinoises qui n’ont pas encore regardé en face ce
qui leur est arrivé pendant la Révolution culturelle. Ce sont les larmes qui
ont soudé ensemble les chapitres de ces livres de famille, et il est encore
trop tôt pour les ouvrir. Les générations futures ou ceux qui n’ont pas connu
ces histoires n’y verront que des titres brouillés. Quand les gens sont
témoins de la joie de familles ou d’amis qui se retrouvent après des années
de séparation, bien rares sont ceux qui osent se demander comment ils ont
réussi à s’accommoder de leurs désirs et de leurs souffrances pendant toutes
ces années-là.
Ce sont souvent les enfants, et plus particulièrement les filles, qui ont subi
les conséquences de la frustration des désirs sexuels. Pour une jeune fille,
grandir pendant la Révolution culturelle signifiait être confrontée à
l’ignorance, la folie et la perversion. On interdisait aux écoles et aux
familles de leur donner l’éducation sexuelle la plus élémentaire. De
nombreuses mères et enseignantes étaient elles-mêmes ignorantes en ces
domaines. Quand leurs corps se développaient, les filles devenaient la proie
d’attouchements ou de viols, des filles telles que Hongxue, dont la seule
expérience de plaisir sensuel venait d’une mouche ; Hua’er, qui fut
« violée » par la révolution ; l’auditrice anonyme mariée par le Parti ; ou
Shilin, qui ne saura jamais qu’elle a grandi. Les auteurs de ces crimes
étaient leurs professeurs, leurs maris, et même leurs pères et leurs frères, qui
avaient perdu le contrôle de leurs instincts bestiaux et se sont comportés de
la façon la plus égoïste et la plus ignoble qui soit. Les espérances de ces
filles ont été réduites à néant, et leur aptitude à faire l’expérience du plaisir
de l’amour, endommagée à vie. Si nous étions prêts à écouter leurs
cauchemars, il y faudrait dix à vingt ans, et leurs histoires se ressemblent
toutes.
Il est trop tard maintenant pour rendre la jeunesse et le bonheur à Hua’er et
aux femmes qui ont enduré la Révolution culturelle. Elles tirent les grandes
ombres noires de leurs souvenirs derrière elles.
avait presque rien dans la coupe ni la couleur qui distinguait les vêtements
des femmes de ceux des hommes. Les objets spécifiquement féminins
étaient rares. Le maquillage, les beaux vêtements et les bijoux n’existaient
que dans des romans interdits. Mais les Chinois de cette époque avaient
beau être révolutionnaires, ils ne pouvaient tous résister à l’appel de la
nature. Une personne pouvait être « révolutionnaire » sous bien des aspects,
il suffisait qu’elle succombe aux désirs sexuels « capitalistes » pour être
traînée sur le devant de la scène publique et mise au banc des prévenus. De
désespoir, certains attentaient à leur vie. D’autres se faisaient passer pour
des modèles de vertu mais abusaient de ceux, hommes et femmes, que l’on
réformait, faisant de leur soumission sexuelle « un test de loyauté ». La
majorité des gens qui ont traversé cette époque ont souffert d’interdits
sexuels, surtout les femmes. Les maris, en pleine maturité, étaient
emprisonnés ou envoyés dans des centres de rééducation, parfois pendant
vingt ans, et leurs femmes étaient contraintes de subir un état de veuvage de
leur vivant.
Maintenant que l’on essaie de mesurer les torts que la Révolution
culturelle a causés à la société chinoise, les dommages faits à l’instinct
sexuel sont un facteur à prendre en compte. Les Chinois disent que « dans
chaque famille, il y a un livre qu’il vaut mieux ne pas lire à haute voix ». Il
y a beaucoup de familles chinoises qui n’ont pas encore regardé en face ce
qui leur est arrivé pendant la Révolution culturelle. Ce sont les larmes qui
ont soudé ensemble les chapitres de ces livres de famille, et il est encore
trop tôt pour les ouvrir. Les générations futures ou ceux qui n’ont pas connu
ces histoires n’y verront que des titres brouillés. Quand les gens sont
témoins de la joie de familles ou d’amis qui se retrouvent après des années
de séparation, bien rares sont ceux qui osent se demander comment ils ont
réussi à s’accommoder de leurs désirs et de leurs souffrances pendant toutes
ces années-là.
Ce sont souvent les enfants, et plus particulièrement les filles, qui ont subi
les conséquences de la frustration des désirs sexuels. Pour une jeune fille,
grandir pendant la Révolution culturelle signifiait être confrontée à
l’ignorance, la folie et la perversion. On interdisait aux écoles et aux
familles de leur donner l’éducation sexuelle la plus élémentaire. De
nombreuses mères et enseignantes étaient elles-mêmes ignorantes en ces
domaines. Quand leurs corps se développaient, les filles devenaient la proie
d’attouchements ou de viols, des filles telles que Hongxue, dont la seule
expérience de plaisir sensuel venait d’une mouche ; Hua’er, qui fut
« violée » par la révolution ; l’auditrice anonyme mariée par le Parti ; ou
Shilin, qui ne saura jamais qu’elle a grandi. Les auteurs de ces crimes
étaient leurs professeurs, leurs maris, et même leurs pères et leurs frères, qui
avaient perdu le contrôle de leurs instincts bestiaux et se sont comportés de
la façon la plus égoïste et la plus ignoble qui soit. Les espérances de ces
filles ont été réduites à néant, et leur aptitude à faire l’expérience du plaisir
de l’amour, endommagée à vie. Si nous étions prêts à écouter leurs
cauchemars, il y faudrait dix à vingt ans, et leurs histoires se ressemblent
toutes.
Il est trop tard maintenant pour rendre la jeunesse et le bonheur à Hua’er et
aux femmes qui ont enduré la Révolution culturelle. Elles tirent les grandes
ombres noires de leurs souvenirs derrière elles.
Puis j’ai appelé le commissaire Mei. Je lui ai dit que Hua’er était japonaise
et je lui ai demandé si on pouvait la transférer dans une de ces prisons pour
étrangers où les conditions de détention étaient meilleures.
Il a hésité avant de répondre : « Xinran, en ce qui concerne le fait que
Hua’er soit japonaise, le silence est d’or. Pour le moment, elle est accusée
de délinquance sexuelle et de cohabitation illégale ; elle devrait sortir
bientôt. Si on apprend qu’elle est étrangère, on pourrait l’accuser d’avoir
des motivations politiques et cela pourrait aggraver son cas. »
Tous ceux qui ont traversé la Révolution culturelle se souviennent que les
femmes qui ont commis le « crime » d’avoir des vêtements ou un style de
vie non chinois ont été publiquement humiliées. On a tondu leurs cheveux
dans des coupes saugrenues selon la fantaisie des gardes rouges ; leurs
visages ont été barbouillés de rouge à lèvres ; les chaussures à hauts talons
liées ensemble sur une ficelle et enroulées autour de leurs corps ; des
morceaux de toutes sortes de « marchandises étrangères » ont été pendus à
leurs vêtements. On obligeait les femmes à raconter encore et encore
comment elles en étaient venues à posséder ces produits étrangers. J’avais
sept ans quand j’ai vu pour la première fois ce qu’on faisait subir à ces
femmes, qu’on promenait dans les rues sous les moqueries du peuple ; je
me souviens d’avoir pensé que s’il y avait une autre vie, je ne voulais pas
renaître femme.
La plupart de ces femmes étaient rentrées avec leurs maris dans leur mère
patrie pour consacrer leurs vies à la révolution et à la construction d’une
Chine nouvelle. A leur retour au pays, elles ont dû faire tout le travail
domestique sans l’aide des appareils les plus rudimentaires, mais le plus
difficile pour elles a été de renoncer au confort de la liberté de vivre et de
penser qu’elles avaient connu à l’étranger. Le moindre mot, la moindre
action étaient jugés sur un arrière-fond politique ; il leur a fallu partager les
persécutions contre leurs maris traités d’« espions » et subir « révolution »
après « révolution » pour avoir possédé des produits venant de l’étranger.
et je lui ai demandé si on pouvait la transférer dans une de ces prisons pour
étrangers où les conditions de détention étaient meilleures.
Il a hésité avant de répondre : « Xinran, en ce qui concerne le fait que
Hua’er soit japonaise, le silence est d’or. Pour le moment, elle est accusée
de délinquance sexuelle et de cohabitation illégale ; elle devrait sortir
bientôt. Si on apprend qu’elle est étrangère, on pourrait l’accuser d’avoir
des motivations politiques et cela pourrait aggraver son cas. »
Tous ceux qui ont traversé la Révolution culturelle se souviennent que les
femmes qui ont commis le « crime » d’avoir des vêtements ou un style de
vie non chinois ont été publiquement humiliées. On a tondu leurs cheveux
dans des coupes saugrenues selon la fantaisie des gardes rouges ; leurs
visages ont été barbouillés de rouge à lèvres ; les chaussures à hauts talons
liées ensemble sur une ficelle et enroulées autour de leurs corps ; des
morceaux de toutes sortes de « marchandises étrangères » ont été pendus à
leurs vêtements. On obligeait les femmes à raconter encore et encore
comment elles en étaient venues à posséder ces produits étrangers. J’avais
sept ans quand j’ai vu pour la première fois ce qu’on faisait subir à ces
femmes, qu’on promenait dans les rues sous les moqueries du peuple ; je
me souviens d’avoir pensé que s’il y avait une autre vie, je ne voulais pas
renaître femme.
La plupart de ces femmes étaient rentrées avec leurs maris dans leur mère
patrie pour consacrer leurs vies à la révolution et à la construction d’une
Chine nouvelle. A leur retour au pays, elles ont dû faire tout le travail
domestique sans l’aide des appareils les plus rudimentaires, mais le plus
difficile pour elles a été de renoncer au confort de la liberté de vivre et de
penser qu’elles avaient connu à l’étranger. Le moindre mot, la moindre
action étaient jugés sur un arrière-fond politique ; il leur a fallu partager les
persécutions contre leurs maris traités d’« espions » et subir « révolution »
après « révolution » pour avoir possédé des produits venant de l’étranger.
Hua’er a repris le fil de son histoire :
— Un jour, contrairement à son habitude, ma mère est rentrée très tard.
Seule ma sœur était encore debout. Somnolant à demi, j’ai entendu ma mère
lui dire : « Ils ont emprisonné papa. Où, je ne sais pas. A partir de
maintenant, je dois assister à des cours spéciaux tous les jours, et je risque
de rentrer très tard. J’emmènerai Shi avec moi, mais tu vas devoir t’occuper
de Shan et de Hua. Shu, tu es grande maintenant, fais-moi confiance : papa
et moi, nous ne sommes pas mauvais. Tu dois croire en nous, quoi qu’il
arrive. Nous sommes venus ici en Chine parce que nous voulions faire
connaître aux gens la culture japonaise et les aider à apprendre le japonais,
pas pour faire du mal… Aide-moi à m’occuper de ton frère et de ta sœur.
Ramasse des plantes sauvages sur le chemin quand tu rentres de l’école et
ajoute-les à la nourriture quand tu fais la cuisine. Persuade ton frère et ta
sœur de manger plus ; vous grandissez tous, il faut que vous mangiez à
votre faim. Fais bien attention à mettre le couvercle sur le poêle avant de
vous coucher pour ne pas être intoxiqués par les émanations de charbon.
Ferme les fenêtres et les portes soigneusement avant de partir et surtout
n’ouvre à personne. Si les gardes rouges viennent fouiller la maison, fais
sortir ton frère et ta sœur pour qu’ils n’aient pas peur. A partir de
maintenant, va te coucher en même temps que les petits. Ne m’attends pas.
Si tu as besoin de quelque chose, laisse-moi un mot, et je te laisserai la
réponse le lendemain matin avant de partir. Continue d’étudier le japonais
et la culture japonaise. Un jour, ça te sera utile. Etudie en secret, mais n’aie
pas peur. Les choses finiront par s’arranger. »
« Le visage de ma sœur était calme, mais les larmes dégoulinaient
silencieusement le long de ses joues en traçant deux sillons. Je me suis
pelotonnée sous l’édredon et j’ai pleuré sans bruit. Je ne voulais pas que ma
mère me voie.
Au souvenir des pleurs que poussait mon frère en réclamant notre mère, je
n’ai pu retenir mes propres larmes en entendant la scène décrite par Hua’er.
Elle était triste, mais elle ne pleurait pas.
— Un jour, contrairement à son habitude, ma mère est rentrée très tard.
Seule ma sœur était encore debout. Somnolant à demi, j’ai entendu ma mère
lui dire : « Ils ont emprisonné papa. Où, je ne sais pas. A partir de
maintenant, je dois assister à des cours spéciaux tous les jours, et je risque
de rentrer très tard. J’emmènerai Shi avec moi, mais tu vas devoir t’occuper
de Shan et de Hua. Shu, tu es grande maintenant, fais-moi confiance : papa
et moi, nous ne sommes pas mauvais. Tu dois croire en nous, quoi qu’il
arrive. Nous sommes venus ici en Chine parce que nous voulions faire
connaître aux gens la culture japonaise et les aider à apprendre le japonais,
pas pour faire du mal… Aide-moi à m’occuper de ton frère et de ta sœur.
Ramasse des plantes sauvages sur le chemin quand tu rentres de l’école et
ajoute-les à la nourriture quand tu fais la cuisine. Persuade ton frère et ta
sœur de manger plus ; vous grandissez tous, il faut que vous mangiez à
votre faim. Fais bien attention à mettre le couvercle sur le poêle avant de
vous coucher pour ne pas être intoxiqués par les émanations de charbon.
Ferme les fenêtres et les portes soigneusement avant de partir et surtout
n’ouvre à personne. Si les gardes rouges viennent fouiller la maison, fais
sortir ton frère et ta sœur pour qu’ils n’aient pas peur. A partir de
maintenant, va te coucher en même temps que les petits. Ne m’attends pas.
Si tu as besoin de quelque chose, laisse-moi un mot, et je te laisserai la
réponse le lendemain matin avant de partir. Continue d’étudier le japonais
et la culture japonaise. Un jour, ça te sera utile. Etudie en secret, mais n’aie
pas peur. Les choses finiront par s’arranger. »
« Le visage de ma sœur était calme, mais les larmes dégoulinaient
silencieusement le long de ses joues en traçant deux sillons. Je me suis
pelotonnée sous l’édredon et j’ai pleuré sans bruit. Je ne voulais pas que ma
mère me voie.
Au souvenir des pleurs que poussait mon frère en réclamant notre mère, je
n’ai pu retenir mes propres larmes en entendant la scène décrite par Hua’er.
Elle était triste, mais elle ne pleurait pas.
Pendant la Révolution culturelle, il suffisait d’appartenir à une famille
riche, d’avoir reçu une éducation supérieure, d’être un expert ou un savant,
d’entretenir des liens avec l’étranger ou d’avoir travaillé pour le
gouvernement de 1949 pour être taxé de contre-révolutionnaire. Il y avait
tellement de criminels politiques que les prisons ne suffisaient pas à les
contenir tous. Alors on envoyait les intellectuels dans des zones rurales
éloignées pour travailler aux champs. Le soir, ils devaient « confesser leurs
crimes » à des gardes rouges ou écouter les leçons de paysans qui n’avaient
jamais vu de voiture de leur vie ni entendu parler de l’électricité. Mes
parents ont connu bien des travaux forcés et des rééducations de ce genre.
Les paysans enseignaient aux intellectuels les chansons qu’ils chantaient
lors des semailles et comment tuer les porcs. Les intellectuels qui avaient
grandi dans des environnements raffinés, entourés de livres, frémissaient à
la vue du sang, et les paysans s’étonnaient de leur manque de savoir-faire et
d’habileté manuelle.
Une femme, professeur d’université, que j’ai interrogée un jour m’a
raconté que le paysan chargé de la surveiller, en voyant les jeunes plants de
blé qu’elle avait déterrés par erreur, lui avait demandé d’un ton apitoyé :
« Vous ne savez même pas faire la différence entre une mauvaise herbe et
un plant de blé. Qu’avez-vous donc appris à vos élèves ? Comment
pouviez-vous vous faire respecter ? » Les paysans de la zone montagneuse
où elle avait été envoyée s’étaient montrés extrêmement bons avec elle, et
partager leur vie pauvre lui avait été d’un grand enseignement. Selon elle, la
nature humaine était fondamentalement simple et fruste, et ce n’était que
lorsque les gens en savaient un peu plus sur les rouages de la société qu’ils
commençaient à se mêler des histoires des autres et à créer des problèmes.
Il y avait une part de vérité dans ce qu’elle disait, mais elle avait eu de la
chance de vivre la Révolution culturelle dans d’aussi bonnes conditions.
riche, d’avoir reçu une éducation supérieure, d’être un expert ou un savant,
d’entretenir des liens avec l’étranger ou d’avoir travaillé pour le
gouvernement de 1949 pour être taxé de contre-révolutionnaire. Il y avait
tellement de criminels politiques que les prisons ne suffisaient pas à les
contenir tous. Alors on envoyait les intellectuels dans des zones rurales
éloignées pour travailler aux champs. Le soir, ils devaient « confesser leurs
crimes » à des gardes rouges ou écouter les leçons de paysans qui n’avaient
jamais vu de voiture de leur vie ni entendu parler de l’électricité. Mes
parents ont connu bien des travaux forcés et des rééducations de ce genre.
Les paysans enseignaient aux intellectuels les chansons qu’ils chantaient
lors des semailles et comment tuer les porcs. Les intellectuels qui avaient
grandi dans des environnements raffinés, entourés de livres, frémissaient à
la vue du sang, et les paysans s’étonnaient de leur manque de savoir-faire et
d’habileté manuelle.
Une femme, professeur d’université, que j’ai interrogée un jour m’a
raconté que le paysan chargé de la surveiller, en voyant les jeunes plants de
blé qu’elle avait déterrés par erreur, lui avait demandé d’un ton apitoyé :
« Vous ne savez même pas faire la différence entre une mauvaise herbe et
un plant de blé. Qu’avez-vous donc appris à vos élèves ? Comment
pouviez-vous vous faire respecter ? » Les paysans de la zone montagneuse
où elle avait été envoyée s’étaient montrés extrêmement bons avec elle, et
partager leur vie pauvre lui avait été d’un grand enseignement. Selon elle, la
nature humaine était fondamentalement simple et fruste, et ce n’était que
lorsque les gens en savaient un peu plus sur les rouages de la société qu’ils
commençaient à se mêler des histoires des autres et à créer des problèmes.
Il y avait une part de vérité dans ce qu’elle disait, mais elle avait eu de la
chance de vivre la Révolution culturelle dans d’aussi bonnes conditions.
Elle a débuté notre entretien en me racontant comment sa mère avait choisi
son prénom et ceux de sa sœur et de ses frères. Sa mère avait dit que toute
chose dans la nature luttait pour trouver sa place, mais que les arbres, les
montagnes et les rochers étaient les plus forts, c’est pourquoi elle avait
appelé sa première fille Shu (arbre), son fils aîné Shan (montagne) et son
plus jeune fils Shi (rocher). Un arbre en fleurs est promesse de fruits, et des
fleurs sur une montagne ou un rocher l’embellissent, c’est pourquoi Hua’er
avait été nommée Hua (fleur).
— Tout le monde disait que j’étais la plus belle… peut-être parce que je
m’appelais Hua.
son prénom et ceux de sa sœur et de ses frères. Sa mère avait dit que toute
chose dans la nature luttait pour trouver sa place, mais que les arbres, les
montagnes et les rochers étaient les plus forts, c’est pourquoi elle avait
appelé sa première fille Shu (arbre), son fils aîné Shan (montagne) et son
plus jeune fils Shi (rocher). Un arbre en fleurs est promesse de fruits, et des
fleurs sur une montagne ou un rocher l’embellissent, c’est pourquoi Hua’er
avait été nommée Hua (fleur).
— Tout le monde disait que j’étais la plus belle… peut-être parce que je
m’appelais Hua.
La première personne qui m’a montré comment trouver le bonheur et la
beauté dans la vie en observant les gens et les choses autour de moi, a été
Yin Da.
Yin Da était orphelin. Il semblait ignorer comment il avait perdu ses
parents ; tout ce qu’il savait, c’est qu’il avait grandi sous la protection de
ses voisins de village, dans une hutte de 1,5 mètre de long sur 1,2 mètre de
large, où il n’y avait qu’un lit qui prenait tout l’espace. Il avait mangé le riz
d’une centaine de familles, porté les habits d’une centaine de maisonnées, et
appelé tous les villageois du nom de mère et père.
Je me souviens que Yin Da n’avait que les vêtements qu’il portait sur le
dos. L’hiver, il portait une épaisse veste de coton matelassé sur ses
vêtements d’été. Tout le monde autour de lui était pauvre, et une veste
matelassée pour l’hiver était déjà un luxe.
Yin Da devait avoir cinq ou six ans de plus que moi, mais nous étions dans
la même classe à l’école militaire. Pendant la Révolution culturelle, toutes
les institutions éducatives étaient virtuellement fermées ; seuls les collèges
et les écoles militaires étaient autorisés à continuer d’instruire les jeunes,
dans les domaines touchant à la défense nationale. Pour montrer son soutien
aux paysans et aux travailleurs de la ville occupée par la base militaire, mon
école s’était arrangée pour que les enfants du coin soient éduqués avec les
enfants de l’armée. La plupart d’entre eux avaient déjà quatorze ou quinze
ans quand ils ont débuté l’école primaire.
Si Yin Da se trouvait dans les alentours quand les enfants de « rouges » me
rossaient, me crachaient dessus ou m’insultaient, il venait toujours à ma
rescousse. Parfois, quand il me trouvait en train de pleurer dans un coin, il
disait aux gardes rouges qu’il allait m’apprendre à connaître les paysans et
il me faisait faire le tour de la ville. Il me montrait des maisons très pauvres
et m’expliquait pourquoi ces gens, qui gagnaient beaucoup moins qu’une
centaine de yuans par an, étaient heureux.
Le midi, Yin Da m’emmenait dans la colline derrière l’école contempler
les arbres et les plantes en fleurs. Il y a beaucoup d’arbres de la même
essence dans le monde, disait-il, et pourtant il n’y a pas deux feuilles
pareilles. Il disait que la vie était précieuse et que l’eau donnait la vie en se
donnant.
Il m’a demandé ce qui me plaisait dans la ville où était la base militaire.
J’ai répondu que je ne savais pas, il n’y avait rien à aimer ; c’était une petite
bourgade morne, sans couleurs, emplie de la fumée étouffante des feux de
poêles et de gens qui déambulaient dans leurs vestes déchirées et leurs
chemises effrangées. Yin Da m’a appris à regarder et à étudier
attentivement chaque maison de la ville, mêmes celles qui avaient été bâties
à partir de trois fois rien. Qui habitait ces maisons ? Que faisaient-ils à
l’intérieur ? Que faisaient-ils au-dehors ? Pourquoi cette porte était-elle à
demi ouverte ? La famille attendait-elle quelqu’un ou avaient-ils oublié de
fermer la porte ? Quelles conséquences pouvaient résulter de leur
négligence ?
J’ai suivi les conseils de Yin Da en m’efforçant de m’intéresser à ce qui
m’entourait, et je ne m’attristais plus autant des crachats et des vexations
que je subissais tous les jours. Je m’absorbais dans mes propres pensées,
imaginant les vies des gens dans les maisons. Le contraste entre le monde
imaginaire et le monde réel allait devenir une source à la fois de réconfort et
de tristesse pour moi.
beauté dans la vie en observant les gens et les choses autour de moi, a été
Yin Da.
Yin Da était orphelin. Il semblait ignorer comment il avait perdu ses
parents ; tout ce qu’il savait, c’est qu’il avait grandi sous la protection de
ses voisins de village, dans une hutte de 1,5 mètre de long sur 1,2 mètre de
large, où il n’y avait qu’un lit qui prenait tout l’espace. Il avait mangé le riz
d’une centaine de familles, porté les habits d’une centaine de maisonnées, et
appelé tous les villageois du nom de mère et père.
Je me souviens que Yin Da n’avait que les vêtements qu’il portait sur le
dos. L’hiver, il portait une épaisse veste de coton matelassé sur ses
vêtements d’été. Tout le monde autour de lui était pauvre, et une veste
matelassée pour l’hiver était déjà un luxe.
Yin Da devait avoir cinq ou six ans de plus que moi, mais nous étions dans
la même classe à l’école militaire. Pendant la Révolution culturelle, toutes
les institutions éducatives étaient virtuellement fermées ; seuls les collèges
et les écoles militaires étaient autorisés à continuer d’instruire les jeunes,
dans les domaines touchant à la défense nationale. Pour montrer son soutien
aux paysans et aux travailleurs de la ville occupée par la base militaire, mon
école s’était arrangée pour que les enfants du coin soient éduqués avec les
enfants de l’armée. La plupart d’entre eux avaient déjà quatorze ou quinze
ans quand ils ont débuté l’école primaire.
Si Yin Da se trouvait dans les alentours quand les enfants de « rouges » me
rossaient, me crachaient dessus ou m’insultaient, il venait toujours à ma
rescousse. Parfois, quand il me trouvait en train de pleurer dans un coin, il
disait aux gardes rouges qu’il allait m’apprendre à connaître les paysans et
il me faisait faire le tour de la ville. Il me montrait des maisons très pauvres
et m’expliquait pourquoi ces gens, qui gagnaient beaucoup moins qu’une
centaine de yuans par an, étaient heureux.
Le midi, Yin Da m’emmenait dans la colline derrière l’école contempler
les arbres et les plantes en fleurs. Il y a beaucoup d’arbres de la même
essence dans le monde, disait-il, et pourtant il n’y a pas deux feuilles
pareilles. Il disait que la vie était précieuse et que l’eau donnait la vie en se
donnant.
Il m’a demandé ce qui me plaisait dans la ville où était la base militaire.
J’ai répondu que je ne savais pas, il n’y avait rien à aimer ; c’était une petite
bourgade morne, sans couleurs, emplie de la fumée étouffante des feux de
poêles et de gens qui déambulaient dans leurs vestes déchirées et leurs
chemises effrangées. Yin Da m’a appris à regarder et à étudier
attentivement chaque maison de la ville, mêmes celles qui avaient été bâties
à partir de trois fois rien. Qui habitait ces maisons ? Que faisaient-ils à
l’intérieur ? Que faisaient-ils au-dehors ? Pourquoi cette porte était-elle à
demi ouverte ? La famille attendait-elle quelqu’un ou avaient-ils oublié de
fermer la porte ? Quelles conséquences pouvaient résulter de leur
négligence ?
J’ai suivi les conseils de Yin Da en m’efforçant de m’intéresser à ce qui
m’entourait, et je ne m’attristais plus autant des crachats et des vexations
que je subissais tous les jours. Je m’absorbais dans mes propres pensées,
imaginant les vies des gens dans les maisons. Le contraste entre le monde
imaginaire et le monde réel allait devenir une source à la fois de réconfort et
de tristesse pour moi.
Un jour, j’étais recroquevillée au fond de la classe à pleurer parce que les
enfants de « rouges » m’avaient rossée. Je croyais être seule, et j’ai été
étonnée quand l’un de mes professeurs s’est approché de moi par-derrière et
m’a tapoté légèrement l’épaule. A travers mes larmes, il m’était difficile de
lire l’expression de son visage à la faible lumière de la lampe, mais j’ai vu
qu’il me faisait signe de le suivre. J’avais confiance en lui parce que je
savais qu’il aidait des gens pauvres à l’extérieur de l’école.
Il m’a conduite jusqu’à une cabane au bord du terrain de jeux, où l’école
entassait du matériel au rebut. Il a ouvert la serrure d’un geste vif et m’a
poussée à l’intérieur. La fenêtre était obturée avec des journaux, et il faisait
très sombre. La pièce était remplie jusqu’au plafond d’un fouillis de choses
dépareillées et sentait le moisi et la pourriture. Je me suis raidie de dégoût,
mais le professeur s’est frayé un chemin dans ce labyrinthe avec une
aisance qui dénotait une longue habitude. Je l’ai suivi du mieux que j’ai pu.
Au centre de la pièce, j’ai été stupéfaite de trouver une bibliothèque
complète, en ordre. Plusieurs centaines de livres étaient rangés sur des
planches cassées. Pour la première fois, j’ai compris le sens de ce vers
célèbre : « Dans l’ombre la plus épaisse des saules, je découvris soudain les
fleurs brillantes d’un village. »
Le professeur m’a dit que cette bibliothèque était un secret qu’il gardait en
cadeau pour les générations futures. Peu importe ce qu’en pensent les
révolutionnaires, a-t-il dit, les gens ne peuvent se passer de livres. Sans
livres, nous ne pourrions pas comprendre le monde ; sans livres, nous ne
pourrions pas évoluer ; sans livres, la nature ne pourrait pas servir
l’humanité ; plus il parlait, plus son enthousiasme se communiquait à moi,
et plus j’avais peur. Je savais que c’étaient justement ces livres-là que la
Révolution culturelle s’efforçait de détruire. Le professeur m’a donné une
clef de la cabane en me disant que je pourrais m’y réfugier et y lire quand je
voulais.
La cabane se trouvait derrière les seules toilettes de l’école, aussi m’était-il
facile de m’y rendre sans me faire remarquer quand les autres enfants
participaient à des activités dont j’étais exclue.
Lors de mes premières visites à la cabane, j’ai trouvé l’odeur et l’obscurité
étouffantes, et j’ai foré un petit trou de la taille d’un pois dans les journaux
qui recouvraient la fenêtre. Je pouvais y coller un œil et regarder les enfants
jouer, en rêvant du jour où il me serait permis de me joindre à eux.
Mais la mêlée sur le terrain de jeux m’attristait tant que j’ai fini par me
mettre à lire. Il n’y avait pas beaucoup de livres faciles à lire et j’avais bien
de mal à comprendre le vocabulaire. Au début, le professeur répondait à
mes questions et m’expliquait des choses quand il venait voir si tout allait
bien ; puis il m’a apporté un dictionnaire, que je consultais
consciencieusement, même si je comprenais à peine la moitié de ce que je
lisais.
Les livres sur l’histoire de la Chine et des autres pays me fascinaient. Ils
m’ont beaucoup appris sur la vie : non seulement sur la « grande histoire »
que chacun connaît, mais aussi sur les gens simples qui tissent leur propre
histoire au jour le jour. Ces livres m’ont aussi enseigné que beaucoup de
questions restent sans réponses.
J’ai beaucoup appris de l’encyclopédie, ce qui m’a épargné bien des soucis
et des dépenses par la suite, car je suis habile de mes mains et je sais réparer
seule toutes sortes de choses, des bicyclettes jusqu’aux petites pannes
électriques. Je rêvais de devenir diplomate, avocate, journaliste ou écrivain.
Quand l’opportunité de choisir une profession s’est présentée, j’ai quitté
mon travail administratif dans l’armée, au bout de douze ans, pour devenir
journaliste. Le savoir latent que j’avais accumulé dans mon enfance est
venu une fois de plus à mon secours.
Le rêve que j’entretenais de rejoindre les autres enfants sur le terrain de
jeux ne s’est jamais réalisé, mais je me suis consolée à la lecture de récits
de batailles et d’effusions de sang dans cette bibliothèque secrète. Les
chroniques de guerre me donnaient le sentiment d’avoir de la chance de
vivre en temps de paix, et m’ont aidée à oublier les brimades qui
m’attendaient à l’extérieur de la cabane.
enfants de « rouges » m’avaient rossée. Je croyais être seule, et j’ai été
étonnée quand l’un de mes professeurs s’est approché de moi par-derrière et
m’a tapoté légèrement l’épaule. A travers mes larmes, il m’était difficile de
lire l’expression de son visage à la faible lumière de la lampe, mais j’ai vu
qu’il me faisait signe de le suivre. J’avais confiance en lui parce que je
savais qu’il aidait des gens pauvres à l’extérieur de l’école.
Il m’a conduite jusqu’à une cabane au bord du terrain de jeux, où l’école
entassait du matériel au rebut. Il a ouvert la serrure d’un geste vif et m’a
poussée à l’intérieur. La fenêtre était obturée avec des journaux, et il faisait
très sombre. La pièce était remplie jusqu’au plafond d’un fouillis de choses
dépareillées et sentait le moisi et la pourriture. Je me suis raidie de dégoût,
mais le professeur s’est frayé un chemin dans ce labyrinthe avec une
aisance qui dénotait une longue habitude. Je l’ai suivi du mieux que j’ai pu.
Au centre de la pièce, j’ai été stupéfaite de trouver une bibliothèque
complète, en ordre. Plusieurs centaines de livres étaient rangés sur des
planches cassées. Pour la première fois, j’ai compris le sens de ce vers
célèbre : « Dans l’ombre la plus épaisse des saules, je découvris soudain les
fleurs brillantes d’un village. »
Le professeur m’a dit que cette bibliothèque était un secret qu’il gardait en
cadeau pour les générations futures. Peu importe ce qu’en pensent les
révolutionnaires, a-t-il dit, les gens ne peuvent se passer de livres. Sans
livres, nous ne pourrions pas comprendre le monde ; sans livres, nous ne
pourrions pas évoluer ; sans livres, la nature ne pourrait pas servir
l’humanité ; plus il parlait, plus son enthousiasme se communiquait à moi,
et plus j’avais peur. Je savais que c’étaient justement ces livres-là que la
Révolution culturelle s’efforçait de détruire. Le professeur m’a donné une
clef de la cabane en me disant que je pourrais m’y réfugier et y lire quand je
voulais.
La cabane se trouvait derrière les seules toilettes de l’école, aussi m’était-il
facile de m’y rendre sans me faire remarquer quand les autres enfants
participaient à des activités dont j’étais exclue.
Lors de mes premières visites à la cabane, j’ai trouvé l’odeur et l’obscurité
étouffantes, et j’ai foré un petit trou de la taille d’un pois dans les journaux
qui recouvraient la fenêtre. Je pouvais y coller un œil et regarder les enfants
jouer, en rêvant du jour où il me serait permis de me joindre à eux.
Mais la mêlée sur le terrain de jeux m’attristait tant que j’ai fini par me
mettre à lire. Il n’y avait pas beaucoup de livres faciles à lire et j’avais bien
de mal à comprendre le vocabulaire. Au début, le professeur répondait à
mes questions et m’expliquait des choses quand il venait voir si tout allait
bien ; puis il m’a apporté un dictionnaire, que je consultais
consciencieusement, même si je comprenais à peine la moitié de ce que je
lisais.
Les livres sur l’histoire de la Chine et des autres pays me fascinaient. Ils
m’ont beaucoup appris sur la vie : non seulement sur la « grande histoire »
que chacun connaît, mais aussi sur les gens simples qui tissent leur propre
histoire au jour le jour. Ces livres m’ont aussi enseigné que beaucoup de
questions restent sans réponses.
J’ai beaucoup appris de l’encyclopédie, ce qui m’a épargné bien des soucis
et des dépenses par la suite, car je suis habile de mes mains et je sais réparer
seule toutes sortes de choses, des bicyclettes jusqu’aux petites pannes
électriques. Je rêvais de devenir diplomate, avocate, journaliste ou écrivain.
Quand l’opportunité de choisir une profession s’est présentée, j’ai quitté
mon travail administratif dans l’armée, au bout de douze ans, pour devenir
journaliste. Le savoir latent que j’avais accumulé dans mon enfance est
venu une fois de plus à mon secours.
Le rêve que j’entretenais de rejoindre les autres enfants sur le terrain de
jeux ne s’est jamais réalisé, mais je me suis consolée à la lecture de récits
de batailles et d’effusions de sang dans cette bibliothèque secrète. Les
chroniques de guerre me donnaient le sentiment d’avoir de la chance de
vivre en temps de paix, et m’ont aidée à oublier les brimades qui
m’attendaient à l’extérieur de la cabane.
Je suis née à Pékin en 1958, quand la Chine était si pauvre que la ration de
nourriture pour un jour consistait en une poignée de pois. Tandis que
d’autres enfants de mon âge avaient froid et faim, je mangeais des chocolats
d’importation dans la maison de ma grand-mère, dont la cour était fleurie et
remplie du chant des oiseaux. Mais la Chine s’apprêtait à abolir les
distinctions entre riches et pauvres, à sa manière unique, politique. Les
enfants qui avaient survécu à la pauvreté et aux privations allaient me traiter
avec mépris et m’insulter ; bientôt les richesses matérielles dont j’avais joui
autrefois seraient plus qu’amplement compensées par des souffrances
immatérielles. Il m’a bien fallu comprendre qu’il y avait dans la vie des
choses plus importantes que le chocolat.
Quand j’étais petite, ma grand-mère peignait et tressait mes cheveux tous
les jours en nattes bien unies et régulières avant de nouer un ruban à chaque
bout. J’étais extrêmement fière de mes nattes, et je secouais la tête avec
orgueil quand je marchais ou jouais. A l’heure du coucher, je ne laissais pas
ma grand-mère dénouer les rubans, et je plaçais mes nattes soigneusement
de chaque côté de l’oreiller avant de m’endormir. Parfois, en me levant le
matin et en trouvant mes nœuds défaits, je demandais d’un ton boudeur qui
avait détruit leur belle ordonnance.
Mes parents avaient été affectés à une base militaire près de la Grande
Muraille. A l’âge de sept ans, je les ai rejoints pour vivre avec eux, pour la
première fois depuis ma naissance. Moins d’une quinzaine de jours après
mon arrivée, les gardes rouges ont perquisitionné chez nous. Ils
soupçonnaient mon père d’être « un intellectuel réactionnaire » parce qu’il
était membre de l’Association chinoise des ingénieurs en mécanique de
haut niveau. On prétendait aussi que c’était « un laquais de l’impérialisme
anglais » parce que son père avait travaillé pour la firme britannique gec
pendant trente-cinq ans. En plus de cela, parce que notre maison contenait
des objets d’art, mon père a été accusé d’être « un représentant du
féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme ».
Je me souviens de l’essaim de gardes rouges envahissant la maison et d’un
grand feu dans notre cour où ils jetaient les livres de mon père, les précieux
meubles traditionnels de mes grands-parents et mes jouets. Ils ont arrêté et
emmené mon père. Effrayée et triste, je suis tombée dans une sorte de
stupeur en regardant le feu, j’avais l’impression d’entendre dans les
flammes des voix crier à l’aide. Le feu a tout consumé : la maison que je
venais tout juste de m’approprier, mon enfance jusque-là heureuse, mes
espoirs et la fierté que ma famille mettait en son savoir et ses richesses. Il a
imprimé en moi des regrets dont la brûlure ne se cicatrisera pas jusqu’à ma
mort.
A la lumière du feu, une fille portant un brassard rouge s’est avancée vers
moi, une grande paire de ciseaux à la main. Elle a empoigné mes tresses et a
décrété : « C’est un style de coiffure petit-bourgeois. »
Avant que je comprenne de quoi elle parlait, elle avait coupé mes tresses et
les avait jetées dans le feu. Figée sur place, j’ai regardé, les yeux
écarquillés, mes nattes et leurs jolis nœuds se transformer en cendres.
Quand les gardes rouges sont partis, la fille qui avait coupé mes nattes m’a
dit : « Dorénavant, il t’est interdit de nouer tes cheveux avec des rubans.
C’est une coiffure impérialiste ! »
Mon père en prison, ma mère n’avait plus le temps de s’occuper de nous.
Elle rentrait toujours tard, et quand elle restait à la maison, elle était
toujours en train d’écrire ; ce qu’elle écrivait, je l’ignorais. Mon frère et moi
ne pouvions acheter de la nourriture qu’à la cantine de l’unité de travail de
notre père où ils servaient un maigre ordinaire de navets ou de choux
bouillis. L’huile de friture était une denrée rare alors.
Un jour, ma mère a rapporté à la maison un morceau de poitrine de porc et
elle a préparé un ragoût pour nous dans la nuit. Le lendemain, avant de
partir travailler, elle m’a dit : « Quand tu rentreras, attise les charbons et
réchauffe le porc pour le déjeuner. Ne m’en laissez pas. Vous avez besoin de
manger, tous les deux. »
A mon retour de l’école à midi, je suis allée chercher mon frère chez une
voisine qui le gardait. Quand je lui ai dit qu’il allait avoir quelque chose de
bon à manger, il était tout content et il s’est assis docilement à table pour
me regarder réchauffer la nourriture.
Notre poêle était un haut fourneau en brique d’un type courant dans le
nord, et pour attiser le charbon avec un tisonnier, il fallait que je grimpe sur
un tabouret. C’était la première fois que je faisais cela toute seule. Je n’ai
pas compris que le tisonnier allait prendre la chaleur du fourneau, et comme
j’avais du mal à le retirer de la main droite, je l’ai agrippé fermement de la
gauche. La peau de ma paume a gonflé et s’est détachée et j’ai hurlé de
douleur.
La voisine est accourue quand elle m’a entendue. Elle a appelé un médecin
qui habitait non loin de là, mais il lui a dit qu’il n’osait pas venir sans
certificat, il lui fallait une permission spéciale pour aller voir à domicile
ceux qui faisaient l’objet d’une enquête.
Un autre voisin, un vieux professeur, a dit qu’il fallait frotter les brûlures
avec de la sauce de soja et il en a versé toute une bouteille sur ma main ; la
douleur était si insupportable que je me suis écroulée et tortillée sur le sol
dans tous les sens avant de m’évanouir.
Quand je suis revenue à moi, j’étais couchée et ma mère, assise à mon
chevet, tenait ma main gauche bandée dans les siennes, en se reprochant de
m’avoir demandé de me servir du poêle.
Aujourd’hui encore, j’ai du mal à comprendre comment ce médecin a pu
invoquer le statut politique de notre famille pour refuser de me porter
secours.
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer penda
nourriture pour un jour consistait en une poignée de pois. Tandis que
d’autres enfants de mon âge avaient froid et faim, je mangeais des chocolats
d’importation dans la maison de ma grand-mère, dont la cour était fleurie et
remplie du chant des oiseaux. Mais la Chine s’apprêtait à abolir les
distinctions entre riches et pauvres, à sa manière unique, politique. Les
enfants qui avaient survécu à la pauvreté et aux privations allaient me traiter
avec mépris et m’insulter ; bientôt les richesses matérielles dont j’avais joui
autrefois seraient plus qu’amplement compensées par des souffrances
immatérielles. Il m’a bien fallu comprendre qu’il y avait dans la vie des
choses plus importantes que le chocolat.
Quand j’étais petite, ma grand-mère peignait et tressait mes cheveux tous
les jours en nattes bien unies et régulières avant de nouer un ruban à chaque
bout. J’étais extrêmement fière de mes nattes, et je secouais la tête avec
orgueil quand je marchais ou jouais. A l’heure du coucher, je ne laissais pas
ma grand-mère dénouer les rubans, et je plaçais mes nattes soigneusement
de chaque côté de l’oreiller avant de m’endormir. Parfois, en me levant le
matin et en trouvant mes nœuds défaits, je demandais d’un ton boudeur qui
avait détruit leur belle ordonnance.
Mes parents avaient été affectés à une base militaire près de la Grande
Muraille. A l’âge de sept ans, je les ai rejoints pour vivre avec eux, pour la
première fois depuis ma naissance. Moins d’une quinzaine de jours après
mon arrivée, les gardes rouges ont perquisitionné chez nous. Ils
soupçonnaient mon père d’être « un intellectuel réactionnaire » parce qu’il
était membre de l’Association chinoise des ingénieurs en mécanique de
haut niveau. On prétendait aussi que c’était « un laquais de l’impérialisme
anglais » parce que son père avait travaillé pour la firme britannique gec
pendant trente-cinq ans. En plus de cela, parce que notre maison contenait
des objets d’art, mon père a été accusé d’être « un représentant du
féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme ».
Je me souviens de l’essaim de gardes rouges envahissant la maison et d’un
grand feu dans notre cour où ils jetaient les livres de mon père, les précieux
meubles traditionnels de mes grands-parents et mes jouets. Ils ont arrêté et
emmené mon père. Effrayée et triste, je suis tombée dans une sorte de
stupeur en regardant le feu, j’avais l’impression d’entendre dans les
flammes des voix crier à l’aide. Le feu a tout consumé : la maison que je
venais tout juste de m’approprier, mon enfance jusque-là heureuse, mes
espoirs et la fierté que ma famille mettait en son savoir et ses richesses. Il a
imprimé en moi des regrets dont la brûlure ne se cicatrisera pas jusqu’à ma
mort.
A la lumière du feu, une fille portant un brassard rouge s’est avancée vers
moi, une grande paire de ciseaux à la main. Elle a empoigné mes tresses et a
décrété : « C’est un style de coiffure petit-bourgeois. »
Avant que je comprenne de quoi elle parlait, elle avait coupé mes tresses et
les avait jetées dans le feu. Figée sur place, j’ai regardé, les yeux
écarquillés, mes nattes et leurs jolis nœuds se transformer en cendres.
Quand les gardes rouges sont partis, la fille qui avait coupé mes nattes m’a
dit : « Dorénavant, il t’est interdit de nouer tes cheveux avec des rubans.
C’est une coiffure impérialiste ! »
Mon père en prison, ma mère n’avait plus le temps de s’occuper de nous.
Elle rentrait toujours tard, et quand elle restait à la maison, elle était
toujours en train d’écrire ; ce qu’elle écrivait, je l’ignorais. Mon frère et moi
ne pouvions acheter de la nourriture qu’à la cantine de l’unité de travail de
notre père où ils servaient un maigre ordinaire de navets ou de choux
bouillis. L’huile de friture était une denrée rare alors.
Un jour, ma mère a rapporté à la maison un morceau de poitrine de porc et
elle a préparé un ragoût pour nous dans la nuit. Le lendemain, avant de
partir travailler, elle m’a dit : « Quand tu rentreras, attise les charbons et
réchauffe le porc pour le déjeuner. Ne m’en laissez pas. Vous avez besoin de
manger, tous les deux. »
A mon retour de l’école à midi, je suis allée chercher mon frère chez une
voisine qui le gardait. Quand je lui ai dit qu’il allait avoir quelque chose de
bon à manger, il était tout content et il s’est assis docilement à table pour
me regarder réchauffer la nourriture.
Notre poêle était un haut fourneau en brique d’un type courant dans le
nord, et pour attiser le charbon avec un tisonnier, il fallait que je grimpe sur
un tabouret. C’était la première fois que je faisais cela toute seule. Je n’ai
pas compris que le tisonnier allait prendre la chaleur du fourneau, et comme
j’avais du mal à le retirer de la main droite, je l’ai agrippé fermement de la
gauche. La peau de ma paume a gonflé et s’est détachée et j’ai hurlé de
douleur.
La voisine est accourue quand elle m’a entendue. Elle a appelé un médecin
qui habitait non loin de là, mais il lui a dit qu’il n’osait pas venir sans
certificat, il lui fallait une permission spéciale pour aller voir à domicile
ceux qui faisaient l’objet d’une enquête.
Un autre voisin, un vieux professeur, a dit qu’il fallait frotter les brûlures
avec de la sauce de soja et il en a versé toute une bouteille sur ma main ; la
douleur était si insupportable que je me suis écroulée et tortillée sur le sol
dans tous les sens avant de m’évanouir.
Quand je suis revenue à moi, j’étais couchée et ma mère, assise à mon
chevet, tenait ma main gauche bandée dans les siennes, en se reprochant de
m’avoir demandé de me servir du poêle.
Aujourd’hui encore, j’ai du mal à comprendre comment ce médecin a pu
invoquer le statut politique de notre famille pour refuser de me porter
secours.
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer penda
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer pendant presque cinq ans. Nous
avons eu plus de chance que d’autres : certains y ont passé près de dix ans.
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer pendant presque cinq ans. Nous
avons eu plus de chance que d’autres : certains y ont passé près de dix ans.
Au début de mon enquête sur la vie des femmes, j’étais pleine
d’enthousiasme juvénile, mais très ignorante. Maintenant que j’en savais
plus, ma compréhension s’était approfondie, mais je souffrais plus aussi. A
certains moments, je me sentais comme anesthésiée par toutes ces
souffrances que j’avais rencontrées, comme si une callosité se formait en
moi. Puis une nouvelle histoire se présentait et réveillait de nouveau toute
ma sensibilité.
d’enthousiasme juvénile, mais très ignorante. Maintenant que j’en savais
plus, ma compréhension s’était approfondie, mais je souffrais plus aussi. A
certains moments, je me sentais comme anesthésiée par toutes ces
souffrances que j’avais rencontrées, comme si une callosité se formait en
moi. Puis une nouvelle histoire se présentait et réveillait de nouveau toute
ma sensibilité.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Xinran (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
132 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre132 lecteurs ont répondu