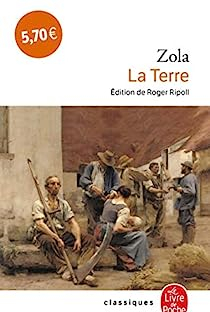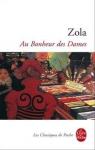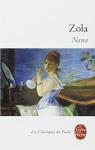Souvenir rugueux de cet opus des Rougon Macquart qui m'est rentré sous les ongles et continue de coller aux talons de mes escarpins de citadine en me rappelant mes origines paysannes.
J'aime particulièrement ce roman à part dans la saga, à la fois ode à la terre et exposition grinçante des moeurs du monde paysan de la fin du 19ième siècle, qui fait écho aux grands romans russes, Tolstoi ou Cholokhov, loin des campagnes riantes De Maupassant ou Thomas Hardy.
Tous les milieux sociaux que Zola explore dans les Rougon sont éminemment charnels et brutaux mais aucun ne l'est de manière aussi violemment érotisée et âpre que celui-là. Dans tous les sociétés humaines des Rougon on rencontre le vil et le bas, mais ces caractères ne sont jamais aussi naturels et consubstantiels à l'homme dans son mileu que dans "la Terre".
La matrice de l'oeuvre, peut-être?
J'aime particulièrement ce roman à part dans la saga, à la fois ode à la terre et exposition grinçante des moeurs du monde paysan de la fin du 19ième siècle, qui fait écho aux grands romans russes, Tolstoi ou Cholokhov, loin des campagnes riantes De Maupassant ou Thomas Hardy.
Tous les milieux sociaux que Zola explore dans les Rougon sont éminemment charnels et brutaux mais aucun ne l'est de manière aussi violemment érotisée et âpre que celui-là. Dans tous les sociétés humaines des Rougon on rencontre le vil et le bas, mais ces caractères ne sont jamais aussi naturels et consubstantiels à l'homme dans son mileu que dans "la Terre".
La matrice de l'oeuvre, peut-être?
Dix années, quatre saisons, plus une, pour boucler et relancer la boucle.
La Terre se donne le temps d'exister , d'inscrire sa marche dans le temps, dans le lent recommencement des saisons, des Travaux et des Jours…
Et pour ouvrir et clore ce cycle, mystérieusement fécond et obstinément vivant, un seul et même témoin : Jean Macquart, étranger à la paysannerie, soldat devenu semeur par dégoût de la guerre, puis semeur redevenu soldat par dégoût de la gent paysanne.
Ce regard extérieur qui ouvre et ferme le récit c'est aussi celui de Zola, l'homme des villes, qui ne connaissait guère que la campagne aixoise de son enfance puis sa « campagne » de Médan où il vécut en bourgeois. Une documentation s'imposait : rencontres, lectures et un séjour en Beauce où il découvrit le village de Romilly-sur-Aigre…
Rognes-sur-Aigre était né !
Une découverte double : celle de la terre et celle des paysans.
Car, si Zola voit la terre comme la mère des plus nobles travaux- ceux qui donnent le pain, le vin, ceux qui nourrissent les hommes et les bêtes, ceux qui donnent la vie- elle est aussi, à ses yeux, le théâtre d'une lutte sauvage, barbare, sans pitié: celle que se livrent entre eux ces paysans sur lesquels il jette un regard …atterré !
Le même, sans doute, que jettent sur le monde paysan, le curé et l'instituteur de Rognes, pour une fois réunis dans le même haut-le cœur ! "Vous ne vous entendez guère ensemble, isolés, méfiants, ignorants ; vous mettez toute votre canaillerie à vous dévorer entre vous..» s'écrie Lequeu, l'instituteur, enfin sorti de sa réserve prudente de fonctionnaire. Et le curé Godard, bégayant de fureur quand ces mécréants lui demandent une messe d'enterrement, fait chorus : « ah ! ces païens faisaient exprès de mourir, ah ! ils croyaient de la sorte l'obliger à céder, eh bien, ils s'enfouiraient tout seuls, ce ne serait fichtre pas lui qui les aiderait à monter au ciel ! »
Ah ! ces habitants de Rognes- sur-Aigre- un nom programmatique ! - : âpres au gain et au grain, obscènes, ivrognes, avares, concupiscents, violents, incestueux, sans foi ni loi -mais plein de ruses avec les lois et plein de craintes superstitieuses- sans le moindre sentiment de respect ou d'attachement familial, - mais farouchement solidaires devant l'étranger…ou le gendarme !- profondément réactionnaires, respectueux de toute richesse même mal acquise, obéissant au plus fort sans rechigner mais durs au faible, au démuni, au vieux, à l'enfant – je ne dis pas à la femme, car La Terre présente quelques beaux spécimens de garces de tout âge: ces dames n'y sont pas en reste de cruauté, de perversité, de violence même…La palme à La Grande, une vieille carne de 90 ans, véritable poison, et increvable!
Quant à l'histoire, deux récits se croisent puis se mêlent - et toute la vie d'un petit village de Beauce plein de passions de jalousies et de haines recuites s'en trouve évoqué avec force, entre 1860 et 1870.
Fouan, un vieux paysan madré, opère une démission de ses biens et un partage de ses terres entre ses trois enfants, Fanny, Buteau et Hyacinthe dit Jésus-Christ, en vue de vivre ses vieux jours dans le repos soutenu par la rente que ne manquera pas de lui assurer cette donation. C'est sans compter la susceptibilité bornée de l'une, la violence retorse du second et la crapulerie ivrogne du troisième…Le pauvre vieux Fouan, sans terre et bientôt sans argent, va errer d'un enfant à l'autre, puis, ne suscitant plus ni respect, ni considération, mourir comme un chien…ses enfants se déchirant jusqu'à la mise en terre du vieux bonhomme..
La terre, encore.
Deux jeunes sœurs,orphelines et cousines des Fouan, Lise et Françoise, liées par une amitié qui paraissait sans faille, vont s'affronter, se déchirer, se détruire pour le sexe, l'argent, la terre.
La terre toujours.
Derrière ces luttes âpres, se disputent de plus vastes enjeux : les nouveaux modes de culture, d'enrichissement des sols, la menace de la mondialisation – le blé américain et ses cultures intensives – les révoltes sociales à venir- la Commune - et, terrible menace pour ces pauvres propriétaires terriens qui s'accrochent à la moindre parcelle, l'expropriation et la mise en commun des terres, et, dans l'immédiat, l'industrialisation galopante, le libéralisme des temps nouveaux qui font de la terre « une banque » et pour achever le tout, la guerre, qui emmène les plus jeunes, les plus pauvres, ceux qui ne peuvent payer pour éviter la conscription et qui tirent le mauvais numéro..
La terre, encore et toujours, à engraisser, à exploiter ou à défendre...
Toute l'époque, comme toujours,dans les Rougon-Macquart, revit avec fièvre derrière ces existences individuelles, mais là où Zola est grand, là où il est immense, c'est justement quand il dépasse l'individuel, le conjoncturel, l'historique et qu'il touche au mythe.
La Terre, c'est surtout cela : Gâ, la mère mycénienne, Déméter, la reine des moissons. Une déesse-Mère, cruelle et généreuse à la fois, qui donne et qui reprend avec la même impassibilité.
Belle sous la brume, odorante sous la fumure,endormie sous les frimas, alanguie sous la pluie, brûlante sous les fièvres d'août, dévastée sous la grêle, mais toujours féconde, recueillant en son sein les semences qu'on lui destine et supportant, sur son dos indifférent, celles des bêtes et des hommes qui y copulent frénétiquement …
Je vous renvoie à la magistrale scène de l'insémination du taureau, où Françoise, toute jeunette encore, donne un efficace coup de main à la nature ou à la scène de coïtus interruptus entre Jean et la même Françoise, quelques années plus tard...
Un livre audacieux, partial, terrible,puissant.
Noir....
La Terre se donne le temps d'exister , d'inscrire sa marche dans le temps, dans le lent recommencement des saisons, des Travaux et des Jours…
Et pour ouvrir et clore ce cycle, mystérieusement fécond et obstinément vivant, un seul et même témoin : Jean Macquart, étranger à la paysannerie, soldat devenu semeur par dégoût de la guerre, puis semeur redevenu soldat par dégoût de la gent paysanne.
Ce regard extérieur qui ouvre et ferme le récit c'est aussi celui de Zola, l'homme des villes, qui ne connaissait guère que la campagne aixoise de son enfance puis sa « campagne » de Médan où il vécut en bourgeois. Une documentation s'imposait : rencontres, lectures et un séjour en Beauce où il découvrit le village de Romilly-sur-Aigre…
Rognes-sur-Aigre était né !
Une découverte double : celle de la terre et celle des paysans.
Car, si Zola voit la terre comme la mère des plus nobles travaux- ceux qui donnent le pain, le vin, ceux qui nourrissent les hommes et les bêtes, ceux qui donnent la vie- elle est aussi, à ses yeux, le théâtre d'une lutte sauvage, barbare, sans pitié: celle que se livrent entre eux ces paysans sur lesquels il jette un regard …atterré !
Le même, sans doute, que jettent sur le monde paysan, le curé et l'instituteur de Rognes, pour une fois réunis dans le même haut-le cœur ! "Vous ne vous entendez guère ensemble, isolés, méfiants, ignorants ; vous mettez toute votre canaillerie à vous dévorer entre vous..» s'écrie Lequeu, l'instituteur, enfin sorti de sa réserve prudente de fonctionnaire. Et le curé Godard, bégayant de fureur quand ces mécréants lui demandent une messe d'enterrement, fait chorus : « ah ! ces païens faisaient exprès de mourir, ah ! ils croyaient de la sorte l'obliger à céder, eh bien, ils s'enfouiraient tout seuls, ce ne serait fichtre pas lui qui les aiderait à monter au ciel ! »
Ah ! ces habitants de Rognes- sur-Aigre- un nom programmatique ! - : âpres au gain et au grain, obscènes, ivrognes, avares, concupiscents, violents, incestueux, sans foi ni loi -mais plein de ruses avec les lois et plein de craintes superstitieuses- sans le moindre sentiment de respect ou d'attachement familial, - mais farouchement solidaires devant l'étranger…ou le gendarme !- profondément réactionnaires, respectueux de toute richesse même mal acquise, obéissant au plus fort sans rechigner mais durs au faible, au démuni, au vieux, à l'enfant – je ne dis pas à la femme, car La Terre présente quelques beaux spécimens de garces de tout âge: ces dames n'y sont pas en reste de cruauté, de perversité, de violence même…La palme à La Grande, une vieille carne de 90 ans, véritable poison, et increvable!
Quant à l'histoire, deux récits se croisent puis se mêlent - et toute la vie d'un petit village de Beauce plein de passions de jalousies et de haines recuites s'en trouve évoqué avec force, entre 1860 et 1870.
Fouan, un vieux paysan madré, opère une démission de ses biens et un partage de ses terres entre ses trois enfants, Fanny, Buteau et Hyacinthe dit Jésus-Christ, en vue de vivre ses vieux jours dans le repos soutenu par la rente que ne manquera pas de lui assurer cette donation. C'est sans compter la susceptibilité bornée de l'une, la violence retorse du second et la crapulerie ivrogne du troisième…Le pauvre vieux Fouan, sans terre et bientôt sans argent, va errer d'un enfant à l'autre, puis, ne suscitant plus ni respect, ni considération, mourir comme un chien…ses enfants se déchirant jusqu'à la mise en terre du vieux bonhomme..
La terre, encore.
Deux jeunes sœurs,orphelines et cousines des Fouan, Lise et Françoise, liées par une amitié qui paraissait sans faille, vont s'affronter, se déchirer, se détruire pour le sexe, l'argent, la terre.
La terre toujours.
Derrière ces luttes âpres, se disputent de plus vastes enjeux : les nouveaux modes de culture, d'enrichissement des sols, la menace de la mondialisation – le blé américain et ses cultures intensives – les révoltes sociales à venir- la Commune - et, terrible menace pour ces pauvres propriétaires terriens qui s'accrochent à la moindre parcelle, l'expropriation et la mise en commun des terres, et, dans l'immédiat, l'industrialisation galopante, le libéralisme des temps nouveaux qui font de la terre « une banque » et pour achever le tout, la guerre, qui emmène les plus jeunes, les plus pauvres, ceux qui ne peuvent payer pour éviter la conscription et qui tirent le mauvais numéro..
La terre, encore et toujours, à engraisser, à exploiter ou à défendre...
Toute l'époque, comme toujours,dans les Rougon-Macquart, revit avec fièvre derrière ces existences individuelles, mais là où Zola est grand, là où il est immense, c'est justement quand il dépasse l'individuel, le conjoncturel, l'historique et qu'il touche au mythe.
La Terre, c'est surtout cela : Gâ, la mère mycénienne, Déméter, la reine des moissons. Une déesse-Mère, cruelle et généreuse à la fois, qui donne et qui reprend avec la même impassibilité.
Belle sous la brume, odorante sous la fumure,endormie sous les frimas, alanguie sous la pluie, brûlante sous les fièvres d'août, dévastée sous la grêle, mais toujours féconde, recueillant en son sein les semences qu'on lui destine et supportant, sur son dos indifférent, celles des bêtes et des hommes qui y copulent frénétiquement …
Je vous renvoie à la magistrale scène de l'insémination du taureau, où Françoise, toute jeunette encore, donne un efficace coup de main à la nature ou à la scène de coïtus interruptus entre Jean et la même Françoise, quelques années plus tard...
Un livre audacieux, partial, terrible,puissant.
Noir....
La terre est une richesse, et comme richesse à l'image de l'or et de l'argent autour desquels les hommes de déchirent et s'entretuent, alors dans ce quinzième tome des Rougon-Macquart, Zola nous fascine avec verve de la puissance vraiment sadique de la terre qui met en danger la vie harmonieuse des familles...la dispute de l'héritage terre conduit à bien de tragédie. Pour une bonne terre, Zola a bien semé dans ce volume!
Malgré sa louable ambition de refléter la situation des paysans français à la fin du 19e siècle, Emile Zola parvient moins à atteindre l'essence réelle de ce monde rural que le reflet qui s'en échappe, devenant vérité aux yeux de l'écrivain alors qu'il « s'est contenté de parcourir la Beauce en calèche ». En-dehors des impressions ethnologiques cumulées au cours de ce parcours touristique, les fantasmes et légendes folkloriques sont esquissés à gros coups de brosse : le sang, le sexe et la mort fricotent dans un sordide mélange d'inceste, de zoophilie et de consanguinité.
Ni jouissive ni répugnante, cette soupe doit se boire avec une cuillère en argent. Emile Zola observe de loin ses paysans et pardonne leurs péchés imaginaires avec l'indulgence du privilégié qui a échappé aux vices de la misère et de l'ignorance. Si quelques scènes sincèrement troublantes émergent de l'ensemble –l'évolution des relations entre le grand-père Fouan et le petit-fils Jules déterminée par la fatalité du jugement social- et si quelques mauvaises prédictions du piètre agronome Zola parviennent à nous faire sourire en cette époque où la décroissance semble plus raisonnable qu'un développement infini de l'agriculture industrielle, le reste de la Terre flotte dans un entre-deux trouble, ne parvenant jamais à atteindre la représentation percutante du monde de Jacques Bonhomme ou une représentation mythique, digne héritière des pastorales antiques.
Ni jouissive ni répugnante, cette soupe doit se boire avec une cuillère en argent. Emile Zola observe de loin ses paysans et pardonne leurs péchés imaginaires avec l'indulgence du privilégié qui a échappé aux vices de la misère et de l'ignorance. Si quelques scènes sincèrement troublantes émergent de l'ensemble –l'évolution des relations entre le grand-père Fouan et le petit-fils Jules déterminée par la fatalité du jugement social- et si quelques mauvaises prédictions du piètre agronome Zola parviennent à nous faire sourire en cette époque où la décroissance semble plus raisonnable qu'un développement infini de l'agriculture industrielle, le reste de la Terre flotte dans un entre-deux trouble, ne parvenant jamais à atteindre la représentation percutante du monde de Jacques Bonhomme ou une représentation mythique, digne héritière des pastorales antiques.
Si, au commencement de ce quinzième tome, j'ai eu les yeux baissés, le regard rivé sur la terre, c'est de plus en plus courbée, pliée sous le poids des multiples vacheries humaines grouillant sur sa surface que j'ai refermé ce volume, complètement écrasée, le nez collé sur cette fameuse terre, objet de tant d'amour et de tant de haine.
À l'origine nourricière, la terre est bien loin de se résumer à cet unique aspect. Convoitée, achetée ou héritée, elle agit comme catalyseur de tous les penchants immoraux et cruels des paysans avides de possessions et de richesses.
Zola nous emmène donc grattouiller la terre de la Beauce. Il ne la grattouille pas vraiment d'ailleurs, il la retourne avec une telle énergie, un tel acharnement qu'il en déterre un joli tas d'immondices déposés par ceux qui la travaillent et dont les relents fétides n'ont rien à envier à ceux dégagés par le lisier !
Côté terre, c'est la Beauce, son étendue à perte de vue de champs cultivables. Un paysage monotone mais fécond où d'entrée de jeu les semeurs s'activent à ensemencer ses parcelles. Au gré des saisons, Zola nous servira les labours, la moisson, la fenaison, les vendanges… L'odeur de foin enveloppe, les fourchées pour former les meules cassent les reins, la sécheresse soulève la poussière au moindre souffle, la grêle fait défiler les lanternes qui sortent des logis pour constater les dégâts. L'auteur excelle à dérouler l'immensité de cette Beauce et, au printemps, y fait exploser les brins des céréales qui viennent l'animer et offrir toutes les teintes de son réveil.
Côté historique, Zola pointe déjà l'agonie de l'agriculture, le problème du morcellement, la chute des cours et la peur de la mondialisation qui va écraser les petits exploitants français.
Côté humain, c'est bien moins bucolique et monotone. le village de Rognes abrite des spécimens de la paysannerie qui prêtent parfois à rire, mais bien plus souvent à pleurer de désespoir face à la cruauté, à l'imbécilité et au comportement bestial qu'ils adoptent jusqu'au crime pour satisfaire leur cupidité.
Le vieux Fouan, fatigué et usé, s'est décidé à partager ses terres entre ses trois enfants. Zola nous régale alors d'une première scène tout à fait cocasse chez le notaire. Celui-ci, en pleine digestion, se coupe les ongles entre deux somnolences alors que la famille Fouan débat avec mesquinerie, avarice et virulence la rente dont les enfants devront s'acquitter pour subvenir aux besoins des parents vieillissants. le venin a pris sa source et nous allons le suivre dans les différents foyers de cette lamentable progéniture où tous les coups sont permis.
Dépossédé de sa terre, le père Fouan se verra aussi ravir toute autorité et toute dignité et ses enfants le feront valser de l'un à l'autre, histoire de lui extorquer le dernier bien qu'il couve fiévreusement.
Les autres villageois ne sont pas en reste, bourreaux ou victimes, ils se vautrent dans l'immoralité jusqu'à épuiser deux curés qui ne voudront ou ne pourront même plus exercer leur sacerdoce auprès de ces paysans mal dégrossis.
Aussi douce qu'une lame de rasoir, il y a aussi La Grande, soeur du vieux Fouan, qui attise les haines et asservit ses propres petits-enfants, se délectant du malheur des autres et de leurs déchéances.
Au milieu de tout ce beau monde, Jean Macquard tente de trouver l'amour mais les sentiments ne poussent pas sur cette terre peuplée de rustres qui se contentent d'assouvir goujatement leurs désirs sur les moindres tas de paille.
Dans cette morne plaine céréalière, les humains se déchaînent et se déchirent pour acquérir le moindre arpent de terre. de fertile, celle-ci deviendra destructrice sous la main de l'homme, trop désireux d'en avoir la propriété. Possessions et dépossessions y jouent alors une véritable farandole macabre.
Poussée à l'extrême, mêlant scènes loufoques, graveleuses, violentes ou tragiques, la vision de Zola du monde rural de l'époque est impitoyable. Un volume qui attaque, qui dézingue et qui ose dresser un tableau peut-être un peu (ou beaucoup ?) exagéré de la paysannerie de l'époque mais qui se lit toujours avec autant d'émerveillement grâce au talent de son auteur.
À l'origine nourricière, la terre est bien loin de se résumer à cet unique aspect. Convoitée, achetée ou héritée, elle agit comme catalyseur de tous les penchants immoraux et cruels des paysans avides de possessions et de richesses.
Zola nous emmène donc grattouiller la terre de la Beauce. Il ne la grattouille pas vraiment d'ailleurs, il la retourne avec une telle énergie, un tel acharnement qu'il en déterre un joli tas d'immondices déposés par ceux qui la travaillent et dont les relents fétides n'ont rien à envier à ceux dégagés par le lisier !
Côté terre, c'est la Beauce, son étendue à perte de vue de champs cultivables. Un paysage monotone mais fécond où d'entrée de jeu les semeurs s'activent à ensemencer ses parcelles. Au gré des saisons, Zola nous servira les labours, la moisson, la fenaison, les vendanges… L'odeur de foin enveloppe, les fourchées pour former les meules cassent les reins, la sécheresse soulève la poussière au moindre souffle, la grêle fait défiler les lanternes qui sortent des logis pour constater les dégâts. L'auteur excelle à dérouler l'immensité de cette Beauce et, au printemps, y fait exploser les brins des céréales qui viennent l'animer et offrir toutes les teintes de son réveil.
Côté historique, Zola pointe déjà l'agonie de l'agriculture, le problème du morcellement, la chute des cours et la peur de la mondialisation qui va écraser les petits exploitants français.
Côté humain, c'est bien moins bucolique et monotone. le village de Rognes abrite des spécimens de la paysannerie qui prêtent parfois à rire, mais bien plus souvent à pleurer de désespoir face à la cruauté, à l'imbécilité et au comportement bestial qu'ils adoptent jusqu'au crime pour satisfaire leur cupidité.
Le vieux Fouan, fatigué et usé, s'est décidé à partager ses terres entre ses trois enfants. Zola nous régale alors d'une première scène tout à fait cocasse chez le notaire. Celui-ci, en pleine digestion, se coupe les ongles entre deux somnolences alors que la famille Fouan débat avec mesquinerie, avarice et virulence la rente dont les enfants devront s'acquitter pour subvenir aux besoins des parents vieillissants. le venin a pris sa source et nous allons le suivre dans les différents foyers de cette lamentable progéniture où tous les coups sont permis.
Dépossédé de sa terre, le père Fouan se verra aussi ravir toute autorité et toute dignité et ses enfants le feront valser de l'un à l'autre, histoire de lui extorquer le dernier bien qu'il couve fiévreusement.
Les autres villageois ne sont pas en reste, bourreaux ou victimes, ils se vautrent dans l'immoralité jusqu'à épuiser deux curés qui ne voudront ou ne pourront même plus exercer leur sacerdoce auprès de ces paysans mal dégrossis.
Aussi douce qu'une lame de rasoir, il y a aussi La Grande, soeur du vieux Fouan, qui attise les haines et asservit ses propres petits-enfants, se délectant du malheur des autres et de leurs déchéances.
Au milieu de tout ce beau monde, Jean Macquard tente de trouver l'amour mais les sentiments ne poussent pas sur cette terre peuplée de rustres qui se contentent d'assouvir goujatement leurs désirs sur les moindres tas de paille.
Dans cette morne plaine céréalière, les humains se déchaînent et se déchirent pour acquérir le moindre arpent de terre. de fertile, celle-ci deviendra destructrice sous la main de l'homme, trop désireux d'en avoir la propriété. Possessions et dépossessions y jouent alors une véritable farandole macabre.
Poussée à l'extrême, mêlant scènes loufoques, graveleuses, violentes ou tragiques, la vision de Zola du monde rural de l'époque est impitoyable. Un volume qui attaque, qui dézingue et qui ose dresser un tableau peut-être un peu (ou beaucoup ?) exagéré de la paysannerie de l'époque mais qui se lit toujours avec autant d'émerveillement grâce au talent de son auteur.
Jean Macquart, ancien soldat revenu de Solferino, frère de Gervaise et de Lisa, cultive une terre de la Beauce, appartenant à Hourdequin, le maire du village de Rognes. Il se lie d'amitié avec Françoise et l'accompagne pour conduire sa vache au taureau chez son employeur.
Françoise est la nièce du père Fouan qui décide de partager ses terres entre ses trois enfants en échange d'une rente et d'un hébergement.
Le partage provoque des querelles, des jalousies, des haines d'une très grande violence et éveille une cupidité meurtrière.
Les paysans travaillent sans relâche et sont en butte avec les aléas du climat: la grêle, la canicule qui font des ravages dans les cultures, comme aujourd'hui.
Hourdequin essaye vainement d'introduire les machines, les méthodes modernes de l'agriculture, comme les phosphates, présents désormais dans les engrais
"La Terre" d'Emile Zola est un livre très noir et cru sur les laboureurs qui restent profondément attachés à la terre, malgré la dureté du travail, et se battent pour la garder quelqu'en soit le prix.
Malgré les condamnations des critiques au moment de la sortie du livre, "La Terre" reste un des romans le plus apprécié pour son réalisme et sa modernité.
Françoise est la nièce du père Fouan qui décide de partager ses terres entre ses trois enfants en échange d'une rente et d'un hébergement.
Le partage provoque des querelles, des jalousies, des haines d'une très grande violence et éveille une cupidité meurtrière.
Les paysans travaillent sans relâche et sont en butte avec les aléas du climat: la grêle, la canicule qui font des ravages dans les cultures, comme aujourd'hui.
Hourdequin essaye vainement d'introduire les machines, les méthodes modernes de l'agriculture, comme les phosphates, présents désormais dans les engrais
"La Terre" d'Emile Zola est un livre très noir et cru sur les laboureurs qui restent profondément attachés à la terre, malgré la dureté du travail, et se battent pour la garder quelqu'en soit le prix.
Malgré les condamnations des critiques au moment de la sortie du livre, "La Terre" reste un des romans le plus apprécié pour son réalisme et sa modernité.
Il m'aura fallu attendre le quinzième tome des Rougon-Macquart - et je peux retirer La bête humaine des suivants, déjà lu et franchement apprécié -, pour émettre mes premières réserves sur un roman de Zola.
En racontant la plaine de la Beauce, entre Châteaudun et Chartres, par l'intermédiaire d'un petit village comme il en existait beaucoup à l'époque, le romancier fait le choix, comme à son habitude, de nous décrire le monde paysan dans son quotidien le plus banal et le plus cru, des batailles d'héritage qui morcellent la terre de génération en génération, rendant les arpents de plus en plus maigres, à l'arrivée galopante de l'agriculture mécanisée, de masse, qui connaît ses premières réussites aux Etats-Unis, et qui sonne tragiquement le glas de l'agriculture telle que pratiquée en France sous peu. Comme toujours, en somme, une description des travers du progrès qui ronge à petit feu la vie des plus petits, ceux qui ne vivent que par et pour la terre, ici, avec en toile de fond, en fin de roman, la guerre contre la Prusse qui ajoute une part d'ombre au destin déjà bien sombre des campagnes.
Comme pour Au bonheur des dames, ce n'est pas l'un des membres de la famille Rougon-Macquart qui sera central, mais cette fois une famille, les Fouan, qui vivent de la terre depuis des siècles, et dont le père, trop âgé pour travailler, décide de partager ses biens à ses trois enfants, Fanny, Buteau, et Jésus-Christ, avant sa mort. Cette décision sonnera le glas, aussi, de la famille, qui usera des pires stratagèmes, plus ou moins tragiques d'ailleurs, pour chacun obtienne mieux que le reste de la fratrie, poussant au vol, au mensonge, au crime. Jean Macquart, frère de Gervaise et de Lisa, d'abord menuisier, parti aux campagnes d'Italie, revenu pour se faire valet de ferme, ne sera qu'une pierre dans l'édifice de cette ruine familiale, puisqu'il n'est qu'un étranger à la terre, celui qui vient de Plassans, celui qui a vécu à la ville, celui qui ne peut comprendre cette terre qu'il tente, tant bien que mal de faire sienne, tout comme Françoise, nièce du père Fouan. Et finalement, c'est, encore plus que les Fouan, la terre qui est centrale, qui décide, par sa possession, par les aléas climatiques qui lui permettent, ou pas, de s'épanouir, de la vie et de la mort de ceux qui la cultivent.
L'on pourrait se demander, après tout ce que je viens d'énoncer, ce qui a bien pu me déplaire dans ce tome : et bien c'est le trop plein, de violence, d'inhumanité, de barbarie... que nous dépeint le romancier dans ce monde agricole qui est, pour une fois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'on n'y croit peu, et l'on ressent, et tout cas je l'ai personnellement ressenti, pour la première fois, une certaine forme de méchanceté, de mépris, de dégoût derrière la peinture qui se veut réaliste du monde décrit, à qui ni l'auteur, ni Jean - qui est l'un des rares membres des Rougon-Macquart à ne pas avoir de violente tare - ne fait de cadeaux, qu'ils jugent terriblement, sans laisser à aucun moment l'idée d'un certain déterminisme social, culturel, qui expliquerait les raisons du comportement immoral présenté, d'ailleurs présenté franchement à outrance - tous boivent à longueur de journée, se troussent derrière les bottes de paille, sont prêts à trahir ou voler leurs prochains pour rien ou presque, et j'en oublie...
La terre est, à mon sens, un roman qui ne remplit pas du tout les objectifs naturalistes que s'était fixé le romancier - il y a toujours eu des entorses aux objectifs, ne serait-ce que par la plume, souvent peu objective, mais le fond le restait toujours à peu près -, qui décrit à charge, plutôt virulente, voire haineuse, le monde paysan, qui met mal à l'aise, d'ailleurs, de ce fait.
J'espère ne pas avoir de nouvelles mauvaises surprises à la lecture des quatre tomes restants.
En racontant la plaine de la Beauce, entre Châteaudun et Chartres, par l'intermédiaire d'un petit village comme il en existait beaucoup à l'époque, le romancier fait le choix, comme à son habitude, de nous décrire le monde paysan dans son quotidien le plus banal et le plus cru, des batailles d'héritage qui morcellent la terre de génération en génération, rendant les arpents de plus en plus maigres, à l'arrivée galopante de l'agriculture mécanisée, de masse, qui connaît ses premières réussites aux Etats-Unis, et qui sonne tragiquement le glas de l'agriculture telle que pratiquée en France sous peu. Comme toujours, en somme, une description des travers du progrès qui ronge à petit feu la vie des plus petits, ceux qui ne vivent que par et pour la terre, ici, avec en toile de fond, en fin de roman, la guerre contre la Prusse qui ajoute une part d'ombre au destin déjà bien sombre des campagnes.
Comme pour Au bonheur des dames, ce n'est pas l'un des membres de la famille Rougon-Macquart qui sera central, mais cette fois une famille, les Fouan, qui vivent de la terre depuis des siècles, et dont le père, trop âgé pour travailler, décide de partager ses biens à ses trois enfants, Fanny, Buteau, et Jésus-Christ, avant sa mort. Cette décision sonnera le glas, aussi, de la famille, qui usera des pires stratagèmes, plus ou moins tragiques d'ailleurs, pour chacun obtienne mieux que le reste de la fratrie, poussant au vol, au mensonge, au crime. Jean Macquart, frère de Gervaise et de Lisa, d'abord menuisier, parti aux campagnes d'Italie, revenu pour se faire valet de ferme, ne sera qu'une pierre dans l'édifice de cette ruine familiale, puisqu'il n'est qu'un étranger à la terre, celui qui vient de Plassans, celui qui a vécu à la ville, celui qui ne peut comprendre cette terre qu'il tente, tant bien que mal de faire sienne, tout comme Françoise, nièce du père Fouan. Et finalement, c'est, encore plus que les Fouan, la terre qui est centrale, qui décide, par sa possession, par les aléas climatiques qui lui permettent, ou pas, de s'épanouir, de la vie et de la mort de ceux qui la cultivent.
L'on pourrait se demander, après tout ce que je viens d'énoncer, ce qui a bien pu me déplaire dans ce tome : et bien c'est le trop plein, de violence, d'inhumanité, de barbarie... que nous dépeint le romancier dans ce monde agricole qui est, pour une fois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'on n'y croit peu, et l'on ressent, et tout cas je l'ai personnellement ressenti, pour la première fois, une certaine forme de méchanceté, de mépris, de dégoût derrière la peinture qui se veut réaliste du monde décrit, à qui ni l'auteur, ni Jean - qui est l'un des rares membres des Rougon-Macquart à ne pas avoir de violente tare - ne fait de cadeaux, qu'ils jugent terriblement, sans laisser à aucun moment l'idée d'un certain déterminisme social, culturel, qui expliquerait les raisons du comportement immoral présenté, d'ailleurs présenté franchement à outrance - tous boivent à longueur de journée, se troussent derrière les bottes de paille, sont prêts à trahir ou voler leurs prochains pour rien ou presque, et j'en oublie...
La terre est, à mon sens, un roman qui ne remplit pas du tout les objectifs naturalistes que s'était fixé le romancier - il y a toujours eu des entorses aux objectifs, ne serait-ce que par la plume, souvent peu objective, mais le fond le restait toujours à peu près -, qui décrit à charge, plutôt virulente, voire haineuse, le monde paysan, qui met mal à l'aise, d'ailleurs, de ce fait.
J'espère ne pas avoir de nouvelles mauvaises surprises à la lecture des quatre tomes restants.
Ce titre est pour moi l'un des plus forts de cette série des Rougon-Macquart. Il met en scène la paysannerie de la Beauce, entre tentatives de modernité (machine à faner, assolement de la terre, fumage de la terre), encore minoritaires et immobilisme.
Ces prises de position se lisent à travers des portraits de personnages forts, de paysans avides de terre, prêts à tuer pour elle. La terre devient le personnage principal, au coeur de la vie des hommes, au coeur du roman.
Cette terre, comparée à une femme fertile, est une maitresse qui épuise les hommes, et qui les incite à se battre pour elle.
C'est cru, bestial, à la limite de la caricature, mais comme dans tout Zola, c'est aussi très documenté, dressant un tableau de la France paysanne de l'Ancien Régime, en opposition à la France napoléonienne présentée dans ce roman. C'est un tableau social, mais aussi politique, avec un rapport de ces hommes à la liberté encore difficile.
Bien que pouvant se lire indépendamment de la série, comme chacun de ces titres, La Terre s'ancre cependant parfaitement dans la continuité voulue par Zola, par l'intermédiaire du personnage de Jean, venant de Plassans, frère de Gervaise (L'Assommoire), et que l'on retrouvera dans La Débâcle, après son engagement dans l'armée. A défaut d'avoir la terre, il va la défendre.
Ces prises de position se lisent à travers des portraits de personnages forts, de paysans avides de terre, prêts à tuer pour elle. La terre devient le personnage principal, au coeur de la vie des hommes, au coeur du roman.
Cette terre, comparée à une femme fertile, est une maitresse qui épuise les hommes, et qui les incite à se battre pour elle.
C'est cru, bestial, à la limite de la caricature, mais comme dans tout Zola, c'est aussi très documenté, dressant un tableau de la France paysanne de l'Ancien Régime, en opposition à la France napoléonienne présentée dans ce roman. C'est un tableau social, mais aussi politique, avec un rapport de ces hommes à la liberté encore difficile.
Bien que pouvant se lire indépendamment de la série, comme chacun de ces titres, La Terre s'ancre cependant parfaitement dans la continuité voulue par Zola, par l'intermédiaire du personnage de Jean, venant de Plassans, frère de Gervaise (L'Assommoire), et que l'on retrouvera dans La Débâcle, après son engagement dans l'armée. A défaut d'avoir la terre, il va la défendre.
N'y a t il pas plus extraordinaire que la Terre chez Zola ?
La façon dont cette dernière nous comble et nous récompense après l'avoir ensemencée, labourée, bêchée, fécondée que dis-je, rien qu'en la travaillant on ne peut que la vénérer et c'est bien elle qui est la plus respectée dans ce tome 15 des Rougon Macquart.
Ah notre cher Zola, nous a fait encore un chef d'oeuvre, plus on avance dans la saga familiale et plus on aime ses personnages ainsi que leurs vices les plus insidieux. Ces sacrés mâles paysans qui n'ont aucun respect pour les femmes et voient en elles que de vulgaires objets qui raviront leurs envies les plus bestiales. Sans oublier leurs intérêts personnels dans la possession et l'héritage des terres, un thème jamais épargné il faut l'avouer. Cela dit les femmes ne restent jamais clouées au sol, leur personnalité est toujours très prononcée, ce qui peut les faire triompher dans chaque tome.
Bref, bien évidemment la Terre est et restera la seule chose qu'on respecte profondément chez Zola, c'est bien pour cela que ce tome lui est dédié. Un magnifique opus que je referme avec délicatesse et plaisir à l'avoir savouré.
La façon dont cette dernière nous comble et nous récompense après l'avoir ensemencée, labourée, bêchée, fécondée que dis-je, rien qu'en la travaillant on ne peut que la vénérer et c'est bien elle qui est la plus respectée dans ce tome 15 des Rougon Macquart.
Ah notre cher Zola, nous a fait encore un chef d'oeuvre, plus on avance dans la saga familiale et plus on aime ses personnages ainsi que leurs vices les plus insidieux. Ces sacrés mâles paysans qui n'ont aucun respect pour les femmes et voient en elles que de vulgaires objets qui raviront leurs envies les plus bestiales. Sans oublier leurs intérêts personnels dans la possession et l'héritage des terres, un thème jamais épargné il faut l'avouer. Cela dit les femmes ne restent jamais clouées au sol, leur personnalité est toujours très prononcée, ce qui peut les faire triompher dans chaque tome.
Bref, bien évidemment la Terre est et restera la seule chose qu'on respecte profondément chez Zola, c'est bien pour cela que ce tome lui est dédié. Un magnifique opus que je referme avec délicatesse et plaisir à l'avoir savouré.
Toujours séduite par l'écriture captivante d'Émile Zola, ce 15ème volume de la série des Rougon-Macquart intitulé "La terre" est une réflexion sur le monde rural à travers l'intimité d'un clan familial, sujet qui fait écho à l'actualité.
Le roman commence et se termine un peu comme dans "Germinal" mais à la place d'Etienne Lantier qui va vivre un moment parmi les mineurs de fond, c'est Jean Macquart dit le caporal parce qu'il a fait l'armée, ancien menuisier, qui va travailler durant une dizaine d'années comme ouvrier agricole en Beauce où les cultures du pays sont toutes aux céréales et aux plantes fourragères avec un peu de vigne. C'est là qu'il rencontre la jeune Françoise, nièce du père Fouan. Trop vieux, ce dernier se résigne à faire don de ses terres à ses trois enfants, en accord avec sa femme. Sa propriété doit être partagée entre l'aîné surnommé Jésus-Christ, alcoolique et révolté qui dilapide ses sous au bistrot du village, Fanny pingre et mariée à Delhomme un cultivateur conseiller municipal et le plus jeune surnommé Buteau parce qu'il est buté, tellement obsédé pas l'idée d'être défavorisé qu'il refuse dans un premier temps le partage du terrain. Les trois héritiers sont en échange chargés de subvenir aux besoins de leurs parents, une obligation dont ils ne s'acquittent pas toujours.
Zola donne à voir la générosité mais surtout l'âpreté et la violence du milieu paysan. Je trouve que si le tableau est noir (les viols de Françoise sont révoltants…) le ton est juste.
Mais il est intéressant de voir que les parcours individuels intimes convergent aussi vers une émancipation collective qui se cherche dans la politique, malgré des différences radicales d'opinions entre républicains et bonapartistes. On y trouve un fond de révolte paysanne qui met en parallèle la situation agricole au 19eme siècle avec celle d'aujourd'hui.
Challenge Pavés 2024
Challenge Multi-défis 2024
Challenge ABC 2023-2024
Challenge XIXème siècle illimité
Le roman commence et se termine un peu comme dans "Germinal" mais à la place d'Etienne Lantier qui va vivre un moment parmi les mineurs de fond, c'est Jean Macquart dit le caporal parce qu'il a fait l'armée, ancien menuisier, qui va travailler durant une dizaine d'années comme ouvrier agricole en Beauce où les cultures du pays sont toutes aux céréales et aux plantes fourragères avec un peu de vigne. C'est là qu'il rencontre la jeune Françoise, nièce du père Fouan. Trop vieux, ce dernier se résigne à faire don de ses terres à ses trois enfants, en accord avec sa femme. Sa propriété doit être partagée entre l'aîné surnommé Jésus-Christ, alcoolique et révolté qui dilapide ses sous au bistrot du village, Fanny pingre et mariée à Delhomme un cultivateur conseiller municipal et le plus jeune surnommé Buteau parce qu'il est buté, tellement obsédé pas l'idée d'être défavorisé qu'il refuse dans un premier temps le partage du terrain. Les trois héritiers sont en échange chargés de subvenir aux besoins de leurs parents, une obligation dont ils ne s'acquittent pas toujours.
Zola donne à voir la générosité mais surtout l'âpreté et la violence du milieu paysan. Je trouve que si le tableau est noir (les viols de Françoise sont révoltants…) le ton est juste.
Mais il est intéressant de voir que les parcours individuels intimes convergent aussi vers une émancipation collective qui se cherche dans la politique, malgré des différences radicales d'opinions entre républicains et bonapartistes. On y trouve un fond de révolte paysanne qui met en parallèle la situation agricole au 19eme siècle avec celle d'aujourd'hui.
Challenge Pavés 2024
Challenge Multi-défis 2024
Challenge ABC 2023-2024
Challenge XIXème siècle illimité
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (294)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
593 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre593 lecteurs ont répondu