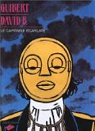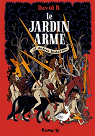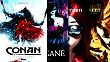Critiques de David B. (261)
Je n'ai pas vraiment aimé cette histoire un peu étrange d'homme sans visage qui livre un combat sans merci avec les Autorités d'un Paris à l'aube du XXème siècle. C'est également un duel qu'il livre avec un rat de bibliothèque pour les beaux yeux de Monelle. Bref, une double confrontation.
Les rapports entre les personnages me semblent totalement improbables. Le capitaine écarlate n'est point charismatique. Seul le commissaire de police a des réflexions qui laissent à réfléchir. Il faudra s'accrocher sur le bateau de l'histoire... Des pirates dans Paris: on aura tout vu ! Cela dépayse forcément.
Les auteurs puisent dans la littérature du XIXème siècle (je pense à Jules Verne) leur source d'inspiration. Cela donne un côté presque poétique.
Oeuvre intelligente et d'une rare richesse pour les uns, elle m'a laissé totalement insensible.
Les rapports entre les personnages me semblent totalement improbables. Le capitaine écarlate n'est point charismatique. Seul le commissaire de police a des réflexions qui laissent à réfléchir. Il faudra s'accrocher sur le bateau de l'histoire... Des pirates dans Paris: on aura tout vu ! Cela dépayse forcément.
Les auteurs puisent dans la littérature du XIXème siècle (je pense à Jules Verne) leur source d'inspiration. Cela donne un côté presque poétique.
Oeuvre intelligente et d'une rare richesse pour les uns, elle m'a laissé totalement insensible.
Un récit onirique hanté par le personnage de Marcel Schwob et de sa Monelle. Le capitaine écarlate quant à lui est un bibliothécaire un peu spécial devenu pirate de Paris ! Un tempestaire capable de commander aux vents qui a pris pour équipage des artisans et boutiquiers qui rêvaient d'une vie d'aventure.
C'est un livre absolument à part, difficile à décrire et à résumer.
Lien : http://toutzazimuth.eklablog..
C'est un livre absolument à part, difficile à décrire et à résumer.
Lien : http://toutzazimuth.eklablog..
Emmanuel Guibert et David B, c’est une association assez évidente. On imagine parfaitement le premier dessiner les univers fantasmagoriques du second. Cette collaboration est née en 2000 avec la sortie du « Capitaine écarlate », un one-shot de 64 pages paru dans la collection Aire Libre de Dupuis. Les amateurs de pirates et du Paris d’antan seront ravis !
David B. a montré déjà son amour pour un Paris passé fantasmé peuplé de gredins et teinté d’onirisme. Dans le « Capitaine écarlate », ledit Capitaine dirige une bande de pirate qui pille la capitale sur un bateau volant. Ou plutôt naviguant sur une vague volante… Quant aux pirates, ils ont échangé leur tête contre des vraies têtes de bandits…
« Le capitaine écarlate » narre l’histoire d’un homme passionné de briganderie et de piraterie, mais qui reste cloîtré dans sa bibliothèque, vivant le tout par procuration. Il y traîne un petit côté « Isaac le Pirate » ! Monelle, son amie, lui sert de lien avec cet univers. Mais quand elle est enlevée par les pirates, Marcel se doit d’intervenir et d’intégrer ce monde qui le fascine tant.
Plus qu’une cohérence, c’est une ambiance que l’on vient chercher dans ce livre. Et on la trouve ! Ce Paris d’antan, où le commissaire ne rêve que d’être muté dans les beaux quartiers est un vrai plaisir à découvrir. Au-delà du fantastique (voire de l’onirisme), il y a beaucoup de second degré dans l’ouvrage. En revanche, il faudra s’accrocher pour tout comprendre et une deuxième lecture se révèlera nécessaire pour saisir pleinement l’ensemble.
Le dessin de Guibert, si particulier et reconnaissable, sublime l’ensemble. Son utilisation des couleurs, avec de la bichromie la nuit, fait des merveilles. Le trait est beau, les personnages plus vrais que nature… Et tout cela en quelques coups de pinceaux maîtrisés.
Si « Le capitaine écarlate » ne manque pas de petits défauts, il n’en reste pas moins une œuvre personnelle, une œuvre d’auteurs, comme on n’en rencontre pas si souvent. L’ambiance particulière ne plaira pas à tout le monde, mais il serait dommage de passer à côté de cet OVNI réalisé par deux grands auteurs de BD.
Lien : http://blogbrother.fr/le-cap..
David B. a montré déjà son amour pour un Paris passé fantasmé peuplé de gredins et teinté d’onirisme. Dans le « Capitaine écarlate », ledit Capitaine dirige une bande de pirate qui pille la capitale sur un bateau volant. Ou plutôt naviguant sur une vague volante… Quant aux pirates, ils ont échangé leur tête contre des vraies têtes de bandits…
« Le capitaine écarlate » narre l’histoire d’un homme passionné de briganderie et de piraterie, mais qui reste cloîtré dans sa bibliothèque, vivant le tout par procuration. Il y traîne un petit côté « Isaac le Pirate » ! Monelle, son amie, lui sert de lien avec cet univers. Mais quand elle est enlevée par les pirates, Marcel se doit d’intervenir et d’intégrer ce monde qui le fascine tant.
Plus qu’une cohérence, c’est une ambiance que l’on vient chercher dans ce livre. Et on la trouve ! Ce Paris d’antan, où le commissaire ne rêve que d’être muté dans les beaux quartiers est un vrai plaisir à découvrir. Au-delà du fantastique (voire de l’onirisme), il y a beaucoup de second degré dans l’ouvrage. En revanche, il faudra s’accrocher pour tout comprendre et une deuxième lecture se révèlera nécessaire pour saisir pleinement l’ensemble.
Le dessin de Guibert, si particulier et reconnaissable, sublime l’ensemble. Son utilisation des couleurs, avec de la bichromie la nuit, fait des merveilles. Le trait est beau, les personnages plus vrais que nature… Et tout cela en quelques coups de pinceaux maîtrisés.
Si « Le capitaine écarlate » ne manque pas de petits défauts, il n’en reste pas moins une œuvre personnelle, une œuvre d’auteurs, comme on n’en rencontre pas si souvent. L’ambiance particulière ne plaira pas à tout le monde, mais il serait dommage de passer à côté de cet OVNI réalisé par deux grands auteurs de BD.
Lien : http://blogbrother.fr/le-cap..
Cette BD, je suis passée des dizaines de fois devant et je ne l'avais même jamais ouverte.
Pourtant, les noms sur la couverture sont pour moi des valeurs sures...
Quoi qu'il en soit, je l'ai lue et j'en suis très contente.
Nous sommes entrainés dans une histoire onirique et extra-ordinaire à la poursuite de pirates en plein coeur du Paris de la fin du XIXe siècles.
On retrouve quelques grands classiques de l'imaginaire de David B. magistralement sublimés par le dessin particulier et quelque peu éthéré de Guibert.
Les personnages sont touchants et attachants et on aimerait tellement rester plus longtemps avec eux, dans cet univers qui semble fuir, déjà.
Un très bon moment de lecture.
Pourtant, les noms sur la couverture sont pour moi des valeurs sures...
Quoi qu'il en soit, je l'ai lue et j'en suis très contente.
Nous sommes entrainés dans une histoire onirique et extra-ordinaire à la poursuite de pirates en plein coeur du Paris de la fin du XIXe siècles.
On retrouve quelques grands classiques de l'imaginaire de David B. magistralement sublimés par le dessin particulier et quelque peu éthéré de Guibert.
Les personnages sont touchants et attachants et on aimerait tellement rester plus longtemps avec eux, dans cet univers qui semble fuir, déjà.
Un très bon moment de lecture.
Petite lecture express du soir.
"Le cercueil de course" est une course contre la mort, une fable sociale pointant du doigt la pression constante pour atteindre des objectifs de plus en plus rapidement. Quelle est la finalité ? La mort ?
Dans un autre monde, "Le cercueil de course" est un élément fictif d'une histoire créative. Il s'agit d'un cercueil mystérieux apparaissant dans un cimetière pendant la pleine lune, contenant des instructions pour une aventure à travers la ville. C'est un élément fantastique et intrigant qui sert de point de départ à une histoire imaginative.
"Le cercueil de course" est une course contre la mort, une fable sociale pointant du doigt la pression constante pour atteindre des objectifs de plus en plus rapidement. Quelle est la finalité ? La mort ?
Dans un autre monde, "Le cercueil de course" est un élément fictif d'une histoire créative. Il s'agit d'un cercueil mystérieux apparaissant dans un cimetière pendant la pleine lune, contenant des instructions pour une aventure à travers la ville. C'est un élément fantastique et intrigant qui sert de point de départ à une histoire imaginative.
Très bel objet livre aux éditions de l'Association (Lewis Trondheim, Joann Sfar, Julie Doucet, Marjane Satrapi, Guy Delisle entre autres), très beau papier qui rend vraiment belles les illustrations en noir et blanc.
Davis B. livre ses cauchemars tout aussi saugrenus que macabres: la mort sous différentes déclinaisons: métamorphoses, fuites, diverses funestes créatures, fascisme...
Il doit être épuisé après de telles nuits
Davis B. livre ses cauchemars tout aussi saugrenus que macabres: la mort sous différentes déclinaisons: métamorphoses, fuites, diverses funestes créatures, fascisme...
Il doit être épuisé après de telles nuits
n des tous premiers livres de L'Association, et pour l'occasion, un sujet rarement abordé en bande dessinée: les rêves, non pas comme argument scénaristique, mais simplement la retranscription des rêves de l'auteur. D'un point de vue strictement narratif, le résultat peut être frustrant parce que ces 'histoires' n'ont évidemment ni queue, ni tête, mais elles témoignent d'un imaginaire étonnant et d'une volonté d'explorer d'autres espaces. Sans doute pas le meilleur David B intrinsèquement, mais un album fondateur.
J'avais acheté ce livre quand j'avais découvert David B. au début des années 2000. A l'époque, cet ouvrage avait déjà une dizaine d'années. J'en gardais un souvenir assez confus mais plutôt positif.
Il y a peu, j'ai lu une autre BD du même auteur, sur la même thématique : les rêves de David B et je n'étais pas vraiment entrée dedans.
Je me suis alors demandée si c'était ma sensibilité qui avait changé et j'ai donc ressorti ce tome du même auteur qui se penche sur le même thème : les rêves de David B.
Et bien j'ai bien aimé. Est ce la façon dont le découpage est fait? Le format? Le noir et blanc?
Je ne sais pas...
En tout cas, c'est amusant de voir comme le dessin de David B. a changé, évolué, entre ce tome et d'autres plus récents.
Il est aussi intéressant de voir dans certains des rêves des éléments qui inspireront la symbolique chère à l'auteur dans, notamment, l'Ascension du Haut Mal.
Il y a peu, j'ai lu une autre BD du même auteur, sur la même thématique : les rêves de David B et je n'étais pas vraiment entrée dedans.
Je me suis alors demandée si c'était ma sensibilité qui avait changé et j'ai donc ressorti ce tome du même auteur qui se penche sur le même thème : les rêves de David B.
Et bien j'ai bien aimé. Est ce la façon dont le découpage est fait? Le format? Le noir et blanc?
Je ne sais pas...
En tout cas, c'est amusant de voir comme le dessin de David B. a changé, évolué, entre ce tome et d'autres plus récents.
Il est aussi intéressant de voir dans certains des rêves des éléments qui inspireront la symbolique chère à l'auteur dans, notamment, l'Ascension du Haut Mal.
Il s'agit d'une bande dessinée de 56 pages, en couleurs. Elle est initialement parue en 2018, écrite par Jérôme Pierrat, dessinée et mise en couleurs par David B. Elle fait partie de la collection intitulée La petite bédéthèque des savoirs, éditée par Le Lombard. Cette collection s'est fixé comme but d'explorer le champ des sciences humaines et de la non-fiction. Elle regroupe donc des bandes dessinées didactiques, associant un spécialiste à un dessinateur professionnel, en proscrivant la forme du récit de fiction. Il s'agit donc d'une entreprise de vulgarisation sous une forme qui se veut ludique.
Cette bande dessinée se présente sous une forme assez petite, 13,9cm*19,6cm. Elle s'ouvre avec un avant-propos de David Vandermeulen de 4 pages, plus une page de notes. Il commence par évoquer l'étymologie du mot brigand, en commençant par celle du mot pirate, dérivé lui-même d'un mot pour désigner le fait de se risquer à quelque chose, de tenter sa chance. Il passe par le bon mot sur le deuxième métier le plus vieux du monde, pour ensuite développer la notion de brigand. Ces derniers correspondent à des individus organisés en bande, généralement s'octroyant les biens soit des honnêtes gens, soit de l'état, par la force et sous la menace. Il constate que de telles bandes existent aux quatre coins du monde, avec des appellations et des particularités diverses et variées, qu'il s'agisse de la mafia, des triades, des yakuzas, de la Camorra, de la Mano Nera, ou de la Yiddish Connection. Il termine son introduction avec la spécificité française, c’est-à-dire l'absence de mafia de grande envergure établie en France.
La bande dessinée commence par un dessin en pleine page représentant une exécution sommaire à Paris, rue de Lévis, un homme d'un certain âge en manteau avec son cabas de course, abattu par un tireur passager sur une moto. L'individu atteint par balle est Michel Kiejewski dit le Polonais, une légende dans le Milieu, qui a même connu le gang des Tractions Avant (en exercice de février à novembre 1946). À l'époque, le sport national des bandits était le braquage de fourgons, banques, paies d'usine et encaisseurs. C'était aussi l'époque des brigands célèbres comme René la Canne (René Girier, 1919-2000) cumulant, à lui tout seul, 17 évasions rocambolesques. Pour certains, c'était des héritiers des anciens des colonies pénitentiaires, dans la tradition des Apaches de Casque d'Or, ayant séjourné au bagne de Cayenne, eux-mêmes réalisant des opérations rappelant les techniques des bandits de grand chemin. Parmi ces bandits célèbres, il est encore possible de citer Mimile Buisson et son frère, Le Nuss, la Mammouth, Nez de Braise, et bien sûr le gang des Tractions Avant (Danos, Ruard, Attia, Naudy, Feufeu, Loutrel, Boucheseiche). Le Milieu comprenait d'autres professions illégales dont les représentants ne voyaient pas forcément d'un bon œil ces bandits aux méfaits trop spectaculaires.
Pour peu qu'il soit un habitué de la petite bédéthèque des savoirs, le lecteur se demande quel sera l'angle d'attaque de l'avant-propos de David Vandermeulen. Il ne s'attend pas forcément à une approche sémantique ; il est plus dans les rails avec l'évocation historique. Ce court avant-propos ne fait qu'établir l'existence de groupes d'individus s'enrichissant sur le dos des citoyens au mépris de la loi, par la coercition, avec une organisation plus ou moins lâche, à toutes les époques, dans différentes régions du globe. La dernière partie est la seule qui vient apporter un éclairage plus intéressant, en faisant observer que le milieu du crime organisé en France n'a pas donné naissance à une organisation pérenne de type mafieuse. Cette partie met plus l'eau à la bouche du lecteur qui espère bien que ce point sera développé dans la bande dessinée. Le reste n'apporte finalement pas grande information quant au grand banditisme, ou quant au contenu de la bande dessinée.
Il s'agit du deuxième de la petite bédéthèque des savoirs écrits par Jérôme Pierrat, le premier étant La Petite Bédéthèque des Savoirs, tome 8 : Le tatouage, avec Alfred. Le lecteur qui l'a lu relève d'ailleurs les références au bagne et aux colonies pénitentiaires présentes pour expliquer l'expression Des durs, des tatoués. Il constate également que l'auteur a réalisé un texte de type récitatif, qui pourrait presque se suffire à lui-même, sans illustration. Chaque page se compose le plus souvent de 3 illustrations, parfois 2, parfois 4, venant montrer une partie de ce qui dit le texte. Le récit commence par l'assassinat de Michel Kiejewski, un bandit notoire, en pleine rue à Paris, à une époque contemporaine. Cet individu étant sensé avoir connu l'époque du gang des Tractions Avant, l'évocation du grand banditisme commence à cette époque. Le lecteur sait bien qu'en 56 pages, les auteurs ne pourront pas réaliser un historique détaillé du grand banditisme à l'échelle mondiale. Un peu décontenancé par cette introduction, il jette un coup d'œil au sous-titre de l'ouvrage qui précise qu'il s'agit d'une histoire de la pègre française. Avec cette précision en tête, il comprend mieux pourquoi David Vandermeulen a consacré plus d'une page à la spécificité française du crime organisé, et pourquoi Jérôme Pierrat entame ainsi son exposé. Le démarrage aurait été moins abrupt si le préfacier avait explicité ce parti pris.
L'auteur fait donc le lien entre l'émergence d'une forme de crime organisé en France, avec les formes des époques passées, en prenant pour exemple les Apaches et Amélie Élie (1878-1933, surnommée Casque d'Or). Il prend ensuite des exemples emblématiques pour montrer d'où viennent les générations de bandits successifs, et quels furent leurs spécialités en matière d'activités criminelles. Le lecteur voit ainsi passer René Girier (1919-2000, 17 évasions au compteur), Pierre Loutrel (1916-1946, dit Pierrot le fou), Joseph Victor Brahim Atti (1916-1972, dit Jo Attia), ou encore Jean-Baptiste Croce, Gaetano Zampa & Francis Vanverberghe, la fratrie des Zemmour. Il établit que le fonds de commerce le plus stable du grand banditisme en France reste le proxénétisme, et que les braquages ont été à la mode à plusieurs époques. Au fil des pages, le lecteur découvre ainsi des personnages hauts en couleurs, usant de violence, occasionnant des dommages collatéraux, à commencer par des victimes innocentes (par exemple 23 convoyeurs abattus en 1995 et 2000). Il contextualise leurs origines, introduisant une dimension sociale. Il pointe du doigt la catastrophe que furent les projets pédagogiques (en toute ironie) des colonies pénitentiaires, ainsi que les associations contre nature (par exemple entre Loutrel ancien gestapiste et Jo Attia ancien prisonnier de camp de concentration).
Au fil des décennies qui sont évoquées, le lecteur observe l'évolution des domaines d'intervention du banditisme (casseur, trafiquant, bookmaker, cambrioleur, faussaire, etc.), ainsi que la capacité des bandits à s'adapter aux évolutions de la société, investissant de nouveaux domaines comme la finance, l'environnement, les denrées alimentaires, les nouvelles technologies, tout ce qui est qualifié de zone grise de l'économie. Il voit aussi arriver de nouvelles formes d'organisation s'appuyant sur l'évolution des technologies et de la demande, comme le marché du haschich marocain, avec revente à la sauvette dans les cités, et approvisionnement des dealers en Go Fast, pour profiter de l'ouverture des frontières et l'apparition du téléphone portable. Au fil des séquences, il trouve des explications sur des termes qu'il a déjà pu croiser dans des fictions sans forcément pouvoir bien les interpréter, comme celui de French Connection.
Le lecteur peut être un peu étonné de découvrir que cet exposé a été illustré par David B., l'auteur de L'ascension du Haut Mal, un récit autobiographique évoquant son frère épileptique. Effectivement, cet artiste se retrouve à illustrer un exposé très carré, peut-être livré clef en main, pour lequel il s'est forcément interrogé sur ce qu'il pouvait apporter. Le lecteur observe que les dessins apportent des éléments d'informations supplémentaires, qui ne sont pas contenus dans les cellules de texte. Pour commencer, les dessins participent à une forme basique mais bien réelle de reconstitution historique. En regardant les cases, le lecteur peut voir les marqueurs temporels que sont les tenues vestimentaires, les véhicules, ou encore les outils, les armes, les éléments technologiques. Les illustrations fixent donc l'époque dans l'esprit du lecteur. En outre, David B. réalise des dessins avec une approche entre caricature et naïveté, à la fois très simples de lecture et très expressifs. Au fil des pages, il apparaît que les bandits cités ou les activités illégales ne sont jamais représentées sous un jour favorable, ou romantique. Les visages et les silhouettes des criminels ne sont pas avenants, sans être non plus hideux. La prostitution et les braquages apparaissent comme prosaïques et brutaux, sans avoir besoin de recourir au gore. En creux, les dessins décrivent un monde agressif et malsain, exsudant une ambiance glauque. Grâce à cette approche graphique, David B. combine une forme descriptive simplifiée mais pas inexistante, avec un malaise sourd dépourvu de toute soupçon d'apologie ou de séduction. Le lecteur peut être décontenancé par la faiblesse de la reconstitution historique, mais rasséréné par l'absence totale de fascination pour ce mode de vie ou pour ce genre d'activité.
Le lecteur peut être un peu déstabilisé en débutant sa lecture, à la fois par l'avant-propos un peu rapide de David Vandermeulen, à la fois par le périmètre restreint de l'exposé, et également par le choix esthétique des dessins. Outre le fait qu'il s'agit d'une vulgarisation, il doit garder à l'esprit le sous-titre de l'ouvrage qui précise que l'objet se cantonne à la pègre française. Avec cette idée en tête, il comprend mieux la démarche des auteurs, et peut apprécier les images refusant de glorifier les bandits de quelque manière que ce soit, ainsi que la période retenue, relativement courte (après la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours). Les auteurs passent en revue et présentent l'évolution des grandes tendances du banditisme ne France, conformément à la promesse du sous-titre. Le lecteur peut apprécier la manière dont ils font ressortir l'adaptabilité de ces bandes, avec agilité et souplesse, en fonction des évolutions sociales et technologiques. Par comparaison avec d'autres tomes de la même collection, il peut regretter un propos pas tout à fait assez dense, qui le laisse sur sa faim.
Cette bande dessinée se présente sous une forme assez petite, 13,9cm*19,6cm. Elle s'ouvre avec un avant-propos de David Vandermeulen de 4 pages, plus une page de notes. Il commence par évoquer l'étymologie du mot brigand, en commençant par celle du mot pirate, dérivé lui-même d'un mot pour désigner le fait de se risquer à quelque chose, de tenter sa chance. Il passe par le bon mot sur le deuxième métier le plus vieux du monde, pour ensuite développer la notion de brigand. Ces derniers correspondent à des individus organisés en bande, généralement s'octroyant les biens soit des honnêtes gens, soit de l'état, par la force et sous la menace. Il constate que de telles bandes existent aux quatre coins du monde, avec des appellations et des particularités diverses et variées, qu'il s'agisse de la mafia, des triades, des yakuzas, de la Camorra, de la Mano Nera, ou de la Yiddish Connection. Il termine son introduction avec la spécificité française, c’est-à-dire l'absence de mafia de grande envergure établie en France.
La bande dessinée commence par un dessin en pleine page représentant une exécution sommaire à Paris, rue de Lévis, un homme d'un certain âge en manteau avec son cabas de course, abattu par un tireur passager sur une moto. L'individu atteint par balle est Michel Kiejewski dit le Polonais, une légende dans le Milieu, qui a même connu le gang des Tractions Avant (en exercice de février à novembre 1946). À l'époque, le sport national des bandits était le braquage de fourgons, banques, paies d'usine et encaisseurs. C'était aussi l'époque des brigands célèbres comme René la Canne (René Girier, 1919-2000) cumulant, à lui tout seul, 17 évasions rocambolesques. Pour certains, c'était des héritiers des anciens des colonies pénitentiaires, dans la tradition des Apaches de Casque d'Or, ayant séjourné au bagne de Cayenne, eux-mêmes réalisant des opérations rappelant les techniques des bandits de grand chemin. Parmi ces bandits célèbres, il est encore possible de citer Mimile Buisson et son frère, Le Nuss, la Mammouth, Nez de Braise, et bien sûr le gang des Tractions Avant (Danos, Ruard, Attia, Naudy, Feufeu, Loutrel, Boucheseiche). Le Milieu comprenait d'autres professions illégales dont les représentants ne voyaient pas forcément d'un bon œil ces bandits aux méfaits trop spectaculaires.
Pour peu qu'il soit un habitué de la petite bédéthèque des savoirs, le lecteur se demande quel sera l'angle d'attaque de l'avant-propos de David Vandermeulen. Il ne s'attend pas forcément à une approche sémantique ; il est plus dans les rails avec l'évocation historique. Ce court avant-propos ne fait qu'établir l'existence de groupes d'individus s'enrichissant sur le dos des citoyens au mépris de la loi, par la coercition, avec une organisation plus ou moins lâche, à toutes les époques, dans différentes régions du globe. La dernière partie est la seule qui vient apporter un éclairage plus intéressant, en faisant observer que le milieu du crime organisé en France n'a pas donné naissance à une organisation pérenne de type mafieuse. Cette partie met plus l'eau à la bouche du lecteur qui espère bien que ce point sera développé dans la bande dessinée. Le reste n'apporte finalement pas grande information quant au grand banditisme, ou quant au contenu de la bande dessinée.
Il s'agit du deuxième de la petite bédéthèque des savoirs écrits par Jérôme Pierrat, le premier étant La Petite Bédéthèque des Savoirs, tome 8 : Le tatouage, avec Alfred. Le lecteur qui l'a lu relève d'ailleurs les références au bagne et aux colonies pénitentiaires présentes pour expliquer l'expression Des durs, des tatoués. Il constate également que l'auteur a réalisé un texte de type récitatif, qui pourrait presque se suffire à lui-même, sans illustration. Chaque page se compose le plus souvent de 3 illustrations, parfois 2, parfois 4, venant montrer une partie de ce qui dit le texte. Le récit commence par l'assassinat de Michel Kiejewski, un bandit notoire, en pleine rue à Paris, à une époque contemporaine. Cet individu étant sensé avoir connu l'époque du gang des Tractions Avant, l'évocation du grand banditisme commence à cette époque. Le lecteur sait bien qu'en 56 pages, les auteurs ne pourront pas réaliser un historique détaillé du grand banditisme à l'échelle mondiale. Un peu décontenancé par cette introduction, il jette un coup d'œil au sous-titre de l'ouvrage qui précise qu'il s'agit d'une histoire de la pègre française. Avec cette précision en tête, il comprend mieux pourquoi David Vandermeulen a consacré plus d'une page à la spécificité française du crime organisé, et pourquoi Jérôme Pierrat entame ainsi son exposé. Le démarrage aurait été moins abrupt si le préfacier avait explicité ce parti pris.
L'auteur fait donc le lien entre l'émergence d'une forme de crime organisé en France, avec les formes des époques passées, en prenant pour exemple les Apaches et Amélie Élie (1878-1933, surnommée Casque d'Or). Il prend ensuite des exemples emblématiques pour montrer d'où viennent les générations de bandits successifs, et quels furent leurs spécialités en matière d'activités criminelles. Le lecteur voit ainsi passer René Girier (1919-2000, 17 évasions au compteur), Pierre Loutrel (1916-1946, dit Pierrot le fou), Joseph Victor Brahim Atti (1916-1972, dit Jo Attia), ou encore Jean-Baptiste Croce, Gaetano Zampa & Francis Vanverberghe, la fratrie des Zemmour. Il établit que le fonds de commerce le plus stable du grand banditisme en France reste le proxénétisme, et que les braquages ont été à la mode à plusieurs époques. Au fil des pages, le lecteur découvre ainsi des personnages hauts en couleurs, usant de violence, occasionnant des dommages collatéraux, à commencer par des victimes innocentes (par exemple 23 convoyeurs abattus en 1995 et 2000). Il contextualise leurs origines, introduisant une dimension sociale. Il pointe du doigt la catastrophe que furent les projets pédagogiques (en toute ironie) des colonies pénitentiaires, ainsi que les associations contre nature (par exemple entre Loutrel ancien gestapiste et Jo Attia ancien prisonnier de camp de concentration).
Au fil des décennies qui sont évoquées, le lecteur observe l'évolution des domaines d'intervention du banditisme (casseur, trafiquant, bookmaker, cambrioleur, faussaire, etc.), ainsi que la capacité des bandits à s'adapter aux évolutions de la société, investissant de nouveaux domaines comme la finance, l'environnement, les denrées alimentaires, les nouvelles technologies, tout ce qui est qualifié de zone grise de l'économie. Il voit aussi arriver de nouvelles formes d'organisation s'appuyant sur l'évolution des technologies et de la demande, comme le marché du haschich marocain, avec revente à la sauvette dans les cités, et approvisionnement des dealers en Go Fast, pour profiter de l'ouverture des frontières et l'apparition du téléphone portable. Au fil des séquences, il trouve des explications sur des termes qu'il a déjà pu croiser dans des fictions sans forcément pouvoir bien les interpréter, comme celui de French Connection.
Le lecteur peut être un peu étonné de découvrir que cet exposé a été illustré par David B., l'auteur de L'ascension du Haut Mal, un récit autobiographique évoquant son frère épileptique. Effectivement, cet artiste se retrouve à illustrer un exposé très carré, peut-être livré clef en main, pour lequel il s'est forcément interrogé sur ce qu'il pouvait apporter. Le lecteur observe que les dessins apportent des éléments d'informations supplémentaires, qui ne sont pas contenus dans les cellules de texte. Pour commencer, les dessins participent à une forme basique mais bien réelle de reconstitution historique. En regardant les cases, le lecteur peut voir les marqueurs temporels que sont les tenues vestimentaires, les véhicules, ou encore les outils, les armes, les éléments technologiques. Les illustrations fixent donc l'époque dans l'esprit du lecteur. En outre, David B. réalise des dessins avec une approche entre caricature et naïveté, à la fois très simples de lecture et très expressifs. Au fil des pages, il apparaît que les bandits cités ou les activités illégales ne sont jamais représentées sous un jour favorable, ou romantique. Les visages et les silhouettes des criminels ne sont pas avenants, sans être non plus hideux. La prostitution et les braquages apparaissent comme prosaïques et brutaux, sans avoir besoin de recourir au gore. En creux, les dessins décrivent un monde agressif et malsain, exsudant une ambiance glauque. Grâce à cette approche graphique, David B. combine une forme descriptive simplifiée mais pas inexistante, avec un malaise sourd dépourvu de toute soupçon d'apologie ou de séduction. Le lecteur peut être décontenancé par la faiblesse de la reconstitution historique, mais rasséréné par l'absence totale de fascination pour ce mode de vie ou pour ce genre d'activité.
Le lecteur peut être un peu déstabilisé en débutant sa lecture, à la fois par l'avant-propos un peu rapide de David Vandermeulen, à la fois par le périmètre restreint de l'exposé, et également par le choix esthétique des dessins. Outre le fait qu'il s'agit d'une vulgarisation, il doit garder à l'esprit le sous-titre de l'ouvrage qui précise que l'objet se cantonne à la pègre française. Avec cette idée en tête, il comprend mieux la démarche des auteurs, et peut apprécier les images refusant de glorifier les bandits de quelque manière que ce soit, ainsi que la période retenue, relativement courte (après la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours). Les auteurs passent en revue et présentent l'évolution des grandes tendances du banditisme ne France, conformément à la promesse du sous-titre. Le lecteur peut apprécier la manière dont ils font ressortir l'adaptabilité de ces bandes, avec agilité et souplesse, en fonction des évolutions sociales et technologiques. Par comparaison avec d'autres tomes de la même collection, il peut regretter un propos pas tout à fait assez dense, qui le laisse sur sa faim.
"Le Grand Banditisme" constitue donc une très bonne entrée en matière pour tout amateur de films noirs et autres tontons flingueurs qui serait curieux de se documenter, d’autant que les auteurs prennent toujours la peine de proposer des lectures complémentaires pour ceux qui désireraient aller plus loin.
Lien : http://www.bodoi.info/le-gra..
Lien : http://www.bodoi.info/le-gra..
Une BD illustrée par David B., d'office, elle a trois étoiles.
Alors, je sais c'est super empirique mais c'est comme ça. David B. c'est comme Klimt, pour moi, c'est quasi inconditionnel.
Mais c'est à peu près tout ce que je retiendrai de cette BD : son dessin toujours impeccable, mesuré et symbolique.
Pour le fond de la BD, je suis très partagée.
Ce petit tome nous donne les grandes lignes du grand banditisme français...mais c'est bien le souci.
Pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose, pour ne pas dire rien, c'est compliqué de comprendre ce petit ouvrage qui se résume, en grande partie, en une énumération de noms et de morts, surtout dans la première partie du tome.
Cela reste, cependant, intéressant pour comprendre l'évolution générale du "milieu" et la façon de celui-ci a évolué dans ses structures, ses techniques et ses centres d'intérêts.
Alors, je sais c'est super empirique mais c'est comme ça. David B. c'est comme Klimt, pour moi, c'est quasi inconditionnel.
Mais c'est à peu près tout ce que je retiendrai de cette BD : son dessin toujours impeccable, mesuré et symbolique.
Pour le fond de la BD, je suis très partagée.
Ce petit tome nous donne les grandes lignes du grand banditisme français...mais c'est bien le souci.
Pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose, pour ne pas dire rien, c'est compliqué de comprendre ce petit ouvrage qui se résume, en grande partie, en une énumération de noms et de morts, surtout dans la première partie du tome.
Cela reste, cependant, intéressant pour comprendre l'évolution générale du "milieu" et la façon de celui-ci a évolué dans ses structures, ses techniques et ses centres d'intérêts.
Visuellement assez pauvre, la mise en page reste très terre-à-terre et bien en deçà de ce qu’il avait montré dans Les Meilleurs Ennemis, un projet documentaire de même nature réalisé en collaboration avec Jean-Pierre Filiu.
Lien : https://www.bdgest.com/chron..
Lien : https://www.bdgest.com/chron..
Petit ouvrage pour grand banditisme, ce 25e volume de La petite bédéthèque des savoirs, section Histoire, est à dévorer comme un bon vieux film en noir et blanc !
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
3 contes réunis dans un lagnifique ouvrage. A partir de notre mythologie religieuse, l auteur nous emmène dans un monde sombre et poétique à la manière des contes des mille et une nuits. Le graphisme travaillé, plein de détails et d une créativité esthétique rare donne à l ouvrage une présence particulière. Gros coup de cœur.
Ce livre publié aux éditions Futuropolis, est un recueil de trois histoires d'ordre mythique ou légendaire.
Dans « Le prophète voilé », il est question de la guerre, du pouvoir et de la quête de vérité.
Dans « Le jardin armé » il y a une quête du Paradis et dans « Le tambour amoureux », un puissant guerrier réincarné en tambour va continuer à influencer les foules par-delà sa mort.
Les histoires ne m'ont pas passionnée, en revanche, je trouve le graphisme superbe et très riche et cette nouvelle lecture confirme pour moi la similitude avec le trait de Marjane Satrapi dans Persepolis.
Lien : http://toutzazimuth.eklablog..
Dans « Le prophète voilé », il est question de la guerre, du pouvoir et de la quête de vérité.
Dans « Le jardin armé » il y a une quête du Paradis et dans « Le tambour amoureux », un puissant guerrier réincarné en tambour va continuer à influencer les foules par-delà sa mort.
Les histoires ne m'ont pas passionnée, en revanche, je trouve le graphisme superbe et très riche et cette nouvelle lecture confirme pour moi la similitude avec le trait de Marjane Satrapi dans Persepolis.
Lien : http://toutzazimuth.eklablog..
Le jardin armé est un recueil de trois "nouvelles" de David B, dont deux sont des rééditions initialement publiées dans la revue Lapin de 1996 à 1998 (n°12-13 et 15 pour le Prophète voilé, et 18 à 21 pour le jardin armé).
L'occasion est bonne pour rappeler à tous ceux qui aiment la bande dessinée de Sfar, Trondheim, David B. ou Blutch que des merveilles sommeillent encore dans les pages de cet excellent Lapin de l'Association. C'est dans cette revue, par exemple, qu'a été pré-publié Pascin de Joann Sfar, et vous y trouverez, entre-autres, une histoire inédite de 46 pages des "Formidables aventures sans Lapinot" (Le crabar de Mammouth, avec Richard enfant, dans Lapin n°7).
La qualité d'invention mythologique, et la beauté graphique du dessin de David B. sont au rendez-vous dans ce recueil. La troisième histoire, inédite, n'est pas en reste. Je le classe aux côtés du Cheval Blême, parmi les meilleures réalisations de son auteur (derrière "L’Ascension du Haut Mal", toutefois).
L'occasion est bonne pour rappeler à tous ceux qui aiment la bande dessinée de Sfar, Trondheim, David B. ou Blutch que des merveilles sommeillent encore dans les pages de cet excellent Lapin de l'Association. C'est dans cette revue, par exemple, qu'a été pré-publié Pascin de Joann Sfar, et vous y trouverez, entre-autres, une histoire inédite de 46 pages des "Formidables aventures sans Lapinot" (Le crabar de Mammouth, avec Richard enfant, dans Lapin n°7).
La qualité d'invention mythologique, et la beauté graphique du dessin de David B. sont au rendez-vous dans ce recueil. La troisième histoire, inédite, n'est pas en reste. Je le classe aux côtés du Cheval Blême, parmi les meilleures réalisations de son auteur (derrière "L’Ascension du Haut Mal", toutefois).
Un peu comme toutes les BD de David B. on entre dans des récits allégoriques. On a affaire ici à trois contes philosophiques, inspiré des mythologies iraniennes et médiévales. Une fois passé le seuil d'un dessin ardu, on est charmé par l'ambiance et la poésie de chaque histoire. Les messages sont assez difficiles à décrypter, mais peut-être qu'il suffit de se laisser aller à la poésie. En tout cas, c'est une BD à aborder l'esprit totalement ouvert.
Ce livre contient trois légendes mêlant le fantastique aux faits historiques réels. La première, Le Prophète Voilé, se passe en perse, entre l'Iran et l'Irak, au VIIIe siècle, les deux suivantes en Bohème au XIVe siècle sous fond de guerre de religion. Le dessin s'inspire d'enluminures médiévales, les personnages sont un peu grossiers, simples, et les éléments décoratifs et frises foisonnent. Le graphisme contribue parfaitement à créer cette atmosphère magique et terrifiante où réalité et fantastique se cotoient (Jan Žižka a réellement existé). Cette lecture me donne vraiment envie de continuer à découvrir l’œuvre de David B.
Magnifique album illustré de David B.
Une oeuvre forte et mystérieuse. Le graphisme en noir et blanc est appuyé, musclé, fascinant.
L'oeuvre est difficile, aussi je laisse la parole à Marius Chapuis du journal LIBERATION, qui en donne quelques clés de lecture.
LES ELLIPSES SOLAIRES DE DAVID B.
Par Marius Chapuis Journal Libération
— 3 octobre 2019 à 09:31
Le cofondateur de l'Asso revient avec «le Mort détective», une enquête policière oubapienne composée uniquement de têtes de chapitre. Un livre passionnant qui teste les limites d'une narration par le fragment et questionne ainsi le geste de lecture.
La quatrième planche, et donc le quatrième chapitre, du «Mort détective» de David B.
La quatrième planche, et donc le quatrième chapitre, du «Mort détective» de David B. David B·L'Association
L’ellipse, c’est le nerf de la guerre en bande dessinée. Matérialisée par un espace laissé vacant, par ce blanc qui sépare deux cases, elle sert à faire rire, à représenter le temps qui passe, à insuffler du mouvement à une image fixe, à caractériser un personnage, à rythmer des séquences ou simplement à s’épargner de longues et laborieuses descriptions.
A chaque fois, l’auteur part du présupposé que le lecteur parviendra à reconnecter les deux cases pour formuler un récit. David B., lui, s’amuse au contraire à rudoyer le lecteur à coups d’ellipses, son nouveau livre se positionnant au bord du point de rupture où l’on ne parviendra plus à combler les blancs. «Dans le Mort détective, je voulais étirer le chewing-gum le plus possible, jusqu’à ce qu’il casse. Tester les limites de l’ellipse», dit le cofondateur de L’Association. Sur le papier, ça donne une enquête policière dans un format à l’italienne où chaque illustration occupe une pleine page et se voit attacher un titre calligraphié et une phrase d’accroche nébuleuse. Une histoire dont on n’aurait que les têtes de chapitres, en somme.
A la première page, un squelette détective en robe de chambre sirote un verre lorsqu’il se voit notifier une nouvelle affaire : «Les écorcheurs sont de retour.» En page 2, l’enquête est déjà bien lancée et le mort éclaire la première victime, un nain pendu et pelé. Une ellipse plus tard, on retrouve le mort saoul et flanqué d’une fille aux cheveux tentaculaires dont les mèches tiennent mille poignards. Au-delà du côté toujours réjouissant de l’écriture sous contrainte, le livre fascine par la façon qu’il a d’interroger quelque chose qu’on tient pour installé : le geste de lecture. Devant ces pages-ruptures, l’esprit turbine pour tenter de rétablir une narration traditionnelle, pour combler les blancs laissés par l’auteur et sauver la sacro-sainte continuité. Une difficulté qui va croissant puisque, progresser dans le livre, c’est accumuler les situations d’incompréhension et reconsidérer en permanence ses analyses précédentes. Une tâche absurde qui succombe au lâcher-prise.
Plutôt que chercher à tout rationaliser et tirer des fils trop longs et fragiles entre les pages, l’esprit se fait aussi vagabond que l’œil et se «contente» de recréer un environnement autour de chaque scène, ses immédiats avant et après. Le surgissement d’un indice venant rallumer la mécanique logique pour tenter de percer le mystère.
On s’abandonne d’autant plus volontiers dans le dédale du Mort détective qu’esthétiquement, on y retrouve notre David B. préféré, celui très noir et dense des Incidents de la nuit, sous influence Edward Gorey et Odilon Redon. «Jules Verne plutôt, corrige l’auteur. Ce livre, il vient des moments où, enfant, je feuilletais Verne sans le lire, parcourant le récit au travers des gravures des éditions Hetzel. Je me contentais de lire la petite légende de chaque gravure et je me faisais une histoire dans ma tête. Rien qu’à la récurrence des personnages, on distingue qui est le héros, qui sont les méchants. D’où ces personnages complètement fous du Grand Vieillard qu’on ne voit toujours que par morceaux, de sâdhu sadique… En progressant dans l’écriture, je me suis rendu compte qu’il fallait des rappels de personnages, qu’ils reviennent de façon régulière pour qu’on ne perde pas trop le fil d’un livre qui vient d’abord du dessin, d’idées graphiques. De l’envie de représenter une jungle, une pieuvre ou de mettre en image une expression populaire. "Sans queue ni tête", par exemple, ça suscite tout de suite des images chez moi.»
Grand livre sur la rupture, le Mort détective a une histoire éditoriale aussi hachée que son récit, puisque les dix premières pages remontent à près de quinze ans, servant pour le lancement de l’éphémère revue Black. Malgré son caractère expérimental, le livre s’inscrit très naturellement dans l’œuvre de David B., par sa façon d’interroger une nouvelle fois la façon de raconter les histoires. L’Ascension du Haut Mal creusait la forme autobiographique ; Hasib, les récits gigognes des Mille et Une Nuits ; tandis que les Meilleurs Ennemis, réalisé avec l’universitaire Jean-Pierre Filiu, travaillait le récit à partir d’un matériau historique et factuel.
On peut aussi regarder l’écriture du Mort détective comme une déclinaison radicale des fragments de rêves que l’auteur livrait, il y a près de trente ans, dans l’important le Cheval blême. A la différence que, cette fois, c’est au lecteur d’aller creuser son propre imaginaire pour nourrir le livre. «C’est vrai que d’habitude, j’occupe beaucoup l’espace dans mes livres, en les remplissant de mon imaginaire et mes références. Cette fois, je laisse la porte ouverte.»
Marius Chapuis
LE MORT DÉTECTIVE de DAVID B.
Une oeuvre forte et mystérieuse. Le graphisme en noir et blanc est appuyé, musclé, fascinant.
L'oeuvre est difficile, aussi je laisse la parole à Marius Chapuis du journal LIBERATION, qui en donne quelques clés de lecture.
LES ELLIPSES SOLAIRES DE DAVID B.
Par Marius Chapuis Journal Libération
— 3 octobre 2019 à 09:31
Le cofondateur de l'Asso revient avec «le Mort détective», une enquête policière oubapienne composée uniquement de têtes de chapitre. Un livre passionnant qui teste les limites d'une narration par le fragment et questionne ainsi le geste de lecture.
La quatrième planche, et donc le quatrième chapitre, du «Mort détective» de David B.
La quatrième planche, et donc le quatrième chapitre, du «Mort détective» de David B. David B·L'Association
L’ellipse, c’est le nerf de la guerre en bande dessinée. Matérialisée par un espace laissé vacant, par ce blanc qui sépare deux cases, elle sert à faire rire, à représenter le temps qui passe, à insuffler du mouvement à une image fixe, à caractériser un personnage, à rythmer des séquences ou simplement à s’épargner de longues et laborieuses descriptions.
A chaque fois, l’auteur part du présupposé que le lecteur parviendra à reconnecter les deux cases pour formuler un récit. David B., lui, s’amuse au contraire à rudoyer le lecteur à coups d’ellipses, son nouveau livre se positionnant au bord du point de rupture où l’on ne parviendra plus à combler les blancs. «Dans le Mort détective, je voulais étirer le chewing-gum le plus possible, jusqu’à ce qu’il casse. Tester les limites de l’ellipse», dit le cofondateur de L’Association. Sur le papier, ça donne une enquête policière dans un format à l’italienne où chaque illustration occupe une pleine page et se voit attacher un titre calligraphié et une phrase d’accroche nébuleuse. Une histoire dont on n’aurait que les têtes de chapitres, en somme.
A la première page, un squelette détective en robe de chambre sirote un verre lorsqu’il se voit notifier une nouvelle affaire : «Les écorcheurs sont de retour.» En page 2, l’enquête est déjà bien lancée et le mort éclaire la première victime, un nain pendu et pelé. Une ellipse plus tard, on retrouve le mort saoul et flanqué d’une fille aux cheveux tentaculaires dont les mèches tiennent mille poignards. Au-delà du côté toujours réjouissant de l’écriture sous contrainte, le livre fascine par la façon qu’il a d’interroger quelque chose qu’on tient pour installé : le geste de lecture. Devant ces pages-ruptures, l’esprit turbine pour tenter de rétablir une narration traditionnelle, pour combler les blancs laissés par l’auteur et sauver la sacro-sainte continuité. Une difficulté qui va croissant puisque, progresser dans le livre, c’est accumuler les situations d’incompréhension et reconsidérer en permanence ses analyses précédentes. Une tâche absurde qui succombe au lâcher-prise.
Plutôt que chercher à tout rationaliser et tirer des fils trop longs et fragiles entre les pages, l’esprit se fait aussi vagabond que l’œil et se «contente» de recréer un environnement autour de chaque scène, ses immédiats avant et après. Le surgissement d’un indice venant rallumer la mécanique logique pour tenter de percer le mystère.
On s’abandonne d’autant plus volontiers dans le dédale du Mort détective qu’esthétiquement, on y retrouve notre David B. préféré, celui très noir et dense des Incidents de la nuit, sous influence Edward Gorey et Odilon Redon. «Jules Verne plutôt, corrige l’auteur. Ce livre, il vient des moments où, enfant, je feuilletais Verne sans le lire, parcourant le récit au travers des gravures des éditions Hetzel. Je me contentais de lire la petite légende de chaque gravure et je me faisais une histoire dans ma tête. Rien qu’à la récurrence des personnages, on distingue qui est le héros, qui sont les méchants. D’où ces personnages complètement fous du Grand Vieillard qu’on ne voit toujours que par morceaux, de sâdhu sadique… En progressant dans l’écriture, je me suis rendu compte qu’il fallait des rappels de personnages, qu’ils reviennent de façon régulière pour qu’on ne perde pas trop le fil d’un livre qui vient d’abord du dessin, d’idées graphiques. De l’envie de représenter une jungle, une pieuvre ou de mettre en image une expression populaire. "Sans queue ni tête", par exemple, ça suscite tout de suite des images chez moi.»
Grand livre sur la rupture, le Mort détective a une histoire éditoriale aussi hachée que son récit, puisque les dix premières pages remontent à près de quinze ans, servant pour le lancement de l’éphémère revue Black. Malgré son caractère expérimental, le livre s’inscrit très naturellement dans l’œuvre de David B., par sa façon d’interroger une nouvelle fois la façon de raconter les histoires. L’Ascension du Haut Mal creusait la forme autobiographique ; Hasib, les récits gigognes des Mille et Une Nuits ; tandis que les Meilleurs Ennemis, réalisé avec l’universitaire Jean-Pierre Filiu, travaillait le récit à partir d’un matériau historique et factuel.
On peut aussi regarder l’écriture du Mort détective comme une déclinaison radicale des fragments de rêves que l’auteur livrait, il y a près de trente ans, dans l’important le Cheval blême. A la différence que, cette fois, c’est au lecteur d’aller creuser son propre imaginaire pour nourrir le livre. «C’est vrai que d’habitude, j’occupe beaucoup l’espace dans mes livres, en les remplissant de mon imaginaire et mes références. Cette fois, je laisse la porte ouverte.»
Marius Chapuis
LE MORT DÉTECTIVE de DAVID B.
Beau riche, avec des illustrations très fortes. Des figures monstrueuses comme la Mort, le grand Sadhou, le Vieillard, le livre de fer des cauchemards mais pas seulement.
De la classe et du mystère.
De la classe et du mystère.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de David B.
Quiz
Voir plus
Vrai ou faux ? (trop facile)
Le coeur d'une crevette est logé dans sa tête.
Vrai
Faux
11 questions
1281 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Devinettes et énigmes
, humour belge
, méduse
, mésolithiqueCréer un quiz sur cet auteur1281 lecteurs ont répondu