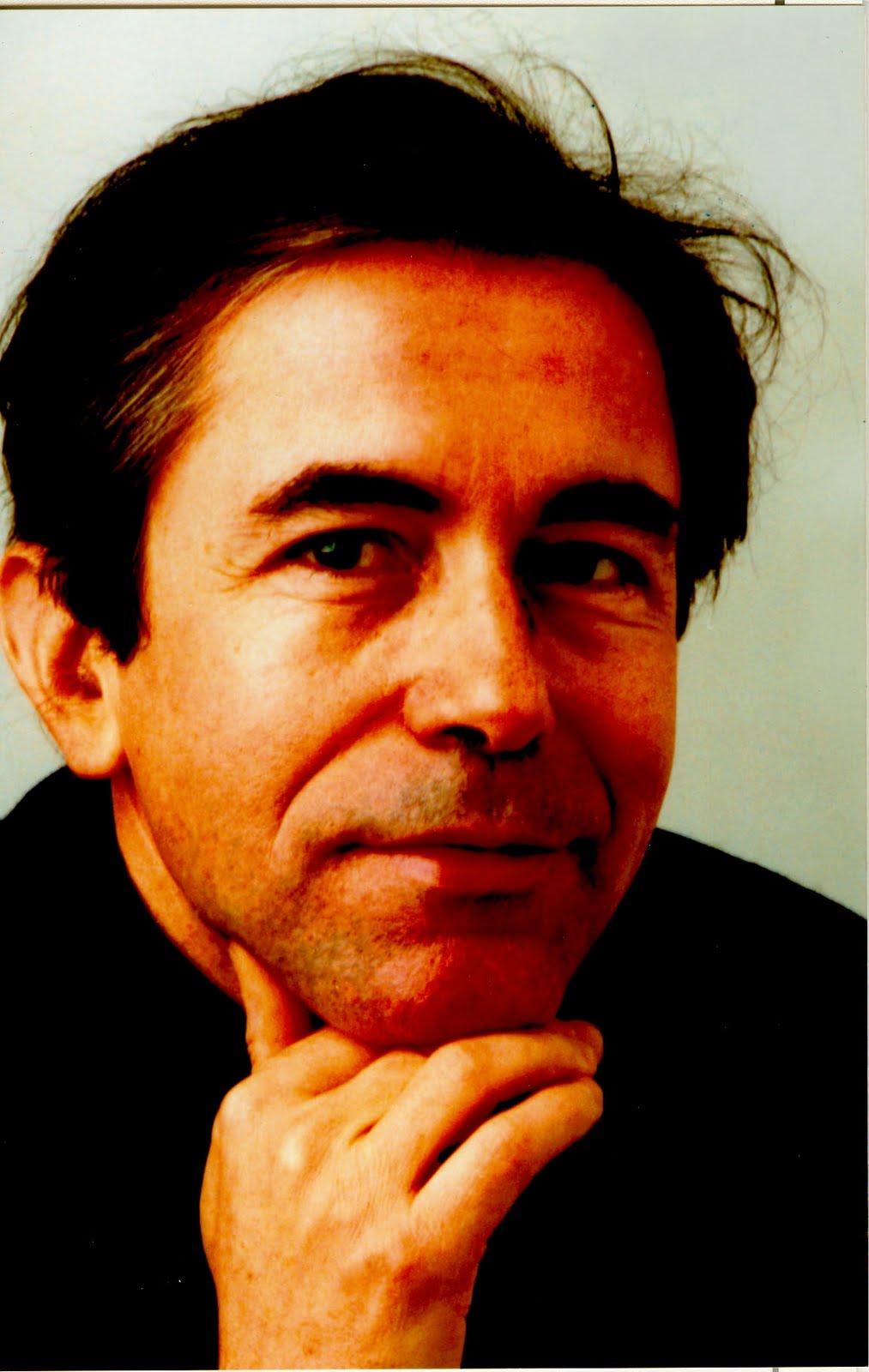Citations de François Jullien (142)
Idée : celle-ci consistant en une sort de schème dont les autres déterminations peuvent varier sans qu'elle en soit affectée (ainsi un ensemble de cinq ne change pas, qu'il s'agisse des "cinq colonnes", des "cinq doigts" ou des "cinq routes" de nos sens.
Plutôt que de dire fièrement (arrogamment ?) "je pense", il est courant, en Chine, et même peut-être encore aujourd'hui, d'introduire sa pensée (même la plus personnelle) par un "j'ai entendu dire que...". Or, celui-ci n'est pas que de prudence ou de modestie.
C'est progressivement, dans mon chantier de sinologue, par des chemins divers mais concourants, et même se recomposant en lui, que j'ai été conduit à voir dans l'idéal un point d'écart opérant et même je crois aujourd'hui le plus marquant, de la pensée européenne face à la chinoise.
Si désarroi de l'Europe il y a, ne vient-il pas d'abord de ce que celle-ci a décroché de ces idéalités qui l'ont si longtemps portée : le Beau, le Juste, le Vrai ?
Idéal est un mot européen.
Dès lors qu'on ne consent plus à renvoyer la plénitude du vivre dans quelque ''Ailleurs'' ou quelque ''Plus tard'', qu'on ne la projette plus dans quelque ''région'' séparée-espérée, qu'on n'accepte pas, par conséquent, qu'une autre vie ait à soutenir ou combler cette vie-ci, la seule, après l'avoir dévaluée (…), il nous faudra concevoir les outils non métaphysiques nous permettant de saisir cet absolu du vivre dans chaque instant qui s'offre ; et que Nietzsche, somme toute, comme tous ceux qui ont voulu ramener la vie sur la terre n'ont pas forgés. En quoi nous nous trouvons encore aujourd'hui si démunis.
Voilà du moins qui, après tours et détours et coupant court à la comparaison intarissable, devrait suffire à nouveau à nous faire entrer. Parti de ces différents bords, de tous ces orients prodiguant leurs trésors d’images et de spéculations, ne pourra-t-on enfin, faisant retour à la pensée chinoise, mieux voir apparaître quel seuil alors on franchit ? Une porte s’est ainsi dessinée peu à peu par enfilade, où, entre ces jambages, se laisse cadrer de la pensée. Y percevra-t-on un autre possible ou ne serait-ce pas, d’abord, l’engloutissement des perspectives précédemment érigées ?
Il est étrange, mais somme toute logique, que j’en vienne seulement maintenant à la question par laquelle j’aurais dû commencer dans mon chantier. Car il est étrange que, après avoir voyagé des années entre les pensées de la Chine et de l’Europe, je m’arrête seulement aujourd’hui à cette question – question préliminaire – qui m’a toujours inquiété, il est vrai, mais que je n’ai encore jamais abordée, du moins de front : qu’est-ce qu’entrer dans une pensée ? (…)
Qui ne désirerait aujourd’hui, en Occident, entrer dans la pensée du plus lointain « Orient » ? Mais comment y entrer, tant on sait bien qu’on ne pourra d’aucune façon la résumer : une pensée ne se résume pas, encore moins la chinoise, si diverse et si vaste. Tant on sait bien aussi que ses principales notions ne sont pas directement traduisibles ; que de l’envisager par écoles, en classant et cataloguant, laisserait échapper l’essentiel et qu’en suivre le développement historique, d’un bout à l’autre, ne suffit pas non plus. On restera chaque fois à l’extérieur de la justification interne, auto-référée, propre à cette pensée. Car d’où celle-ci a-t-elle commencé ? Or, quand je pose cette question : comment entrer dans la pensée chinoise ?, je fais de plus le pari de m’adresser aux non-sinologues comme s’ils pouvaient lire eux-mêmes le chinois. Pour cela, je m’exercerai à lire méthodiquement une phrase de chinois, une seule, une première phrase, en élaborant progressivement les éléments qui permettent de la lire à la fois du dedans (de la pensée chinoise) et du dehors (de l’Occident). Car on ne peut « entrer » effectivement dans une pensée qu’en commençant de travailler avec elle, c’est-à-dire en passant par elle pour s’interroger.
Qui ne désirerait aujourd’hui, en Occident, entrer dans la pensée du plus lointain « Orient » ? Mais comment y entrer, tant on sait bien qu’on ne pourra d’aucune façon la résumer : une pensée ne se résume pas, encore moins la chinoise, si diverse et si vaste. Tant on sait bien aussi que ses principales notions ne sont pas directement traduisibles ; que de l’envisager par écoles, en classant et cataloguant, laisserait échapper l’essentiel et qu’en suivre le développement historique, d’un bout à l’autre, ne suffit pas non plus. On restera chaque fois à l’extérieur de la justification interne, auto-référée, propre à cette pensée. Car d’où celle-ci a-t-elle commencé ? Or, quand je pose cette question : comment entrer dans la pensée chinoise ?, je fais de plus le pari de m’adresser aux non-sinologues comme s’ils pouvaient lire eux-mêmes le chinois. Pour cela, je m’exercerai à lire méthodiquement une phrase de chinois, une seule, une première phrase, en élaborant progressivement les éléments qui permettent de la lire à la fois du dedans (de la pensée chinoise) et du dehors (de l’Occident). Car on ne peut « entrer » effectivement dans une pensée qu’en commençant de travailler avec elle, c’est-à-dire en passant par elle pour s’interroger.
Faire surgir ces possibles de l'esprit, à la fois affranchit et passionne : nous affranchit en nous désolidarisant des adhérences subies; nous passionne (l'erôs philosophique) parce que ces possibles s'avivent respectivement, en s'éclairant dans leurs choix, et se découvrent engagés. On y est moins tenu par une conviction, attaché qu'on serait d'abord à un certain contenu déterminé de vérité, que par un désir à la fois d'exploration et d'exploitation. En même temps qu'on prend du recul dans son esprit, on fait apparaître des embranchements qui donnent à choisir et qui sont à tenter.
Aussi serait-il philosophiquement fallacieux c'est-à-dire stérile, de mettre en cage, c'est-à-dire en tableau, ces possibles de la pensée, comme sont tentés de le faire des anthropologues; ou même seulement de souhaiter en faire le tour, en voulant être exhaustif.
Il y a une intelligence ou "vérité" biblique qu'on voit à la fois se détacher et s'explorer dans l'exposé réécrit de la Création. En posant liminairement un Autre absolu, extérieur au monde, cette ouverture creuse dans l'humain - y déploie et met en route - les conditions d'une subjectivation qui n'en finira plus, à travers la culpabilité et l'Attente, de se forger et de se découvrir. Ou bien disons encore que, à la rencontre de ce qu'il pose d'entrée, dans cette scène inaugurale, en Dehors incommensurable, l'humain biblique, sous le thème de l'Alliance qui s'y noue, ne cesse d'avoir dorénavant à tendre vers Lui et à en faire son "dedans" : il découvre (promeut) cet Extérieur intime; en même temps qu'il perçoit (déploie) cet intime comme un infini, s'appropriant ainsi un devenir inouï ( à travers les motifs de la mort vaincue et du salut). Cohérence éminemment singulière et productrice, qui a sa fécondité propre, fait indéfiniment travailler , et selon laquelle a pris forme le religieux en Europe - et qu'il ne suffit pas de caractériser par la référence, si banale, à ce qu'on appelle "Dieu". Car, sous "Dieu", Pascal déjà nous mettait en garde, on met tant de choses qui n'ont vraiment guère à voir ensemble.
En ouvrant la Théologie d'Hésiode, on y trouve une intelligence (vérité) d'un autre type, "mythologique", qui, si elle puise à l'occasion à la même source que la précédente, se singularise ou "choisit" d'une autre façon, se donne un autre usage et connaît un autre rendement : figurant, variant, dramatisant, à fonction à la fois exploratoire et probatoire, elle essaye tout un jeu de cohérences pour expliquer le monde à partir des forces et facteurs impliqués. Ceux-ci s'allient ou s'opposent, s'engendrent ou se mêlent, s'équilibrent ou se compensent, d'où découlent tant d'enchaînements, de filiations et de renouvellements formant "destin". La fécondité en a été exploitée, depuis, selon la veine intarissable, promue par le plaisir de la narration, de la fiction et du roman. A quoi se rattache, mais dont veut aussi se démarquer, dont dépend mais que combat d'autant plus violemment, l'intelligence ou vérité "logique" du commencement qu'on voit proposé dans ce muthos réelaboré du Timée : intelligence qui n'est plus seulement symbolisante mais qui abstrait, ne pensant plus en termes de figures mais d'entités; qui est non plus seulement causaliste mais aussi finaliste, pesant de tout les tenants et aboutissants. Elle ne se contente pas de répondre à des questions, mais est délibérément problématique, s'explicitant à partir d'un système de cas; et, pour cela, elle est constructrice et modélisante, explicative et déductrice. Elle chasse l'ambiguïté antérieure en s'armant du principe de non-contradiction, source de clarté par exclusion; transforme l'enchaînement du récit en nécessité intérieure reposant sur la seule argumentation. C'est elle qui à fait le lit de la science ou, disons plutôt, d'une certaine science (classique) fondant sur elle sa prise et son efficacité.
Or nous découvrons, en Chine, une autre forme d'intelligence, de "prise" ou de "vérité", en ouvrant le Classique du changement et toujours à propos du commencement. Je crois qu'on peut la concevoir globalement comme une intelligence à la fois de la processivité et de l'opérativité ( tao signifiant à la fois le cours des choses et la façon d'opérer : "tao" du monde" et "mon tao"). Elle n'a donc pas à mettre nécessairement en scène un sujet, se dispense du récit et dissout toute dramatisation; elle pense en termes, non de cause et de fin, de modèle et de visée, mais de condition et de conséquence ou, pus précisément, pour reprendre ces quatre notions d'ouverture, en termes d'"amorçage" - de "maturation" - de "moissonnage" - et de "régulation". Y compris dans sa dimension religieuse et éthique, cette intelligence est stratégique : puisant à même les procédures du rituel, elle enseigne l'art de se mettre en phase avec le moment, en se conformant aux lignes de forces de son déroulement - celui-ci s'éclairant par le jeu des polarités - et trouve son rendement dans la capacité d'induire l'évolution, sans affronter la situation ni s'épuiser. On comprend que ce qui lui sert, non de modèle ou d'idéal, car ne se détachant pas de l'ordre des choses, mais de norme, soit l'harmonie" : celle-ci, tai he, est à la fois la condition du renouvellement du monde, par son constant équilibrage, et le fondement - absolu - de la morale échappant à la déviation et dérégulation par partialité.
En ouvrant la Théologie d'Hésiode, on y trouve une intelligence (vérité) d'un autre type, "mythologique", qui, si elle puise à l'occasion à la même source que la précédente, se singularise ou "choisit" d'une autre façon, se donne un autre usage et connaît un autre rendement : figurant, variant, dramatisant, à fonction à la fois exploratoire et probatoire, elle essaye tout un jeu de cohérences pour expliquer le monde à partir des forces et facteurs impliqués. Ceux-ci s'allient ou s'opposent, s'engendrent ou se mêlent, s'équilibrent ou se compensent, d'où découlent tant d'enchaînements, de filiations et de renouvellements formant "destin". La fécondité en a été exploitée, depuis, selon la veine intarissable, promue par le plaisir de la narration, de la fiction et du roman. A quoi se rattache, mais dont veut aussi se démarquer, dont dépend mais que combat d'autant plus violemment, l'intelligence ou vérité "logique" du commencement qu'on voit proposé dans ce muthos réelaboré du Timée : intelligence qui n'est plus seulement symbolisante mais qui abstrait, ne pensant plus en termes de figures mais d'entités; qui est non plus seulement causaliste mais aussi finaliste, pesant de tout les tenants et aboutissants. Elle ne se contente pas de répondre à des questions, mais est délibérément problématique, s'explicitant à partir d'un système de cas; et, pour cela, elle est constructrice et modélisante, explicative et déductrice. Elle chasse l'ambiguïté antérieure en s'armant du principe de non-contradiction, source de clarté par exclusion; transforme l'enchaînement du récit en nécessité intérieure reposant sur la seule argumentation. C'est elle qui à fait le lit de la science ou, disons plutôt, d'une certaine science (classique) fondant sur elle sa prise et son efficacité.
Or nous découvrons, en Chine, une autre forme d'intelligence, de "prise" ou de "vérité", en ouvrant le Classique du changement et toujours à propos du commencement. Je crois qu'on peut la concevoir globalement comme une intelligence à la fois de la processivité et de l'opérativité ( tao signifiant à la fois le cours des choses et la façon d'opérer : "tao" du monde" et "mon tao"). Elle n'a donc pas à mettre nécessairement en scène un sujet, se dispense du récit et dissout toute dramatisation; elle pense en termes, non de cause et de fin, de modèle et de visée, mais de condition et de conséquence ou, pus précisément, pour reprendre ces quatre notions d'ouverture, en termes d'"amorçage" - de "maturation" - de "moissonnage" - et de "régulation". Y compris dans sa dimension religieuse et éthique, cette intelligence est stratégique : puisant à même les procédures du rituel, elle enseigne l'art de se mettre en phase avec le moment, en se conformant aux lignes de forces de son déroulement - celui-ci s'éclairant par le jeu des polarités - et trouve son rendement dans la capacité d'induire l'évolution, sans affronter la situation ni s'épuiser. On comprend que ce qui lui sert, non de modèle ou d'idéal, car ne se détachant pas de l'ordre des choses, mais de norme, soit l'harmonie" : celle-ci, tai he, est à la fois la condition du renouvellement du monde, par son constant équilibrage, et le fondement - absolu - de la morale échappant à la déviation et dérégulation par partialité.
La pensée chinoise, au lieu d'expliquer l'avènement du monde par sa causalité, en éclaire sa processivité, c'est à dire sa capacité d'être en procès qui se renouvelle de lui-même, de phase en phase, et ne dévie pas. [...] C'est pourquoi, au lieu de poser Dieu au départ de sa création, elle pense la voie, tao, celle de la viabilité selon laquelle ce procès, en se régulant, peut à nouveau - indéfiniment - s'amorcer.
Car "je" suis, moi aussi, dans toutes mes manifestations d'existence, intérieures aussi bien qu'extérieures, une actualisation momentanée de ce dynamisme ou de cet élan qui s'épand partout, s'investit, interagit, et fait communiquer l'énergie.
L'Europe s'étonne soudain, rétrospectivement, du grand sacrifice qu'elle a ainsi accompli, commis comme on commet un crime, et d'abord du point de vue de ce qu'elle ne peut plus, dès lors, qu'appeler dramatiquement l'"existence" et non plus la vie : on ne cesse, en effet, de vouloir percer le secret du biologique, mais on ne sais plus vivre (mourir) - a-t-on seulement pensé la respiration (elle que n'a cessé de penser la Chine) ? Ou l'on ne cesse de vouloir maîtriser le temps, le planifiant toujours plus commodément, mais on ne sait plus penser l'opportunité d'un moment - la Chine a commencé par penser le "moment" saisonnier, etc. En promouvant avec acharnement la connaissance, on a rompu les connivences; et l'Individu est condamné à s'enfermer dans son individualisme. Du plus foncier échappe, une désintégration serait en cours, qui va du social au métaphysique (le fameux "nihilisme"), et la maîtrise acquise nous laisserait finalement si démunis.
Oui, les grecs ont bien conçu tout les possibles, mais configurés d'une certaine façon, déjà pliés selon certains choix qu'ils ne pensaient pas, dont ils ne doutaient pas, ne se doutaient pas ou ne s'étonnaient pas : qu'ils ne pensaient pas à penser.
La vocation morale de l'homme (procédant comme toute autre manifestation d'existence du réel) se trouve donc impliquée initialement en nous ; son contenu se définit aussi de lui-même : il consiste seulement à continuer de "faire exister" par notre conduite et dont nous nous trouvons investis comme ce dont procède notre vie. C'est-à-dire qu'il consiste seulement à maintenir active en nous notre nature – au lieu de la laisser perdre ou s'étioler.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Grandeur Nature : le Paysage
Alzie
57 livres

Ombres & Pénombre...
fanfanouche24
26 livres
Auteurs proches de François Jullien
Quiz
Voir plus
vendredi ou la vie sauvages
Où se dirige le bateau de Robinson ?
vers le Chili
vers le Canada
vers la Réunion
vers Madagascar
10 questions
45 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur45 lecteurs ont répondu