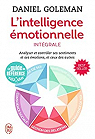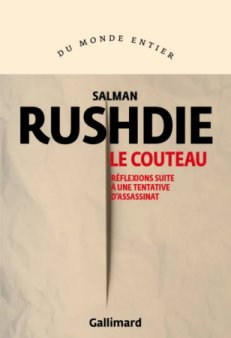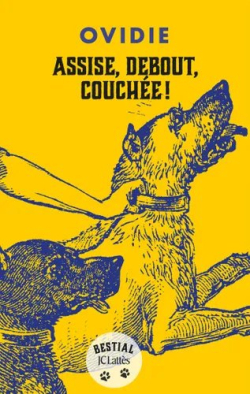Revue Annales historiques de la Révolution française/5
1 notes
Résumé :
Sommaire du numéro
Pages : 3-12 Émotions Révolutionnaires Karine Rance-Valérie Sottocasa-Denise Z. Davidson
Pages : 13-24 Indispensables Émotions Révolutionnaires Sophie Wahnich
Pages : 25-38 Un nouveau sentiment en temps de révolution : « l’ivresse de la liberté » Haim Burstin
Pages : 39-47 Tracer les voies de la peur dans la convention nationale Marisa Linton
Pages : 49-70 L’histoire émotionnelle de Maximilien Robespie... >Voir plus
Pages : 3-12 Émotions Révolutionnaires Karine Rance-Valérie Sottocasa-Denise Z. Davidson
Pages : 13-24 Indispensables Émotions Révolutionnaires Sophie Wahnich
Pages : 25-38 Un nouveau sentiment en temps de révolution : « l’ivresse de la liberté » Haim Burstin
Pages : 39-47 Tracer les voies de la peur dans la convention nationale Marisa Linton
Pages : 49-70 L’histoire émotionnelle de Maximilien Robespie... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Annales historiques de la Révolution française, n°415 : Émotions révolutionnairesVoir plus

Annales historiques de la Révolution française, n°403 : Royalismes et royalistes dans la France révolutionnaire
Revue Annales hist..
4.00★ (2)

Annales historiques de la révolution française / nº377 / 3-2014: L'animal en révolution
Pierre Serna
5.00★ (1)
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Sensibilités révolutionnaires,
En lien avec l'ouvrage collectif dernièrement paru sur l'amitié en Révolution (chroniqué), les Annales Historiques de la Révolution Française consacrent leur numéro 415 du premier trimestre 2024 aux Emotions révolutionnaires.
Un thème sur lequel les historiens sont réservés car le sujet a été premièrement capté par l'historiographie contre-révolutionnaire :
- Taine, par exemple, qui écrit que les émotions sont contagieuses, dangereuses et primitives et sont la matrice d'une action populaire qui révèle la nature profonde des individus qui ne sont que des brigands ou des fous.
- les émotions par leur irrationalité et leur refoulement hors du politique ne peuvent être une clé de compréhension du processus révolutionnaire.
Les historiens favorables à la Révolution française ont préféré enquêter sur les stratégies individuelles et collectives, les structures et les institutions qui les encadrent.
Les émotions, pour eux, sont antihistoriques ! Ceci malgré les travaux de Jean Delumeau sur la peur en Occident, et deux d'Anne Simonin qui explique qu'elles risquent de consacrer la thèse de François Furet, sur le dérapage de la Révolution.
Mais, les travaux pertinents de Jean Nicolas sur les rébellions au XVIIIe siècle expliquent que ces dernières touchent d'abord l'affectivité du lecteur et déclenchent une suite d'images liées au bruit, à la fureur, au déchainement de pulsions.
Tant qu'au maître, Michel Vovelle, il écrivait que les émotions sont au coeur d'une historiographie de la "mentalité révolutionnaire" ! Pour lui, la peur est l'un des éléments de base pour comprendre la sensibilité révolutionnaire.
Le terme "émotions", d'abord au pluriel, entre dans la langue française au XVe siècle et désigne un phénomène collectif, qui traduit le mouvement du peuple ému et ébranlé.
Puis, au XVIIe siècle, le terme change de sens :
Autome Furetière définit l'"esmotion" comme un commencement de sédition et un mouvement extraordinaire qui agit le corps ou l'esprit.
Au milieu du XVIIIe siècle, la foule commence à s'individualiser, sous le regard d'une élite gagnée au sentimentalisme et à la lecture de Rousseau...
Cinq auteurs présentent une synthèse de leurs travaux :
J'ai particulièrement apprécié celle de Sophie Wahnich qui démontre que le concept de "régime émotif" est politique car il se situe à l'articulation d'une demande de justice et de la réception faite par le pouvoir politique. Elle y voit la capacité du peuple à faire entendre ses émotions et donc réalise un acte de souveraineté. Pour Sophie Wahnich, il existe un rapport de réciprocité entre les émotions et l'évènement : elles sont mobilisatrices et l'acteur devient un protagoniste ayant conscience de sa capacité d'agir sur le cours de l'histoire.
Les thèses de Timothy Tackett sont très intéressantes car elles expliquent que la peur joue un rôle crucial dans l'anatomie de la terreur, mais aussi l'enthousiasme, la joie, l'amour, la colère, la haine, l'euphorie, l'angoisse qui se révèlent être motrice d'une mobilisation collective.
Un numéro dense, assez complexe à lire et à comprendre, car il s'agit surtout d'historiographie, mais toujours utile à compulser.
En lien avec l'ouvrage collectif dernièrement paru sur l'amitié en Révolution (chroniqué), les Annales Historiques de la Révolution Française consacrent leur numéro 415 du premier trimestre 2024 aux Emotions révolutionnaires.
Un thème sur lequel les historiens sont réservés car le sujet a été premièrement capté par l'historiographie contre-révolutionnaire :
- Taine, par exemple, qui écrit que les émotions sont contagieuses, dangereuses et primitives et sont la matrice d'une action populaire qui révèle la nature profonde des individus qui ne sont que des brigands ou des fous.
- les émotions par leur irrationalité et leur refoulement hors du politique ne peuvent être une clé de compréhension du processus révolutionnaire.
Les historiens favorables à la Révolution française ont préféré enquêter sur les stratégies individuelles et collectives, les structures et les institutions qui les encadrent.
Les émotions, pour eux, sont antihistoriques ! Ceci malgré les travaux de Jean Delumeau sur la peur en Occident, et deux d'Anne Simonin qui explique qu'elles risquent de consacrer la thèse de François Furet, sur le dérapage de la Révolution.
Mais, les travaux pertinents de Jean Nicolas sur les rébellions au XVIIIe siècle expliquent que ces dernières touchent d'abord l'affectivité du lecteur et déclenchent une suite d'images liées au bruit, à la fureur, au déchainement de pulsions.
Tant qu'au maître, Michel Vovelle, il écrivait que les émotions sont au coeur d'une historiographie de la "mentalité révolutionnaire" ! Pour lui, la peur est l'un des éléments de base pour comprendre la sensibilité révolutionnaire.
Le terme "émotions", d'abord au pluriel, entre dans la langue française au XVe siècle et désigne un phénomène collectif, qui traduit le mouvement du peuple ému et ébranlé.
Puis, au XVIIe siècle, le terme change de sens :
Autome Furetière définit l'"esmotion" comme un commencement de sédition et un mouvement extraordinaire qui agit le corps ou l'esprit.
Au milieu du XVIIIe siècle, la foule commence à s'individualiser, sous le regard d'une élite gagnée au sentimentalisme et à la lecture de Rousseau...
Cinq auteurs présentent une synthèse de leurs travaux :
J'ai particulièrement apprécié celle de Sophie Wahnich qui démontre que le concept de "régime émotif" est politique car il se situe à l'articulation d'une demande de justice et de la réception faite par le pouvoir politique. Elle y voit la capacité du peuple à faire entendre ses émotions et donc réalise un acte de souveraineté. Pour Sophie Wahnich, il existe un rapport de réciprocité entre les émotions et l'évènement : elles sont mobilisatrices et l'acteur devient un protagoniste ayant conscience de sa capacité d'agir sur le cours de l'histoire.
Les thèses de Timothy Tackett sont très intéressantes car elles expliquent que la peur joue un rôle crucial dans l'anatomie de la terreur, mais aussi l'enthousiasme, la joie, l'amour, la colère, la haine, l'euphorie, l'angoisse qui se révèlent être motrice d'une mobilisation collective.
Un numéro dense, assez complexe à lire et à comprendre, car il s'agit surtout d'historiographie, mais toujours utile à compulser.
Citations et extraits (5)
Ajouter une citation
Toutefois certaines émotions peuvent entraîner les acteurs au-delà du domaine politique selon Haim Burstin qui distingue les "sensations subies" (comme la peur), de l'ivresse de la liberté, "simulateur endogène qui confère un surcroît d'énergie à l'action politique".
oui, la peur est l'un des éléments de base pour comprendre la sensibilité révolutionnaire. (Michel Vovelle).
Sophie Wahnich voit dans la capacité du peuple à faire entendre ses émotions un "acte de souveraineté".
Elles "les émotions" étaient pour Michel Vovelle au cœur d'une historiographie de la "mentalité révolutionnaire" : "abordons les choses en face, écrivait il ; oui la peur est l'un des éléments de base pour comprendre la sensibilité révolutionnaire".
Deux présupposés sont à l'œuvre dans le refus de considérer les émotions comme une clé de compréhension du processus révolutionnaire : l'irrationalité des émotions d'une part, leur refoulement hors du politique d'autre part.
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Revue Annales historiques de la Révolution française (35)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3236 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3236 lecteurs ont répondu