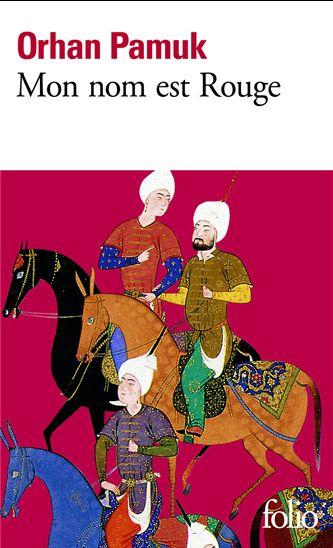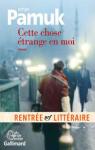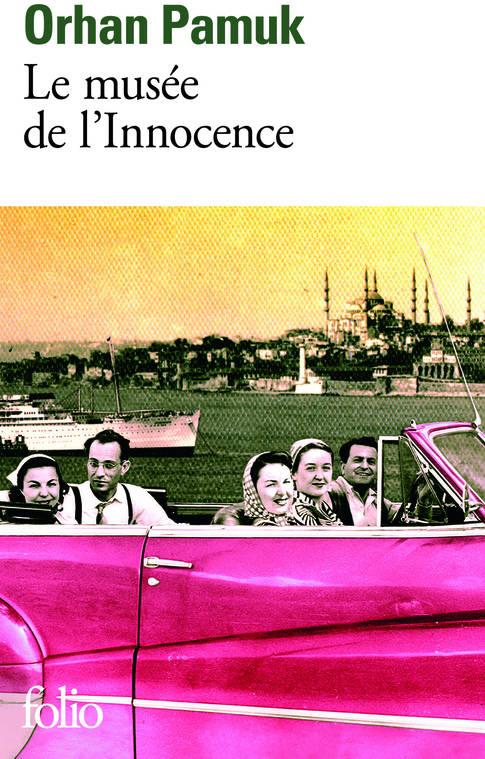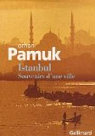Critiques filtrées sur 4 étoiles
Orhan Pamuk écrit « long ». Il est peut-être étrange de commencer par cette considération, mais elle explique certaines qualités et certains défauts du livre.
Pénétrer dans le récit demande la patience d'un arpenteur de labyrinthe, continuer exige parfois la persévérance d'un coureur de fond. L'écriture de Pamuk est à la fois foisonnante et aride. C'est un conteur dont la phrase s'enroule sur elle-même avec des complexités serpentines – le traducteur a souffert si l'on se rapporte à quelques lourdeurs de traduction – le détail est riche et la description scrupuleuse. Cependant, à force d'annotations, de récits dans le récit, de mises en abyme, la clarté du style et du propos s'efface devant la pesanteur de la construction et de l'érudition.
Revenons à l'histoire. Un homme revient à Istanbul après des années de pérégrination. Il était secrétaire au service de pachas, chefs de guerre et gouverneurs de provinces lointaines. Il retrouve son oncle qui l'a chassé douze ans auparavant quand il a su son amour pour sa fille, Shékuré. Après tant de temps, les choses ont bien changé : le Noir est devenu un homme déterminé, l'Oncle un vieillard obstiné et manipulateur, et Shékuré une belle veuve décidée à s'émanciper par un nouveau mariage. Voilà pour le trio de premier plan. Ensuite, viennent les trois peintres qui gravitent autour de l'Oncle, commanditaire zélé d'un livre d'enluminures qui sera offert par le Sultan aux Vénitiens : Olive, Papillon et Cigogne. Puis, s'avancent sur le théâtre d'ombres les personnages secondaires, Esther l'entremetteuse, Hassan le beau-frère amoureux de Shékuré, Hayriyé la servante. Ajoutons trois meurtres qui sont les bornes temporelles du récit : le livre s'ouvre sur le meurtre de Monsieur Délicat, l'enlumineur, le point de retournement de l'histoire est l'assassinat de l'Oncle et le récit se clôt avec la fin violente du meurtrier.
le propos de Pamuk prend des allures de parabole. Sous la Turquie d'hier, nous trouvons les turpitudes de la Turquie d'aujourd'hui. le hodja d'Erzurum, prédicateur illuminé dont les bandes hantent les rues d'Istanbul, figure assez bien le péril islamiste. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est dans la confrontation de l'Orient à l'Occident, de la tradition à la modernité, dans la tension entre la sclérose des modèles et la brutalité de leur imposition. La question posée est celle du déclin d'une civilisation. Pamuk choisit de transposer le débat dans la Turquie du 16ème siècle. Les maîtres de l'enluminure dans l'atelier du Sultan suivent la grande tradition léguée par l'école d'Hérat ou les peintres chinois. Leur peinture, aussi belle soit-elle, obéit à des règles strictes, dictées par la religion, l'esthétique et la tradition. Toute évolution possible, toute originalité, est bannie par le carcan que se sont imposé les artistes eux-mêmes. Une femme sera toujours représentée sous les canons de la beauté chinoise et le regard de Dieu organisera la perception stéréotypée des peintres. Mais l'empire ottoman, si puissant et si riche, se tourne vers de nouvelles frontières, non plus orientales mais occidentales. le choc culturel des deux civilisations va alors se décliner dans le regard d'un homme – l'Oncle envoyé comme ambassadeur auprès du doge de Venise qui découvre la peinture de la Renaissance et repart contaminé – puis dans celui de son équipe d'artistes, partagée entre fidélité à la tradition et nécessité de « recréer » et, enfin, dans le peuple dans son entier, symbolisé par la belle Shékuré qui rêve que l'on fasse un jour son portrait.
Orhan Pamuk ne répond pas à la question du « Que faut-il faire face au déclin ? ». Il se contente de constater presque cliniquement la décadence d'un art enfermé dans des critères qui ne sont plus ceux de la création, mais ceux de la perpétuation. Il montre aussi la violence qui accompagne le changement, une violence inévitable car elle provient d'un rapport de domination et de sujétion. Une lueur d'espoir demeure tant qu'on laisse aux hommes la liberté de maîtriser leur avenir. Lorsque le Sultan commande un livre novateur, il permet cette liberté et l'encourage. Lorsque son successeur brise la grande horloge envoyé par la reine Élisabeth d'Angleterre, il ferme la voie à toute évolution possible et renvoie l'individu à la violence.
À maintes reprises, une image symbolique extrêmement forte revient dans le récit, celle du peintre à qui l'on crève les yeux ou qui se crève les yeux. le pouvoir aveugle ceux qui le menacent ou refusent de lui prêter allégeance, mais l'artiste lui-même s'aveugle quand il refuse l'irruption de la modernité au profit de la tradition.
La saison d'hiver est la saison préférée de Pamuk. Un décor qui sied à la dureté des coeurs et à la noirceur des hommes. Une saison qui donne aussi à la mélancolie la pureté d'un diamant. Par contraste, elle exalte le rouge, les lueurs d'un brasero, les lèvres d'une bouche aimée, le sang où circule la vie.
Pénétrer dans le récit demande la patience d'un arpenteur de labyrinthe, continuer exige parfois la persévérance d'un coureur de fond. L'écriture de Pamuk est à la fois foisonnante et aride. C'est un conteur dont la phrase s'enroule sur elle-même avec des complexités serpentines – le traducteur a souffert si l'on se rapporte à quelques lourdeurs de traduction – le détail est riche et la description scrupuleuse. Cependant, à force d'annotations, de récits dans le récit, de mises en abyme, la clarté du style et du propos s'efface devant la pesanteur de la construction et de l'érudition.
Revenons à l'histoire. Un homme revient à Istanbul après des années de pérégrination. Il était secrétaire au service de pachas, chefs de guerre et gouverneurs de provinces lointaines. Il retrouve son oncle qui l'a chassé douze ans auparavant quand il a su son amour pour sa fille, Shékuré. Après tant de temps, les choses ont bien changé : le Noir est devenu un homme déterminé, l'Oncle un vieillard obstiné et manipulateur, et Shékuré une belle veuve décidée à s'émanciper par un nouveau mariage. Voilà pour le trio de premier plan. Ensuite, viennent les trois peintres qui gravitent autour de l'Oncle, commanditaire zélé d'un livre d'enluminures qui sera offert par le Sultan aux Vénitiens : Olive, Papillon et Cigogne. Puis, s'avancent sur le théâtre d'ombres les personnages secondaires, Esther l'entremetteuse, Hassan le beau-frère amoureux de Shékuré, Hayriyé la servante. Ajoutons trois meurtres qui sont les bornes temporelles du récit : le livre s'ouvre sur le meurtre de Monsieur Délicat, l'enlumineur, le point de retournement de l'histoire est l'assassinat de l'Oncle et le récit se clôt avec la fin violente du meurtrier.
le propos de Pamuk prend des allures de parabole. Sous la Turquie d'hier, nous trouvons les turpitudes de la Turquie d'aujourd'hui. le hodja d'Erzurum, prédicateur illuminé dont les bandes hantent les rues d'Istanbul, figure assez bien le péril islamiste. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est dans la confrontation de l'Orient à l'Occident, de la tradition à la modernité, dans la tension entre la sclérose des modèles et la brutalité de leur imposition. La question posée est celle du déclin d'une civilisation. Pamuk choisit de transposer le débat dans la Turquie du 16ème siècle. Les maîtres de l'enluminure dans l'atelier du Sultan suivent la grande tradition léguée par l'école d'Hérat ou les peintres chinois. Leur peinture, aussi belle soit-elle, obéit à des règles strictes, dictées par la religion, l'esthétique et la tradition. Toute évolution possible, toute originalité, est bannie par le carcan que se sont imposé les artistes eux-mêmes. Une femme sera toujours représentée sous les canons de la beauté chinoise et le regard de Dieu organisera la perception stéréotypée des peintres. Mais l'empire ottoman, si puissant et si riche, se tourne vers de nouvelles frontières, non plus orientales mais occidentales. le choc culturel des deux civilisations va alors se décliner dans le regard d'un homme – l'Oncle envoyé comme ambassadeur auprès du doge de Venise qui découvre la peinture de la Renaissance et repart contaminé – puis dans celui de son équipe d'artistes, partagée entre fidélité à la tradition et nécessité de « recréer » et, enfin, dans le peuple dans son entier, symbolisé par la belle Shékuré qui rêve que l'on fasse un jour son portrait.
Orhan Pamuk ne répond pas à la question du « Que faut-il faire face au déclin ? ». Il se contente de constater presque cliniquement la décadence d'un art enfermé dans des critères qui ne sont plus ceux de la création, mais ceux de la perpétuation. Il montre aussi la violence qui accompagne le changement, une violence inévitable car elle provient d'un rapport de domination et de sujétion. Une lueur d'espoir demeure tant qu'on laisse aux hommes la liberté de maîtriser leur avenir. Lorsque le Sultan commande un livre novateur, il permet cette liberté et l'encourage. Lorsque son successeur brise la grande horloge envoyé par la reine Élisabeth d'Angleterre, il ferme la voie à toute évolution possible et renvoie l'individu à la violence.
À maintes reprises, une image symbolique extrêmement forte revient dans le récit, celle du peintre à qui l'on crève les yeux ou qui se crève les yeux. le pouvoir aveugle ceux qui le menacent ou refusent de lui prêter allégeance, mais l'artiste lui-même s'aveugle quand il refuse l'irruption de la modernité au profit de la tradition.
La saison d'hiver est la saison préférée de Pamuk. Un décor qui sied à la dureté des coeurs et à la noirceur des hommes. Une saison qui donne aussi à la mélancolie la pureté d'un diamant. Par contraste, elle exalte le rouge, les lueurs d'un brasero, les lèvres d'une bouche aimée, le sang où circule la vie.
Premier contact avec un écrivain très attachant.
Je l'ai découvert à travers une visite d'Istanbul qu'il guidait pour une émission de télévision sur les voyages.
Sa personnalité a retenu mon attention et son évident amour pour sa ville m'a incitée à lire quelque chose de cet auteur.
J'ai choisi ce livre 'moelleux' car les longs ouvrages me séduisent toujours.
Superbe écriture et plongée dans un passé tout à fait 'étranger' dans l'univers des enlumineurs.
Invitation à un voyage qu'il serait dommage de décliner.
Je l'ai découvert à travers une visite d'Istanbul qu'il guidait pour une émission de télévision sur les voyages.
Sa personnalité a retenu mon attention et son évident amour pour sa ville m'a incitée à lire quelque chose de cet auteur.
J'ai choisi ce livre 'moelleux' car les longs ouvrages me séduisent toujours.
Superbe écriture et plongée dans un passé tout à fait 'étranger' dans l'univers des enlumineurs.
Invitation à un voyage qu'il serait dommage de décliner.
Ces histoires de caricatures ont finalement fait de tout temps couler beaucoup plus d'ancre à écrire qu'a dessiné. Ah !ces dessins miniatures de tous genres qui sont souvent a la limite d'enluminures, Et c'est exactement d'enluminures dont je voudrai vous parler ce soir... Ne désespérons plus!... Coïncidence ou pas, un an après la fameuse affaire des « caricatures » voici qu'Orhan Pamuk nous sort son livre « Mon nom est Rouge ». Istanbul la fin du XVIe siècle : le sultan Murad III a commandé un manuscrit pour célébrer le millénaire de l'hégire et tenez-vous bien avec illustrations et images. Devra-t-il être illustré à la manière traditionnelle des miniaturistes persans ou à la manière italienne utilisant perspective et représentation des personnages dans leur réalité ? Mais voilà qu'un des miniaturistes, monsieur Délicat, de l'atelier chargé de réaliser cette oeuvre est assassiné, les autres sont menacés. S'agit-il d'un complot contre l'empire ottoman, sa culture, ses traditions, sa peinture ? Cet atelier fera tout pour sortir ce livre : car« Même si vous êtes persuadés, en votre for intérieur, que l'ombre du blasphème pèse en effet sur ces miniatures, vous êtes incapables de le reconnaître et surtout de le faire savoir, car ce serait donner raison aux fanatiques » … Ce livre est conduit comme un roman policier, comme une histoire d'amour, comme un essai sur la confrontation des cultures. Tour à tour les personnages prennent la parole, mais aussi des animaux et même des objets. Parmi eux on peut citer : un chien, un arbre, un écu d'argent et même une couleur. Ils vous racontent leur histoire et au-delà de toute attente c'est un mort qui prend le premier la parole, Mr Delicat, pour nous décrire son propre assassina… Orhan Pamuk aime se jouer de son lecteur, il multiplie pirouettes et pieds de nez et se met lui- même en scène, sous les traits d'Orhan, fils de Shékuré (une jeune veuve au caractère ombrageux, dont le modèle est, parait-il, la mère d'Orhan Pamuk elle- même)
Ohran Pamuk est un grand écrivain. Ce n'est pas pour rien qu'il a obtenu le prix Nobel de littérature en 2006. "Mon nom est Rouge" est un roman de grande ampleur, dont le sujet et l'écriture sont très originaux. L'auteur nous introduit dans la ville d'Istanbul, à la fin du XVIème siècle, dans l'atelier des enlumineurs du sultan. Plusieurs de ces grands artistes participent à l'illustration d'un manuscrit de grande valeur. Mais l'un d'entre eux est assassiné. Un ancien apprenti de l'atelier, désigné sous le nom de le Noir, mène l'enquête sur ce meurtre; au cours de sa longue investigation, il finit par acquérir la conviction que le meurtrier est l'un des enlumineurs. le Noir joue un rôle central. Il s'est longtemps exilé afin d'oublier son amour malheureux pour Shékuré, qui s'est mariée avec un autre. Maintenant ce mari est porté disparu, probablement mort: donc le Noir espère à nouveau convoler avec Shékuré... Cependant, le roman se focalise aussi sur bien d'autres thèmes, notamment sur le conflit entre deux conceptions antagonistes de l'art: celle qui reste conforme à la tradition orientale et celle qui introduit le réalisme et la perspective, tels qu'il sont pratiqués dans la peinture occidentale. D'ailleurs, O. Pamuk fait petit un clin d'oeil à l'actualité en introduisant un prédicateur "islamiste" ultra-conservateur, qui menace tous les artistes inspirés par l'Occident. de nombreux personnages souvent intéressants - appartenant ou non au milieu des miniaturistes - évoluent dans ce roman foisonnant. J'ai eu l'impression de pénétrer vraiment dans le monde stambouliote d'autrefois. Sur le plan de l'écriture, une particularité doit absolument être mentionnée: dans chaque chapitre, c'est un narrateur différent qui raconte l'histoire: parfois il s'agit d'un des protagonistes du roman, mais ça peut être aussi un animal, ou la Mort, voire même une couleur (le rouge): certains lecteurs pourront être surpris par ce procédé. J'ajoute que le livre est très long, touffu, et qu'il faut de la persévérance pour garder le fil du récit jusqu'au bout. Pour ma part, pour le lire in extenso, je me suis autorisé quelques pauses. Tout ceci étant signalé, j'estime que "Mon nom est rouge" est une grande réussite.
Rouge comme le sang d'un meurtre mystérieux qui sert de prétexte à une plongée dans l'histoire de l'art à la fin du XVIe siècle, de l'influence de l'art occidental sur l'art oriental et de la psychologie des artistes entre désir de perfection et souhait d'épouser les tendances nouvelles.
Merveilleux et tellement instructif !
Merveilleux et tellement instructif !
Lecteur avide, connaisseur du proche et moyen-orient, de l'Asie mineure (Turquie et Istanbul inclus si l'on considère que l'essentiel de ce pays se situe sur le continent asiatique), amateur d'art et collectionneur de miniatures indiennes, perses et ottomanes, ce livre encensé, ciselé par un prix Nobel de littérature, avait tout pour m'intéresser, pour me passionner.
J'en sors soulagé d'être arrivé au bout, frustré par "l'intrigue", avec un sentiment mitigé, un peu comme après un repas prometteur gâché par un mauvais assaisonnement ou un excès de cuisson. Je vais tenter d'expliquer pourquoi.
- D'abord la traduction que j'ai trouvé maladroite, parfois lourdingue, laquelle, loin de fluidifier le texte le rend souvent inutilement abscons. Une traduction de qualité est fondamentale. Elle participe au plaisir de la lecture d'un auteur étranger et j'avoue qu'à ce titre le bas blesse et dessert le texte.
- L'intrigue "criminelle" et "amoureuse " qui n'est qu'un prétexte à la description du monde des miniaturistes et de son importance géopolitique, culturelle et religieuse est mince et révèle à quel point elle traîne en longueur.
- Un texte long, très long, trop long ; 720 pages (qui tiendrait aisément en 100 de moins) truffées de descriptions, citations, évocations de guerres inconnues, contextes et personnages historiques mystérieux, parfois répétitifs et dont l'utilité m'a souvent échappé, au détriment de descriptions nécessairement enrichissantes mais manquantes de la vie quotidienne foisonnante à Constantinople au XVIe siècle. Je mets au défi les lecteurs non spécialistes de ces époques de me citer de mémoire la somme des noms des Shah, Sultan, Moghul, Khan et miniaturistes du XIIIe au XVIe siècle cités, énumérés, répétés à l'envi, parfois sans chronologie ou nécessité rédactionnelle ; comme le déficit de description du fascinant maelström de vie de cette ville à cette époque (cf les descriptions ébouriffantes de Paris dans "Le Parfum" de Suskind ; de Florence et Constantinople dans "L'Enchanteresse de Florence" de Rushdie)
- A contrario, l'histoire de l'évolution de l'art de la miniature me semble survolée, depuis son origine Perse alors dénuée des contraintes liée à des interprétations ultérieures de sourates du Coran ; des explications et mises en perspective manquantes mais pourtant nécessaire pour mieux comprendre une des références religieuses essentielles du texte perpétuellement évoquée et répétée. Quid du pourquoi et des interactions rivales des cultes Zoroastrien, Sunnite, Shiite, ou Derviche ?
- de même l'évolution du style, du contenu, de la fabrication des instruments - calames, pinceaux, certains parfois surprenants mais juste évoqués (duvet de nuque de chaton), la fabrication des encres et les symboliques des couleurs associées, etc...
Bref, je ne vais pas rédiger 720 pages et mieux continuer à admirer mes miniatures en continuant de rêver.
P.s. à l'intention de l'éditeur : La ville de Constantinople fût baptisé Istanbul en 1930 ; pas avant...
J'en sors soulagé d'être arrivé au bout, frustré par "l'intrigue", avec un sentiment mitigé, un peu comme après un repas prometteur gâché par un mauvais assaisonnement ou un excès de cuisson. Je vais tenter d'expliquer pourquoi.
- D'abord la traduction que j'ai trouvé maladroite, parfois lourdingue, laquelle, loin de fluidifier le texte le rend souvent inutilement abscons. Une traduction de qualité est fondamentale. Elle participe au plaisir de la lecture d'un auteur étranger et j'avoue qu'à ce titre le bas blesse et dessert le texte.
- L'intrigue "criminelle" et "amoureuse " qui n'est qu'un prétexte à la description du monde des miniaturistes et de son importance géopolitique, culturelle et religieuse est mince et révèle à quel point elle traîne en longueur.
- Un texte long, très long, trop long ; 720 pages (qui tiendrait aisément en 100 de moins) truffées de descriptions, citations, évocations de guerres inconnues, contextes et personnages historiques mystérieux, parfois répétitifs et dont l'utilité m'a souvent échappé, au détriment de descriptions nécessairement enrichissantes mais manquantes de la vie quotidienne foisonnante à Constantinople au XVIe siècle. Je mets au défi les lecteurs non spécialistes de ces époques de me citer de mémoire la somme des noms des Shah, Sultan, Moghul, Khan et miniaturistes du XIIIe au XVIe siècle cités, énumérés, répétés à l'envi, parfois sans chronologie ou nécessité rédactionnelle ; comme le déficit de description du fascinant maelström de vie de cette ville à cette époque (cf les descriptions ébouriffantes de Paris dans "Le Parfum" de Suskind ; de Florence et Constantinople dans "L'Enchanteresse de Florence" de Rushdie)
- A contrario, l'histoire de l'évolution de l'art de la miniature me semble survolée, depuis son origine Perse alors dénuée des contraintes liée à des interprétations ultérieures de sourates du Coran ; des explications et mises en perspective manquantes mais pourtant nécessaire pour mieux comprendre une des références religieuses essentielles du texte perpétuellement évoquée et répétée. Quid du pourquoi et des interactions rivales des cultes Zoroastrien, Sunnite, Shiite, ou Derviche ?
- de même l'évolution du style, du contenu, de la fabrication des instruments - calames, pinceaux, certains parfois surprenants mais juste évoqués (duvet de nuque de chaton), la fabrication des encres et les symboliques des couleurs associées, etc...
Bref, je ne vais pas rédiger 720 pages et mieux continuer à admirer mes miniatures en continuant de rêver.
P.s. à l'intention de l'éditeur : La ville de Constantinople fût baptisé Istanbul en 1930 ; pas avant...
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre. Sur ses défauts comme ses nombreuses longueurs, mais surtout sur ses qualités dont la mise en avant d'un empire ottoman aux confluences de civilisations disparates.
Il prend donc lu temps pour bien faire comprendre les subtilités entre tradition et modernisme, entre culture antique orientalo-méditerranéenne et modernisme occidental. L'univers de l'iconographie sert de trait d'union à tout cela tout comme le rythme pondéré (qui donne cette sensation pas très désagréable de lenteur) de l'écriture pour mieux faire ressortir l'univers placide ottoman loin des excitations d'une modernité industrieuse auquel il essaye tant bien que mal, de se rattacher pourtant.
Il faut donc accepter son rythme modéré, que l'intrigue peine à dynamiser, pour apprécier à sa juste valeur la pertinence du propos.
Il prend donc lu temps pour bien faire comprendre les subtilités entre tradition et modernisme, entre culture antique orientalo-méditerranéenne et modernisme occidental. L'univers de l'iconographie sert de trait d'union à tout cela tout comme le rythme pondéré (qui donne cette sensation pas très désagréable de lenteur) de l'écriture pour mieux faire ressortir l'univers placide ottoman loin des excitations d'une modernité industrieuse auquel il essaye tant bien que mal, de se rattacher pourtant.
Il faut donc accepter son rythme modéré, que l'intrigue peine à dynamiser, pour apprécier à sa juste valeur la pertinence du propos.
L'empire Ottoman tiraillée entre tradition et occident...Un chef d'oeuvre !!
Écrit dans un style qui demande une attention constante du lecteur, ce roman est assez extraordinaire. Bien qu'une histoire de crime, le regard porté sur l'art est probablement ce qui frappe le plus dans ce roman.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Orhan Pamuk (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1090 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1090 lecteurs ont répondu