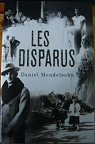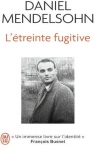Citations de Daniel Adam Mendelsohn (214)
Quiconque a étudié la Shoah reconnaîtra la terrible sagesse de cette remarque; son histoire est peuplée de soldats et de civils d'Allemands, de Polonais, d'Ukrainiens, de Néerlandais et de Français, qui allaient à l'église le dimanche, s'inquiétaient de leur santé, s'occupaient de leurs épouses malades, punissaient leurs enfants lorsqu'ils mentaient ou trichaient, et passaient de temps en temps un après-midi à loger une balle dans le crâne de quelques grands-mères et enfants juifs. Certains trouveront sans doute « obscène» la sympathie d'auteur qu'affiche Littell pour Aue - et par « sympathie », j'entends simplement son désir de comprendre le personnage -, mais son projet semble infiniment plus recevable que le geste de repli sur soi qui consisterait à reléguer tous ces millions d'assassins dans la catégorie des « 'monstres» et des « êtres inhumains», qui nous permet trop
facilement de tracer une nette démarcation entre « eux» et « nous». La première phrase du roman prend la forme de la salutation troublante de Aue à ses « frères humains» : l'objectif improbable du livre, et pourtant largement atteint, est de préserver ce sentiment troublant de fraternité.
La façon dont Littell accomplit ce tour de force mérite que nous nous y attardions et nous amène à considérer le style et la technique narrative de son roman - souvent mis en cause par ses détracteurs. Il est vrai qu'au niveau des mots et des phrases le style de Littell n'a rien d'exceptionnel et est parfois même prosaïque - sa traductrice anglaise, Charlotte Mandel!, a produit une version d'une remarquable fluidité, plus agréable à lire que le français. Dès que l'auteur s'essaie aux effets de manches, le roman déraille systématiquement. Des phrases comme « Ma pensée fuyait dans tous les sens, comme un banc de poissons devant un plongeur », ou « Je suis sorti de la guerre un homme vide, avec seulement de l'amertume et une longue honte, comme du sable qui crisse entre les dents» nous font d'autant plus grimacer que Littell réussit par ailleurs très souvent à rendre avec beaucoup de bonheur la platitude des propos quotidiens, les potins sur les promotions et les ordres du milieu militaire qu'il décrit.
La grande réussite du livre - cette façon qu'a Littell de nous
entraîner dans l'univers mental de Aue - repose en grande partie sur la technique saisissante qu'il emploie de bout en bout, et qui consiste à intégrer, avec de plus en plus d'insistance à mesure que l'intrigue se déroule, des scènes d'une horreur incommensurable (ou bien des scènes dans lesquelles les personnages discutent froidement d'actes ou de projets épouvantables) à des tirades prosaïques, voire ennuyeuses, des conversations sur les petites intrigues militaires mesquines, et autres interminables chamailleries entre officiers, mêlant ainsi l'horrible et l'ordinaire avec un ton si convaincant qu'il en est déstabilisant - le banal finissant par normaliser l'horrible, et l'horrible paraissant contaminer le banal. (Dans un passage très caractéristique, vers le début du roman, la conversation d'un groupe d'officiers va et vient entre la stratégie d'extermination et les vertus du canard rôti fourré aux pommes avec de la purée qu'ils sont en train de manger : « "Oui, excellent", approuva Oberlander. "C'est une spécialité de la région ?" »)
facilement de tracer une nette démarcation entre « eux» et « nous». La première phrase du roman prend la forme de la salutation troublante de Aue à ses « frères humains» : l'objectif improbable du livre, et pourtant largement atteint, est de préserver ce sentiment troublant de fraternité.
La façon dont Littell accomplit ce tour de force mérite que nous nous y attardions et nous amène à considérer le style et la technique narrative de son roman - souvent mis en cause par ses détracteurs. Il est vrai qu'au niveau des mots et des phrases le style de Littell n'a rien d'exceptionnel et est parfois même prosaïque - sa traductrice anglaise, Charlotte Mandel!, a produit une version d'une remarquable fluidité, plus agréable à lire que le français. Dès que l'auteur s'essaie aux effets de manches, le roman déraille systématiquement. Des phrases comme « Ma pensée fuyait dans tous les sens, comme un banc de poissons devant un plongeur », ou « Je suis sorti de la guerre un homme vide, avec seulement de l'amertume et une longue honte, comme du sable qui crisse entre les dents» nous font d'autant plus grimacer que Littell réussit par ailleurs très souvent à rendre avec beaucoup de bonheur la platitude des propos quotidiens, les potins sur les promotions et les ordres du milieu militaire qu'il décrit.
La grande réussite du livre - cette façon qu'a Littell de nous
entraîner dans l'univers mental de Aue - repose en grande partie sur la technique saisissante qu'il emploie de bout en bout, et qui consiste à intégrer, avec de plus en plus d'insistance à mesure que l'intrigue se déroule, des scènes d'une horreur incommensurable (ou bien des scènes dans lesquelles les personnages discutent froidement d'actes ou de projets épouvantables) à des tirades prosaïques, voire ennuyeuses, des conversations sur les petites intrigues militaires mesquines, et autres interminables chamailleries entre officiers, mêlant ainsi l'horrible et l'ordinaire avec un ton si convaincant qu'il en est déstabilisant - le banal finissant par normaliser l'horrible, et l'horrible paraissant contaminer le banal. (Dans un passage très caractéristique, vers le début du roman, la conversation d'un groupe d'officiers va et vient entre la stratégie d'extermination et les vertus du canard rôti fourré aux pommes avec de la purée qu'ils sont en train de manger : « "Oui, excellent", approuva Oberlander. "C'est une spécialité de la région ?" »)
La surprise - qui est aussi une clé pour comprendre l'indignation que le livre de Littell a soulevée, ainsi que les raisons de ses succès et de ses échecs - tient à la manière dont ces structures sont censées aborder les grands thèmes suggérés par son titre eschylien. Car c'est en réalité la structure historique qui devrait jeter un éclairage sur le problème de la nature humaine, tandis que la composante mythico-fantasmatique - et surtout, si j'interprète correctement l'allusion complexe de Littell à une révision bien plus récente du mythe d'Oreste, ces scènes sexuelles explicites,voire pornographiques - est là pour explorer la nature du crime, de l'atrocité et de la justice.
Le conflit entre la civilisation et les forces du mal que les institutions civilisées cherchent, souvent en vain, à contenir est une tension qui est au coeur de tout débat sur les implications morales de la Shoah - tension que l'on retrouve également au niveau de la psychologie individuelle. Car la question de savoir comment un pays comme l'Allemagne, connu pour ses extraordinaires réalisations culturelles, a pu également créer Auschwitz,soulève aussi la question corollaire : comment des individus allemands (ou polonais, ukrainiens, lettons, lituaniens, français, etc.)qui, pour la plupart, se considéraient comme des gens normaux et raisonnables, et menèrent effectivement une vie apparemment normale pendant toute la guerre, mise à part leur participation aux crimes - ont-ils pu perpétrer des horreurs que nous nous plaisons, avec peut-être une certaine naïveté ou une certaine facilité, à qualifier d'« inhumaines» ?
Mais dans un passage qui dénote une aversion provocante pour le sentiment et qui risque de lui aliéner quelques lecteurs,le protagoniste de Littell se refuse à qualifier d'« inhumaines» les atrocités nazies. Aue rappelle à cet égard le cas d'un soldat , qui, apprend-il, s'était engagé dans la police parce que « c'était le seul moyen d'être sûr de pouvoir mettre une assiette sur la table tous les jours », et qui avait échoué dans une unité chargée de
l'horrible mission de liquider les soldats blessés irrécupérables - des soldats allemands- lors de l'effondrement du front russe:
"On a beaucoup parlé, après la guerre, pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé, de l'inhumain. Mais l'inhumain, excusez-moi,cela n'existe pas. Il n'y a que l'humain, et encore de l'humain: et ce Döll en est un bon exemple. Qu'est-ce que c'est d'autre, Döll, qu'un bon père de famille qui voulait nourrir ses enfants, et qui obéissait à son gouvernement, même si en son for intérieur, il n'était pas tout à fait d'accord?"
Le conflit entre la civilisation et les forces du mal que les institutions civilisées cherchent, souvent en vain, à contenir est une tension qui est au coeur de tout débat sur les implications morales de la Shoah - tension que l'on retrouve également au niveau de la psychologie individuelle. Car la question de savoir comment un pays comme l'Allemagne, connu pour ses extraordinaires réalisations culturelles, a pu également créer Auschwitz,soulève aussi la question corollaire : comment des individus allemands (ou polonais, ukrainiens, lettons, lituaniens, français, etc.)qui, pour la plupart, se considéraient comme des gens normaux et raisonnables, et menèrent effectivement une vie apparemment normale pendant toute la guerre, mise à part leur participation aux crimes - ont-ils pu perpétrer des horreurs que nous nous plaisons, avec peut-être une certaine naïveté ou une certaine facilité, à qualifier d'« inhumaines» ?
Mais dans un passage qui dénote une aversion provocante pour le sentiment et qui risque de lui aliéner quelques lecteurs,le protagoniste de Littell se refuse à qualifier d'« inhumaines» les atrocités nazies. Aue rappelle à cet égard le cas d'un soldat , qui, apprend-il, s'était engagé dans la police parce que « c'était le seul moyen d'être sûr de pouvoir mettre une assiette sur la table tous les jours », et qui avait échoué dans une unité chargée de
l'horrible mission de liquider les soldats blessés irrécupérables - des soldats allemands- lors de l'effondrement du front russe:
"On a beaucoup parlé, après la guerre, pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé, de l'inhumain. Mais l'inhumain, excusez-moi,cela n'existe pas. Il n'y a que l'humain, et encore de l'humain: et ce Döll en est un bon exemple. Qu'est-ce que c'est d'autre, Döll, qu'un bon père de famille qui voulait nourrir ses enfants, et qui obéissait à son gouvernement, même si en son for intérieur, il n'était pas tout à fait d'accord?"
Les Bienveillantes comporte deux éléments structuraux majeurs censés approfondir ces questions. Le premier est l'intrigue historico-documentaire - en l'occurrence la reconstitution chronologique minutieuse de la carrière de Maximilien Aue pendant la guerre, entre 1941 et 1945, qui nous permet également de retracer le parcours de l'Allemagne, des charniers de Pologne orientale
et d'Ukraine, après l'opération Barbarossa, jusqu'à Babi Yar,Kiev et au Caucase, et de là (après qu'un officier supérieur
,furieux l'a puni en l'envoyant au front) à la débâcle de Stalingrad.On retrouve ensuite le héros à Berlin où il devient un favori d'Himmler et d'Eichmann; après quoi il passe quelque temps à Paris, où il en profite pour renouer avec d'anciens amis de ses années d'étudiant, des collaborateurs qui, comme nombre de protagonistes, sont des personnages historiques réels (Robert Brasillach, Lucien Rebatet) ; il est ensuite muté à Auschwitz en 1943 et enfin, lors de la chute de Berlin, le très opportuniste Aue ressurgit dans le bunker d'Hitler. Ce parcours permet à Max d'être en même temps témoin oculaire et acteur des atrocités - et, parce que le narrateur est un homme cultivé qui semble raisonnable, il ouvre au lecteur une fenêtre sur la mentalité d'un tortionnaire.
Le deuxième élément est d'ordre mythico-sexuel : c'est l'intégralité de l'histoire de l' Orestie, superposée au récit primaire et composée de flash-back sur la vie passée de Max et des événements se déroulant dans le présent de la guerre, ce qui érige le personnage en un Oreste des temps modernes. Il est obsédé par la disparition de son père, mort sous l'uniforme pendant la Grande Guerre, et par ce qu'il considère comme l'impardonnable trahison de sa « chienne odieuse» de mère.
(" C'est comme s'ils l'avaient assassiné [... ] Quelle disgrâce! Pour leurs désirs honteux!")
Avec sa soeur jumelle Una, une sorte d'Électre, il entretient des rapports contre nature (qui s'avèrent incestueux - clin d'oeil à Chateaubriand, l'un des nombreux romanciers français qui président au texte de Littell ; le thème de l'inceste entre frère et soeur reste également un thème majeur dans l'oeuvre du barde allemand du XIIe siècle Hartmann von Aue, auquel Littell emprunte le nom pour baptiser son héros.)
Il tue sa mère et son deuxième mari (dans une scène étroitement calquée sur le mythe grec, où l'on voit notamment la mère offrir son sein nu au bras vengeur de son fils, armé d'une hache). Il est inlassablement poursuivi par les agents du châtiment - deux détectives de film noir auxquels il donne les noms évocateurs de Weser et Clemens (personnages qui, dans la réalité, n'étaient autres que les officiers de la Gestapo qui persécutèrent le Juif allemand Victor Klemperer dont le journal, "Je veux témoigner jusqu'au bout", constitue aujourd'hui un document incontournable dans l'étude de la Shoah, et caractérisé, pourrait-on dire, par le même mélange de récit dramatique et de détails banals, méticuleux et parfois fastidieux, que le roman de Littell). Sur tout cela, se greffent des descriptions de plus en plus fouillées des fantasmes et activités sexuelles qui culminent en une orgie onaniste dans la maison abandonnée de sa soeur au moment où les Russes entrent en Poméranie.
et d'Ukraine, après l'opération Barbarossa, jusqu'à Babi Yar,Kiev et au Caucase, et de là (après qu'un officier supérieur
,furieux l'a puni en l'envoyant au front) à la débâcle de Stalingrad.On retrouve ensuite le héros à Berlin où il devient un favori d'Himmler et d'Eichmann; après quoi il passe quelque temps à Paris, où il en profite pour renouer avec d'anciens amis de ses années d'étudiant, des collaborateurs qui, comme nombre de protagonistes, sont des personnages historiques réels (Robert Brasillach, Lucien Rebatet) ; il est ensuite muté à Auschwitz en 1943 et enfin, lors de la chute de Berlin, le très opportuniste Aue ressurgit dans le bunker d'Hitler. Ce parcours permet à Max d'être en même temps témoin oculaire et acteur des atrocités - et, parce que le narrateur est un homme cultivé qui semble raisonnable, il ouvre au lecteur une fenêtre sur la mentalité d'un tortionnaire.
Le deuxième élément est d'ordre mythico-sexuel : c'est l'intégralité de l'histoire de l' Orestie, superposée au récit primaire et composée de flash-back sur la vie passée de Max et des événements se déroulant dans le présent de la guerre, ce qui érige le personnage en un Oreste des temps modernes. Il est obsédé par la disparition de son père, mort sous l'uniforme pendant la Grande Guerre, et par ce qu'il considère comme l'impardonnable trahison de sa « chienne odieuse» de mère.
(" C'est comme s'ils l'avaient assassiné [... ] Quelle disgrâce! Pour leurs désirs honteux!")
Avec sa soeur jumelle Una, une sorte d'Électre, il entretient des rapports contre nature (qui s'avèrent incestueux - clin d'oeil à Chateaubriand, l'un des nombreux romanciers français qui président au texte de Littell ; le thème de l'inceste entre frère et soeur reste également un thème majeur dans l'oeuvre du barde allemand du XIIe siècle Hartmann von Aue, auquel Littell emprunte le nom pour baptiser son héros.)
Il tue sa mère et son deuxième mari (dans une scène étroitement calquée sur le mythe grec, où l'on voit notamment la mère offrir son sein nu au bras vengeur de son fils, armé d'une hache). Il est inlassablement poursuivi par les agents du châtiment - deux détectives de film noir auxquels il donne les noms évocateurs de Weser et Clemens (personnages qui, dans la réalité, n'étaient autres que les officiers de la Gestapo qui persécutèrent le Juif allemand Victor Klemperer dont le journal, "Je veux témoigner jusqu'au bout", constitue aujourd'hui un document incontournable dans l'étude de la Shoah, et caractérisé, pourrait-on dire, par le même mélange de récit dramatique et de détails banals, méticuleux et parfois fastidieux, que le roman de Littell). Sur tout cela, se greffent des descriptions de plus en plus fouillées des fantasmes et activités sexuelles qui culminent en une orgie onaniste dans la maison abandonnée de sa soeur au moment où les Russes entrent en Poméranie.
Cette tentative et d'autres pour disculper le père de tous les Juifs me paraissent aujourd'hui bien futiles. Je pense à l'histoire souvent, l'homme et sa femme et sa famille, la patrie qu'ils sont obligés de fuir pendant une période de crise. L'exploitation du mensonge pour ( il n'y a pas d'autre mot pour ça ) s'enrichir, l'utilisation de l'épouse pour fournir une couverture à une évasion qui est devenue, contre toute probabilité, un moyen d'enrichissement, de la propagation réussie d'une nouvelle progéniture dans ce nouveau pays. Je pense à tout cela et je me dis que quiconque a écrit Parashat Lech Lecha devait savoir quelque chose sur la façon dont les gens se comportent dans les périodes troublées.
DEPUIS LONGTEMPS, je vis dans deux endroits.
La distance qu'il leur fallut parcourir équivaut à la dernière étape de mon circuit habituel sur la 8e Avenue - la distance qui vous ramène du Croisement du Désir à chez moi.
C'est ce que vous êtes ; c'est la grammaire de votre identité
[…] puisque ce garçon, bien qu’il soit très jeune, sait déjà qu’il y a eu une autre catastrophe, plus lointaine dans le temps mais beaucoup plus significative, laquelle lie l’histoire de sa famille à l’Histoire elle-même ; mais précisément parce qu’il est si jeune il n’arrive pas à concevoir cette chose grande et abstraite qu’est l’Histoire, et en effet beaucoup d’années vont passer avant qu’il ne songe à aller à la recherche de ce chagrin plus grand encore, qu’il ne devienne un touriste dans les souffrances des autres […]
So my father loved knowing things and my mother lover organizing things, and perhaps this is why I, at an early age, discovered in myself an acute pleasure in organizing knowledge. (…) This, I now realize, was the first expression of an impulse that is, ultimately, the same as the one that drives a person to write – to impose order on a chaos of facts by assembling them into a story that has a beginning, a middle, and an end. (…) I felt a kind of pain, a form of anxiety even, when confronted by masses of information that seemed resistant to organization.(...) Naturally, I'd always been curious : how could I not, I whose face reminded certain people of someone long dead ?
(page 38)
(page 38)
Locke, comme encore beaucoup de parents aujourd'hui, se gaussait : que gagnerait un ouvrier à savoir le latin ? À quoi Wolf répliquait : la connaissance de la nature humaine.
Dans la mesure où l’Odyssée elle-même foisonne de soudaines péripéties et de détours surprenants, exerce son héros à la déception, apprend à son public à attendre l’inattendu, le fait que nous ne sommes jamais arrivés à Ithaque fut peut-être l’aspect le plus odysséen de notre croisière culturelle.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Daniel Adam Mendelsohn
Quiz
Voir plus
L'énigme Toutankhamon
Toutankhamon était un enfant pharaon. A quel âge a-t-il accédé au pouvoir?
9 ans
22 ans
11 ans
44 ans
34 questions
68 lecteurs ont répondu
Thèmes :
pharaon
, mystère
, antiquité
, animaux
, énigmes
, egypte
, archéologieCréer un quiz sur cet auteur68 lecteurs ont répondu