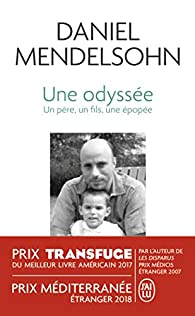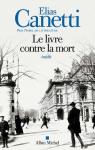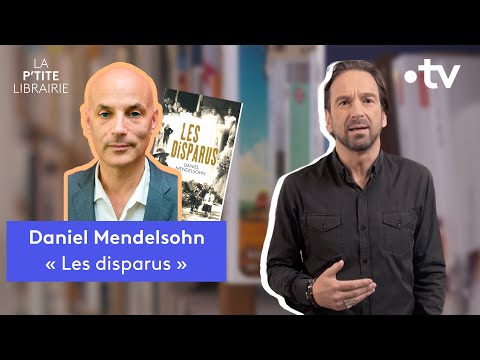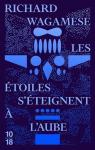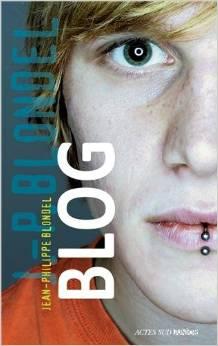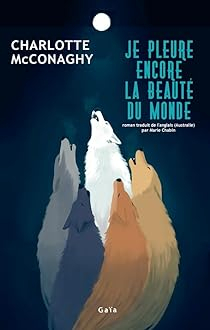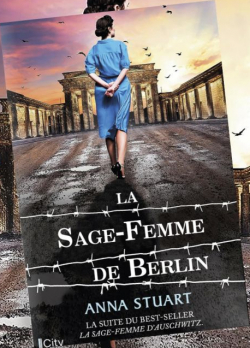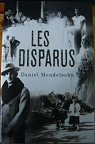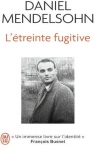Daniel Adam MendelsohnDaniel Mendelsohn/5
232 notes
Résumé :
Lorsque Jay Mendelsohn, âgé de 81 ans, décide de suivre le séminaire que son fils Daniel consacre à l’Odyssée d’Homère, père et fils commencent un périple intellectuel et émotionnel de grande ampleur. Croisant les thèmes de l’enfance et de la mort, de l’amour et du voyage, de la filiation et de la transmission, ce livre est le récit poignant de la redécouverte mutuelle d’un fils et d’un père.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Une Odyssée : Un père, un fils, une épopéeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (60)
Voir plus
Ajouter une critique
L'Odyssée est mon livre-fétiche : lu et relu- dès que j'ai su lire, dans les Contes et Légendes d'abord, puis dans la version de Bérard, si douce à l'oreille, et enfin dans celle de Jacottet, en alexandrins magnifiques – traduit et retraduit - au lycée et , à plusieurs reprises, au cours de mes études classiques- joué et rejoué pendant presque deux ans, dans une « tournée théâtrale » et néanmoins scolaire qui fait partie de mes plus chers souvenirs– je faisais Nausicaa, lui Ulysse, une version hellénique de toi Tarzan, moi Jane… à quinze ans, ça ne s'oublie pas…
Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'Odyssée l'a marquée de son empreinte pleine de fantaisie et de sagesse, de ruses et de souffrances, de tours et de détours…et je n'ai pas été étonnée qu'encore une fois elle me retrouve, dans un tardif retour de boomerang…
J'avais adoré Les Disparus de Mendelsohn et, sitôt qu'elle s'est annoncée à l'horizon de la rentrée littéraire, cette « Odyssée, un père, un fils, une épopée » m'a, bien entendu, fait de l'oeil…Un vieil ami qui me connaît bien m'en a fait cadeau et la flamme s'est rallumée aussitôt ! Je viens de l'emmener dans mes bagages faire un tour sur une île –bretonne, pas grecque !- et ma lecture s'est terminée avec ce joli périple insulaire…
Pas déçue du voyage ! Quelle lecture ! J'ai ressorti mon Bérard et surtout mon petit classique Hachette orange, tout en V.O. Je suis même arrivée, de temps en temps, à lâcher Mendelsohn pour retrouver le poète grec dans le texte, picorer une expression, un hexamètre dactylique –dactyle, spondée, le rap des aèdes !- et me faire bercer par la vague vineuse tandis que l'Aurore aux doigts de rose mettait un peu de baume sur le corps d'Ulysse rejeté sur la plage de Phéacie par la colère de l'Ebranleur du Sol.
"Andra moi ennepe, Mousa, polutropov, hos mala polla plachthè , epei Troiès hierov ptoliethron eperse..."
Le livre de Daniel Mendelsohn court trois challenges à la fois : développer une analyse pointue et convaincante des subtilités de l'Odyssée qui sert de trame à un séminaire universitaire qu'il a donné en tant que professeur de lettres, à Bard College, renouer les liens avec Jay Mendelsohn, son père, un matheux exigeant et peu communicatif , plus craint qu'aimé, qui assiste chaque semaine au cours de son fils , et enfin l'emmener, à l'issue de cette session, dans une croisière qui se propose de suivre le périple d'Ulysse en Méditerrannée…
Relation philologique, pédagogique et filiale à la fois, « Une Odyssée » tisse avec une grande habileté, une vraie finesse aussi, ces trois trames ensemble : le fil de la navette, comme celui des trois Parques le fait pour la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, lie judicieusement le sens du livre, la quête d'une transmission et la découverte d'un père inattendu pour ce fils qui croyait être maître du périple au long cours qu'il a composé et proposé - et qui « apprend » de ses étudiants, ce qui est le propre de toute relation pédagogique, mais qui "apprend" surtout de son père jusqu'aux dernières pages du livre qu'il est train d'écrire …
C'est vrai que l'Odyssée est une épopée étrange, précédée qu'elle est par la quête de Télémaque au début, qui nous dérobe Ulysse jusqu'au chant V. Loin d'être un appendice rajouté ou superflu, la quête de Télémaque, qui n'a jamais connu son père et ne peut donc pas le « reconnaître », donne à l'Odyssée tout entière un éclairage particulier qui permet d'en délivrer l'apologue.
Qu'il s'agisse d'Ulysse pour Télémaque, ou, pour Ulysse, de Télémaque, des Phéaciens, de Circé, de Polyphème, du chien, du porcher Eumée, de la nourrice Euriclée, de Pénélope, et enfin du vieux Laërte , tout le « nostos »- retour- d'Ulysse est marqué par le processus de reconnaissance : qui suis-je ? qui es-tu ? à quoi me reconnais-tu ? es-tu bien sûr(e) qu'il s'agit de moi ? suis-je bien sûr que je puis te faire confiance, que tu m'es resté(e) fidèle ?
Pleine de tours et de détours, l'épopée de ce polutropos Odusseus – Ulysse aux mille tours- fait des retours en arrière étonnants : les récits merveilleux contés par Ulysse aux Phéaciens, l'histoire de sa blessure à la jambe, la chute de Troie narrée par les âmes des morts, etc..
Sans doute parce que, comme la connaissance de soi, comme celle des siens, récit et voyage tournent en rond , suspendus au bon vouloir des dieux - ce qui irrite particulièrement Jay qui trouve vraiment qu'Ulysse a la vie trop facile- mais surtout suspendus à l'identification – souvent douloureuse, lente, difficile- des quelques rares points fixes d'une existence, qui font, de tout retour, une suite d'épreuves mais aussi le suprême but, la plus haute félicité d'une vie. Du Bellay l'a bien dit :
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Et s'en est retourné plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge…
Une Odyssée est un récit plein d'échos, de relais, de liens. C'est aussi une réflexion pleine de poésie, de philosophie et de tendresse filiale.
Comme Elpénor le marin d'Ulysse avec sa rame, le vieux Jay reçoit, avec ce livre, le plus beau « sèma » qu'un fils pouvait dresser à son père.
Bouleversant et diablement intelligent.
Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'Odyssée l'a marquée de son empreinte pleine de fantaisie et de sagesse, de ruses et de souffrances, de tours et de détours…et je n'ai pas été étonnée qu'encore une fois elle me retrouve, dans un tardif retour de boomerang…
J'avais adoré Les Disparus de Mendelsohn et, sitôt qu'elle s'est annoncée à l'horizon de la rentrée littéraire, cette « Odyssée, un père, un fils, une épopée » m'a, bien entendu, fait de l'oeil…Un vieil ami qui me connaît bien m'en a fait cadeau et la flamme s'est rallumée aussitôt ! Je viens de l'emmener dans mes bagages faire un tour sur une île –bretonne, pas grecque !- et ma lecture s'est terminée avec ce joli périple insulaire…
Pas déçue du voyage ! Quelle lecture ! J'ai ressorti mon Bérard et surtout mon petit classique Hachette orange, tout en V.O. Je suis même arrivée, de temps en temps, à lâcher Mendelsohn pour retrouver le poète grec dans le texte, picorer une expression, un hexamètre dactylique –dactyle, spondée, le rap des aèdes !- et me faire bercer par la vague vineuse tandis que l'Aurore aux doigts de rose mettait un peu de baume sur le corps d'Ulysse rejeté sur la plage de Phéacie par la colère de l'Ebranleur du Sol.
"Andra moi ennepe, Mousa, polutropov, hos mala polla plachthè , epei Troiès hierov ptoliethron eperse..."
Le livre de Daniel Mendelsohn court trois challenges à la fois : développer une analyse pointue et convaincante des subtilités de l'Odyssée qui sert de trame à un séminaire universitaire qu'il a donné en tant que professeur de lettres, à Bard College, renouer les liens avec Jay Mendelsohn, son père, un matheux exigeant et peu communicatif , plus craint qu'aimé, qui assiste chaque semaine au cours de son fils , et enfin l'emmener, à l'issue de cette session, dans une croisière qui se propose de suivre le périple d'Ulysse en Méditerrannée…
Relation philologique, pédagogique et filiale à la fois, « Une Odyssée » tisse avec une grande habileté, une vraie finesse aussi, ces trois trames ensemble : le fil de la navette, comme celui des trois Parques le fait pour la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, lie judicieusement le sens du livre, la quête d'une transmission et la découverte d'un père inattendu pour ce fils qui croyait être maître du périple au long cours qu'il a composé et proposé - et qui « apprend » de ses étudiants, ce qui est le propre de toute relation pédagogique, mais qui "apprend" surtout de son père jusqu'aux dernières pages du livre qu'il est train d'écrire …
C'est vrai que l'Odyssée est une épopée étrange, précédée qu'elle est par la quête de Télémaque au début, qui nous dérobe Ulysse jusqu'au chant V. Loin d'être un appendice rajouté ou superflu, la quête de Télémaque, qui n'a jamais connu son père et ne peut donc pas le « reconnaître », donne à l'Odyssée tout entière un éclairage particulier qui permet d'en délivrer l'apologue.
Qu'il s'agisse d'Ulysse pour Télémaque, ou, pour Ulysse, de Télémaque, des Phéaciens, de Circé, de Polyphème, du chien, du porcher Eumée, de la nourrice Euriclée, de Pénélope, et enfin du vieux Laërte , tout le « nostos »- retour- d'Ulysse est marqué par le processus de reconnaissance : qui suis-je ? qui es-tu ? à quoi me reconnais-tu ? es-tu bien sûr(e) qu'il s'agit de moi ? suis-je bien sûr que je puis te faire confiance, que tu m'es resté(e) fidèle ?
Pleine de tours et de détours, l'épopée de ce polutropos Odusseus – Ulysse aux mille tours- fait des retours en arrière étonnants : les récits merveilleux contés par Ulysse aux Phéaciens, l'histoire de sa blessure à la jambe, la chute de Troie narrée par les âmes des morts, etc..
Sans doute parce que, comme la connaissance de soi, comme celle des siens, récit et voyage tournent en rond , suspendus au bon vouloir des dieux - ce qui irrite particulièrement Jay qui trouve vraiment qu'Ulysse a la vie trop facile- mais surtout suspendus à l'identification – souvent douloureuse, lente, difficile- des quelques rares points fixes d'une existence, qui font, de tout retour, une suite d'épreuves mais aussi le suprême but, la plus haute félicité d'une vie. Du Bellay l'a bien dit :
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Et s'en est retourné plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge…
Une Odyssée est un récit plein d'échos, de relais, de liens. C'est aussi une réflexion pleine de poésie, de philosophie et de tendresse filiale.
Comme Elpénor le marin d'Ulysse avec sa rame, le vieux Jay reçoit, avec ce livre, le plus beau « sèma » qu'un fils pouvait dresser à son père.
Bouleversant et diablement intelligent.
Choisir Ulysse et Télémaque comme emblèmes de reconnaissance père-fils, prendre L'Odyssée comme support littéraire pour mieux éclairer sa relation avec son propre père, l'idée est pour le moins alléchante, pour ne pas dire géniale. Enfin si c'en est une, d'idée. Tout porte à croire en effet qu'il s'agit d'un récit, celui de Daniel Mendelsohn donc, professeur d'université spécialiste d'Homère, dont le père Jay décide un beau jour, du haut de ses 81 ans, de participer à un de ses séminaires sur l'Odyssée. L'occasion sans cesse renouvelée pour Daniel, le temps des cours, de revisiter ou redécouvrir sa relation au père, à l'aune de l'épopée mythique.
«Qui sait vraiment quel père l'a engendré ? demande amèrement Télémaque dès le début de l'Odyssée. Qui le sait, en effet ? Nos parents sont à bien des égards mystérieux, plus mystérieux que nous ne le serons jamais pour eux. »
Les deux histoires suivent des courbes narratives parfois parallèles d'autres fois concentriques, elles s'entrecroisent dans des déploiements de réflexions fines et profondes, s'auto-alimentent au gré d'une prose longue et savoureuse. Un régal pour le lecteur comme moi, ignare sur L'Odyssée, passionné par l'éclairage universitaire apporté sur le mythe. Du coup, j'ai rajouté un livre à ma pal, L'Odyssée.
«Qui sait vraiment quel père l'a engendré ? demande amèrement Télémaque dès le début de l'Odyssée. Qui le sait, en effet ? Nos parents sont à bien des égards mystérieux, plus mystérieux que nous ne le serons jamais pour eux. »
Les deux histoires suivent des courbes narratives parfois parallèles d'autres fois concentriques, elles s'entrecroisent dans des déploiements de réflexions fines et profondes, s'auto-alimentent au gré d'une prose longue et savoureuse. Un régal pour le lecteur comme moi, ignare sur L'Odyssée, passionné par l'éclairage universitaire apporté sur le mythe. Du coup, j'ai rajouté un livre à ma pal, L'Odyssée.
«Une maison est un royaume vaste et inconnu et une vie ne suffit pas à l'odyssée entre la chambre d'enfant, la chambre à coucher, le couloir dans lequel les enfants se poursuivent, la table de la salle à manger sur laquelle les bouchons sautent et le secrétaire avec ses quelques livres et ses quelques papiers, qui cherchent à dire le sens de ce va-et-vient entre la cuisine et l'office, entre Troie et Ithaque.»
Jamais auparavant une citation épinglée au cours d'une de mes lectures (ci-avant - extraite du livre «Danube», de Claudio Magris) ne m'aura paru à ce point appropriée à synthétiser l'impression profonde que m'en laisserait une autre, effectuée quelque temps après et en principe très différente de la première...
L'écriture de «UNE ODYSSEE - Un père, un fils, une épopée» relèverait pour moi, en effet, de ce même élan condensé magnifiquement dans ce passage de «Danube» : mouvement réunissant intellect, imagination et coeur, réconciliant avec grâce et naturel des dimensions la plupart du temps tenues à distance par la force des choses, incompatibles en apparence avec un quotidien subsumé dans cet horizon à court-terme auquel nous astreignent nos listes de courses et nos réunions à préparer, pris entre factures à régler et lave-vaisselles à remplir, entre le menu du jour et la chambre à échoir (ouf!) la nuit...
Exégèse savante d'un des textes fondateurs de la littérature occidentale, récit autour de d'une expérience singulière de l'auteur en tant qu'enseignant de lettres classiques, livre de mémoires dédié à son père, UNE ODYSSEE est un essai à entrées multiples, dont le dénominateur commun pourrait être la question de savoir comment créer les conditions subjectives pour qu'une «transmission» soit réussie : l'héritage d'une oeuvre classique, de ses lectures et interprétations successives à travers les époques; celle d'un maitre envers ses disciples; d'une génération à l'autre, ou encore celle d'un père à son fils.
Transmission qui s'envisage avant tout, ici, comme un cheminement partagé et comme «mouvement volontaire vers» : vers un dépassement du combat ininterrompu des consciences décrit par Hegel dans sa dialectique du maître et de l'esclave, «lutte de prestige» où chacun cherche instinctivement à ce que l'autre en face reconnaisse sa valeur comme étant prépondérante ; volonté de réduire le hiatus important existant entre un certain héritage humaniste classique et des modalités nouvelles de pensée, induites notamment par la révolution technologique et numérique actuellement en cours ; vers un décloisonnement aussi entre des modèles de rigueur et de travail intellectuels traditionnellement considérés comme incontournables pour accéder à un tel héritage, et ceux d'une jeunesse de plus en plus décomplexée à cet égard, habituée à un accès aux savoirs et à la connaissance à la carte, circonstancié et immédiat ; enfin, vers une levée possible de ce seuil de fer habituellement dressé entre vie professionnelle et vie personnelle, entre salon familial et la salle de classe, lorsque l'auteur, décidant d'accéder à la demande faite spontanément par son père de quatre-vingt-un ans, accepte qu'il suive en auditeur libre un de ses séminaires universitaires, consacré cette année-là (2011) à l'Odyssée.
Voilà en gros la feuille de route de ce récit lumineux de Daniel Mendelsohn, à la fois d'une érudition très généreuse et d'une intelligence émotionnelle absolument renversantes.
Dans la littérature grecque, d'ailleurs, nous explique l'auteur lors d'une de ses très nombreuses (et savoureuses) incursions philologiques, le mot «chant» (oimê) dérive d'un autre plus ancien (oimos), qui veut dire «chemin», ce dernier étant à son tour apparenté à un troisième mot, «oima», qui signifie lui «mouvement», «élan». C'est ainsi donc qu'en Grèce antique, le chant et la poésie auraient été étroitement associés à l'idée d'un «chemin», voire, plus archaïquement, à celle d'un «mouvement volontaire vers l'avant». (Et moi j'entends en ce moment, dans ma tête, «un chemin qui chemine», chanté par la voix veloutée de Georges Moustaki dans sa magnifique version française de la chanson «Águas de Março» - «Les Eaux de Mars» - du fondateur de la bossa-nova, Tom Jobim).
UNE ODYSSEE s'ouvre par ce que les érudits appellent un «proème» (c'est-à-dire «ce qui vient avant l'oimê», «avant le chant»). Il s'agit des vers par lesquels commencent pratiquement toutes les épopées classiques, annonçant en grands traits le sujet de l'oeuvre, son cadre, ses personnages et thèmes principaux. Entrée en matière où l'auteur tissera un étonnant écheveau d'imbrications signifiantes, accomplissant un véritable tour de force narratif inspiré de la technique de composition circulaire omniprésente dans la littérature grecque et, plus particulièrement, chez Homère.
«Si à première vue, elle peut s'apparenter à une digression, la composition circulaire, constitue une technique efficace pour intégrer à une même histoire le passé, le présent, et parfois même l'avenir puisque certaines «spirales» se déroulent vers l'avant, anticipant des événements qui se produiront après la conclusion du récit principal.»
Ainsi, procédant par des circonvolutions dans le temps et l'espace, par des allers-retours incessants entre un patrimoine universel légué par la Grèce antique et le réservoir de sa mémoire individuelle, mariant philologie et éléments autobiographiques, l'auteur détaille, pas à pas, quasiment pied à pied, les dix premiers vers incantatoires constitutifs du proème de l'Odyssée. Et tout en les analysant d'un point de vue littéraire, les relie symboliquement à ses souvenirs de son père et aux grandes étapes de l'odyssée vécue par tous deux grâce à leur lecture commune d'Homère durant cette année universitaire de 2011.
Cette «odyssée» dans l'Odyssée sera ensuite développée dans les chapitres suivants, au rythme même du séminaire universitaire et des cours consacrés aux principaux épisodes du voyage de retour du héros de Troie à Ithaque - itinéraire qu'à leur tour père et fils referont ensemble au terme du séminaire, lors d'un voyage en Grèce à l'été 2011 bouclant la boucle du récit.
Chapitres qui s'intitulant «Télémachie», «Paideusis», «Homophrosyné», «Apologoi», «Nostos», «Anagnorisisis» et «Sigma», pourraient de prime abord rebuter ou faire craindre le pire à un lecteur lambda s'estimant manquer d'érudition humaniste et classique suffisante, termes érudits que le talent et la pédagogie de Mendelsohn réussiront néanmoins à rendre parfaitement tangibles, actuels et vivants, accessibles au tout venant, du début à la fin du voyage.
Avec une grande délicatesse, avec la même attention et patience qu'il semble accorder à ses étudiants (et également à un père qu'il découvrira peu enclin à jouer le rôle de l'élève discipliné en classe !), l'auteur nous invite ainsi à partager, étape par étape, leur odyssée commune ayant permis, in fine, à tous les deux de trouver des réponses surprenantes à ce qui constituerait l'une des énigmes cruciales posées par l'épopée homérique : «mais quel est la vraie nature d'un homme, et combien de natures un homme peut-il posséder?»
Grâce à cet essai autobiographique, touchant par l'honnêteté du ton employé, surprenant par l'intelligence, la sensibilité et la vérité qui se dégagent à tout moment - brillante démonstration intellectuelle aussi, érudite, qui apprend et instruit, transmise en même temps avec coeur et générosité -, j'eus le sentiment de découvrir avec plaisir un style et une voix littéraire particuliers, atypiques.
Tout en abordant des thèmes liés à sa vie personnelle, à son intimité, Daniel Mendelsohn ne semble jamais céder à la tentation d'une auto-observation compulsive et/ou complaisante, ni à une forme quelconque de revendication (quelquefois de vindicte) confinant dans l'impudeur, ce que l'on retrouve, hélas, trop souvent chez des auteurs, de plus en nombreux, pratiquant une certaine forme d'autofiction dont le marché littéraire actuel paraît si friand (mais qui personnellement m'insupporte au plus haut point, y compris quand elle se prévaut d'illustrer un phénomène de société à déplorer, ou d'être simplement à visée soi-disant «sociologique»).
Enfin, l'auteur montre (à l'instar d'Homère) un art consommé de la digression (trop «agaçant», diront certains lecteurs du site) – aptitude remontant donc à la Grèce antique qui, toutefois, quoi qu'on en pense, maitrisée à merveille comme c'est le cas ici, s'avérera précieuse, incontournable, dès qu'on cherchera "à dire le [complexe] sens de ce va-et-vient entre la cuisine et l'office, entre Troie et Ithaque»...!
Jamais auparavant une citation épinglée au cours d'une de mes lectures (ci-avant - extraite du livre «Danube», de Claudio Magris) ne m'aura paru à ce point appropriée à synthétiser l'impression profonde que m'en laisserait une autre, effectuée quelque temps après et en principe très différente de la première...
L'écriture de «UNE ODYSSEE - Un père, un fils, une épopée» relèverait pour moi, en effet, de ce même élan condensé magnifiquement dans ce passage de «Danube» : mouvement réunissant intellect, imagination et coeur, réconciliant avec grâce et naturel des dimensions la plupart du temps tenues à distance par la force des choses, incompatibles en apparence avec un quotidien subsumé dans cet horizon à court-terme auquel nous astreignent nos listes de courses et nos réunions à préparer, pris entre factures à régler et lave-vaisselles à remplir, entre le menu du jour et la chambre à échoir (ouf!) la nuit...
Exégèse savante d'un des textes fondateurs de la littérature occidentale, récit autour de d'une expérience singulière de l'auteur en tant qu'enseignant de lettres classiques, livre de mémoires dédié à son père, UNE ODYSSEE est un essai à entrées multiples, dont le dénominateur commun pourrait être la question de savoir comment créer les conditions subjectives pour qu'une «transmission» soit réussie : l'héritage d'une oeuvre classique, de ses lectures et interprétations successives à travers les époques; celle d'un maitre envers ses disciples; d'une génération à l'autre, ou encore celle d'un père à son fils.
Transmission qui s'envisage avant tout, ici, comme un cheminement partagé et comme «mouvement volontaire vers» : vers un dépassement du combat ininterrompu des consciences décrit par Hegel dans sa dialectique du maître et de l'esclave, «lutte de prestige» où chacun cherche instinctivement à ce que l'autre en face reconnaisse sa valeur comme étant prépondérante ; volonté de réduire le hiatus important existant entre un certain héritage humaniste classique et des modalités nouvelles de pensée, induites notamment par la révolution technologique et numérique actuellement en cours ; vers un décloisonnement aussi entre des modèles de rigueur et de travail intellectuels traditionnellement considérés comme incontournables pour accéder à un tel héritage, et ceux d'une jeunesse de plus en plus décomplexée à cet égard, habituée à un accès aux savoirs et à la connaissance à la carte, circonstancié et immédiat ; enfin, vers une levée possible de ce seuil de fer habituellement dressé entre vie professionnelle et vie personnelle, entre salon familial et la salle de classe, lorsque l'auteur, décidant d'accéder à la demande faite spontanément par son père de quatre-vingt-un ans, accepte qu'il suive en auditeur libre un de ses séminaires universitaires, consacré cette année-là (2011) à l'Odyssée.
Voilà en gros la feuille de route de ce récit lumineux de Daniel Mendelsohn, à la fois d'une érudition très généreuse et d'une intelligence émotionnelle absolument renversantes.
Dans la littérature grecque, d'ailleurs, nous explique l'auteur lors d'une de ses très nombreuses (et savoureuses) incursions philologiques, le mot «chant» (oimê) dérive d'un autre plus ancien (oimos), qui veut dire «chemin», ce dernier étant à son tour apparenté à un troisième mot, «oima», qui signifie lui «mouvement», «élan». C'est ainsi donc qu'en Grèce antique, le chant et la poésie auraient été étroitement associés à l'idée d'un «chemin», voire, plus archaïquement, à celle d'un «mouvement volontaire vers l'avant». (Et moi j'entends en ce moment, dans ma tête, «un chemin qui chemine», chanté par la voix veloutée de Georges Moustaki dans sa magnifique version française de la chanson «Águas de Março» - «Les Eaux de Mars» - du fondateur de la bossa-nova, Tom Jobim).
UNE ODYSSEE s'ouvre par ce que les érudits appellent un «proème» (c'est-à-dire «ce qui vient avant l'oimê», «avant le chant»). Il s'agit des vers par lesquels commencent pratiquement toutes les épopées classiques, annonçant en grands traits le sujet de l'oeuvre, son cadre, ses personnages et thèmes principaux. Entrée en matière où l'auteur tissera un étonnant écheveau d'imbrications signifiantes, accomplissant un véritable tour de force narratif inspiré de la technique de composition circulaire omniprésente dans la littérature grecque et, plus particulièrement, chez Homère.
«Si à première vue, elle peut s'apparenter à une digression, la composition circulaire, constitue une technique efficace pour intégrer à une même histoire le passé, le présent, et parfois même l'avenir puisque certaines «spirales» se déroulent vers l'avant, anticipant des événements qui se produiront après la conclusion du récit principal.»
Ainsi, procédant par des circonvolutions dans le temps et l'espace, par des allers-retours incessants entre un patrimoine universel légué par la Grèce antique et le réservoir de sa mémoire individuelle, mariant philologie et éléments autobiographiques, l'auteur détaille, pas à pas, quasiment pied à pied, les dix premiers vers incantatoires constitutifs du proème de l'Odyssée. Et tout en les analysant d'un point de vue littéraire, les relie symboliquement à ses souvenirs de son père et aux grandes étapes de l'odyssée vécue par tous deux grâce à leur lecture commune d'Homère durant cette année universitaire de 2011.
Cette «odyssée» dans l'Odyssée sera ensuite développée dans les chapitres suivants, au rythme même du séminaire universitaire et des cours consacrés aux principaux épisodes du voyage de retour du héros de Troie à Ithaque - itinéraire qu'à leur tour père et fils referont ensemble au terme du séminaire, lors d'un voyage en Grèce à l'été 2011 bouclant la boucle du récit.
Chapitres qui s'intitulant «Télémachie», «Paideusis», «Homophrosyné», «Apologoi», «Nostos», «Anagnorisisis» et «Sigma», pourraient de prime abord rebuter ou faire craindre le pire à un lecteur lambda s'estimant manquer d'érudition humaniste et classique suffisante, termes érudits que le talent et la pédagogie de Mendelsohn réussiront néanmoins à rendre parfaitement tangibles, actuels et vivants, accessibles au tout venant, du début à la fin du voyage.
Avec une grande délicatesse, avec la même attention et patience qu'il semble accorder à ses étudiants (et également à un père qu'il découvrira peu enclin à jouer le rôle de l'élève discipliné en classe !), l'auteur nous invite ainsi à partager, étape par étape, leur odyssée commune ayant permis, in fine, à tous les deux de trouver des réponses surprenantes à ce qui constituerait l'une des énigmes cruciales posées par l'épopée homérique : «mais quel est la vraie nature d'un homme, et combien de natures un homme peut-il posséder?»
Grâce à cet essai autobiographique, touchant par l'honnêteté du ton employé, surprenant par l'intelligence, la sensibilité et la vérité qui se dégagent à tout moment - brillante démonstration intellectuelle aussi, érudite, qui apprend et instruit, transmise en même temps avec coeur et générosité -, j'eus le sentiment de découvrir avec plaisir un style et une voix littéraire particuliers, atypiques.
Tout en abordant des thèmes liés à sa vie personnelle, à son intimité, Daniel Mendelsohn ne semble jamais céder à la tentation d'une auto-observation compulsive et/ou complaisante, ni à une forme quelconque de revendication (quelquefois de vindicte) confinant dans l'impudeur, ce que l'on retrouve, hélas, trop souvent chez des auteurs, de plus en nombreux, pratiquant une certaine forme d'autofiction dont le marché littéraire actuel paraît si friand (mais qui personnellement m'insupporte au plus haut point, y compris quand elle se prévaut d'illustrer un phénomène de société à déplorer, ou d'être simplement à visée soi-disant «sociologique»).
Enfin, l'auteur montre (à l'instar d'Homère) un art consommé de la digression (trop «agaçant», diront certains lecteurs du site) – aptitude remontant donc à la Grèce antique qui, toutefois, quoi qu'on en pense, maitrisée à merveille comme c'est le cas ici, s'avérera précieuse, incontournable, dès qu'on cherchera "à dire le [complexe] sens de ce va-et-vient entre la cuisine et l'office, entre Troie et Ithaque»...!
Deux livres récents rendent hommage à Homère, ce grand poète grec à l'identité unique ou plurielle mystérieuse. Je conseille de lire Une odyssée, de Daniel Mendelsohn, après Un été avec Homère, de Sylvain Tesson. Je publie en même temps mes critiques de ces deux ouvrages très complémentaires.
Une odyssée – un père, un fils, une épopée ! de quoi ce titre à rallonge est-il le nom ? Daniel Mendelsohn, écrivain, intellectuel, enseigne le grec dans une université new-yorkaise. Il anime des séminaires sur l'Iliade et l'Odyssée pour des étudiants de première année ; des séances hebdomadaires d'une demi-journée sur un semestre. Dans le livre, il revient sur un séminaire consacré à l'Odyssée, quelques années plus tôt, en présence de son père, un homme de quatre-vingt-un ans qui s'y était inscrit de son propre chef et l'avait suivi avec assiduité. Après la dernière séance, l'auteur et son père décidaient d'embarquer pour une croisière culturelle en Méditerranée « sur les traces d'Ulysse »…
Le poème de l'Odyssée, on le sait, relate les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, ses dix années d'errance en Méditerranée après les dix années précédentes au siège de Troie, ses rencontres fantastiques d'île en île, avant son arrivée finale à Ithaque, chez lui, où il exécute les prétendants à sa succession, sans s'embarrasser de sommations inutiles. Retour à l'ordre des anciens jours auprès de Pénélope, sa fidèle épouse, et de leur fils Télémaque, vingt ans.
On trouve de tout chez Mendelsohn. Il met l'accent sur l'étude lexicale du poème : son analyse étymologique à la manière des exégèses hébraïques de rabbins érudits, séduira les philologues et les hellénistes (je ne suis ni l'un ni l'autre). Une approche de l'Odyssée à l'opposé de celle de Sylvain Tesson ! Me revient d'ailleurs une sentence de ce dernier, peut-être bien une pique pour un livre considéré comme concurrent : « Quand on tient un diamant dans les mains, on ne s'éberlue pas de la structure moléculaire du carbone, on s'émerveille des reflets »… Et pan !...
Mais quand, plus loin, Mendelsohn entreprend de décoder ce qu'il appelle la stratégie narrative homérique, il fait étinceler comme personne toutes les facettes du diamant. Pour l'amateur de romans que je suis, ça devient absolument passionnant.
Il faut bien comprendre que la lecture intégrale du poème, même traduit en français, est réservée à quelques hauts lettrés. Treize mille vers ! Comptez cinq cents pages, truffées de métaphores, de formulations cryptées, d'envolées lyriques. Les lecteurs de mon niveau doivent se contenter de résumés des aventures d'Ulysse. Des résumés complets, mais sèchement factuels. Frustrant !
Et voilà qu'avec Mendelsohn, on décrypte l'extraordinaire travail de composition narrative effectué par Homère afin d'assurer la cohérence des péripéties qui s'enchaînent et celle des attitudes des personnages. Un travail de romancier ! Les applications étudiées au cours du séminaire et rapportées dans le livre dévoilent toutes les richesses de l'Odyssée, un véritable roman-monde insérant la biographie complète d'un homme, Ulysse, dans la cosmologie métaphysique de son temps, sans oublier les sujets du quotidien auxquels Homère attache de l'importance, comme les relations fils-père – je vais y revenir ! – ou les petites choses qui assurent la cohésion d'un couple avec les années…
La lecture du livre donne l'impression d'être présent au séminaire, de participer au jeu des questions-réponses entre le maître et son auditoire, des jeunes gens tout juste sortis de l'adolescence, auxquels s'est joint un vieux monsieur apportant un complément d'éclairage qui les enchante, contrairement aux inquiétudes de son fils. Certaines scènes sont jubilatoires.
Les relations fils-père ! Au début, je ne voyais pas l'enjeu d'un tel livre. Encore un écrivain, m'étais-je dit, qui étale ses difficultés familiales en public, plutôt que d'aller consulter un psy !... Je faisais erreur. Ces relations fils-père sont fondamentales chez Homère, convaincu qu'un père garde toujours une part de mystère pour un fils. Pour Daniel Mendelsohn quinquagénaire, le séminaire et la croisière sont l'occasion ultime de découvrir un père. Au même titre que Télémaque, qui n'avait jamais connu le sien, Ulysse étant parti quelques semaines seulement après sa naissance. Au même titre qu'Ulysse lui-même, qui découvre à son retour un père très âgé, et ressent l'inexorabilité de sa mort prochaine… Jay Mendelsohn, père de Daniel, décédera dans l'année suivant le séminaire.
Finalement, un livre riche, passionnant et émouvant.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Une odyssée – un père, un fils, une épopée ! de quoi ce titre à rallonge est-il le nom ? Daniel Mendelsohn, écrivain, intellectuel, enseigne le grec dans une université new-yorkaise. Il anime des séminaires sur l'Iliade et l'Odyssée pour des étudiants de première année ; des séances hebdomadaires d'une demi-journée sur un semestre. Dans le livre, il revient sur un séminaire consacré à l'Odyssée, quelques années plus tôt, en présence de son père, un homme de quatre-vingt-un ans qui s'y était inscrit de son propre chef et l'avait suivi avec assiduité. Après la dernière séance, l'auteur et son père décidaient d'embarquer pour une croisière culturelle en Méditerranée « sur les traces d'Ulysse »…
Le poème de l'Odyssée, on le sait, relate les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, ses dix années d'errance en Méditerranée après les dix années précédentes au siège de Troie, ses rencontres fantastiques d'île en île, avant son arrivée finale à Ithaque, chez lui, où il exécute les prétendants à sa succession, sans s'embarrasser de sommations inutiles. Retour à l'ordre des anciens jours auprès de Pénélope, sa fidèle épouse, et de leur fils Télémaque, vingt ans.
On trouve de tout chez Mendelsohn. Il met l'accent sur l'étude lexicale du poème : son analyse étymologique à la manière des exégèses hébraïques de rabbins érudits, séduira les philologues et les hellénistes (je ne suis ni l'un ni l'autre). Une approche de l'Odyssée à l'opposé de celle de Sylvain Tesson ! Me revient d'ailleurs une sentence de ce dernier, peut-être bien une pique pour un livre considéré comme concurrent : « Quand on tient un diamant dans les mains, on ne s'éberlue pas de la structure moléculaire du carbone, on s'émerveille des reflets »… Et pan !...
Mais quand, plus loin, Mendelsohn entreprend de décoder ce qu'il appelle la stratégie narrative homérique, il fait étinceler comme personne toutes les facettes du diamant. Pour l'amateur de romans que je suis, ça devient absolument passionnant.
Il faut bien comprendre que la lecture intégrale du poème, même traduit en français, est réservée à quelques hauts lettrés. Treize mille vers ! Comptez cinq cents pages, truffées de métaphores, de formulations cryptées, d'envolées lyriques. Les lecteurs de mon niveau doivent se contenter de résumés des aventures d'Ulysse. Des résumés complets, mais sèchement factuels. Frustrant !
Et voilà qu'avec Mendelsohn, on décrypte l'extraordinaire travail de composition narrative effectué par Homère afin d'assurer la cohérence des péripéties qui s'enchaînent et celle des attitudes des personnages. Un travail de romancier ! Les applications étudiées au cours du séminaire et rapportées dans le livre dévoilent toutes les richesses de l'Odyssée, un véritable roman-monde insérant la biographie complète d'un homme, Ulysse, dans la cosmologie métaphysique de son temps, sans oublier les sujets du quotidien auxquels Homère attache de l'importance, comme les relations fils-père – je vais y revenir ! – ou les petites choses qui assurent la cohésion d'un couple avec les années…
La lecture du livre donne l'impression d'être présent au séminaire, de participer au jeu des questions-réponses entre le maître et son auditoire, des jeunes gens tout juste sortis de l'adolescence, auxquels s'est joint un vieux monsieur apportant un complément d'éclairage qui les enchante, contrairement aux inquiétudes de son fils. Certaines scènes sont jubilatoires.
Les relations fils-père ! Au début, je ne voyais pas l'enjeu d'un tel livre. Encore un écrivain, m'étais-je dit, qui étale ses difficultés familiales en public, plutôt que d'aller consulter un psy !... Je faisais erreur. Ces relations fils-père sont fondamentales chez Homère, convaincu qu'un père garde toujours une part de mystère pour un fils. Pour Daniel Mendelsohn quinquagénaire, le séminaire et la croisière sont l'occasion ultime de découvrir un père. Au même titre que Télémaque, qui n'avait jamais connu le sien, Ulysse étant parti quelques semaines seulement après sa naissance. Au même titre qu'Ulysse lui-même, qui découvre à son retour un père très âgé, et ressent l'inexorabilité de sa mort prochaine… Jay Mendelsohn, père de Daniel, décédera dans l'année suivant le séminaire.
Finalement, un livre riche, passionnant et émouvant.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Jay Mendelsohn, mathématicien et universitaire à la retraite à toujours regretté d'avoir abandonné l'apprentissage du Grec et du Latin en fin de lycée. C'est donc tout naturellement qu'il décide de participer, en auditeur libre, au séminaire sur l'Odyssée d'Homère dirigé par son fils Daniel.
Une fois par semaine durant six mois le vieux monsieur de quatre-vingt-un ans quitte son pavillon de banlieue, prend deux trains successifs pour étudier le voyage d'Ulysse au milieu de jeunes gens d'à peine vingt ans. « J'irais au fond et ne poserais pas de question » Tu parles ! Á peine installé, le père écoute puis participe activement, chef de l'opposition des théories universitaires, il emporte avec lui l'enthousiasme des jeunes étudiants. Á l'issu de ce séminaire, le père et le fils partirons ensemble pour une croisière en mer Egée sur les traces d'Ulysse. Daniel et Jay vivrons des moments inoubliables.
Daniel Mendelsohn, romancier et professeur de lettres classiques est persuadé que les littératures grecques et latines et ses Mythes fondateurs nous parlent de nous au XXIe siècle, avec « Une Odyssée, (soustitré un père, un fils, une épopée )» il nous le prouve à chaque page.
Grace à Laërte, Ulysse et Télémaque, l'écrivain explore et questionne le lien père-fils qui se tisse tout le long du récit d'Homère pour essayer de comprendre Jay, ce père si distant, si strict, ce père taiseux et inflexible en famille.
Durant ce séminaire il va aussi découvrir un père motivé, impliqué, parfois un peu trop, remettant en question les théories de son professeur de fils pour le plus grand plaisir des élèves sous le charme de l'octogénaire.
Mendelsohn, depuis son roman « Les Disparus » (à lire impérativement) questionne l'identité individuelle et collective. Qui suis-je, qui sommes-nous au monde ? Qui suis-je pour l'autre, mon regard sur les membres de ma famille est-il juste ? Qui sont ces inconnus que nous croyons connaitre ?
Récit érudit et intime à la fois, récit poignant, l'histoire d'une vie d'homme de la petite bourgeoisie Newyorkaise, mais aussi autofiction profonde qui impressionne par sa sincérité.
L'Odyssée c'est un retour et Daniel Mendelsohn nous conte son retour au père et c'est formidablement émouvant.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Une fois par semaine durant six mois le vieux monsieur de quatre-vingt-un ans quitte son pavillon de banlieue, prend deux trains successifs pour étudier le voyage d'Ulysse au milieu de jeunes gens d'à peine vingt ans. « J'irais au fond et ne poserais pas de question » Tu parles ! Á peine installé, le père écoute puis participe activement, chef de l'opposition des théories universitaires, il emporte avec lui l'enthousiasme des jeunes étudiants. Á l'issu de ce séminaire, le père et le fils partirons ensemble pour une croisière en mer Egée sur les traces d'Ulysse. Daniel et Jay vivrons des moments inoubliables.
Daniel Mendelsohn, romancier et professeur de lettres classiques est persuadé que les littératures grecques et latines et ses Mythes fondateurs nous parlent de nous au XXIe siècle, avec « Une Odyssée, (soustitré un père, un fils, une épopée )» il nous le prouve à chaque page.
Grace à Laërte, Ulysse et Télémaque, l'écrivain explore et questionne le lien père-fils qui se tisse tout le long du récit d'Homère pour essayer de comprendre Jay, ce père si distant, si strict, ce père taiseux et inflexible en famille.
Durant ce séminaire il va aussi découvrir un père motivé, impliqué, parfois un peu trop, remettant en question les théories de son professeur de fils pour le plus grand plaisir des élèves sous le charme de l'octogénaire.
Mendelsohn, depuis son roman « Les Disparus » (à lire impérativement) questionne l'identité individuelle et collective. Qui suis-je, qui sommes-nous au monde ? Qui suis-je pour l'autre, mon regard sur les membres de ma famille est-il juste ? Qui sont ces inconnus que nous croyons connaitre ?
Récit érudit et intime à la fois, récit poignant, l'histoire d'une vie d'homme de la petite bourgeoisie Newyorkaise, mais aussi autofiction profonde qui impressionne par sa sincérité.
L'Odyssée c'est un retour et Daniel Mendelsohn nous conte son retour au père et c'est formidablement émouvant.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
critiques presse (2)
Mêlant tous ces fils narratifs avec le récit d’Homère, dans une construction aussi joyeuse que subtile et raffinée, Mendelsohn nous confie un récit captivant et riche de réflexions profondes sur les rapports père-fils, maître-élèves, et cette question, au cœur de l’Odyssée : qu’est-ce qu’un homme ?
Lire la critique sur le site : Actualitte
Pour son nouveau livre, qui mêle avec audace le poète antique et l’histoire familiale, l’écrivain et helléniste a relu l’« Odyssée » au prisme des relations filiales.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (57)
Voir plus
Ajouter une citation
Tom pose la question "pourquoi votre père suit ce cours"?
Notre chambre était donc devenue son bureau. PROF. JAY MENDELSOHN, annonçait la plaque en plastique blanc sur la porte.
Je l'imaginais mal dans son rôle d'enseignant. Je voyais très bien ma mère en institutrice, à l'époque où elle enseignait en maternelle et en primaire, dans les années 1950, d'abord, peu après leur mariage, puis après vingt années d'intermède, quand elle a eu fini de nous élever, dans les années 1980 et 1990. Maman était exubérante, vive, pleine d'entrain et intelligente ; tout le monde disait qu'elle était faite pour enseigner. Avec mes frères et sœur, nous avons d'ailleurs profité de son instinct pédagogique même si, à l'époque, nous ne l'appréciions pas à sa juste valeur : quand nous rentrions de l'école, l'après-midi, nous trouvions sur la table de la cuisine une rose dans un soliflore, ou une orange soigneusement coupée en deux, ou un poivron vert, et elle nous faisait asseoir autour de la table et disait : Regardez mes enfants comme la nature est merveilleuse ! Admirez cette géométrie parfaite des pétales, des tranches, des cosses !........
Mais j'étais totalement incapable de me figurer mon père devant une classe. Je repensais à l'œil qu'il posait sur les exercices et les interros de maths que je rapportais à la maison, sur les X rouges griffonnés en marge, comme une broderie furieuse festonnant le côté du papier, et j'en étais réduit à me demander quel genre d'enseignant PROF. JAY MENDELSOHN avait pu être.
Et maintenant, en ce premier jour du séminaire sur l'Odyssée, il était assis dans ma classe la main en l'air.
"Effectivement, je suis son père" di-il!
Je suis le cours de Dan (quelques étudiants s'amusèrent à l'entendre m'appeler par mon prénom) parce que j'ai eu envie de relire les Classiques que j'avais lu au lycée. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940.
Notre chambre était donc devenue son bureau. PROF. JAY MENDELSOHN, annonçait la plaque en plastique blanc sur la porte.
Je l'imaginais mal dans son rôle d'enseignant. Je voyais très bien ma mère en institutrice, à l'époque où elle enseignait en maternelle et en primaire, dans les années 1950, d'abord, peu après leur mariage, puis après vingt années d'intermède, quand elle a eu fini de nous élever, dans les années 1980 et 1990. Maman était exubérante, vive, pleine d'entrain et intelligente ; tout le monde disait qu'elle était faite pour enseigner. Avec mes frères et sœur, nous avons d'ailleurs profité de son instinct pédagogique même si, à l'époque, nous ne l'appréciions pas à sa juste valeur : quand nous rentrions de l'école, l'après-midi, nous trouvions sur la table de la cuisine une rose dans un soliflore, ou une orange soigneusement coupée en deux, ou un poivron vert, et elle nous faisait asseoir autour de la table et disait : Regardez mes enfants comme la nature est merveilleuse ! Admirez cette géométrie parfaite des pétales, des tranches, des cosses !........
Mais j'étais totalement incapable de me figurer mon père devant une classe. Je repensais à l'œil qu'il posait sur les exercices et les interros de maths que je rapportais à la maison, sur les X rouges griffonnés en marge, comme une broderie furieuse festonnant le côté du papier, et j'en étais réduit à me demander quel genre d'enseignant PROF. JAY MENDELSOHN avait pu être.
Et maintenant, en ce premier jour du séminaire sur l'Odyssée, il était assis dans ma classe la main en l'air.
"Effectivement, je suis son père" di-il!
Je suis le cours de Dan (quelques étudiants s'amusèrent à l'entendre m'appeler par mon prénom) parce que j'ai eu envie de relire les Classiques que j'avais lu au lycée. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940.
En partie parce qu'il donnait l'impression d'être toujours penché sur un livre, en train de raisonner ou d'absorber les raisonnements des autres, quand j'étais petit, je ne voyais mon père que comme une tête. Cette impression que sa tête était la plus grande partie de son corps était accentuée par sa calvitie précoce, apparue sans doute alors que j'étais encore enfant, et j'imaginais que l'énorme cerveau qui se logeait à l'intérieur de sa boîte crânienne avait tellement grossi qu'à force d'appuyer sur les parois, il avait fini par faire tomber les cheveux de son crâne. Nombre de mes souvenirs de lui partent d'une image, non pas de son visage - l'ovale cireux souligné par l'arcade de ses sourcils et ses petits yeux marron foncé légèrement rapprochés, le long nez busqué, un peu tordu au bout, qui avait l'apparence du caoutchouc, la bouche aux lèvres fines qui avait tendance à se figer dans un pincement -, mais de sa tête, cette tête dégarnie qui semblait presque émouvante de vulnérabilité, comme exposée aux blessures (J'ai lu, 2018, pp. 45-46).
C’est drôle, dit-il, mais je trouve que cette partie du poème [la reconnaissance d’Ulysse sous les traits d’un vieil homme par Pénélope] est tout à fait réaliste. Il y a des choses qu’on partage dans un couple qui n’ont rien de physique : des blagues ou des souvenirs glanés au fil du temps, des petites choses que personne d’autre ne sait.
Il leva les yeux et vit tous ces regards de jeunes gens braqués sur lui. Soudain embarrassé, il tenta de détendre l’atmosphère : Bon, des fois aussi, ce sont des choses physiques! (...)
Les étudiants ne pipaient mot. Qu’auraient-ils bien pu dire ? Le mariage de mes parents avait duré trois fois leur vie. Leurs visages graves, les regards ébahis qu’ils posaient sur mon père à l’autre bout de la salle disaient à quel point ils étaient impressionnés. Et même, me sembla-t-il soudain, admiratifs.
Alors, dans le silence palpable qui régnait autour de la table je compris que les métamorphoses magiques qui ont lieu dans l’Odyssée ne sont rien d’autre que cela. Elles n’ont rien de magique. Quelque chose se passe, quelqu’un s’exprime avec passion ou autorité – avec des «mots ailés», épê pteroenta, selon l’expression d’Homère -, et l’on voit soudain les choses autrement : la personne en face a effectivement l’air d’avoir changé.
Il leva les yeux et vit tous ces regards de jeunes gens braqués sur lui. Soudain embarrassé, il tenta de détendre l’atmosphère : Bon, des fois aussi, ce sont des choses physiques! (...)
Les étudiants ne pipaient mot. Qu’auraient-ils bien pu dire ? Le mariage de mes parents avait duré trois fois leur vie. Leurs visages graves, les regards ébahis qu’ils posaient sur mon père à l’autre bout de la salle disaient à quel point ils étaient impressionnés. Et même, me sembla-t-il soudain, admiratifs.
Alors, dans le silence palpable qui régnait autour de la table je compris que les métamorphoses magiques qui ont lieu dans l’Odyssée ne sont rien d’autre que cela. Elles n’ont rien de magique. Quelque chose se passe, quelqu’un s’exprime avec passion ou autorité – avec des «mots ailés», épê pteroenta, selon l’expression d’Homère -, et l’on voit soudain les choses autrement : la personne en face a effectivement l’air d’avoir changé.
En grec, nostos signifie «le retour». La forme plurielle du mot, nostoi, était en fait le titre d’une épopée perdue consacrée aux retours des rois et des chefs de guerre qui combattirent à Troie. L’Odyssée est elle-même un récit de nostos (...) Peu à peu, le mot nostos, teinté de mélancolie et si profondément ancré dans les thèmes de l’Odyssée, a fini par se combiner à un autre mot du vaste vocabulaire grec de la souffrance, algos, pour nous offrir un moyen d’exprimer avec une élégante simplicité le sentiment doux-amer que nous éprouvons parfois pour une forme particulière et troublante de vague à l’âme. Littéralement, le mot signifie «la douleur qui naît du désir de retrouver son foyer», mais comme nous le savons, ce «foyer», surtout lorsqu’on vieillit, peut aussi bien se situer dans le temps que dans l’espace, être un moment autant qu’un lieu. Ce mot est «nostalgie».
Mon père détestait les signes de faiblesse, à commencer par la maladie, pour laquelle il affichait une sorte de mépris, comme si le fait d’être souffrant était une défaillance éthique plutôt que physique. Quand il nous arrivait de devoir rester à la maison parce que nous étions malades, il passait la tête par la porte de notre chambre avant de partir travailler et soupirait d’un air las et excédé, comme si cette grippe ou cette varicelle signifiait le début de quelque irréversible décadence morale.
Videos de Daniel Adam Mendelsohn (14)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Vous savez ce que c'est, vous, un héros ? Et la vérité dans une histoire familiale, comment la découvrir ?
« Les disparus » de Daniel Mendelsohn c'est à lire en poche chez J'ai Lu.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Vous savez ce que c'est, vous, un héros ? Et la vérité dans une histoire familiale, comment la découvrir ?
« Les disparus » de Daniel Mendelsohn c'est à lire en poche chez J'ai Lu.
autres livres classés : relation père-filsVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Daniel Adam Mendelsohn (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1710 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1710 lecteurs ont répondu