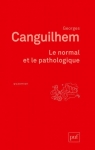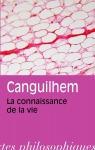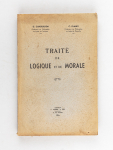Citations de Georges Canguilhem (110)
Si Laplace n'usait pas du terme de déterminisme, il est un des pères spirituels, et en France au moins, un père autoritaire et autorisé, de la doctrine que ce terme désigne. Le déterminisme ce n'est pas pour Laplace une exigence de méthode, un postulat normatif de la recherche, assez souple pour ne rien préjuger de la forme des résultats auxquels il conduira, 'est la réalité même, achevée, coulée ne variateur dans les cadres de la mécanique newtonienne et laplacienne. On peut concevoir le déterminisme comme ouvert à d'incessantes corrections des formules de lois et des concepts qu'elles relient, ou bien comme clos, sur son contenu définitif supposé. Laplace a construit la théorie du déterminisme clos.
La quantité, c’est la qualité niée, mais non la qualité supprimée. La variété qualitative des lumières simples, perçues par l’œil humain comme couleurs, est réduite par la science à la différence quantitative de longueurs d’onde, mais c’est la variété qualitative qui persiste encore, sous forme de différences de quantité, dans le calcul des longueurs d’onde.
Le refus d’une conception ontologique de la maladie, corollaire négatif de l’affirmation d’identité quantitative entre le normal et le pathologique, c’est d’abord peut-être le refus plus profond d’avérer le mal.
En somme, Claude Bernard a formulé dans le domaine médical […] l’exigence profonde d’une époque qui croyait à la toute-puissance d’une technique fondée sur la science, et qui se trouvait bien dans la vie, en dépit, ou peut-être en raison, des lamentations romantiques.
En cette théorie se fait jour, tout d’abord, la conviction d’optimisme rationaliste qu’il n’y a pas de réalité du mal. Ce qui distingue la médecine du XIXe siècle, surtout avant l’ère pastorienne, par rapport à la médecine des siècles antérieurs, c’est son caractère résolument moniste. En dépit des efforts des iatromécaniciens et des iatrochimistes, la médecine du XVIIIe siècle était restée, par l’influence des animistes et des vitalistes, une médecine dualiste, un manichéisme médical. La Santé et la Maladie se disputaient l’Homme, comme le Bien et le Mal, le Monde. C’est avec beaucoup de satisfaction intellectuelle que nous relevons dans une histoire de la médecine le passage suivant: «Paracelse est un illuminé, Van Helmont, un mystique, Stahl, un piétiste. Tous les trois innovent avec génie, mais subissent l’influence de leur milieu et des traditions héréditaires. Ce qui rend très difficile l’appréciation des doctrines réformatrices de ces trois grands hommes, c’est l’extrême difficulté qu’on éprouve quand on veut séparer leurs opinions scientifiques de leurs croyances religieuses… Il n’est pas bien sûr que Paracelse n’ait pas cru trouver l’élixir de vie; il est certain que Van Helmont a confondu la santé avec le salut et la maladie avec le péché; et Stahl lui-même, malgré sa force de tête, a usé plus qu’il ne fallait dans l’exposé de La vraie théorie médicale, de la croyance à la faute originelle et à la déchéance de l’homme» [48, 311]. Plus qu’il ne fallait! dit l’auteur, précisément grand admirateur de Broussais, l’ennemi juré, à la naissance du XIXe siècle, de toute ontologie médicale. Le refus d’une conception ontologique de la maladie, corollaire négatif de l’affirmation d’identité quantitative entre le normal et le pathologique, c’est d’abord peut-être le refus plus profond d’avérer le mal.
La maladie, l'état pathologique, ne sont pas perte d'une norme mais allure de la vie réglée par des normes vitales inférieures ou dépréciées du fait qu'elles interdisent au vivant la participation active et aisée, génératrice de confiance et d'assurance, à un genre de vie qui était antérieurement le sien et qui reste permis à d'autres.
Être malade c'est vraiment pour l'homme vivre d'une autre vie, même au sens biologique du mot.
Une certaine finalité semble manifestée par les êtres et les phénomènes biologiques. Un organe est une série de tissus différenciés dont la structure et les relations semblent répondre à un plan pour coopérer à une fonction. Sans doute, chaque tissu peut être cultivé à part (expériences de Carrel), mais en perdant les caractères propres qu'il a dans l'organisme du fait de sa coopération avec d'autres tissus morphologiquement différents. Par conséquent, supposé que l'existence artificielle de chaque tissu puisse être réduite à une seule série causale, ce qui est important c'est que dans l'organe et dans l'orga-nisme, ces séries causales sont concourantes. Si nous considérons non plus les organes mais l'organisme, nous constatons qu'il est un système d'organes réciproquement fins et moyens par rapport les uns aux autres et qu'il se présente comme une synthèse de fonctions réciproquement dépendantes. Si donc nous entendons par finalité un rapport tel que les éléments divers d'un composé soient unifiés synthétiquement non seulement par et dans un tout, mais pour un tout, ce caractère de finalité est incontestable dans les phénomènes de la vie. Par ailleurs, la croissance, qui n'est pas seulement un accroissement quantitatif mais la direction irréversible vers une forme, l'assimilation qui maintient l'intégrité de cette forme, et la reproduction qui assure, au delà et au moyen des individus périssables, la continuité des formes, sont autant d'aspects du vivant qui semblent requérir pour leur interprétation l'appel à une finalité effective. La persistance de la forme et la subordination à l'espèce, autant de relations apparemment irréductibles à un mécanisme causal.
Quand donc la prévision scientifique semble prendre en compte des causes connues d'un changement, la notion de ces causes s'entend toujours finalement (on les dit connues pour cette raison) de conditions fixes et abstraites de l'évolution d'un système : ce n'est pas le déterminisme qui se fait causalité mais l'inverse, par hypothèse; et autrement dit ce n'est pas l'action causale évolutive du système que la prévision détermine, c'est le déterminisme des conditions qui est référé par la prévision à cette action une fois supposée.
Ainsi une une géométrie, une trigonométrie ne sont pas en soi différentes d'une théorie physique, elles sont des interprétations déductives de l'expérience perçue. Une géométrie est une théorie de l'espace. De quel espace? De celui-là même qu'elle se donne ou qu'elle définit comme rendant possibles des opérations de mesure et de comparaison des phénomènes. Cela veut dire qu'en définitive les postulats d'une géométrie sont relatifs aux phénomènes qui pourront être mesurés, expliqués et prévus par les conséquences nécessaires de ces postulats.
Qu'on entende bien cette dernière proposition. Elle ne signifie pas que le géomètre calque sa géométrie sur une expérience préalable spatialement présentée. La géométrie usuelle n'est pas euclidienne parce que l'espace de la perception est euclidien. La perception n'a de valeur et de signification euclidienne qu'après la géométrie d'Euclide et non avant. Il n'y a pas de droite euclidienne, de plan, de trièdre dans la perception prégéométrique.
Qu'est-ce qui amènera à changer de géométrie? Cela même qui amène à changer de théorie physique, l'incapacité de l'une et la capacité de l'autre à interpréter intelligiblement de nouveaux phénomènes physiques.
Qu'on entende bien cette dernière proposition. Elle ne signifie pas que le géomètre calque sa géométrie sur une expérience préalable spatialement présentée. La géométrie usuelle n'est pas euclidienne parce que l'espace de la perception est euclidien. La perception n'a de valeur et de signification euclidienne qu'après la géométrie d'Euclide et non avant. Il n'y a pas de droite euclidienne, de plan, de trièdre dans la perception prégéométrique.
Qu'est-ce qui amènera à changer de géométrie? Cela même qui amène à changer de théorie physique, l'incapacité de l'une et la capacité de l'autre à interpréter intelligiblement de nouveaux phénomènes physiques.
La quantité c'est la qualité niée, mais cette négation ne peut pas procéder de qu'elle nie.
En résumant tout l'examen ci-dessus, nous arrivons à ceci: l'esprit scientifique cherche à dégager d'une expérience confuse les constances qui doivent s'y trouver, et qui nous permettraient, en la comprenant objectivement, de régler sur elles notre pensée. Mais notre pensée, cela implique à la fois les Sens, la Mémoire et la Raison. Chercher par la Raison ce qui demeure d'immuable et d'identique dans le divers, cela définit une opération exactement opposée à celle des Sens, de la Mémoire et des fonctions qui se rattachent à celles-ci: car la Raison veut l'analyse et ces fonctions n'accomplissent par elles-mêmes que des synthèses, c'est-à-dire des altérations. Le rapport de l'a priori rationnel à l'expérience doit dès lors s'interpréter ainsi : une matière de nature synthétique, diverse et indéfiniment changeante doit être pliée à une forme de structure fixe ou qui tend à l'être. Toute démonstration scientifique est le fruit fatalement discursif de cette obligation une fois conçue, et proprement de cette décision une fois prise.
Relativement au problème posé (de la possibilité de bases à la fois "matérielles" et intuitivement vraies de la Science), la conclusion normale semble donc être la suivante : de telles bases ne sont données ni par l'expérience perceptive usuelle, ni par la fonction réceptive des sens. Il n'y a pas de vérité antérieurement au savoir. Certes il n'est pas contestable que l'expérience fournit une "matière" à quoi devra s'appliquer la forme régulatrice du savoir pour que la vérité effective se découvre; mais cette "matière", sensoriellement qualifiée ou ajustée par l'intelligence conceptuelle aux milieux quantitatifs de l'Espace et du Temps, ne possède par soi aucune valeur intuitive de réalité: il semble qu'il faille ici récuser à la fois le dogmatisme des rationalistes et l'empirisme des sensualistes. La fonction propre de cette matière, c'est, lorsque se découvre, par l'erreur soupçonnée ou reconnue, le conflit de croyances opposées qui fait le périlleux imbroglio de l'expérience de susciter, par sa résistance même à une tentative de vérification immédiate, l'entreprise à longue échéance de la Connaissance pure: des deux croyances absurdement emmêlées, la Science est effort pour dégager l'une et l'autre, par une difficile abstraction. Dans le débat pendant entre la Qualité et la Quantité, le rôle formel de la Science est de présumer d'abord, de démontrer ensuite, la suprématie de la Quantité; l'expérience elle-même est neutre, la fonction "matérielle" de la Qualité est celle d'un adversaire : c'est celle de l'Illusion s'opposant aux exigences de la Vérité
Parce que les physiciens et les chimistes avaient, en quelque sorte, dématérialisé la matière, les biologistes ont pu expliquer la vie en la dévitalisant [...] De descriptif, le darwinisme est devenu déductif.
p152
p152
Aucune pratique ne peut fournir à une théorie des données théoriquement exploitables et valables si la théorie n'a pas d'elle-même d’abord inventé et défini les conditions de validité selon lesquelles les données seront reçues.
p137
p137
L'histoire des sciences devrait nous rendre plus attentifs au fait que les découvertes scientifiques, dans un certain ordre de phénomènes, peuvent jouer, du fait de leur dégradation possible en idéologies, un rôle d'obstacles au travail théorique en cours dans un autre ordre. Mais il arrive aussi que ce travail théorique, à ses débuts, et surtout dans les domaines où la preuve expérimentale est longue à instituer, affecte lui-même la forme d'une idéologie.
p131
p131
L'idéologie, c'est la connaissance d'autant plus éloignée de son objet donné qu'elle croit coller à lui ; c'est la méconnaissance du fait qu'une connaissance critique de son projet et de son problème se sait d'abord à distance de son objet opératoirement construit.
p55
p55
Les idéologies scientifiques sont des systèmes explicatifs dont l'objet est hyperbolique, relativement à la norme de scientificité qui lui est appliquée par emprunt.
p53
p53
En présence d’un oiseau à trois pattes, faut-il être plus sensible à ceci que c’est une de trop ou à cela que ce n’est guère qu’une de plus ?
Toutes les réussites sont menacées puisque les individus meurent, et même les espèces. Les réussites sont des échecs retardés, les échecs des réussites avortées.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Tous Gémeaux !
moravia
91 livres
Auteurs proches de Georges Canguilhem
Quiz
Voir plus
Couleur: Jaune
Ce peintre a réussi à peindre jaune sur jaune . Les Tournesols est une oeuvre signée:
Paul Gauguin
Pablo Picasso
Vincent Van Gogh
8 questions
109 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jaune
, couleur
, culture générale
, peinture
, cinema
, littérature
, art
, histoireCréer un quiz sur cet auteur109 lecteurs ont répondu