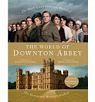Nationalité : Royaume-Uni
Né(e) : 1974
Ajouter des informations
Né(e) : 1974
Biographie :
Jessica Fellowes est écrivaine et journaliste.
Elle est la nièce du Baron Julian Fellowes (1949), le créateur de la série à succès "Downton Abbey" (2010–2015).
Elle a été journaliste à "The London Paper" et a écrit pour le "Daily Telegraph", "Telegraph Weekend", "Psychologies" et "The Lady".
Elle est connue pour sa carrière de conférencière internationale qui a accompagné la série "Downton Abbey" dont elle a consacré cinq livres (2011-2015).
Jessica Fellowes est aussi auteure d'une série de romans policier, "Les sœurs Mitford enquêtent" ("The Mitford Murders").
Le premier tome et son premier roman, "L'assassin du train" ("The Mitford Murders"), est paru en 2017, suivi de "Le Gang de la Tamise" ("Bright Young Dead") en 2018.
site officiel : https://www.jessicafellowes.com/
+ Voir plusJessica Fellowes est écrivaine et journaliste.
Elle est la nièce du Baron Julian Fellowes (1949), le créateur de la série à succès "Downton Abbey" (2010–2015).
Elle a été journaliste à "The London Paper" et a écrit pour le "Daily Telegraph", "Telegraph Weekend", "Psychologies" et "The Lady".
Elle est connue pour sa carrière de conférencière internationale qui a accompagné la série "Downton Abbey" dont elle a consacré cinq livres (2011-2015).
Jessica Fellowes est aussi auteure d'une série de romans policier, "Les sœurs Mitford enquêtent" ("The Mitford Murders").
Le premier tome et son premier roman, "L'assassin du train" ("The Mitford Murders"), est paru en 2017, suivi de "Le Gang de la Tamise" ("Bright Young Dead") en 2018.
site officiel : https://www.jessicafellowes.com/
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (49)
Voir plus
Ajouter une citation
Louisa aimait sa mère, mais à son goût, elle ressemblait un peu trop à l’une des taies d’oreiller qu’elle lavait et repassait avec tant de soin : propre, blanche, sentant bon le frais, et n’existant que pour le confort d’autrui.
Quand on fouine dans les affaires des autres, il n'en ressort jamais rien de bon.
Elles avaient toutes deux tenté de forger une sorte d'amitié, favorisée par le fait qu'elles étaient presque du même âge, mais contrariée par leur statut social trop différent, l'une étant presque en bas de l'échelle, et l'autre presque en haut. C'était comme si leurs mains se tendaient l'une vers l'autre sans pouvoir se toucher, à l'image de la fresque montrant Dieu et l'Homme sur le plafond de la chapelle Sixtine que Louisa avait vue dans un livre d'art.
Elle se mouvait lentement, mais avec grâce, et d'un geste plein de délicatesse, elle désigna ses bagages posés dans le grand hall, comme s'il s'agissait d'une sorte de fardeau métaphysique dont quelqu'un d'autre devait se charger. Dans ce simple geste, il y avait aussi l'assurance d'une femme à qui l'on a jamais demandé de porter rien de plus lourd ou de moins glorieux qu'un diamant à son doigt.
Tout comme on ne peut repeindre une seule pièce dans une maison sans qu'aussitôt les autres semblent plus miteuses, une nouvelle robe menait à de nouveaux escarpins, sacs, manteaux de soirée, foulards, chemise de nuit, lingerie, jusqu'à changer le fond de toute la garde-robe.
Quand la guerre éclata, ils y virent l'occasion de manger à leur faim et d'avoir un toit sur leurs têtes. Pauvres gars...Quels idiots nous étions, tous !
Serait-il possible de boire un verre ? Après tout, il est 6 heures du soir quelque part dans le monde.
Ce jour-là, lady Redesdale, en tant que fondatrice et présidente, recevait à déjeuner le comité du Women's institute d'Asthall et Swinbrook, un évènement un peu trop fréquent aux yeux de Mme Stobie. La cuisinière se plaignait haut et fort que ces dames s'occupaient peut-être de bonnes œuvres , mais qu'en attendant c'était elle qui se " tapait tout le boulot", sans parler du trifle, un dessert qui exigeait des heures de préparation.
(...), tout changeait : à Londres comme à Paris, les choses évoluaient. Où qu'elle porte le regard, elle voyait des femmes élégantes aller et venir d'un air et d'un pas décidés. Les journaux parlaient d'abondance de femmes qui avaient atteint des niveaux d'études universitaires impressionnants, faisaient de grandes découvertes scientifiques, exploraient de nouvelles contrées, pilotaient des avions. Sur les photos où elles apparaissaient, les cheveux coupés très courts, en pantalons bouffants, leurs visages radieux et confiants semblaient dire " Regardez-nous, tout ce que les hommes font, nous sommes capables de le faire !" Ce qui aurait dû l'inspirer la faisait se sentir au contraire d'autant plus pitoyable à ses yeux : tant d'opportunités s'offraient à elle, or elle s'était limitée à des emplois de domestiques et de couturière, comme si elle vivait à l'époque victorienne. Elle aurait pu échanger sa vie avec celle de sa grand-mère sans que personne ne voit la différence.
« Nous avons fait un rêve, ma chère, et maintenant il est terminé. Le monde vivait dans un rêve avant la guerre, mais il est réveillé et il lui a dit au revoir. Nous devons l’accepter. » (p. 263)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Cosy Crime
GabySensei
34 livres

Quand une lady enquête
Candice42
13 livres
Auteurs proches de Jessica Fellowes
Lecteurs de Jessica Fellowes (709)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quizz sur le livre de Philippe Grimbert : un secret
Qu'est-ce que le personnage principal s'est inventé ?
un ami
un frère
un animal de compagnie
un père
5 questions
29 lecteurs ont répondu
Thème : Un secret de
Philippe GrimbertCréer un quiz sur cet auteur29 lecteurs ont répondu