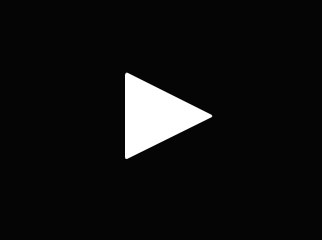Nationalité : France
Né(e) le : 18/03/1971
Né(e) le : 18/03/1971
Biographie :
Juan Asensio, né le 18 mars 1971 est un critique et rédacteur pour diverses revues (L'Atelier du roman, Nunc, La Sœur de l'Ange, (feu-)Cancer !, (feu-)Salamandra, Liberté politique, Contrelittérature, Les provinciales, etc.), est l’auteur d’un ouvrage sur George Steiner, La Parole souffle sur notre poussière (L’Harmattan, 2001), d'un recueil d'études sur la littérature et le Mal intitulé La Littérature à contre-nuit (A Contrario, 2005; réédition Sulliver, 2007), d'un recueil de textes de critique littéraire, La Critique meurt jeune (Le Rocher, 2006) et de Maudit soit Andreas Werckmeister ! qui a paru aux éditions de La Nuit.
Son dernier livre, La Chanson d'amour de Judas Iscariote, a été édité par le Cerf en 2010.
Il a en outre participé au Cahier de l’Herne sur George Steiner et aux Dossiers H consacrés à Pierre Boutang et Joseph de Maistre.
Enfin, signalons plusieurs articles sur l'œuvre de Georges Bernanos parus ou à paraître dans les Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève (aux éditions Minard).
Son site internet, Stalker, est sous-titré Dissection du cadavre de la littérature.
+ Voir plusJuan Asensio, né le 18 mars 1971 est un critique et rédacteur pour diverses revues (L'Atelier du roman, Nunc, La Sœur de l'Ange, (feu-)Cancer !, (feu-)Salamandra, Liberté politique, Contrelittérature, Les provinciales, etc.), est l’auteur d’un ouvrage sur George Steiner, La Parole souffle sur notre poussière (L’Harmattan, 2001), d'un recueil d'études sur la littérature et le Mal intitulé La Littérature à contre-nuit (A Contrario, 2005; réédition Sulliver, 2007), d'un recueil de textes de critique littéraire, La Critique meurt jeune (Le Rocher, 2006) et de Maudit soit Andreas Werckmeister ! qui a paru aux éditions de La Nuit.
Son dernier livre, La Chanson d'amour de Judas Iscariote, a été édité par le Cerf en 2010.
Il a en outre participé au Cahier de l’Herne sur George Steiner et aux Dossiers H consacrés à Pierre Boutang et Joseph de Maistre.
Enfin, signalons plusieurs articles sur l'œuvre de Georges Bernanos parus ou à paraître dans les Études bernanosiennes dirigées par Michel Estève (aux éditions Minard).
Son site internet, Stalker, est sous-titré Dissection du cadavre de la littérature.
Source : http://stalker.hautetfort.com/
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Podcasts (1)
Citations et extraits (55)
Voir plus
Ajouter une citation
Écoutez-moi, voulez-vous que je les redise pour vous seuls, ces mots qui trottent dans mon crâne comme des bêtes de la nuit, tendez donc l'oreille dans ce cas, plus près voyons, plus près, de quoi avez-vous peur, regardez-moi, approchez-vous de moi, et regardez maintenant ces femmes et ces hommes qui n'en sont point, qui se taisent, qui ferment leurs yeux, leur bouche et leurs oreilles, regardez ces femmes et ces hommes qui en me jugeant, refusent de se juger, comme c'est facile n'est-ce pas ? Mon procès, mon jugement disent-ils en roulant des yeux, l'honneur retrouvé, le sang lavé et tant d'autres mensonges, la vérité qui sortira de mes entrailles éclatées et les tirera, croient-ils, vers la lumière la plus pure, c'est bien évidemment faux et, se trompant, sachant qu'ils se trompent, ils n'ont qu'une seule hâte, en finir avec l'accusation bien vivante que je représente à leurs yeux, cacher le scandale, arracher de ma bouche cette maudite langue qui n'en finit pas de remuer, c'est pourquoi ils me regardent, ils ne me voient pas car, s'ils me regardaient, ils me verraient et se verraient immédiatement, eux, ils m'entendent mais ne m'écoutent pas car, s'ils m'écoutaient, ils me verraient et écouteraient les mots qui ne demandent qu'à couler dans leurs veines vides, la foi est affaire d'oreille n'est-ce pas, c'est pour cela qu'ils refusent de m'écouter car, s'ils m'écoutaient, ils auraient la foi.
22
Les plus anciens rêves du langage
Voyons : à peine sorti de sa matrice, le mot (n'importe lequel), c'est déjà trop tard !, tombe dans notre
demeure, patauge dans le marais de l'inévitable succion, dans le risible hic et nunc de la Chute, dans la
marne pourrissante qui l'avale goulûment et le recrache, comme tomberait — et non plus viendrait —
au monde le nouveau-né encore tout recouvert du liquide primordial lubrifiant le forceps ; alors, elle
n'est plus la même, cette parole-enfant mystérieusement destituée même si rien, absolument rien n'a pu
l'avertir du changement, même si rien ne la différencie de ce qu'elle était l'instant d'avant, de ce qu'elle
continue d'être, mais cette fois-ci sur le mode de l'apparence, sur le registre du simulacre, même si rien
ne l'alerte du changement, et surtout pas la fontanelle qui, comme le reste, refermée, a pris l'apparence
qui convenait à la duperie. Corrompu et sale, chassieux et dégouttant le jus poisseux du... Péché ?
Faulkner le dit par l'un de ses personnages, bouche toute proche d'être pleine de terre, Addie : Je
pensais au péché comme à un vêtement qu'il nous faudrait enlever afin de modeler, d'adapter le sang
terrible à l'écho des mots sans vie, perdus là-haut dans les airs. Voici donc le langage qui s'affiche
dans ses plus ordes atours : seul Dieu le connaît nu, vierge, primordial, inaltéré, divin, mais inaudible
pour l'homme, improféré, improférable, absent (Dieu ou le tout petit enfant ? L'un et l'autre partagent
en effet cette joie silencieuse face au mot qui gronde et luit comme une évidence inaltérable, nette de
toute insertion dans la trame de la causalité, pur événement dont l'échéance n'est rien d'assignable).
Autant dire que le langage n'est rien d'étant, puisqu'il est roulé dans le parchemin de l'innocence,
disparu un instant après sa venue au monde, plus bref qu'un éclair, invisible tant que le paletot du mal
n'a pas recouvert sa carne ladre, et alors, quel éclair que cette langue ruisselante de sang et visible
comme un poteau criard, planté sur le crâne d'un Dieu ! Autant dire aussi que l'homme n'est
certainement pas son gardien : s'il s'en trouvait un capable de devenir le berger du Rien, celui-là ne
mériterait même pas qu'un mouton lui crache au visage. Mais j'ai presque oublié que le Rien, chez le
théologien-parodiste, est le synonyme le plus convenable de l'Etre, et que les pâtres, invisibles,
habitent au-delà des champs de notre terre dévastée, comme des idoles d'arrière-monde !
Est-ce donc cela ? Le secret, cette patine qui ronge lentement l'ossature poreuse du langage, qui
cependant est inexistant sans elle, comme une photographie dont la lumière n'aurait pas été fixée par le
bain acide de la révélation ? Y a-t-il un secret, inapparent parce qu'il est partout présent et visible,
comme dans le conte du Phénix de Borges, ne pouvant s'accrocher à rien d'autre qu'à cela qui
justement n'a d'existence — la parole — qu'à condition d'être voilée, c'est-à-dire : présentable ? JeanLouis Chrétien, dans un très beau livre, écrit ces phrases, disant du secret qu'il n'équivaut pas pour
autant à la confusion de l'informe et de l'inconsistant. C'est précisément sa clarté qui interdit de le
thématiser, car cette clarté nous entoure et nous enveloppe. Elle rayonne autour de nous en nousmêmes, nous ne lui sommes pas étrangers. La lueur du secret n'éclaire pas seulement le secret luimême, elle nous éclaire avec lui, et nous inclut de quelque façon en lui. Penser le secret, c'est penser
aussi cette essentielle inclusion solidaire de sa clarté même. Le rayonnement par lequel le secret nous
inclut en lui est à la fois ce qui le rassemble en son éclat et ce qui l'accomplit comme secret. Nous ne
sommes pas l'origine du secret, ni le secret lui-même, et pourtant sa lueur ne serait pas sans nous, ni
sa flamme si déchirante si notre cœur n'en était pas blessé.6
Si nous ne pouvons rejoindre le lieu énigmatique d'où cette condamnation a été prononcée (encore une
fois, par qui ?, par quoi ?, pourquoi ?), puisque, le rejoindre, retrouver en somme le mot premier
prononcé par l'homme, ou ce qui s'approche le plus — jusqu'à lui ressembler troublement, en énigme
et comme au travers d'un miroir — de ce que nous appelons un homme, faire cela, réaliser une telle
prouesse, revenir près de la source qui, pourtant cristalline et pure, contient déjà le germe
insoupçonnable de la contamination future, s'étendant au reste des langues du monde, comme un
fleuve infecté se jette à l'océan qu'il polluera, parvenir à faire cela, s'approcher d'une telle folie, serait
tenter l'absurde opération par laquelle l'homme prétendrait se débarrasser du langage, en le considérant
comme une chose extérieure sur laquelle il aurait pouvoir, non seulement d'étude, mais de
régénération, si la réalisation d'une telle tâche demeure encore hors de notre portée, et le demeurera
sans doute à jamais7
, s'il nous est donc impossible de sortir du langage pour expérimenter sur lui du
dehors (comme Foucault a tenté de le faire8
), s'il nous est absolument impossible, je l'ai suffisamment
répété, de ressaisir par une œuvre l'origine, car c'est [son] propre, comme Maurice Blanchot l'écrit
d'être toujours voilée par ce dont elle est l'origine, au moins nous reste-t-il quelque vestige de cet
événement primordial, quelque trace, une trace et une preuve de ce qui s'est passé jadis, dans des
temps immémoriaux, prodigieusement reculés, un vestige énigmatique et ambigu. Encore une fois,
l'exemple emprunté au vocabulaire de l'astrophysique va nous offrir une aide précieuse, cette
discipline affirmant qu'un fond de rayonnement cosmique (donnée cosmologique qui nous permet de
retrouver la très ancienne idée pythagoricienne d'une mélodie des sphères, d'une musique de l'univers,
invariable et éternelle) subsiste, immanent et immuable, qui est comme la signature de sa naissance,
dans quelque coin que l'on observe — plutôt, que l'on écoute —, dans quelque direction de l'Univers
que l'on dirige une de ces gigantesques oreilles électroniques qui captent ce premier chant du Monde.
La métaphore peut être filée car, s'il est vrai que regarder le plus loin possible dans la texture du
Cosmos, c'est s'enfoncer proportionnellement dans celle du passé, alors je crois que ce domaine
difficile, peut-être même aporétique, de la linguistique10, entrouvre devant Steiner les portes qui
gardent des terres inconnues et peut-être illimitées, depuis longtemps occultées derrière le mur du
temps, lequel, sur ces terres pré-historiques, comme un voile d'effroi sacré, a apposé le sceau de
l'oubli, le manteau de la nuit et de la terreur. Ici, notre rayonnement est celui qui va parcourir comme
une onde imperceptible, un émoi sacré, une rumeur inquiétante, une vague chuchotante, l'étendue
multicolore des langues, les creuser en profondeur, parfois, les agiter d'une fièvre sourde et persistante,
d'une brusque remontée, d'une résurgence d'un quelque chose que l'on croyait disparu, aboli : Les
archétypes, les Ur-mythes, dont nous devinons qu'ils naissent du no man's land (parce que d'une terre
commune) juste à l'extérieur de la conscience lucide et de la volonté, sont des vestiges, des formes
ataviques de rêves avant le langage. Le langage est, en un sens, un effort pour interpréter, pour
raconter des rêves plus anciens que lui. Mais comme il raconte ses rêves, l'homo sapiens s'enfonce
dans la contradiction : l'animal ne le comprend plus, et à chaque acte narrativo-linguistique,
l'individuation, la cassure entre le moi et la communication d'images partagées se creuse. Racontés,
interprétés, les rêves sont passés de la vérité dans l'histoire. Deux choses seulement nous rappellent
leur source organique : la résonance et la signification au-delà de la conceptualisation qui est le
propre du mythe (Bab, 239).
Comme l'écrit Agamben : Le langage maintient pareillement l'homme dans son ban, car, en tant qu'être
parlant, l'homme est toujours déjà entré en lui sans pouvoir en rendre compte. Tout ce que l'on présuppose par
rapport au langage (dans les formes d'un non-linguistique, d'un ineffable, etc.) n'est précisément rien d'autre
qu'un présupposé du langage, qui comme tel reste en relation avec lui précisément en tant qu'il en est exclu.
Mallarmé exprimait cette nature auto-présupposante du langage quand il écrivait, à l'aide d'une formule
hégélienne, que le «logos est un principe qui se développe par la négation de tout principe». En tant que forme
pure de la relation, en effet, le langage […] se présuppose toujours déjà soi-même dans la figure d'un horsrelation, et il n'est pas possible d'entrer en relation ou de sortir de la relation avec ce qui appartient à la forme
même de la relation. Cela ne signifie pas que l'être parlant se voie fermer l'accès au non-linguistique, mais
seulement qu'il ne peut jamais l'atteindre dans la forme d'un présupposé hors-relation ou d'un ineffable ; mais il
le fait plutôt dans le langage lui-même (selon les termes de Benjamin, seule l'«élimination de l'indicible dans le
langage» peut conduire «à ce qui se refuse au mot»), Homo Sacer, p. 60 ; la citation de Benjamin provient des
Briefe, I, Francfort, 1966, p. 127.
En dénonçant la question fausse des origines comme relevant d'une anthropologie transcendantale : voir par
exemple son Archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 54. Jacques Derrida quant à lui, critique de l'intérieur
cette même tradition métaphysique, à ses yeux d'essence logocentrique, qu'il continue de déstructurer depuis son
ouvrage fondamental, La Dissémination, Seuil, 1972.
L'espace littéraire, Gallimard, coll. “Idées”, 1955, p. 318.
Puisqu'en somme il tente d'analyser cela qui défie toute analyse verbale : Nous ne pouvons pas, si ce n'est de
matière métaphorique, utiliser des mots pour poser des questions relatives à ce qui précède peut-être les mots
(Ent, pp. 79-80).
Les plus anciens rêves du langage
Voyons : à peine sorti de sa matrice, le mot (n'importe lequel), c'est déjà trop tard !, tombe dans notre
demeure, patauge dans le marais de l'inévitable succion, dans le risible hic et nunc de la Chute, dans la
marne pourrissante qui l'avale goulûment et le recrache, comme tomberait — et non plus viendrait —
au monde le nouveau-né encore tout recouvert du liquide primordial lubrifiant le forceps ; alors, elle
n'est plus la même, cette parole-enfant mystérieusement destituée même si rien, absolument rien n'a pu
l'avertir du changement, même si rien ne la différencie de ce qu'elle était l'instant d'avant, de ce qu'elle
continue d'être, mais cette fois-ci sur le mode de l'apparence, sur le registre du simulacre, même si rien
ne l'alerte du changement, et surtout pas la fontanelle qui, comme le reste, refermée, a pris l'apparence
qui convenait à la duperie. Corrompu et sale, chassieux et dégouttant le jus poisseux du... Péché ?
Faulkner le dit par l'un de ses personnages, bouche toute proche d'être pleine de terre, Addie : Je
pensais au péché comme à un vêtement qu'il nous faudrait enlever afin de modeler, d'adapter le sang
terrible à l'écho des mots sans vie, perdus là-haut dans les airs. Voici donc le langage qui s'affiche
dans ses plus ordes atours : seul Dieu le connaît nu, vierge, primordial, inaltéré, divin, mais inaudible
pour l'homme, improféré, improférable, absent (Dieu ou le tout petit enfant ? L'un et l'autre partagent
en effet cette joie silencieuse face au mot qui gronde et luit comme une évidence inaltérable, nette de
toute insertion dans la trame de la causalité, pur événement dont l'échéance n'est rien d'assignable).
Autant dire que le langage n'est rien d'étant, puisqu'il est roulé dans le parchemin de l'innocence,
disparu un instant après sa venue au monde, plus bref qu'un éclair, invisible tant que le paletot du mal
n'a pas recouvert sa carne ladre, et alors, quel éclair que cette langue ruisselante de sang et visible
comme un poteau criard, planté sur le crâne d'un Dieu ! Autant dire aussi que l'homme n'est
certainement pas son gardien : s'il s'en trouvait un capable de devenir le berger du Rien, celui-là ne
mériterait même pas qu'un mouton lui crache au visage. Mais j'ai presque oublié que le Rien, chez le
théologien-parodiste, est le synonyme le plus convenable de l'Etre, et que les pâtres, invisibles,
habitent au-delà des champs de notre terre dévastée, comme des idoles d'arrière-monde !
Est-ce donc cela ? Le secret, cette patine qui ronge lentement l'ossature poreuse du langage, qui
cependant est inexistant sans elle, comme une photographie dont la lumière n'aurait pas été fixée par le
bain acide de la révélation ? Y a-t-il un secret, inapparent parce qu'il est partout présent et visible,
comme dans le conte du Phénix de Borges, ne pouvant s'accrocher à rien d'autre qu'à cela qui
justement n'a d'existence — la parole — qu'à condition d'être voilée, c'est-à-dire : présentable ? JeanLouis Chrétien, dans un très beau livre, écrit ces phrases, disant du secret qu'il n'équivaut pas pour
autant à la confusion de l'informe et de l'inconsistant. C'est précisément sa clarté qui interdit de le
thématiser, car cette clarté nous entoure et nous enveloppe. Elle rayonne autour de nous en nousmêmes, nous ne lui sommes pas étrangers. La lueur du secret n'éclaire pas seulement le secret luimême, elle nous éclaire avec lui, et nous inclut de quelque façon en lui. Penser le secret, c'est penser
aussi cette essentielle inclusion solidaire de sa clarté même. Le rayonnement par lequel le secret nous
inclut en lui est à la fois ce qui le rassemble en son éclat et ce qui l'accomplit comme secret. Nous ne
sommes pas l'origine du secret, ni le secret lui-même, et pourtant sa lueur ne serait pas sans nous, ni
sa flamme si déchirante si notre cœur n'en était pas blessé.6
Si nous ne pouvons rejoindre le lieu énigmatique d'où cette condamnation a été prononcée (encore une
fois, par qui ?, par quoi ?, pourquoi ?), puisque, le rejoindre, retrouver en somme le mot premier
prononcé par l'homme, ou ce qui s'approche le plus — jusqu'à lui ressembler troublement, en énigme
et comme au travers d'un miroir — de ce que nous appelons un homme, faire cela, réaliser une telle
prouesse, revenir près de la source qui, pourtant cristalline et pure, contient déjà le germe
insoupçonnable de la contamination future, s'étendant au reste des langues du monde, comme un
fleuve infecté se jette à l'océan qu'il polluera, parvenir à faire cela, s'approcher d'une telle folie, serait
tenter l'absurde opération par laquelle l'homme prétendrait se débarrasser du langage, en le considérant
comme une chose extérieure sur laquelle il aurait pouvoir, non seulement d'étude, mais de
régénération, si la réalisation d'une telle tâche demeure encore hors de notre portée, et le demeurera
sans doute à jamais7
, s'il nous est donc impossible de sortir du langage pour expérimenter sur lui du
dehors (comme Foucault a tenté de le faire8
), s'il nous est absolument impossible, je l'ai suffisamment
répété, de ressaisir par une œuvre l'origine, car c'est [son] propre, comme Maurice Blanchot l'écrit
d'être toujours voilée par ce dont elle est l'origine, au moins nous reste-t-il quelque vestige de cet
événement primordial, quelque trace, une trace et une preuve de ce qui s'est passé jadis, dans des
temps immémoriaux, prodigieusement reculés, un vestige énigmatique et ambigu. Encore une fois,
l'exemple emprunté au vocabulaire de l'astrophysique va nous offrir une aide précieuse, cette
discipline affirmant qu'un fond de rayonnement cosmique (donnée cosmologique qui nous permet de
retrouver la très ancienne idée pythagoricienne d'une mélodie des sphères, d'une musique de l'univers,
invariable et éternelle) subsiste, immanent et immuable, qui est comme la signature de sa naissance,
dans quelque coin que l'on observe — plutôt, que l'on écoute —, dans quelque direction de l'Univers
que l'on dirige une de ces gigantesques oreilles électroniques qui captent ce premier chant du Monde.
La métaphore peut être filée car, s'il est vrai que regarder le plus loin possible dans la texture du
Cosmos, c'est s'enfoncer proportionnellement dans celle du passé, alors je crois que ce domaine
difficile, peut-être même aporétique, de la linguistique10, entrouvre devant Steiner les portes qui
gardent des terres inconnues et peut-être illimitées, depuis longtemps occultées derrière le mur du
temps, lequel, sur ces terres pré-historiques, comme un voile d'effroi sacré, a apposé le sceau de
l'oubli, le manteau de la nuit et de la terreur. Ici, notre rayonnement est celui qui va parcourir comme
une onde imperceptible, un émoi sacré, une rumeur inquiétante, une vague chuchotante, l'étendue
multicolore des langues, les creuser en profondeur, parfois, les agiter d'une fièvre sourde et persistante,
d'une brusque remontée, d'une résurgence d'un quelque chose que l'on croyait disparu, aboli : Les
archétypes, les Ur-mythes, dont nous devinons qu'ils naissent du no man's land (parce que d'une terre
commune) juste à l'extérieur de la conscience lucide et de la volonté, sont des vestiges, des formes
ataviques de rêves avant le langage. Le langage est, en un sens, un effort pour interpréter, pour
raconter des rêves plus anciens que lui. Mais comme il raconte ses rêves, l'homo sapiens s'enfonce
dans la contradiction : l'animal ne le comprend plus, et à chaque acte narrativo-linguistique,
l'individuation, la cassure entre le moi et la communication d'images partagées se creuse. Racontés,
interprétés, les rêves sont passés de la vérité dans l'histoire. Deux choses seulement nous rappellent
leur source organique : la résonance et la signification au-delà de la conceptualisation qui est le
propre du mythe (Bab, 239).
Comme l'écrit Agamben : Le langage maintient pareillement l'homme dans son ban, car, en tant qu'être
parlant, l'homme est toujours déjà entré en lui sans pouvoir en rendre compte. Tout ce que l'on présuppose par
rapport au langage (dans les formes d'un non-linguistique, d'un ineffable, etc.) n'est précisément rien d'autre
qu'un présupposé du langage, qui comme tel reste en relation avec lui précisément en tant qu'il en est exclu.
Mallarmé exprimait cette nature auto-présupposante du langage quand il écrivait, à l'aide d'une formule
hégélienne, que le «logos est un principe qui se développe par la négation de tout principe». En tant que forme
pure de la relation, en effet, le langage […] se présuppose toujours déjà soi-même dans la figure d'un horsrelation, et il n'est pas possible d'entrer en relation ou de sortir de la relation avec ce qui appartient à la forme
même de la relation. Cela ne signifie pas que l'être parlant se voie fermer l'accès au non-linguistique, mais
seulement qu'il ne peut jamais l'atteindre dans la forme d'un présupposé hors-relation ou d'un ineffable ; mais il
le fait plutôt dans le langage lui-même (selon les termes de Benjamin, seule l'«élimination de l'indicible dans le
langage» peut conduire «à ce qui se refuse au mot»), Homo Sacer, p. 60 ; la citation de Benjamin provient des
Briefe, I, Francfort, 1966, p. 127.
En dénonçant la question fausse des origines comme relevant d'une anthropologie transcendantale : voir par
exemple son Archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 54. Jacques Derrida quant à lui, critique de l'intérieur
cette même tradition métaphysique, à ses yeux d'essence logocentrique, qu'il continue de déstructurer depuis son
ouvrage fondamental, La Dissémination, Seuil, 1972.
L'espace littéraire, Gallimard, coll. “Idées”, 1955, p. 318.
Puisqu'en somme il tente d'analyser cela qui défie toute analyse verbale : Nous ne pouvons pas, si ce n'est de
matière métaphorique, utiliser des mots pour poser des questions relatives à ce qui précède peut-être les mots
(Ent, pp. 79-80).
31
Quel aveu ! Un livre entier, un livre entier qui reprend pour titre provocateur — provocation par et
pour l'esprit — le sens consacré par les Pères de l'Église (puis, significativement, celui de l'expression
théologique : de propagande théologique s'adressant aux réformés, consacrée par la relation que
Guillaume Postel fit dans son Summopere26 : “reale presence”, puis “réelle présence”, désignait
spécifiquement la présence du Christ dans l'Eucharistie), un livre entier, un livre entier donc pour
déboucher sur une circonstancielle de manière dont l'assise verbale (le Verbe, justement, c'est-à-dire la
certitude inébranlable de la présence) est absente ! Nous devons lire comme si... Comme si Dieu
n'avait pas déserté notre monde, comme si nous ne l'avions pas chassé de sa création, comme si nous
n'avions pas rasé puis oublié le lieu, ce haut-lieu de réelle présence (cette Bêt El, ou maison de Dieu),
que consacra Jacob lorsque, au réveil du songe qui lui avait fait entrevoir la splendeur divine (Genèse,
28. 16-19), il décida d'en marquer l'emplacement par une pierre qu'il dressa comme une stèle,
s'exclamant, En vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas ! Comme s'il était impossible que le
génie de l'artiste fouaille plus profondément encore qu'il ne l'a fait avec Kafka ou Beckett l'âme
désertée — mais parler d'une âme désertée n'est-ce pas écrire sereinement une absurdité ? — bien qu'étrangement nostalgique de Celui qui n'est plus, comme s'il était impossible encore qu'il creuse plus
profondément l'âme vide des hommes. C'est que l'absence même de Dieu est une pure densité, est
encore une, est encore la présence, dans un prolongement d'une pensée de Carlyle, non-présence
conduite dans les ténèbres de la non-preuve, de l'existence, non pas déficiente, mais enveloppée dans
les ténèbres : Il n'est pas de pensée vraie germée dans le cœur de l'homme qui n'ait enfantée une vision
authentique et sincère de la réalité divine, qui n'ait en elle une vérité essentielle ; et cette vérité résiste
à tous les changements, à tous les bouleversements : elle porte le sceau de l'Éternité, elle est pour
toujours notre bien à tous.27 Steiner, lui, renverse la proposition — au moins superficiellement — et
ne craint pas d'affirmer, établissant au passage une comparaison ardue entre “l'être-non-là” présent
dans l'horreur des camps et les œuvres phares de la littérature contemporaine, que : La densité de
l'absence de Dieu, le surplomb de la présence dans cette absence, n'est pas un tour dialectique vide de
sens. [...] C'est cet “être-là” absent, à l'œuvre dans les camps de la mort, dans la destruction de la
planète, que l'on trouve dans les textes majeurs de notre temps (Rp, 272).
Il faut donc lire comme si...28 Comme si le poète Paul Celan, bouche d'or d'une horreur chantée
jusqu'au mutisme crispé des morts29, n'avait pas fixé le soleil du Mal, le soleil noir de Mandelstam,
contemplé naguère par Georg Trakl, Nerval et Lautréamont, avec cependant plus d'irréparable beauté
que nul autre avant lui, comme si le langage était capable d'affirmer autre chose que sa propre
immanence irrécusable, comme si par exemple il était capable d'affirmer — ou d'infirmer, c'est
équivalent — l'existence de Dieu, puisque : Dans la république des mots, une légitimité égale
s'attache à la conviction que la prédication de l'existence de Dieu est à la source même du langage
humain et en constitue la dignitas finale ; et à l'idée des positivistes logiques, selon qui cette
prédication est du même ordre que la poésie du non-sens (Rp, 81-82). Steiner sait tout cela bien mieux
que moi ; mais il fait comme si, selon l'étonnante opiniâtreté de ces croyants à la charnière du doute et
de la prière dont il reconnaît faire partie (une seule fois !, écrivant dans ses Dialogues (128-129) avec
Boutang : pour un Juif qui comme moi cherche, qui est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, ce
qui est la pire des situations).
Plus de deux cents pages, impatiemment (car la soif de Steiner, sous l'apparence d'une surface étale,
bouillonne d'une impatience messianique !) consacrées à tenter de fonder l'appréhension nouvelle —
nouvelle parce qu'elle se pose à l'esprit de nos contemporains de façon radicale — de la présence de
l'œuvre d'art, plus de deux cents pages séparent les deux moments du constat terrible : d'abord la
certitude que notre époque est celle d'une (non : de la) postface, ensuite celle qui nous intime de faire
comme si. Dans un de ses articles qui n'a pas été traduit en français, le commandement de cet El Hadj
privé de Dieu, l'impératif catégorique de ce Kant qui ne peut se résoudre à ne jamais pouvoir atteindre
la chose en soi, est dramatiquement souligné par le rejet, et symboliquement cerné par le blanc de la
page qu'il est chargé de féconder vainement :
Deux cents pages séparent ces deux moments de Réelles présences, qui dans le creux de leur athanor
ont tenté l'opération alchimique impossible, le Grand Œuvre chimérique qui veut parvenir à la
conception de l'homoncule, ce surgeon lointain des vieux mythes de la Kabbale concernant la création
du Golem. Je parle d'échec : c'est que le travail de Steiner, qui, n'étant pas pure création se suffisant à
elle-même, mais commentaire parasite, ne peut prétendre à la fondation d'une quelconque estance.
Mais aussi, c'est que, en élève surdoué du maître danois, l'auteur a compris qu'une pareille fondation
ne pouvait être réalisée que par le travail patient de son lecteur, lui-même pariant sur l'horizon
transcendantal sur lequel se découpe le tableau peint, depuis lequel murmure l'œuvre musicale, sur
lequel écrit l'œuvre littéraire. C'est dans cet espace de la communication indirecte que réside le
tragique, non seulement propre à tout commentaire qui n'est jamais qu'une image dans le tapis, selon
la métaphore que choisit James pour titre d'une de ses nouvelles énigmatiques, mais aussi, sans aucun
doute, à toute œuvre d'art. Dès lors s'éclaire l'importance primordiale de la lecture bien faite, comme
Péguy la nommait, de la lecture qui parie sur le sens, même caché et non obvie, même raillé ou attaqué
de toutes parts ; dès lors comprend-on que la véritable lecture est appréhension d'un sens et d'une
présence qui, comme dans l'icône, invite au recueillement, assure la douce certitude que l'œuvre brille
d'un éclat qui ne saurait être celui du reflet dans lequel se mire (pour y tomber comme Narcisse) le
mauvais lecteur derridien. Car, lorsque nous lisons vraiment, lorsque l'expérience convoquée est celle
de la signification, nous faisons comme si le texte (le morceau de musique, l'œuvre picturale) incarnait
[l'auteur souligne le mot dans son acception religieuse, liturgique] une real presence of significant
being, une réelle présence et un être signifiant qui demeurent irréductibles à n'importe quelle tentative
de déconstruction analytique, singularité où la forme et le fond s'unissent indiciblement pour signifier,
bien plus qu'une tautologie, l'au-delà d'une confiance qui fonde et certifie l'existence même de celui
qui contemple l'œuvre traversée par son âme.
Quel aveu ! Un livre entier, un livre entier qui reprend pour titre provocateur — provocation par et
pour l'esprit — le sens consacré par les Pères de l'Église (puis, significativement, celui de l'expression
théologique : de propagande théologique s'adressant aux réformés, consacrée par la relation que
Guillaume Postel fit dans son Summopere26 : “reale presence”, puis “réelle présence”, désignait
spécifiquement la présence du Christ dans l'Eucharistie), un livre entier, un livre entier donc pour
déboucher sur une circonstancielle de manière dont l'assise verbale (le Verbe, justement, c'est-à-dire la
certitude inébranlable de la présence) est absente ! Nous devons lire comme si... Comme si Dieu
n'avait pas déserté notre monde, comme si nous ne l'avions pas chassé de sa création, comme si nous
n'avions pas rasé puis oublié le lieu, ce haut-lieu de réelle présence (cette Bêt El, ou maison de Dieu),
que consacra Jacob lorsque, au réveil du songe qui lui avait fait entrevoir la splendeur divine (Genèse,
28. 16-19), il décida d'en marquer l'emplacement par une pierre qu'il dressa comme une stèle,
s'exclamant, En vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas ! Comme s'il était impossible que le
génie de l'artiste fouaille plus profondément encore qu'il ne l'a fait avec Kafka ou Beckett l'âme
désertée — mais parler d'une âme désertée n'est-ce pas écrire sereinement une absurdité ? — bien qu'étrangement nostalgique de Celui qui n'est plus, comme s'il était impossible encore qu'il creuse plus
profondément l'âme vide des hommes. C'est que l'absence même de Dieu est une pure densité, est
encore une, est encore la présence, dans un prolongement d'une pensée de Carlyle, non-présence
conduite dans les ténèbres de la non-preuve, de l'existence, non pas déficiente, mais enveloppée dans
les ténèbres : Il n'est pas de pensée vraie germée dans le cœur de l'homme qui n'ait enfantée une vision
authentique et sincère de la réalité divine, qui n'ait en elle une vérité essentielle ; et cette vérité résiste
à tous les changements, à tous les bouleversements : elle porte le sceau de l'Éternité, elle est pour
toujours notre bien à tous.27 Steiner, lui, renverse la proposition — au moins superficiellement — et
ne craint pas d'affirmer, établissant au passage une comparaison ardue entre “l'être-non-là” présent
dans l'horreur des camps et les œuvres phares de la littérature contemporaine, que : La densité de
l'absence de Dieu, le surplomb de la présence dans cette absence, n'est pas un tour dialectique vide de
sens. [...] C'est cet “être-là” absent, à l'œuvre dans les camps de la mort, dans la destruction de la
planète, que l'on trouve dans les textes majeurs de notre temps (Rp, 272).
Il faut donc lire comme si...28 Comme si le poète Paul Celan, bouche d'or d'une horreur chantée
jusqu'au mutisme crispé des morts29, n'avait pas fixé le soleil du Mal, le soleil noir de Mandelstam,
contemplé naguère par Georg Trakl, Nerval et Lautréamont, avec cependant plus d'irréparable beauté
que nul autre avant lui, comme si le langage était capable d'affirmer autre chose que sa propre
immanence irrécusable, comme si par exemple il était capable d'affirmer — ou d'infirmer, c'est
équivalent — l'existence de Dieu, puisque : Dans la république des mots, une légitimité égale
s'attache à la conviction que la prédication de l'existence de Dieu est à la source même du langage
humain et en constitue la dignitas finale ; et à l'idée des positivistes logiques, selon qui cette
prédication est du même ordre que la poésie du non-sens (Rp, 81-82). Steiner sait tout cela bien mieux
que moi ; mais il fait comme si, selon l'étonnante opiniâtreté de ces croyants à la charnière du doute et
de la prière dont il reconnaît faire partie (une seule fois !, écrivant dans ses Dialogues (128-129) avec
Boutang : pour un Juif qui comme moi cherche, qui est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, ce
qui est la pire des situations).
Plus de deux cents pages, impatiemment (car la soif de Steiner, sous l'apparence d'une surface étale,
bouillonne d'une impatience messianique !) consacrées à tenter de fonder l'appréhension nouvelle —
nouvelle parce qu'elle se pose à l'esprit de nos contemporains de façon radicale — de la présence de
l'œuvre d'art, plus de deux cents pages séparent les deux moments du constat terrible : d'abord la
certitude que notre époque est celle d'une (non : de la) postface, ensuite celle qui nous intime de faire
comme si. Dans un de ses articles qui n'a pas été traduit en français, le commandement de cet El Hadj
privé de Dieu, l'impératif catégorique de ce Kant qui ne peut se résoudre à ne jamais pouvoir atteindre
la chose en soi, est dramatiquement souligné par le rejet, et symboliquement cerné par le blanc de la
page qu'il est chargé de féconder vainement :
Deux cents pages séparent ces deux moments de Réelles présences, qui dans le creux de leur athanor
ont tenté l'opération alchimique impossible, le Grand Œuvre chimérique qui veut parvenir à la
conception de l'homoncule, ce surgeon lointain des vieux mythes de la Kabbale concernant la création
du Golem. Je parle d'échec : c'est que le travail de Steiner, qui, n'étant pas pure création se suffisant à
elle-même, mais commentaire parasite, ne peut prétendre à la fondation d'une quelconque estance.
Mais aussi, c'est que, en élève surdoué du maître danois, l'auteur a compris qu'une pareille fondation
ne pouvait être réalisée que par le travail patient de son lecteur, lui-même pariant sur l'horizon
transcendantal sur lequel se découpe le tableau peint, depuis lequel murmure l'œuvre musicale, sur
lequel écrit l'œuvre littéraire. C'est dans cet espace de la communication indirecte que réside le
tragique, non seulement propre à tout commentaire qui n'est jamais qu'une image dans le tapis, selon
la métaphore que choisit James pour titre d'une de ses nouvelles énigmatiques, mais aussi, sans aucun
doute, à toute œuvre d'art. Dès lors s'éclaire l'importance primordiale de la lecture bien faite, comme
Péguy la nommait, de la lecture qui parie sur le sens, même caché et non obvie, même raillé ou attaqué
de toutes parts ; dès lors comprend-on que la véritable lecture est appréhension d'un sens et d'une
présence qui, comme dans l'icône, invite au recueillement, assure la douce certitude que l'œuvre brille
d'un éclat qui ne saurait être celui du reflet dans lequel se mire (pour y tomber comme Narcisse) le
mauvais lecteur derridien. Car, lorsque nous lisons vraiment, lorsque l'expérience convoquée est celle
de la signification, nous faisons comme si le texte (le morceau de musique, l'œuvre picturale) incarnait
[l'auteur souligne le mot dans son acception religieuse, liturgique] une real presence of significant
being, une réelle présence et un être signifiant qui demeurent irréductibles à n'importe quelle tentative
de déconstruction analytique, singularité où la forme et le fond s'unissent indiciblement pour signifier,
bien plus qu'une tautologie, l'au-delà d'une confiance qui fonde et certifie l'existence même de celui
qui contemple l'œuvre traversée par son âme.
17
On pensera alors sûrement, et on n'aura pas tort de le penser, que mon rôle, pris dans la grille de
parole tissée par de telles voix — une multitude de voix, parmi lesquelles certaines ont façonné, et
continuent à distance de façonner le visage hideux de notre époque —, est réduit à bien peu de chose,
peut-être même à rien de moins utile qu'un exercice de style de comparatiste, voué au silence final de
l'oubli. En effet. Et peut-être même ne suis-je rien d'autre, dans ces pages qui se veulent, dans la suite
de celles qu'écrivirent Cioran ou Charles Du Bos, un exercice d'admiration, peut-être ne suis-je rien
de plus que la navette filant courtoisement d'un bord à l'autre du métier magnifiquement tendu, sans
presque qu'aucun effort de volonté ne soit exigé d'elle : c'est qu'on ne demande à l'outil, à la navette
mêlant le fil de la trame à ceux de la chaîne, rien de plus que de filer droit, comme le petit bateau
qu'elle a été jadis, découvrant peut-être, dans l'écume de son sillon, dans la tension du câble qu'elle
tire derrière elle, quelque créature jusqu'alors inconnue, qu'elle ramènera sagement au port pour
exalter et dessiller l'étonnement des enfants. Dès lors, je l'ai dit, au rebours de la tendance actuelle de
la recherche, et parce que l'approche à découvert du mystère exige le plus extrême dépouillement (qui
n'est certes pas ce avec quoi les idiots le confondent : la simplification) ou, dans mon cas, le barda
incomplet équipant l'expéditionnaire profane, je me refuse à faire vœu de pauvreté ou de purge. Car,
si un seul jouet, même modeste et artisanal, suffit à la joie enfantine de celui dont le cœur n'a pas été
gâté par le prestige creux de la nouveauté perpétuelle et de l'incessante publicité, il me semble qu'une
multitude, et des plus scintillantes, convient encore mal au cœur fatigué et pervers de celui qui, comme
le héros de Musset, cet enfant du siècle écœuré de tout, avoue que plus rien n'émeut son esprit, que
son cœur est sec. De plus, ce sont les égouts et les réduits de saleté que l'on purge, non le savoir, qui
n'est jamais une épure glacée, sauf dans les mauvaises thèses.
C'est pour cette raison que l'on trouvera, dans les pages pourtant peu nombreuses de cet essai, une
multitude, une profusion chaotique, herbeuse et libre (disons : un peu anarchiste, n'est-ce pas ?) de
noms, comme autant d'archipels que ne relie entre eux aucun pont — c'est ainsi qu'Isaiah Berlin, dans
un de ses trop nombreux livres peu avare de multiples schématisations, caractérisait la prose déréglée
d'Hamann —, que les pédants s'amuseront peut-être à tracer, en réalignant la végétation touffue et
erratique selon le cordeau guindé du jardin à la française, mais que je me contente, pour ma part, de
jeter à la hâte et sans beaucoup de rigueur, certain que la parenté des idées ne saurait obéir qu'à la
seule ivresse stochastique de celui qui a énormément lu. Et puis, si tel était le cas, que m'importerait ?
Je suis en effet certain qu'il y a, qu'il doit y avoir plus qu'une affinité élective entre des œuvres
qu'inquiète la même question d'une transcendance du langage, transcendance pour le moins
paradoxale puisqu'elle n'hésite pas à sonder les profondeurs du Mal, espérant dans sa tentative folle
déboucher sur une lumière nouvelle, comme l'ultime cercle de l'Enfer de Dante communique avec le
ciel en creux du Purgatoire. Il y a, il doit y avoir plus que l'intérêt benoît de l'amateur en littérature
comparée pour réunir les exemples de Bernanos, de Trakl ou de Celan. Il y a, je crois, la volonté
d'analyser par quels détours souterrains ces auteurs ont dit, appelé et invoqué Dieu — non, c'est
encore trop : l'exigence de Dieu — dont ils fouaillaient la plaie vide. Il y a l'évidence, mille fois
répétée mais toujours raillée ou suspectée d'un pessimisme fasciné, que le Mal est la grande affaire de
notre siècle — celui dans lequel j'écris ces lignes, qui est encore, pour peu de jours, le vingtième —, et
le sera de celui, très certainement spirituel, mais avant tout criminel comme son père, qui s'ouvre sous
nos pas et nos yeux. Et puis, après tout, qu'importent les savantes raisons que je pourrais avancer ?
Ne suffit-il pas de dire que les livres sont les cœurs des hommes, embrouillés et contradictoires, mais
tous écrits d'après le Livre de Dieu selon Hugues de Saint-Victor, puisque nos cœurs multiples et
inconstants ont été façonnés à Son image unique et pérenne ? Ne suffit-il pas d'écrire que George
Steiner ne cesse de questionner le gouffre béant de l'horreur, et que le témoignage universel de la
littérature, de la peinture et de la musique, est le chemin le plus direct pour parvenir aux abords du
précipice ?
Quoi qu'il en soit de cette accumulation de noms presque jetés avec rage, j'affirme qu'elle-même est
un leurre. Trop de voix nous empêchent très certainement de nous écouter, ou même de nous entendre,
à moins qu'elles ne cherchent à signifier, comme par un retournement de la simplicité, qu'une
débauche sonore s'annule toujours en son contraire, et accède à quelque mystérieuse place où règne
le silence et la solitude de l'étendue vierge, blanche, débarrassée de toute parole trop évidente, de
toute théorie trop certaine et connue d'avance, là où Newton avoua s'être tenu à la fin de sa vie
extraordinaire, le murmure lointain du ressac contant au prodigieux génie les choses inouïes du grand
large. De ce lieu, si je l'atteignais, je ne pourrais plus rien dire, la parole m'étant devenue inutile et
pesante. Toutefois, pour ceux qui ne liraient que les introductions des ouvrages qu'ils sont censés
commenter et critiquer, je le dis une fois clairement, et je ne le redirai plus : à mes yeux, la première
originalité de George Steiner est qu'il tente de comprendre à quelle profondeur la déréliction du
langage signifie, non seulement la mort de Dieu dont il s'efforce de combattre, chez les tenanciers de
la nouvelle critique, la tentation nihiliste et le jeu devant l'Arche, mais la semaison de nouvelles
idoles. Ainsi encore, cet auteur, que l'on dit volontiers obsédé par le scandale du Mal, dont on se
moque tout aussi volontiers en l'affublant de la voix de fausset de Cassandre, ainsi George Steiner, en
sondant les gouffres du ténébreux comme à vrai dire peu d'autres auteurs contemporains peuvent —
ou veulent — le faire, parvient (non, il n'est probablement jamais encore parvenu à contempler le
scintillement de cette source), parviendra à une trouée d'eau fraîche qui le désaltérera, lui donnant,
non pas l'oubli du mythe grec, mais la grâce d'une vision nouvelle et lumineuse. Dois-je ajouter, trop
naïvement pour prétendre échapper aux questions soupçonneuses, que cet essai n'est pas autre chose
qu'une tentative maladroite pour débroussailler quelque peu la forêt de ronces où se cache la source
mystérieuse ?
On pensera alors sûrement, et on n'aura pas tort de le penser, que mon rôle, pris dans la grille de
parole tissée par de telles voix — une multitude de voix, parmi lesquelles certaines ont façonné, et
continuent à distance de façonner le visage hideux de notre époque —, est réduit à bien peu de chose,
peut-être même à rien de moins utile qu'un exercice de style de comparatiste, voué au silence final de
l'oubli. En effet. Et peut-être même ne suis-je rien d'autre, dans ces pages qui se veulent, dans la suite
de celles qu'écrivirent Cioran ou Charles Du Bos, un exercice d'admiration, peut-être ne suis-je rien
de plus que la navette filant courtoisement d'un bord à l'autre du métier magnifiquement tendu, sans
presque qu'aucun effort de volonté ne soit exigé d'elle : c'est qu'on ne demande à l'outil, à la navette
mêlant le fil de la trame à ceux de la chaîne, rien de plus que de filer droit, comme le petit bateau
qu'elle a été jadis, découvrant peut-être, dans l'écume de son sillon, dans la tension du câble qu'elle
tire derrière elle, quelque créature jusqu'alors inconnue, qu'elle ramènera sagement au port pour
exalter et dessiller l'étonnement des enfants. Dès lors, je l'ai dit, au rebours de la tendance actuelle de
la recherche, et parce que l'approche à découvert du mystère exige le plus extrême dépouillement (qui
n'est certes pas ce avec quoi les idiots le confondent : la simplification) ou, dans mon cas, le barda
incomplet équipant l'expéditionnaire profane, je me refuse à faire vœu de pauvreté ou de purge. Car,
si un seul jouet, même modeste et artisanal, suffit à la joie enfantine de celui dont le cœur n'a pas été
gâté par le prestige creux de la nouveauté perpétuelle et de l'incessante publicité, il me semble qu'une
multitude, et des plus scintillantes, convient encore mal au cœur fatigué et pervers de celui qui, comme
le héros de Musset, cet enfant du siècle écœuré de tout, avoue que plus rien n'émeut son esprit, que
son cœur est sec. De plus, ce sont les égouts et les réduits de saleté que l'on purge, non le savoir, qui
n'est jamais une épure glacée, sauf dans les mauvaises thèses.
C'est pour cette raison que l'on trouvera, dans les pages pourtant peu nombreuses de cet essai, une
multitude, une profusion chaotique, herbeuse et libre (disons : un peu anarchiste, n'est-ce pas ?) de
noms, comme autant d'archipels que ne relie entre eux aucun pont — c'est ainsi qu'Isaiah Berlin, dans
un de ses trop nombreux livres peu avare de multiples schématisations, caractérisait la prose déréglée
d'Hamann —, que les pédants s'amuseront peut-être à tracer, en réalignant la végétation touffue et
erratique selon le cordeau guindé du jardin à la française, mais que je me contente, pour ma part, de
jeter à la hâte et sans beaucoup de rigueur, certain que la parenté des idées ne saurait obéir qu'à la
seule ivresse stochastique de celui qui a énormément lu. Et puis, si tel était le cas, que m'importerait ?
Je suis en effet certain qu'il y a, qu'il doit y avoir plus qu'une affinité élective entre des œuvres
qu'inquiète la même question d'une transcendance du langage, transcendance pour le moins
paradoxale puisqu'elle n'hésite pas à sonder les profondeurs du Mal, espérant dans sa tentative folle
déboucher sur une lumière nouvelle, comme l'ultime cercle de l'Enfer de Dante communique avec le
ciel en creux du Purgatoire. Il y a, il doit y avoir plus que l'intérêt benoît de l'amateur en littérature
comparée pour réunir les exemples de Bernanos, de Trakl ou de Celan. Il y a, je crois, la volonté
d'analyser par quels détours souterrains ces auteurs ont dit, appelé et invoqué Dieu — non, c'est
encore trop : l'exigence de Dieu — dont ils fouaillaient la plaie vide. Il y a l'évidence, mille fois
répétée mais toujours raillée ou suspectée d'un pessimisme fasciné, que le Mal est la grande affaire de
notre siècle — celui dans lequel j'écris ces lignes, qui est encore, pour peu de jours, le vingtième —, et
le sera de celui, très certainement spirituel, mais avant tout criminel comme son père, qui s'ouvre sous
nos pas et nos yeux. Et puis, après tout, qu'importent les savantes raisons que je pourrais avancer ?
Ne suffit-il pas de dire que les livres sont les cœurs des hommes, embrouillés et contradictoires, mais
tous écrits d'après le Livre de Dieu selon Hugues de Saint-Victor, puisque nos cœurs multiples et
inconstants ont été façonnés à Son image unique et pérenne ? Ne suffit-il pas d'écrire que George
Steiner ne cesse de questionner le gouffre béant de l'horreur, et que le témoignage universel de la
littérature, de la peinture et de la musique, est le chemin le plus direct pour parvenir aux abords du
précipice ?
Quoi qu'il en soit de cette accumulation de noms presque jetés avec rage, j'affirme qu'elle-même est
un leurre. Trop de voix nous empêchent très certainement de nous écouter, ou même de nous entendre,
à moins qu'elles ne cherchent à signifier, comme par un retournement de la simplicité, qu'une
débauche sonore s'annule toujours en son contraire, et accède à quelque mystérieuse place où règne
le silence et la solitude de l'étendue vierge, blanche, débarrassée de toute parole trop évidente, de
toute théorie trop certaine et connue d'avance, là où Newton avoua s'être tenu à la fin de sa vie
extraordinaire, le murmure lointain du ressac contant au prodigieux génie les choses inouïes du grand
large. De ce lieu, si je l'atteignais, je ne pourrais plus rien dire, la parole m'étant devenue inutile et
pesante. Toutefois, pour ceux qui ne liraient que les introductions des ouvrages qu'ils sont censés
commenter et critiquer, je le dis une fois clairement, et je ne le redirai plus : à mes yeux, la première
originalité de George Steiner est qu'il tente de comprendre à quelle profondeur la déréliction du
langage signifie, non seulement la mort de Dieu dont il s'efforce de combattre, chez les tenanciers de
la nouvelle critique, la tentation nihiliste et le jeu devant l'Arche, mais la semaison de nouvelles
idoles. Ainsi encore, cet auteur, que l'on dit volontiers obsédé par le scandale du Mal, dont on se
moque tout aussi volontiers en l'affublant de la voix de fausset de Cassandre, ainsi George Steiner, en
sondant les gouffres du ténébreux comme à vrai dire peu d'autres auteurs contemporains peuvent —
ou veulent — le faire, parvient (non, il n'est probablement jamais encore parvenu à contempler le
scintillement de cette source), parviendra à une trouée d'eau fraîche qui le désaltérera, lui donnant,
non pas l'oubli du mythe grec, mais la grâce d'une vision nouvelle et lumineuse. Dois-je ajouter, trop
naïvement pour prétendre échapper aux questions soupçonneuses, que cet essai n'est pas autre chose
qu'une tentative maladroite pour débroussailler quelque peu la forêt de ronces où se cache la source
mystérieuse ?
30
Mais quelle transcendance peut demeurer à l'horizon sanglant de notre siècle barbare ? Mais comment
parier sur une “réelle présence” après l'effondrement en Occident des données religieuses, après le
minuit de toute parole humaine que fut Auschwitz ? (15, id.). Nous retrouvons, dans ces quelques
lignes d'ouverture, la nostalgie, perceptible tout au long de l'histoire de l'Occident, d'une langue
primordiale, magique, dont l'expulsion d'Adam hors de l'Eden puis la chute de la tour de Babel
paraphèrent la perte définitive, irrémédiable.20 Comme le dit, une fois de plus, Hoffmannsthal, cette
fois dans une lettre bien réelle adressée à son ami Edgar Karg, dans laquelle la multiplicité des
exemples, comme nous l’avons vu à propos des textes de la Cabbale, signifie l'effroi du sans-nombre,
de l'innommable, le vertige d'une conscience dont l'intime certitude est de se savoir bâtarde de la
Création et orpheline de Dieu : L'être-escarpé des montagnes, l'être-immense de la mer, l'être-obscur
de la nuit, la manière qu'ont les chevaux de regarder fixement, la constitution de nos mains, le parfum
des oeillets, la succession des houles et des creux dans le sol, ou des dunes, ou des falaises sévères, la
manière dont un pays entier se livre vu d'une montagne […] : dans toutes les innombrables choses de
l'existence, en chacune isolément et de façon singulière, quelque chose s'exprime, que les mots jamais
ne peuvent rendre, mais qui parle à notre âme. Ainsi, poursuit Hoffmannsthal, le monde entier est un
discours de l'insaisissable, le monde entier s'adresse à notre âme, mais celle-ci souffre de ressentir le
manque cruel, la fatalité dormante inscrite au plus intime de la jointure entre le réel et le langage, car
on ne peut jamais dire une chose tout à fait comme elle est.21
Comment taire ? est le titre d'un des ouvrages de Steiner. Comment dire ? eût pu en constituer
malignement le sous-titre, sous la plume de celui qui sait de quel poids de ténèbres et de silence est
informé l'ondée bruissante de la parole, pour celui qui a juré, comme Falk, qu'il reviendrait un jour
pour écouter le silence.
22 Comment dire Dieu, se demande Steiner, non pas l’idole sordide et braillarde
du polythéisme, mais le Dieu de Moïse [qui] a été, dès le départ, et jusque dans les invocations les
plus passionnées, une incommensurable Absence (Chât, 49) ? Comment dire Dieu, alors que le
langage, déjà intrinsèquement imparfait, est vicié par le mauvais usage que les hommes en ont fait, en
font (nous verrons ce point ultérieurement), alors que la bouche de l'Éternel elle-même commande aux
hommes — et singulièrement à Moïse — de se détourner sur Son passage ? : Fais-moi de grâce voir ta
gloire, demande à Dieu le guide d'Israël, qui lui répond, Je ferai passer devant toi toute ma beauté et
je prononcerai devant toi le nom de Yahvé […]. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme
ne peut me voir et vivre, de sorte que Moïse, lorsque passera la splendeur terrifiante, sera caché dans la
fente d'un rocher et ne verra que le dos de Dieu (Exode, 33. 18 et sq.). Comment dire le Dieu des Juifs,
unique, inconcevable [Steiner se souvient bien évidemment de l'interdiction de représenter Dieu par
une image contenue dans Nombres, 4. 15] et, au sens propre, impensable, aussi éloigné de l'idole qu'il
l'est du Dieu chrétien, du panthéon trinitaire, parfaitement représentable, des Églises (50, id.) ?
Comment dire le silence aussi, le silence qui est le sujet de Comment taire ? Comment dire le silence
dans un monde qui est envahi par le bruit intolérable du bavardage, par l'éclaboussure du bruit,
l'impossibilité de rencontrer des espaces accordés au silence (Ent, 117) ? Comment dire le silence
auquel aspire la musique — la musique qui, selon Walter Pater23, est ce à quoi aspirent tous les autres arts — alors que le langage ne peut rien dire d'elle, comment dire le silence par l'intermédiaire d'un
langage qui est incapable de se taire ? Comment dire le silence, évoquer ses plages musicales, peindre
les eaux lustrales de son archipel, dans l'écrin duquel la parole se courbe et se concentre comme pour
jaillir, pure et virginale, vers Dieu ? Et comment se taire après la découverte de l'horreur, comment
garder le silence autour de la parole démoniaque proférée par Hitler (ou plutôt, comment dire le
silence, comme la poésie de Celan le réussit), pour tenter, non pas de contenir le déferlement de
l'horreur — sur ce point, Steiner est plus que pessimiste —, mais afin de préserver quelques îlots de
pureté au large des rives du langage polluées par l'ordure, quelques plages blanches où la langue
allemande, charriée dans la boue nazie, trouverait une halte, une rade protectrices, d'où repartir,
bondissante et lavée, rédimée ? Précisément parce que la parole est l'insigne de la condition humaine,
qu'elle fait de l'homme une créature d'inquiétude et de recherche, le langage, écrit l'auteur, ne devrait
trouver ni vie ni repos dans les hauts lieux de la cruauté. Le silence est vraiment une alternative.
Quand la cité éructe la sauvagerie et le mensonge, rien ne porte plus loin que le poème non écrit
(Lang, 91). Mais le poème non écrit, la sonate non écoutée, le tableau non contemplé, puis-je encore
prétendre qu'ils existent vraiment, comme je pourrais sans doute dire, par le biais d’un paradoxe facile,
que Dieu existe, est, sans mon accord ou ma permission, mon écoute ou ma prière. Mais au fait, puisje dire de Dieu qu'il Est sans moi ?
Lassé par l’usage d’un langage figé dans son immobilité nauséeuse en face des choses qui lui
demeurent étrangères, c'est le rêve du silence qui hante désormais — hantise dont les prodromes ont
été bien évidemment visibles dès les premiers siècles de l'écrit —, à partir du braillard dix-neuvième
siècle, les esprits des écrivains, dont l'œuvre, comme celle de Blanchot ou de Louis-René des Forêts,
sera bâtie tout entière sur sa mise en demeure, sur sa surrection scintillante. Ce rêve douloureux, dont
l’assomption est sans doute donnée par la musique (qui demeure, selon Steiner, cet impondérable dont
le langage ne peut rien dire24, impondérable qui s'approche le plus de la kénose d'une présence réelle),
alors qu'avec la prose d'un Paul Celan nous demeurons, non pas dans l'Ouvert de la mélodie, mais dans
la béance de l'innommable et du sourd. Ce rêve douloureux, ce rêve splendide d'un au-delà du langage
va devenir, avec la disparition des hurlements avalés par la gueule sans nom, Auschwitz et les camps
de la mort, et l'impératif d'Adorno ayant contribué à banaliser ce qui fait question25, cauchemar dans
les contes paraboliques du grand Kafka (Rp, 143). Oui, il est sans doute vrai que le silence est plus
authentique, encore qu'ici aussi, on soit sans espoir.
Mais quelle transcendance peut demeurer à l'horizon sanglant de notre siècle barbare ? Mais comment
parier sur une “réelle présence” après l'effondrement en Occident des données religieuses, après le
minuit de toute parole humaine que fut Auschwitz ? (15, id.). Nous retrouvons, dans ces quelques
lignes d'ouverture, la nostalgie, perceptible tout au long de l'histoire de l'Occident, d'une langue
primordiale, magique, dont l'expulsion d'Adam hors de l'Eden puis la chute de la tour de Babel
paraphèrent la perte définitive, irrémédiable.20 Comme le dit, une fois de plus, Hoffmannsthal, cette
fois dans une lettre bien réelle adressée à son ami Edgar Karg, dans laquelle la multiplicité des
exemples, comme nous l’avons vu à propos des textes de la Cabbale, signifie l'effroi du sans-nombre,
de l'innommable, le vertige d'une conscience dont l'intime certitude est de se savoir bâtarde de la
Création et orpheline de Dieu : L'être-escarpé des montagnes, l'être-immense de la mer, l'être-obscur
de la nuit, la manière qu'ont les chevaux de regarder fixement, la constitution de nos mains, le parfum
des oeillets, la succession des houles et des creux dans le sol, ou des dunes, ou des falaises sévères, la
manière dont un pays entier se livre vu d'une montagne […] : dans toutes les innombrables choses de
l'existence, en chacune isolément et de façon singulière, quelque chose s'exprime, que les mots jamais
ne peuvent rendre, mais qui parle à notre âme. Ainsi, poursuit Hoffmannsthal, le monde entier est un
discours de l'insaisissable, le monde entier s'adresse à notre âme, mais celle-ci souffre de ressentir le
manque cruel, la fatalité dormante inscrite au plus intime de la jointure entre le réel et le langage, car
on ne peut jamais dire une chose tout à fait comme elle est.21
Comment taire ? est le titre d'un des ouvrages de Steiner. Comment dire ? eût pu en constituer
malignement le sous-titre, sous la plume de celui qui sait de quel poids de ténèbres et de silence est
informé l'ondée bruissante de la parole, pour celui qui a juré, comme Falk, qu'il reviendrait un jour
pour écouter le silence.
22 Comment dire Dieu, se demande Steiner, non pas l’idole sordide et braillarde
du polythéisme, mais le Dieu de Moïse [qui] a été, dès le départ, et jusque dans les invocations les
plus passionnées, une incommensurable Absence (Chât, 49) ? Comment dire Dieu, alors que le
langage, déjà intrinsèquement imparfait, est vicié par le mauvais usage que les hommes en ont fait, en
font (nous verrons ce point ultérieurement), alors que la bouche de l'Éternel elle-même commande aux
hommes — et singulièrement à Moïse — de se détourner sur Son passage ? : Fais-moi de grâce voir ta
gloire, demande à Dieu le guide d'Israël, qui lui répond, Je ferai passer devant toi toute ma beauté et
je prononcerai devant toi le nom de Yahvé […]. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme
ne peut me voir et vivre, de sorte que Moïse, lorsque passera la splendeur terrifiante, sera caché dans la
fente d'un rocher et ne verra que le dos de Dieu (Exode, 33. 18 et sq.). Comment dire le Dieu des Juifs,
unique, inconcevable [Steiner se souvient bien évidemment de l'interdiction de représenter Dieu par
une image contenue dans Nombres, 4. 15] et, au sens propre, impensable, aussi éloigné de l'idole qu'il
l'est du Dieu chrétien, du panthéon trinitaire, parfaitement représentable, des Églises (50, id.) ?
Comment dire le silence aussi, le silence qui est le sujet de Comment taire ? Comment dire le silence
dans un monde qui est envahi par le bruit intolérable du bavardage, par l'éclaboussure du bruit,
l'impossibilité de rencontrer des espaces accordés au silence (Ent, 117) ? Comment dire le silence
auquel aspire la musique — la musique qui, selon Walter Pater23, est ce à quoi aspirent tous les autres arts — alors que le langage ne peut rien dire d'elle, comment dire le silence par l'intermédiaire d'un
langage qui est incapable de se taire ? Comment dire le silence, évoquer ses plages musicales, peindre
les eaux lustrales de son archipel, dans l'écrin duquel la parole se courbe et se concentre comme pour
jaillir, pure et virginale, vers Dieu ? Et comment se taire après la découverte de l'horreur, comment
garder le silence autour de la parole démoniaque proférée par Hitler (ou plutôt, comment dire le
silence, comme la poésie de Celan le réussit), pour tenter, non pas de contenir le déferlement de
l'horreur — sur ce point, Steiner est plus que pessimiste —, mais afin de préserver quelques îlots de
pureté au large des rives du langage polluées par l'ordure, quelques plages blanches où la langue
allemande, charriée dans la boue nazie, trouverait une halte, une rade protectrices, d'où repartir,
bondissante et lavée, rédimée ? Précisément parce que la parole est l'insigne de la condition humaine,
qu'elle fait de l'homme une créature d'inquiétude et de recherche, le langage, écrit l'auteur, ne devrait
trouver ni vie ni repos dans les hauts lieux de la cruauté. Le silence est vraiment une alternative.
Quand la cité éructe la sauvagerie et le mensonge, rien ne porte plus loin que le poème non écrit
(Lang, 91). Mais le poème non écrit, la sonate non écoutée, le tableau non contemplé, puis-je encore
prétendre qu'ils existent vraiment, comme je pourrais sans doute dire, par le biais d’un paradoxe facile,
que Dieu existe, est, sans mon accord ou ma permission, mon écoute ou ma prière. Mais au fait, puisje dire de Dieu qu'il Est sans moi ?
Lassé par l’usage d’un langage figé dans son immobilité nauséeuse en face des choses qui lui
demeurent étrangères, c'est le rêve du silence qui hante désormais — hantise dont les prodromes ont
été bien évidemment visibles dès les premiers siècles de l'écrit —, à partir du braillard dix-neuvième
siècle, les esprits des écrivains, dont l'œuvre, comme celle de Blanchot ou de Louis-René des Forêts,
sera bâtie tout entière sur sa mise en demeure, sur sa surrection scintillante. Ce rêve douloureux, dont
l’assomption est sans doute donnée par la musique (qui demeure, selon Steiner, cet impondérable dont
le langage ne peut rien dire24, impondérable qui s'approche le plus de la kénose d'une présence réelle),
alors qu'avec la prose d'un Paul Celan nous demeurons, non pas dans l'Ouvert de la mélodie, mais dans
la béance de l'innommable et du sourd. Ce rêve douloureux, ce rêve splendide d'un au-delà du langage
va devenir, avec la disparition des hurlements avalés par la gueule sans nom, Auschwitz et les camps
de la mort, et l'impératif d'Adorno ayant contribué à banaliser ce qui fait question25, cauchemar dans
les contes paraboliques du grand Kafka (Rp, 143). Oui, il est sans doute vrai que le silence est plus
authentique, encore qu'ici aussi, on soit sans espoir.
33
Toute lecture est donc un pari, et toute contemplation d’un tableau, et toute écoute d’une œuvre
musicale, comme l’est l’acte par lequel l’artiste a donné vie, forme et chair à sa création. Seulement,
ce pari est tragique, car il existe bel et bien un art capable de livrer aux hommes des productions qui
proclament, non plus la “mort de Dieu” des philosophes, mais l'oubli de Dieu des post-modernes, et
qui s'enferment dans ce que Steiner nomme, usant d’une image intraduisible, les autistic echochambers où résonne ad infinitum la morne fatuité d’un insignifiant questionnement spéculaire. Même
si, oui encore, existent et demeurent des œuvres d'art naissent qui tirent leur sang maigre du substrat
— le granit où murmure la cavité secrète d'une source pure, invisible aux yeux et aux prières des
hommes, refusée à leur bouche — où s'ancrent pour des vigilances inquiètes quelques sarments
noueux qui ont nom Faulkner, Lagerkvist, Kafka, Gadenne, Boudot. Pierre Boudot dont les phrases
inquiètes annoncent et rejoignent les éclairs noirs qui cisaillent les pages ultimes de Réelles présences,
taraudées par l'urgence du doute lancinant : Si les larmes de Pierre humilié par la souillon de Ponce
Pilate me paraissent presque plus tragiques, écrit-il, plus riches de sens pour notre époque que la
mort du Golgotha, ce n'est pas seulement parce que le basculement de la civilisation met en quête de
détresses exemplaires mais parce que le besoin de beauté et la médiocrité de notre société font naître
en chacun de nous et dans l'humanité entière un si furieux vertige que Pierre ne semble pas pleurer
sur sa faiblesse mais sur la crainte de voir Jésus refuser de ressusciter.32 Dans ses Passions impunies
(44), Steiner écrira lui-même une phrase sans ambiguïté : le concept de résurrection pâlit au moment
précis où celui de l'agonie sur le Golgotha se fait plus saisissant. Nous vivons le Vendredi saint avec
plus d'intensité que le Dimanche.
Cette crainte, cette anorexie, ce refus de la résurrection ayant lieu le dimanche est le masque
d'angoisse porté par les hommes qui ont survécu aux outrages du Vendredi, dont l'art, quoi qu'en dise
Steiner, s'est nourri avec une évidente voracité — il est patent de constater que celui-ci, comme
Baudelaire n'a cessé de le répéter, est, avant toute autre chose, une fleur du Mal : face à l'indicible,
qu'il soit lumineux ou ténébreux, l'art n'est jamais muet. Ces hommes, nos contemporains, qui, selon
Steiner, sont bien près maintenant de succomber aux vapeurs délétères du long néant du Samedi, cette
marque terrifiante de notre modernité : notre époque est celle du long samedi. Entre la souffrance, la
solitude, l'inexprimable destruction d'une part et le rêve de libération, de renaissance de l'autre.
Devant la torture d'un enfant, de la mort de l'amour que représente le vendredi, même les plus grandes formes d'art et de poésie sont presque sans ressource. Dans l'utopie du dimanche,
l'esthétique, je présume, n'aura plus de raison d'être. Les appréhensions et les figurations qui sont en
jeu dans l'imagination métaphysique, dans le poème, dans la composition musicale, qui parlent de la
douleur et de l'espoir, de la chair qui a le goût de la cendre et de l'esprit qui a la saveur du feu, sont
tous œuvres du samedi. Elles ont surgi d'une immensité de l'attente qui caractérise l'homme. Sans
elles, comment pourrions-nous patienter ? (Rp, 275).
Dans cette brèche formidable de l'absence et de l'oubli, dans le désert de l'interminable attente des
hommes, dans cet il y a de ce que nous pourrions nommer une “immanence inquiète” où se tient
George Steiner contre son ami Boutang33, la corruption et sa pourriture va s'engouffrer. Et d'abord
sous sa forme la plus insignifiante, ce que l'auteur nomme l'après-culture, c'est-à-dire la sous-culture
d'un art (ou plutôt d'une performance) cantonné à ses manifestations les plus radicalement appauvries,
débarrassées en tout cas de toute visée trop nettement transcendante — celle-ci comprise comme un
dernier vestige de souci téléologique —, de toute référence à la tradition occidentale — celle-ci
comprise comme la preuve irréfutable de l'autorité et de l'ancrage respectueux dans le passé —, sousculture percluse dans le porcin contentement du happening, fouillant de son groin la stochastique et
contingente notion de beauté, passablement raillée ou méprisée, et celles, concomitantes, de goût, de
canon classique étant elles tout simplement annulées. Pourtant, Steiner, comme de coutume, ne cesse
d'être ambigu. Nous ne pouvons raisonnablement en faire le porte-parole agressif d'un retour
quelconque à une tradition artistique spécifiquement affirmée. C'est que l'art, qui, nous l'avons vu, ne
saurait se passer de Dieu à moins qu'il ne prétende sombrer dans la banalité de l'insignifiance — je
répète : Si le pari sur la transcendance ne semble plus valoir la peine et si nous nous dirigeons vers
une utopie de l'immédiat, les valeurs de notre civilisation vont se modifier […] de façon imprévisible
(Chât, 106) —, c'est que l'art doit s'auréoler d'une orbe d'essence religieuse, celle-ci, non pas
uniquement comprise comme la désignation spécifique de telle ou telle confession s'assurant une
illusoire domination, mais recouvrant une acception plus large : J'entends le mot religieux, nous dit
l'auteur, dans un sens spécial, beaucoup plus ancien ; c'est qu'une vraie culture interroge les rapports
du temps et de la mort (Ibid., 102). Au reste, écrit-il, concevoir une théorie de la culture qui puisse
tenir en l'absence de tout dogme ou d'un impératif métaphorique de perfectibilité et de progrès semble
être l'une des tâches les plus difficiles qu'il nous revienne d'affronter .
Toute lecture est donc un pari, et toute contemplation d’un tableau, et toute écoute d’une œuvre
musicale, comme l’est l’acte par lequel l’artiste a donné vie, forme et chair à sa création. Seulement,
ce pari est tragique, car il existe bel et bien un art capable de livrer aux hommes des productions qui
proclament, non plus la “mort de Dieu” des philosophes, mais l'oubli de Dieu des post-modernes, et
qui s'enferment dans ce que Steiner nomme, usant d’une image intraduisible, les autistic echochambers où résonne ad infinitum la morne fatuité d’un insignifiant questionnement spéculaire. Même
si, oui encore, existent et demeurent des œuvres d'art naissent qui tirent leur sang maigre du substrat
— le granit où murmure la cavité secrète d'une source pure, invisible aux yeux et aux prières des
hommes, refusée à leur bouche — où s'ancrent pour des vigilances inquiètes quelques sarments
noueux qui ont nom Faulkner, Lagerkvist, Kafka, Gadenne, Boudot. Pierre Boudot dont les phrases
inquiètes annoncent et rejoignent les éclairs noirs qui cisaillent les pages ultimes de Réelles présences,
taraudées par l'urgence du doute lancinant : Si les larmes de Pierre humilié par la souillon de Ponce
Pilate me paraissent presque plus tragiques, écrit-il, plus riches de sens pour notre époque que la
mort du Golgotha, ce n'est pas seulement parce que le basculement de la civilisation met en quête de
détresses exemplaires mais parce que le besoin de beauté et la médiocrité de notre société font naître
en chacun de nous et dans l'humanité entière un si furieux vertige que Pierre ne semble pas pleurer
sur sa faiblesse mais sur la crainte de voir Jésus refuser de ressusciter.32 Dans ses Passions impunies
(44), Steiner écrira lui-même une phrase sans ambiguïté : le concept de résurrection pâlit au moment
précis où celui de l'agonie sur le Golgotha se fait plus saisissant. Nous vivons le Vendredi saint avec
plus d'intensité que le Dimanche.
Cette crainte, cette anorexie, ce refus de la résurrection ayant lieu le dimanche est le masque
d'angoisse porté par les hommes qui ont survécu aux outrages du Vendredi, dont l'art, quoi qu'en dise
Steiner, s'est nourri avec une évidente voracité — il est patent de constater que celui-ci, comme
Baudelaire n'a cessé de le répéter, est, avant toute autre chose, une fleur du Mal : face à l'indicible,
qu'il soit lumineux ou ténébreux, l'art n'est jamais muet. Ces hommes, nos contemporains, qui, selon
Steiner, sont bien près maintenant de succomber aux vapeurs délétères du long néant du Samedi, cette
marque terrifiante de notre modernité : notre époque est celle du long samedi. Entre la souffrance, la
solitude, l'inexprimable destruction d'une part et le rêve de libération, de renaissance de l'autre.
Devant la torture d'un enfant, de la mort de l'amour que représente le vendredi, même les plus grandes formes d'art et de poésie sont presque sans ressource. Dans l'utopie du dimanche,
l'esthétique, je présume, n'aura plus de raison d'être. Les appréhensions et les figurations qui sont en
jeu dans l'imagination métaphysique, dans le poème, dans la composition musicale, qui parlent de la
douleur et de l'espoir, de la chair qui a le goût de la cendre et de l'esprit qui a la saveur du feu, sont
tous œuvres du samedi. Elles ont surgi d'une immensité de l'attente qui caractérise l'homme. Sans
elles, comment pourrions-nous patienter ? (Rp, 275).
Dans cette brèche formidable de l'absence et de l'oubli, dans le désert de l'interminable attente des
hommes, dans cet il y a de ce que nous pourrions nommer une “immanence inquiète” où se tient
George Steiner contre son ami Boutang33, la corruption et sa pourriture va s'engouffrer. Et d'abord
sous sa forme la plus insignifiante, ce que l'auteur nomme l'après-culture, c'est-à-dire la sous-culture
d'un art (ou plutôt d'une performance) cantonné à ses manifestations les plus radicalement appauvries,
débarrassées en tout cas de toute visée trop nettement transcendante — celle-ci comprise comme un
dernier vestige de souci téléologique —, de toute référence à la tradition occidentale — celle-ci
comprise comme la preuve irréfutable de l'autorité et de l'ancrage respectueux dans le passé —, sousculture percluse dans le porcin contentement du happening, fouillant de son groin la stochastique et
contingente notion de beauté, passablement raillée ou méprisée, et celles, concomitantes, de goût, de
canon classique étant elles tout simplement annulées. Pourtant, Steiner, comme de coutume, ne cesse
d'être ambigu. Nous ne pouvons raisonnablement en faire le porte-parole agressif d'un retour
quelconque à une tradition artistique spécifiquement affirmée. C'est que l'art, qui, nous l'avons vu, ne
saurait se passer de Dieu à moins qu'il ne prétende sombrer dans la banalité de l'insignifiance — je
répète : Si le pari sur la transcendance ne semble plus valoir la peine et si nous nous dirigeons vers
une utopie de l'immédiat, les valeurs de notre civilisation vont se modifier […] de façon imprévisible
(Chât, 106) —, c'est que l'art doit s'auréoler d'une orbe d'essence religieuse, celle-ci, non pas
uniquement comprise comme la désignation spécifique de telle ou telle confession s'assurant une
illusoire domination, mais recouvrant une acception plus large : J'entends le mot religieux, nous dit
l'auteur, dans un sens spécial, beaucoup plus ancien ; c'est qu'une vraie culture interroge les rapports
du temps et de la mort (Ibid., 102). Au reste, écrit-il, concevoir une théorie de la culture qui puisse
tenir en l'absence de tout dogme ou d'un impératif métaphorique de perfectibilité et de progrès semble
être l'une des tâches les plus difficiles qu'il nous revienne d'affronter .
38
Deux noms disais-je ? En voici un troisième : Walter Benjamin qui, dans son Journal de la Pentecôte
datant de l'année 1911, évoque avec quelques amis le massacre de la langue.
45 Sans doute n'est-ce pas
un hasard si ces deux observations, celle de Georges Bernanos et celle de Walter Benjamin, encadrent
le grand événement du premier conflit mondial, qui a dénudé jusqu'à l'intolérable blancheur de l'os le
corps du langage malade : en Allemagne, c'est le traumatisme absolu de la première guerre mondiale
qui engendre la Frontgeneration, alors que l'effondrement de l'Empire wilhelmien, garant de la bourgeoise prospérité, marque durablement les esprits, ceux de Bloch, de Rosenzweig (qui écrit dans
les tranchées L'Étoile de la rédemption, comme un pendant juif à Sein und Zeit et, plus encore, un
exorcisme de la philosophie hégélienne), celui de Benjamin et d’une multitude d’esprits. Cependant,
cette explication, aussi probante soit-elle dans la sphère historique, reste à la surface des choses. Car,
comme Jan Patocka le dit, elle consiste à expliquer les origines de la première guerre mondiale par des
raisons qui, encore, restent celles du XIXe
siècle, même si elles tentent de penser le bouleversement
radical dont ce début de siècle tragique a été le théâtre : c'est ce premier conflit mondial qui a
démontré que la transformation du monde en un laboratoire actualisant des réserves d'énergie
accumulées durant des milliards d'années devait forcément se faire par voie de guerre.46 Or, aussi
appropriées qu'elles soient, ces explications, pense le philosophe tchèque, sont encore et toujours les
idées du jour, de ses intérêts et de sa paix, alors que notre siècle est celui de la nuit, alors que notre
siècle est le siècle de la guerre et de la mort. Mais la nuit la plus profonde n’est-elle pas toujours
percée par une lumière, même ridicule ? Sans doute l’expérience du front est-elle l'aventure absurde
par excellence ; pourtant, elle peut provoquer un sursaut chez les combattants qui, comme Teilhard ou
Jünger, feront l'expérience d'une solidarité des ébranlés, seule capable d'apporter un peu de fraternité
dans le cœur des chiens de guerre. Mais rien n'y fait car, dans ces lieux boueux et infestés de cadavres,
la peur a vite fait de noyer les combattants sous ses flots amers. Alors, il faut se résigner à l'évidence,
et admettre avec Patocka que le front commande la manifestation d’une nouvelle présence, qui
jusqu'alors ne s’était qu’épisodiquement manifestée aux soldats des différentes guerres européennes :
l'expérience profonde du front avec sa ligne de feu réside cependant en ceci, qu'elle évoque la nuit
comme une présence impérieuse qu'on ne peut négliger. Cette nuit que nous pourrions rapprocher de
l'il y a évoqué par Lévinas, détruit et fait oublier jusqu'au souvenir des mobiles diurnes qui ont suscité
la volonté de guerre ; désormais, la nuit devient tout à coup un obstacle absolu sur le chemin du jour
vers le mauvais infini des lendemains. Désormais encore, cette même nuit nous semble une épreuve
insurpassable, le triomphe absolu du Rien, la déhiscence scandaleuse de la Mort qui a fléchi la vie vers
le royaume ténébreux, dans lequel cette dernière est toute proche de sombrer définitivement, sans
espoir de retour, sans espoir de pouvoir dire aux autres hommes, ceux de l'Arrière mais ceux aussi qui
ne sont pas encore nés, l'horreur entrevue dans le bourbier. Ici s'ouvre désormais, une fois franchies les
colossales portes d'airain, ce que le penseur tchèque appelle le domaine abyssal de la «prière pour
l'ennemi», sur lequel il ne donne, hélas !, guère de précisions.
Y verrons-nous, dans cette prière, la main tendue de la petite fille espérance, comme l'appelait Péguy,
seule capable de se promener avec une folle insouciance dans l'antre puant et vociférant où les
ennemis ne sont plus des ennemis absolus, qu'il faut à tout prix supprimer et abattre comme des
chiens, mais des hommes, emprisonnés dans la même geôle que nous, des hommes, c’est-à-dire des
frères ? Pouvons-nous penser que le langage, lui aussi revenu victorieux — mais de quelle amère
victoire ! — du front, saura désormais dire, pas même, chuchoter, les mots de cette prière tragique et
douloureuse ? Faut-il alors penser (pensée étrange), que les deux guerres sont nées d'une sénescence
du langage, selon l'hypothèse déjà mentionnée de Fritz Mauthner ? Faut-il croire, au contraire, que la
pourriture de la guerre a jailli de la boue pour épauler celle qui stagnait dans la langue, ou peut-être
même pour la combattre, les hommes fatigués et excédés par ces mots qu'ils ne reconnaissaient plus
cherchant dans le Mal un exutoire au Mal, un contre-poison plus dangereux que le poison qu’il est
censé combattre, comme Shakespeare le dit : things bad begun make strong themselves by ill ? Karl
Kraus, polémiste redoutable, celui qu'on nommait Nörgler, c'est-à-dire le grincheux, est bien près de le
penser. Il existe selon le pamphlétaire un lien tacite entre le déclenchement des massacres, finalement
ramenés à de simples événements presque irréels, et la parole, douée d'une puissance infâme mais,
elle, bien réelle. Ces lignes sont la suite de celles que j'ai citées plus haut : De nos jours, les liens entre
les catastrophes et les salles de rédaction sont plus profonds et, de ce fait, beaucoup moins clairs. Car
pendant qu'une guerre se déroule l'acte est plus puissant que le verbe ; mais l'écho qu'on lui donne est
plus fort encore que l'action. Nous vivons de l'écho des choses et dans ce monde sens dessus dessous
c'est lui qui suscite le cri.
Deux noms disais-je ? En voici un troisième : Walter Benjamin qui, dans son Journal de la Pentecôte
datant de l'année 1911, évoque avec quelques amis le massacre de la langue.
45 Sans doute n'est-ce pas
un hasard si ces deux observations, celle de Georges Bernanos et celle de Walter Benjamin, encadrent
le grand événement du premier conflit mondial, qui a dénudé jusqu'à l'intolérable blancheur de l'os le
corps du langage malade : en Allemagne, c'est le traumatisme absolu de la première guerre mondiale
qui engendre la Frontgeneration, alors que l'effondrement de l'Empire wilhelmien, garant de la bourgeoise prospérité, marque durablement les esprits, ceux de Bloch, de Rosenzweig (qui écrit dans
les tranchées L'Étoile de la rédemption, comme un pendant juif à Sein und Zeit et, plus encore, un
exorcisme de la philosophie hégélienne), celui de Benjamin et d’une multitude d’esprits. Cependant,
cette explication, aussi probante soit-elle dans la sphère historique, reste à la surface des choses. Car,
comme Jan Patocka le dit, elle consiste à expliquer les origines de la première guerre mondiale par des
raisons qui, encore, restent celles du XIXe
siècle, même si elles tentent de penser le bouleversement
radical dont ce début de siècle tragique a été le théâtre : c'est ce premier conflit mondial qui a
démontré que la transformation du monde en un laboratoire actualisant des réserves d'énergie
accumulées durant des milliards d'années devait forcément se faire par voie de guerre.46 Or, aussi
appropriées qu'elles soient, ces explications, pense le philosophe tchèque, sont encore et toujours les
idées du jour, de ses intérêts et de sa paix, alors que notre siècle est celui de la nuit, alors que notre
siècle est le siècle de la guerre et de la mort. Mais la nuit la plus profonde n’est-elle pas toujours
percée par une lumière, même ridicule ? Sans doute l’expérience du front est-elle l'aventure absurde
par excellence ; pourtant, elle peut provoquer un sursaut chez les combattants qui, comme Teilhard ou
Jünger, feront l'expérience d'une solidarité des ébranlés, seule capable d'apporter un peu de fraternité
dans le cœur des chiens de guerre. Mais rien n'y fait car, dans ces lieux boueux et infestés de cadavres,
la peur a vite fait de noyer les combattants sous ses flots amers. Alors, il faut se résigner à l'évidence,
et admettre avec Patocka que le front commande la manifestation d’une nouvelle présence, qui
jusqu'alors ne s’était qu’épisodiquement manifestée aux soldats des différentes guerres européennes :
l'expérience profonde du front avec sa ligne de feu réside cependant en ceci, qu'elle évoque la nuit
comme une présence impérieuse qu'on ne peut négliger. Cette nuit que nous pourrions rapprocher de
l'il y a évoqué par Lévinas, détruit et fait oublier jusqu'au souvenir des mobiles diurnes qui ont suscité
la volonté de guerre ; désormais, la nuit devient tout à coup un obstacle absolu sur le chemin du jour
vers le mauvais infini des lendemains. Désormais encore, cette même nuit nous semble une épreuve
insurpassable, le triomphe absolu du Rien, la déhiscence scandaleuse de la Mort qui a fléchi la vie vers
le royaume ténébreux, dans lequel cette dernière est toute proche de sombrer définitivement, sans
espoir de retour, sans espoir de pouvoir dire aux autres hommes, ceux de l'Arrière mais ceux aussi qui
ne sont pas encore nés, l'horreur entrevue dans le bourbier. Ici s'ouvre désormais, une fois franchies les
colossales portes d'airain, ce que le penseur tchèque appelle le domaine abyssal de la «prière pour
l'ennemi», sur lequel il ne donne, hélas !, guère de précisions.
Y verrons-nous, dans cette prière, la main tendue de la petite fille espérance, comme l'appelait Péguy,
seule capable de se promener avec une folle insouciance dans l'antre puant et vociférant où les
ennemis ne sont plus des ennemis absolus, qu'il faut à tout prix supprimer et abattre comme des
chiens, mais des hommes, emprisonnés dans la même geôle que nous, des hommes, c’est-à-dire des
frères ? Pouvons-nous penser que le langage, lui aussi revenu victorieux — mais de quelle amère
victoire ! — du front, saura désormais dire, pas même, chuchoter, les mots de cette prière tragique et
douloureuse ? Faut-il alors penser (pensée étrange), que les deux guerres sont nées d'une sénescence
du langage, selon l'hypothèse déjà mentionnée de Fritz Mauthner ? Faut-il croire, au contraire, que la
pourriture de la guerre a jailli de la boue pour épauler celle qui stagnait dans la langue, ou peut-être
même pour la combattre, les hommes fatigués et excédés par ces mots qu'ils ne reconnaissaient plus
cherchant dans le Mal un exutoire au Mal, un contre-poison plus dangereux que le poison qu’il est
censé combattre, comme Shakespeare le dit : things bad begun make strong themselves by ill ? Karl
Kraus, polémiste redoutable, celui qu'on nommait Nörgler, c'est-à-dire le grincheux, est bien près de le
penser. Il existe selon le pamphlétaire un lien tacite entre le déclenchement des massacres, finalement
ramenés à de simples événements presque irréels, et la parole, douée d'une puissance infâme mais,
elle, bien réelle. Ces lignes sont la suite de celles que j'ai citées plus haut : De nos jours, les liens entre
les catastrophes et les salles de rédaction sont plus profonds et, de ce fait, beaucoup moins clairs. Car
pendant qu'une guerre se déroule l'acte est plus puissant que le verbe ; mais l'écho qu'on lui donne est
plus fort encore que l'action. Nous vivons de l'écho des choses et dans ce monde sens dessus dessous
c'est lui qui suscite le cri.
3
George Steiner qui sait tout s'étonne de tout. L'idiot ou le prétentieux, le plus souvent l'universitaire,
dont l'idiotie est haussée jusqu'à l'universalité (je tente de raviver, par l'alliance des contraires, le sens
premier de ces deux mots si étonnamment apparentés), est celui qui, croyant tout savoir, ne sait rien,
ne s'étonne de rien, et surtout pas du fait qu'il ne veut rien savoir, rien sentir de sa crasse indéfectible,
rien remarquer de la monstrueuse carapace que son ignorance édifie patiemment sur sa propre peau,
autrefois blanche et propre, lorsque cet universitaire était encore — mais l'a-t-il jamais été ? — un
enfant. Sur ce point qui est quelque chose comme le nœud gordien autour duquel il emmaillote sa
vanité, l'idiot ne démord pas, il ne veut rien savoir ni entendre : il est intraitable, en un mot, comme
l'est un déchet radioactif. George Steiner qui sait tout et s'étonne de tout ne sait donc rien, car c'est la
première vertu de celui qui sait, et qui sait réellement, que d'être certain de son ignorance, et de n'en
point rougir comme rougit le prétentieux lorsque son savoir de fausset se termine en couac, cette
mauvaise note de la suffisance.
Il est cependant légitime que je m'interroge sur l'exotique nature d'un savoir qui professe l'ignorance,
d'une science joyeuse fondée sur l'assurance qu'elle ne parviendra jamais à comprendre son objet,
savoir et science étayés l'un et l'autre par l'argument d'autorité qu'ils ne savent justement rien. Quelle
doit être la force secrète de pareil savoir pour qu'il accepte sans broncher l'injure et, pire, la
moquerie des imbéciles, pour, qu'en maîtresse dédaigneuse et sûre de ses attraits irrésistibles, il
accepte de laisser que la canine malpropre de la hyène déforme son flanc ? Sans doute, Steiner est-il
un maître d'ironie, comme Socrate ou Kierkegaard auquel il faut toujours revenir, auquel, d'ailleurs,
l'auteur a puisé largement, lui qui voit en ce bourgeois espion de Dieu un chrétien étrange et solitaire,
un presque-Juif du Nouveau Testament. Ce savoir, qu'on peut appeler, en débarrassant le mot de ses
stupides et poisseux badigeons moralisateurs, en lui ôtant des yeux ses oeillères bien-pensantes, et
surtout, en retrouvant le sens antique du mot, une sagesse, c'est-à-dire, l'une des quatre vertus
cardinales — avec le courage, la tempérance et la justice — selon Platon qui en faisait un savoir
6
englobant, ce savoir est le seul qui convienne à notre époque qui, avec beaucoup de têtes, des millions
à vrai dire, a coupé de tout aussi nombreuses certitudes et quelques espérances pourtant presque
vierges. Je dis presque vierges, car le siècle des grimaces, le siècle du Singe, le dix-huitième siècle, le
siècle des Lumières pressé de tout avilir (et que de trop rares esprits réellement lumineux n'ont pu
sauver de la ruine de la sottise), n'a finalement déposé sur le mystère des choses et des êtres qu'une
pellicule mince et superficielle comme un souffle d'imbécillité, s'envolant à la première brise d'air pur.
Il faut donc que nous révélions la blancheur des vieilles espérances devenues folles. Il faut donc,
comme nous le montre Gerald Maune, héros de la nouvelle de Steiner intitulée Adorable mars, que
nous entreprenions de décrasser notre âme souillée, afin que nous puissions la contempler dans sa
terrible nudité. Et j'ajoute : le savoir qui seul convient à notre âge est, ne peut être par essence que
tragique, c'est-à-dire, enchaîné à la certitude de sa propre vanité, de son propre échec cuisants,
comme l'est peut-être notre assurance en ce qui touche le mystère de l'âme. C'est aussi que le savoir
de notre âge doit redevenir une science de l'âme.
Mais l'ironie et le masque, dont les maîtres, Darien, Pessoa ou Debord, n'ont pas fini de fasciner
notre siècle, risque tôt ou tard de devenir aussi dangereusement coupante qu'une arête de glace, et
coupante et blessante, d'abord, pour le pauvre bougre qui aurait oublié la proximité du dard vipérin,
et quelle est la saveur de la chair — cette chair, c'est la sienne, cette saveur, c'est celle de sa chair, ce
dard, le sien — dans laquelle il se plantera en premier : qui manie l'ironie sait toujours quelle corne
de taureau l'embrochera un jour, lorsque la danse experte autour de la mort aura perdu de sa fluide
souplesse. Alors, pour une autre raison, pratiquement inverse de la première et constituant pourtant
sa doublure inarrachable, cette sagesse, parce qu'elle provient d'un vieux mot qui, à côté du sens
premier de “savoir”, unit inextricablement celui-ci (le parcours d'un homme dans le labyrinthe du
monde), à son apprentissage de la douleur et de l'amertume, ce savoir et cette sagesse amers tirent
leur pertinence de l'excès même qu'ils fondent dans leur confiance inquiète, ébranlable, humaine et
tragique. J'aurai sensiblement approché de ce que je veux dire, j'aurai un peu plus clairement éclairé
le visage d'homme que je tente d'évoquer, lorsque j'aurai écrit le mot sublime, le mot terrible, le mot
clabaudé par la foule, le mot espérance. C'est que notre époque, qui continue de s'éblouir des
prestiges vite éventés de la table rase et du soupçon universel, qui s'amuse à déconstruire plutôt qu'à
bâtir, s'étonne parfois de découvrir, entre deux rires moqueurs grimacés par les vieillards ironiques,
quel horrible manque creuse son assise fragile : ce manque est un schisme de l'être, selon la
prédiction de Joseph de Maistre, ce manque qui est une plaie est la volonté de ne devoir rien — ou
alors le moins possible — à personne, et surtout pas, grands dieux non !, à Quelqu'un.
George Steiner qui sait tout s'étonne de tout. L'idiot ou le prétentieux, le plus souvent l'universitaire,
dont l'idiotie est haussée jusqu'à l'universalité (je tente de raviver, par l'alliance des contraires, le sens
premier de ces deux mots si étonnamment apparentés), est celui qui, croyant tout savoir, ne sait rien,
ne s'étonne de rien, et surtout pas du fait qu'il ne veut rien savoir, rien sentir de sa crasse indéfectible,
rien remarquer de la monstrueuse carapace que son ignorance édifie patiemment sur sa propre peau,
autrefois blanche et propre, lorsque cet universitaire était encore — mais l'a-t-il jamais été ? — un
enfant. Sur ce point qui est quelque chose comme le nœud gordien autour duquel il emmaillote sa
vanité, l'idiot ne démord pas, il ne veut rien savoir ni entendre : il est intraitable, en un mot, comme
l'est un déchet radioactif. George Steiner qui sait tout et s'étonne de tout ne sait donc rien, car c'est la
première vertu de celui qui sait, et qui sait réellement, que d'être certain de son ignorance, et de n'en
point rougir comme rougit le prétentieux lorsque son savoir de fausset se termine en couac, cette
mauvaise note de la suffisance.
Il est cependant légitime que je m'interroge sur l'exotique nature d'un savoir qui professe l'ignorance,
d'une science joyeuse fondée sur l'assurance qu'elle ne parviendra jamais à comprendre son objet,
savoir et science étayés l'un et l'autre par l'argument d'autorité qu'ils ne savent justement rien. Quelle
doit être la force secrète de pareil savoir pour qu'il accepte sans broncher l'injure et, pire, la
moquerie des imbéciles, pour, qu'en maîtresse dédaigneuse et sûre de ses attraits irrésistibles, il
accepte de laisser que la canine malpropre de la hyène déforme son flanc ? Sans doute, Steiner est-il
un maître d'ironie, comme Socrate ou Kierkegaard auquel il faut toujours revenir, auquel, d'ailleurs,
l'auteur a puisé largement, lui qui voit en ce bourgeois espion de Dieu un chrétien étrange et solitaire,
un presque-Juif du Nouveau Testament. Ce savoir, qu'on peut appeler, en débarrassant le mot de ses
stupides et poisseux badigeons moralisateurs, en lui ôtant des yeux ses oeillères bien-pensantes, et
surtout, en retrouvant le sens antique du mot, une sagesse, c'est-à-dire, l'une des quatre vertus
cardinales — avec le courage, la tempérance et la justice — selon Platon qui en faisait un savoir
6
englobant, ce savoir est le seul qui convienne à notre époque qui, avec beaucoup de têtes, des millions
à vrai dire, a coupé de tout aussi nombreuses certitudes et quelques espérances pourtant presque
vierges. Je dis presque vierges, car le siècle des grimaces, le siècle du Singe, le dix-huitième siècle, le
siècle des Lumières pressé de tout avilir (et que de trop rares esprits réellement lumineux n'ont pu
sauver de la ruine de la sottise), n'a finalement déposé sur le mystère des choses et des êtres qu'une
pellicule mince et superficielle comme un souffle d'imbécillité, s'envolant à la première brise d'air pur.
Il faut donc que nous révélions la blancheur des vieilles espérances devenues folles. Il faut donc,
comme nous le montre Gerald Maune, héros de la nouvelle de Steiner intitulée Adorable mars, que
nous entreprenions de décrasser notre âme souillée, afin que nous puissions la contempler dans sa
terrible nudité. Et j'ajoute : le savoir qui seul convient à notre âge est, ne peut être par essence que
tragique, c'est-à-dire, enchaîné à la certitude de sa propre vanité, de son propre échec cuisants,
comme l'est peut-être notre assurance en ce qui touche le mystère de l'âme. C'est aussi que le savoir
de notre âge doit redevenir une science de l'âme.
Mais l'ironie et le masque, dont les maîtres, Darien, Pessoa ou Debord, n'ont pas fini de fasciner
notre siècle, risque tôt ou tard de devenir aussi dangereusement coupante qu'une arête de glace, et
coupante et blessante, d'abord, pour le pauvre bougre qui aurait oublié la proximité du dard vipérin,
et quelle est la saveur de la chair — cette chair, c'est la sienne, cette saveur, c'est celle de sa chair, ce
dard, le sien — dans laquelle il se plantera en premier : qui manie l'ironie sait toujours quelle corne
de taureau l'embrochera un jour, lorsque la danse experte autour de la mort aura perdu de sa fluide
souplesse. Alors, pour une autre raison, pratiquement inverse de la première et constituant pourtant
sa doublure inarrachable, cette sagesse, parce qu'elle provient d'un vieux mot qui, à côté du sens
premier de “savoir”, unit inextricablement celui-ci (le parcours d'un homme dans le labyrinthe du
monde), à son apprentissage de la douleur et de l'amertume, ce savoir et cette sagesse amers tirent
leur pertinence de l'excès même qu'ils fondent dans leur confiance inquiète, ébranlable, humaine et
tragique. J'aurai sensiblement approché de ce que je veux dire, j'aurai un peu plus clairement éclairé
le visage d'homme que je tente d'évoquer, lorsque j'aurai écrit le mot sublime, le mot terrible, le mot
clabaudé par la foule, le mot espérance. C'est que notre époque, qui continue de s'éblouir des
prestiges vite éventés de la table rase et du soupçon universel, qui s'amuse à déconstruire plutôt qu'à
bâtir, s'étonne parfois de découvrir, entre deux rires moqueurs grimacés par les vieillards ironiques,
quel horrible manque creuse son assise fragile : ce manque est un schisme de l'être, selon la
prédiction de Joseph de Maistre, ce manque qui est une plaie est la volonté de ne devoir rien — ou
alors le moins possible — à personne, et surtout pas, grands dieux non !, à Quelqu'un.
35
Pour l'instant elle patauge, la vieille déesse romaine, Spes, l'attente, dont la brièveté syllabique claque
comme d'un soufflet chaque joue de l'homme misérable, l'espérance, la petite fille espérance dont parle
le poète-enfant, Charles Péguy. Elle essaie d'avancer comme elle peut dans le marécageux
compost : le cœur caché, le cœur des ténèbres, la pourriture au sein même de la vitalité, ou plutôt son
apparence. Nous y voici, sans aucun doute, mais c'est presque rien, un peu de fumée vite dissipée :
Vienne, Salzbourg, Innsbruck... Villes croulantes et énormes… Villes avachies dans une jungle de
mornes soupirs, de râles de vieillards remplis d'eux-mêmes, c'est-à-dire de vent, comme l'est la venise
agglomération, grignotée patiemment par les murènes du temps, que nous momifie Gracq dans son
Rivage des Syrtes, qu'il eût été bien inspiré d'appeler Syrtes-la-Morte. Villes attaquées sournoisement
par une autre lèpre, qui trompeusement se présente comme un dernier sursaut de vie, un ultime hallali
de rancœur, le pilon incendiaire de Karl Kraus, Die Fackel (La Torche), l'auteur bloyen des Derniers
jours de l'Humanité, dont l'acide crachat sera pieusement ramassé par Wittgenstein, cet imprécateur du
silence de la fin de partie métaphysique. Villes hautaines et croulantes dans lesquelles des marcheurs
déboussolés versifient leurs beuveries, croyant parfois avoir entrevu la matrice impénétrable où
grondent les flots de la Mort et du Mal, liés amoureusement dans une copulation de sangsues. Villes
pleines d'yeux grands ouverts qui, après une nuit de débauche blanche comme une vestale, peindront
ce qu'ils ont cru voir en couleurs vives et criardes, impudiques et macabres : c'est de nouveau le pas
des mendiants qui va faire trembler la terre, dans ces toutes premières années qui voient se fortifier
l'expressionnisme, mot commode et années arbitraires sous lesquels s'agglutinent, pour se réchauffer
quelque peu en attendant la lumière universitaire que les générations patientes et érudites dispenseront
prétentieusement sur ce qui n'est, en fin de compte, ni plus ni moins qu'une misère crasse et superbe,
mais instituée en bohème géniale, les parias, en rang pour le défilé de la critique. La singularité de
l'époque ? La sensibilité monstrueuse des fins d'empire, l'urticaire des grabats où se contorsionnent les
mourants exténués. On pressent alors, comme une rumeur colportée par les Histoires pragoises du
jeune Rilke, que tout finit, et que tout, peut-être, va renaître miraculeusement, comme un fulgurant
démenti à la sombre et irréversible faille que la Mort introduit dans les Cahiers de Malte Laurids
Brigge. C'est que certaines voix, comme celle d'Yvan Goll, ont proclamé que l'expressionnisme n'était
qu'une immense recherche, qu'il était une sorte de généralisation de toute notre vie sur la base d'une
influence purement spirituelle, un élan vers la divinité venant au moment où toutes les religions font
faillite. Est-ce qu'il ne nous apprendrait pas même de nouveau à prier ? Belle chimère, horizon vite
éventé, car la prière, si elle est montée assez haut, a vite fait de culbuter sur le rebord des tranchées,
d'où elle ne ressortira plus, malgré le délestage — on devrait dire le dégazage — des putréfactions
enfouies sous la boue. Qu'est-ce qui va s'élever du tas de décombres brûlants qui survit de l'empire
bariolé comme une tunique magyare, du tout-puissant empire austro-hongrois qu'on surnomme, tant il
est vaste, “l'Empire du Milieu”, cette ingouvernable mixture de peuples (Metternich dira : J'ai
gouverné l'Europe, jamais l'Autriche) tchèques, polonais, slaves, germains et romains décrit
minutieusement par L'Homme sans qualités de Musil, dernier battement de la paupière rougie du géant
pour un bref éternuement d'énergie ? Qu’est-ce qui va sortir de ce magma informe ? Rien. Rien du
tout. Quelques toiles, quelques livres — romans et pièces de théâtre —, c'est finalement bien peu.
Mais de ce rien poussé jusqu'à l'extrême abnégation, un rêve cruel, halluciné, ondoyant comme une
Ophélie pluvieuse, va grandir et grossir telle une bulle de pâle lumière remontée des profondeurs
aveugles, puis se fixer dans la fulgurance d'une vie grippée en 1918, dans les traits spasmodiques
d'Egon Schiele ou dans les ors byzantins d'Émile Nolde, ou encore mêlée à la boue des tranchées
d'Otto Dix. C'est, je l'ai dit, Rilke, Musil, Kafka, Wedekind, Hoffmannsthal, Benn, Schnitzler,
beaucoup d'autres encore, tous lus par Steiner. Ils bâtissent, littéralement, sur les ruines qu'ils
pressentent, qu'ils sentent, puisque pavane sous leur nez le premier frisson d'un vent bizarrement
poisseux, les avertissant qu'il ira bientôt charriant le pollen de millions de charognes, le souffle des
tranchées chaudes et humides, ils édifient quelques constructions éphémères, pantelantes et décomposées, creusant dans la terre noire pour y chercher et y trouver peut-être, avec le trésor des
vieux contes de l'Allemagne légendaire, l'espérance enfouie comme une reine de Saba.
Mais c'est une autre espèce de monstre que leur recherche, finalement, aura excorié des profondeurs
puantes et noires, cet horrible monceau (Di kupè) de corps liquéfiés dont parle Peretz Markish, relatant
les pogromes d'Ukraine de 1919 :
O hanche noire ! O sang de feu ! Dansez, dansez, relevez vos chemises !
S'étale ici toute la ville — en tas — tous, tous,
Le onze de Tishrei, en l'an 5681.
Pour l'instant elle patauge, la vieille déesse romaine, Spes, l'attente, dont la brièveté syllabique claque
comme d'un soufflet chaque joue de l'homme misérable, l'espérance, la petite fille espérance dont parle
le poète-enfant, Charles Péguy. Elle essaie d'avancer comme elle peut dans le marécageux
compost : le cœur caché, le cœur des ténèbres, la pourriture au sein même de la vitalité, ou plutôt son
apparence. Nous y voici, sans aucun doute, mais c'est presque rien, un peu de fumée vite dissipée :
Vienne, Salzbourg, Innsbruck... Villes croulantes et énormes… Villes avachies dans une jungle de
mornes soupirs, de râles de vieillards remplis d'eux-mêmes, c'est-à-dire de vent, comme l'est la venise
agglomération, grignotée patiemment par les murènes du temps, que nous momifie Gracq dans son
Rivage des Syrtes, qu'il eût été bien inspiré d'appeler Syrtes-la-Morte. Villes attaquées sournoisement
par une autre lèpre, qui trompeusement se présente comme un dernier sursaut de vie, un ultime hallali
de rancœur, le pilon incendiaire de Karl Kraus, Die Fackel (La Torche), l'auteur bloyen des Derniers
jours de l'Humanité, dont l'acide crachat sera pieusement ramassé par Wittgenstein, cet imprécateur du
silence de la fin de partie métaphysique. Villes hautaines et croulantes dans lesquelles des marcheurs
déboussolés versifient leurs beuveries, croyant parfois avoir entrevu la matrice impénétrable où
grondent les flots de la Mort et du Mal, liés amoureusement dans une copulation de sangsues. Villes
pleines d'yeux grands ouverts qui, après une nuit de débauche blanche comme une vestale, peindront
ce qu'ils ont cru voir en couleurs vives et criardes, impudiques et macabres : c'est de nouveau le pas
des mendiants qui va faire trembler la terre, dans ces toutes premières années qui voient se fortifier
l'expressionnisme, mot commode et années arbitraires sous lesquels s'agglutinent, pour se réchauffer
quelque peu en attendant la lumière universitaire que les générations patientes et érudites dispenseront
prétentieusement sur ce qui n'est, en fin de compte, ni plus ni moins qu'une misère crasse et superbe,
mais instituée en bohème géniale, les parias, en rang pour le défilé de la critique. La singularité de
l'époque ? La sensibilité monstrueuse des fins d'empire, l'urticaire des grabats où se contorsionnent les
mourants exténués. On pressent alors, comme une rumeur colportée par les Histoires pragoises du
jeune Rilke, que tout finit, et que tout, peut-être, va renaître miraculeusement, comme un fulgurant
démenti à la sombre et irréversible faille que la Mort introduit dans les Cahiers de Malte Laurids
Brigge. C'est que certaines voix, comme celle d'Yvan Goll, ont proclamé que l'expressionnisme n'était
qu'une immense recherche, qu'il était une sorte de généralisation de toute notre vie sur la base d'une
influence purement spirituelle, un élan vers la divinité venant au moment où toutes les religions font
faillite. Est-ce qu'il ne nous apprendrait pas même de nouveau à prier ? Belle chimère, horizon vite
éventé, car la prière, si elle est montée assez haut, a vite fait de culbuter sur le rebord des tranchées,
d'où elle ne ressortira plus, malgré le délestage — on devrait dire le dégazage — des putréfactions
enfouies sous la boue. Qu'est-ce qui va s'élever du tas de décombres brûlants qui survit de l'empire
bariolé comme une tunique magyare, du tout-puissant empire austro-hongrois qu'on surnomme, tant il
est vaste, “l'Empire du Milieu”, cette ingouvernable mixture de peuples (Metternich dira : J'ai
gouverné l'Europe, jamais l'Autriche) tchèques, polonais, slaves, germains et romains décrit
minutieusement par L'Homme sans qualités de Musil, dernier battement de la paupière rougie du géant
pour un bref éternuement d'énergie ? Qu’est-ce qui va sortir de ce magma informe ? Rien. Rien du
tout. Quelques toiles, quelques livres — romans et pièces de théâtre —, c'est finalement bien peu.
Mais de ce rien poussé jusqu'à l'extrême abnégation, un rêve cruel, halluciné, ondoyant comme une
Ophélie pluvieuse, va grandir et grossir telle une bulle de pâle lumière remontée des profondeurs
aveugles, puis se fixer dans la fulgurance d'une vie grippée en 1918, dans les traits spasmodiques
d'Egon Schiele ou dans les ors byzantins d'Émile Nolde, ou encore mêlée à la boue des tranchées
d'Otto Dix. C'est, je l'ai dit, Rilke, Musil, Kafka, Wedekind, Hoffmannsthal, Benn, Schnitzler,
beaucoup d'autres encore, tous lus par Steiner. Ils bâtissent, littéralement, sur les ruines qu'ils
pressentent, qu'ils sentent, puisque pavane sous leur nez le premier frisson d'un vent bizarrement
poisseux, les avertissant qu'il ira bientôt charriant le pollen de millions de charognes, le souffle des
tranchées chaudes et humides, ils édifient quelques constructions éphémères, pantelantes et décomposées, creusant dans la terre noire pour y chercher et y trouver peut-être, avec le trésor des
vieux contes de l'Allemagne légendaire, l'espérance enfouie comme une reine de Saba.
Mais c'est une autre espèce de monstre que leur recherche, finalement, aura excorié des profondeurs
puantes et noires, cet horrible monceau (Di kupè) de corps liquéfiés dont parle Peretz Markish, relatant
les pogromes d'Ukraine de 1919 :
O hanche noire ! O sang de feu ! Dansez, dansez, relevez vos chemises !
S'étale ici toute la ville — en tas — tous, tous,
Le onze de Tishrei, en l'an 5681.
26
Échec du langage. Échec du langage que mime l'échec de la lecture, si celle-ci n'est pas une action, s'il
est vrai que lire bien, comme l'affirme Pierre Boutang dans ses Dialogues avec son ami, c'est lire avec
une intensité telle qu'on pourrait retrouver le moyen d'agir. Le constat de cet échec, acclamé avec ravissement par les théoriciens de la Déconstruction qui le répètent dans chacun de leurs ouvrages en
rappelant au passage l'expression célèbre par laquelle Michael Riffaterre entérinait le divorce entre le
langage et le monde17, ce constat, nous le faisons également nôtre. Mais aussi, et cela seul me paraît
être un signe véritable, échec du langage, sous la plume des plus grands, qui, ayant redonné au langage
la pure autonomie de son être brut oublié (l'expression est de Michel Foucault), c'est-à-dire en le
désenclavant de son usage représentatif et purement utilitaire, se rendent compte de la dramatique
ineptie de ce petit jeu sans conséquence. Alors, il faut passer outre, et, puisque décidément la lecture
que nous faisons du grand livre du monde est incorrecte et inattentive, puisque, selon Steiner, nous
sommes dans la condition d'une lumière parfois noire qui va à travers nos faits, nous devons tenter le
saut de la foi comme l'exigeait avec crainte et tremblement le veilleur de Copenhague, même si
demeure l'assurance que ce langage, que ce texte qui ne parlent de rien d'autre que d'eux-mêmes, leurs
mots et leurs phrases n'évoquant rien de plus que d'autres mots et d'autres phrases dans une giration
infinie, effrayante, contiennent le monde, l'univers entier, sont réellement ce monde et cet univers,
selon la voie d'une parenté encore mystérieuse : non pas abolie, j'ose le dire, mais encore mystérieuse,
parenté et voie que ces mots et ces phrases, même s'ils sont courants et banals, employés par chacune
de nos bouches bavardes, reflètent plus fidèlement qu'une goutte de pluie. Steiner, bizarrement, se
trouve assez proche d'un Derrida lorsqu'il écrit ces phrases : Le contexte informatif de n'importe quelle
phrase du Madame Bovary de Flaubert, par exemple, est celui du paragraphe immédiat, du chapitre
qui l'entoure, du roman tout entier. C'est aussi celui de l'état de la langue française à l'époque et dans
le pays de Flaubert, de l'histoire de la société française, et des idéologies, de la vie politique, des
résonances du quotidien et du terrain de référence implicite et explicite, qui impriment leur marque
sur les mots, les tournures de cette phrase en particulier, qui peut-être les subvertissent ou les
ironisent. La pierre frappe l'eau et les cercles concentriques ondoient vers des horizons infinis. Le
contexte sans lequel il ne saurait y avoir ni sens ni compréhension, c'est le monde (Err, 34).
Le monde, c'est-à-dire l'univers, donc : Dieu, caché mais révélé par cette parcelle d'infini lumineux
que chaque lettre cache et révèle comme dans le texte de Flaubert, comme dans celui de n'importe quel
autre auteur. Lire bien selon Steiner, ce n'est rien de moins, ne l'avons-nous pas encore compris ?, que
prier, non pas dans la joie douce et confiante, dans la certitude de Celui qu'on invoque, à l'abri de la
tourmente, dans la familière sécurité d'une chambre pénombrée où le face à face peut s'instaurer, mais
dans la violence et le vacarme, dans le brouhaha, dans l'incertitude, dans le doute perpétuel qui est la
marque de notre âge, la marque, plus sûrement, de toute foi exigeante, réelle, la marque aussi d'une foi
qui tente de recueillir dans sa prière chaque éclat de lumière éparpillée, la marque enfin des lectures
bouleversantes, où l'âme de l'auteur se découvre dans sa radicale pauvreté, dans son impuissance à
parler et peut-être, à son tour, dans la douce timidité de sa prière silencieuse, maladive, pourtant tout
entière dressée vers le ciel. Je me demande si la lecture, chez Steiner, ne ressemble pas au dogme
catholique de la communion des saints, où la réelle présence du Christ, que les chrétiens cherchent —
et trouvent — dans le partage et la consommation de l'hostie — ou de celle, invisible, de la prière —
serait remplacée par l'espérance de la rencontre, et, au-delà de cette rencontre, d'une véritable
fondation, de personne à personne, d'un lien de parole marqué au coin du Logos.
Finalement, le paradoxe que nous avons soulevé n'est pas différent du paradoxe de la foi. Foi juive
bien sûr, inimitable mélange de confiance chenue et de doute indéracinable, foi dont je ne suis guère le
spécialiste, mais qui me semble plus radicalement hantée par la question de la disparition de Dieu,
voire, par celle de son impuissance — question bien sûr aiguisée jusqu'à l'absurde depuis sa mort dans
les camps de concentration allemands —, que ne l'est l'espérance catholique, invinciblement confiante
puisqu'elle se sait accomplie, consommée, depuis la venue du Christ, même si les doutes exposés par
exemple par André Néher, sont ceux de chrétiens tourmentés à l'extrême comme le furent Bloy ou
Bernanos, Lequier ou Kierkegaard, qui n'ont jamais cru que la foi était autre chose qu'une invincible
exigence de fermeté face à la tentation du désespoir, mais qui, de la même façon, ont compris que
cette foi serait bien peu de chose, une chose de rien, si la certitude épouvantable et le péril du
désespoir ne rôdaient autour d'eux.
Échec du langage. Échec du langage que mime l'échec de la lecture, si celle-ci n'est pas une action, s'il
est vrai que lire bien, comme l'affirme Pierre Boutang dans ses Dialogues avec son ami, c'est lire avec
une intensité telle qu'on pourrait retrouver le moyen d'agir. Le constat de cet échec, acclamé avec ravissement par les théoriciens de la Déconstruction qui le répètent dans chacun de leurs ouvrages en
rappelant au passage l'expression célèbre par laquelle Michael Riffaterre entérinait le divorce entre le
langage et le monde17, ce constat, nous le faisons également nôtre. Mais aussi, et cela seul me paraît
être un signe véritable, échec du langage, sous la plume des plus grands, qui, ayant redonné au langage
la pure autonomie de son être brut oublié (l'expression est de Michel Foucault), c'est-à-dire en le
désenclavant de son usage représentatif et purement utilitaire, se rendent compte de la dramatique
ineptie de ce petit jeu sans conséquence. Alors, il faut passer outre, et, puisque décidément la lecture
que nous faisons du grand livre du monde est incorrecte et inattentive, puisque, selon Steiner, nous
sommes dans la condition d'une lumière parfois noire qui va à travers nos faits, nous devons tenter le
saut de la foi comme l'exigeait avec crainte et tremblement le veilleur de Copenhague, même si
demeure l'assurance que ce langage, que ce texte qui ne parlent de rien d'autre que d'eux-mêmes, leurs
mots et leurs phrases n'évoquant rien de plus que d'autres mots et d'autres phrases dans une giration
infinie, effrayante, contiennent le monde, l'univers entier, sont réellement ce monde et cet univers,
selon la voie d'une parenté encore mystérieuse : non pas abolie, j'ose le dire, mais encore mystérieuse,
parenté et voie que ces mots et ces phrases, même s'ils sont courants et banals, employés par chacune
de nos bouches bavardes, reflètent plus fidèlement qu'une goutte de pluie. Steiner, bizarrement, se
trouve assez proche d'un Derrida lorsqu'il écrit ces phrases : Le contexte informatif de n'importe quelle
phrase du Madame Bovary de Flaubert, par exemple, est celui du paragraphe immédiat, du chapitre
qui l'entoure, du roman tout entier. C'est aussi celui de l'état de la langue française à l'époque et dans
le pays de Flaubert, de l'histoire de la société française, et des idéologies, de la vie politique, des
résonances du quotidien et du terrain de référence implicite et explicite, qui impriment leur marque
sur les mots, les tournures de cette phrase en particulier, qui peut-être les subvertissent ou les
ironisent. La pierre frappe l'eau et les cercles concentriques ondoient vers des horizons infinis. Le
contexte sans lequel il ne saurait y avoir ni sens ni compréhension, c'est le monde (Err, 34).
Le monde, c'est-à-dire l'univers, donc : Dieu, caché mais révélé par cette parcelle d'infini lumineux
que chaque lettre cache et révèle comme dans le texte de Flaubert, comme dans celui de n'importe quel
autre auteur. Lire bien selon Steiner, ce n'est rien de moins, ne l'avons-nous pas encore compris ?, que
prier, non pas dans la joie douce et confiante, dans la certitude de Celui qu'on invoque, à l'abri de la
tourmente, dans la familière sécurité d'une chambre pénombrée où le face à face peut s'instaurer, mais
dans la violence et le vacarme, dans le brouhaha, dans l'incertitude, dans le doute perpétuel qui est la
marque de notre âge, la marque, plus sûrement, de toute foi exigeante, réelle, la marque aussi d'une foi
qui tente de recueillir dans sa prière chaque éclat de lumière éparpillée, la marque enfin des lectures
bouleversantes, où l'âme de l'auteur se découvre dans sa radicale pauvreté, dans son impuissance à
parler et peut-être, à son tour, dans la douce timidité de sa prière silencieuse, maladive, pourtant tout
entière dressée vers le ciel. Je me demande si la lecture, chez Steiner, ne ressemble pas au dogme
catholique de la communion des saints, où la réelle présence du Christ, que les chrétiens cherchent —
et trouvent — dans le partage et la consommation de l'hostie — ou de celle, invisible, de la prière —
serait remplacée par l'espérance de la rencontre, et, au-delà de cette rencontre, d'une véritable
fondation, de personne à personne, d'un lien de parole marqué au coin du Logos.
Finalement, le paradoxe que nous avons soulevé n'est pas différent du paradoxe de la foi. Foi juive
bien sûr, inimitable mélange de confiance chenue et de doute indéracinable, foi dont je ne suis guère le
spécialiste, mais qui me semble plus radicalement hantée par la question de la disparition de Dieu,
voire, par celle de son impuissance — question bien sûr aiguisée jusqu'à l'absurde depuis sa mort dans
les camps de concentration allemands —, que ne l'est l'espérance catholique, invinciblement confiante
puisqu'elle se sait accomplie, consommée, depuis la venue du Christ, même si les doutes exposés par
exemple par André Néher, sont ceux de chrétiens tourmentés à l'extrême comme le furent Bloy ou
Bernanos, Lequier ou Kierkegaard, qui n'ont jamais cru que la foi était autre chose qu'une invincible
exigence de fermeté face à la tentation du désespoir, mais qui, de la même façon, ont compris que
cette foi serait bien peu de chose, une chose de rien, si la certitude épouvantable et le péril du
désespoir ne rôdaient autour d'eux.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

La critique littéraire
palamede
11 livres
Lecteurs de Juan Asensio (26)Voir plus
Quiz
Voir plus
Complétez les titres de Pierre Desproges
Chroniques de la haine ...
annoncée
ordinaire
amoureuse
nécessaire
10 questions
88 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre DesprogesCréer un quiz sur cet auteur88 lecteurs ont répondu