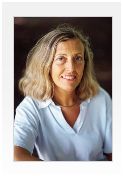Nationalité : France
Biographie :
Nicole Aubert, sociologue et psychologue, est professeur à l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP-EAP). Elle a mené de nombreuses recherches sur le coût humain de la performance et est auteur ou co-auteur de plusieurs livres dont, notamment, Le Coût de l'excellence et Le Stress professionnel.
Nicole Aubert, sociologue et psychologue, est professeur à l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP-EAP). Elle a mené de nombreuses recherches sur le coût humain de la performance et est auteur ou co-auteur de plusieurs livres dont, notamment, Le Coût de l'excellence et Le Stress professionnel.
Source : http://editions.flammarion.com
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
La quête de la vitesse, culminant dans l'instantanéité du temps réel qui abolit l'attente et supprime l'épaisseur de la durée, confère à l'individu une suprématie aléatoire et temporaire. Devenu apparemment maître du temps, il tombe simultanément sous le joug de l'urgence.
En dissociant complètement l'espace et le temps, elle ( la technologie) confère à l'individu le sentiment de pouvoir être en plusieurs temps à la fois et révèle, sinon une volonté d'anéantissement du temps, au moins un sentiment d'autonomie face au temps, un temps qu'il ne subit plus mais qu'il pose et croit maîtriser en fonction de ses seules aspirations subjectives.
Serge Tisseron montre ainsi comment, à côté du désir d’intimité de chacun, est apparu à travers ces nouveaux réseaux un autre désir qu’il appelle d’extimité, désir qui nous incite à montrer certains aspects de notre moi intime pour les faire valider par d’autres afin qu’ils prennent une valeur plus grande à nos yeux.
Le soubassement de ce nouveau rapport au temps réside dans l’alliance qui s’est opérée entre la logique du profit immédiat, celle des marchés financiers qui règnent en maîtres sur l’économie, et l’instantanéité des nouveaux moyens de communication. Cette alliance a donné naissance à un individu « en temps réel », fonctionnant selon le rythme même de l’économie et devenu apparemment maître du temps. Mais l’apparence est trompeuse et, derrière, se cache souvent un individu prisonnier du temps réel et de la logique de marché, incapable de différencier l’urgent de l’important, l’accessoire de l’essentiel. Dans une économie qui fonctionne « à flux tendu », n’est-il pas devenu lui-même un homme à flux tendu, un produit à durée éphémère, dont l’entreprise s’efforce de comprimer le plus possible le cycle de conception et la durée de vie, un produit de consommation dont il faut assurer la rentabilité immédiate et la rotation rapide ? La logique de court terme, qui préside au fonctionnement des marchés financiers, semble déteindre sur les relations entre l’entreprise et ses salariés et les conduire à adopter l’un à l’égard de l’autre une mentalité d’actionnaire « volatil », n’investissant sur l’autre que de manière éphémère, avec une visée immédiatement et uniquement rentabiliste.
L'"excès" qui caractérise le premier type d'individus (les winners) peut se repérer sur différents registres. Sur celui du mode de jouissance, d'abord, caractérisé par un "toujours plus", comme si l'hypermodernité révélait un "mode aigu de désintrication pulsionnelle", se manifestant dans un "pousse au plaisir", un "pousse à la jouissance", selon l'expression de Paul-Laurent Assoun, une sorte de "devoir de jouissance". Dans ce domaine, la seule loi possible de l'individu, c'est celle de son propre désir. Eugène Enriquez évoque ainsi l'apparition d'individus nouveaux "sans surmoi, sans idéal du Moi (sauf l'argent, le sexe, la sécurité ou la santé), et qui font de leur désir et de leur plaisir le paradigme de leur vie". Sur le registre de ses investissement professionnels, c'est au contraire l'environnement économique qui dicte ses contraintes en exigeant des individus des performances toujours plus grandes, dans un contexte où l'extrême pression du temps les enserre dans un climat d'urgence permanente. Dans le domaine de ses investissements personnels, enfin, un type particulier de conduites est apparu, les conduites dites "à risques", dans lesquelles la recherche des limites ultimes de la résistance corporelle constitue une forme nouvelle de recherche de sens, dans une société devenue précisément sans limites. Dans cette exigence de dépassement personnel, c'est une sorte de transcendance de lui-même que recherche l'individu, transcendance du dieu intérieur qu'il porte en lui et qui semble avoir pris la place du Dieu tout-puissant des religions traditionnelles. Sur tous ces registres, c'est la notion d'excès qui prédomine, un excès recherché ou subi, mais qui colore toutes ces expériences d'une intensité particulière.
Les deux faces de l'individualisme contemporain
Selon Robert Castel, le type de personnalité que nous qualifions d'"hypermoderne" émergerait dans les années 1970 en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Dans la société qui se dessine à partir de ces années-là, société où l'hyperconsommation devient la règle, société flexible, sans frontières et sans limites, société fluide ou "liquide", pour reprendre l'expression de Zygmund Bauman (2000), deux pôles extrêmes se dégagent, deux sortes d'idéaux types. D'un côté, des individus qui vivent dans une sorte d'excès permanent - excès de consommation, mais aussi excès de pressions, de sollicitations, de stress - et qui, en quête de performances toujours plus grandes, se brûlent dans l'hyperactivité tout en se débattant dans un rapport au temps toujours plus contraignant. Ceux-là, qui ressemblent par certains aspects à ces "défoncés", défonceurs d'eux-mêmes, dont Jean Cournut trace le portrait, correspondent à ce que Vincent de Gaulejac appelle la face "flamboyante" de l'individualisme contemporain. Mais si ceux-là ont pu accéder à l'autonomie et, de ce fait, entrer dans les aventures de la subjectivité", c'est aussi, comme le rappelle Robert Castel, parce qu'ils bénéficient d'un socle de ressources économiques et sociales. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui se situent sur le pôle opposé et qui constituent la face négative de l'hypermodernité, des individus qui n'ont jamais bénéficié de supports économiques ou dont les supports se sont effondrés et qui, dès lors, ont connu un parcours d'exclusion ou d'échec. La vacuité de l'existence des seconds s'opposerait ainsi à l'intensité de celle des premiers.
Selon Robert Castel, le type de personnalité que nous qualifions d'"hypermoderne" émergerait dans les années 1970 en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Dans la société qui se dessine à partir de ces années-là, société où l'hyperconsommation devient la règle, société flexible, sans frontières et sans limites, société fluide ou "liquide", pour reprendre l'expression de Zygmund Bauman (2000), deux pôles extrêmes se dégagent, deux sortes d'idéaux types. D'un côté, des individus qui vivent dans une sorte d'excès permanent - excès de consommation, mais aussi excès de pressions, de sollicitations, de stress - et qui, en quête de performances toujours plus grandes, se brûlent dans l'hyperactivité tout en se débattant dans un rapport au temps toujours plus contraignant. Ceux-là, qui ressemblent par certains aspects à ces "défoncés", défonceurs d'eux-mêmes, dont Jean Cournut trace le portrait, correspondent à ce que Vincent de Gaulejac appelle la face "flamboyante" de l'individualisme contemporain. Mais si ceux-là ont pu accéder à l'autonomie et, de ce fait, entrer dans les aventures de la subjectivité", c'est aussi, comme le rappelle Robert Castel, parce qu'ils bénéficient d'un socle de ressources économiques et sociales. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui se situent sur le pôle opposé et qui constituent la face négative de l'hypermodernité, des individus qui n'ont jamais bénéficié de supports économiques ou dont les supports se sont effondrés et qui, dès lors, ont connu un parcours d'exclusion ou d'échec. La vacuité de l'existence des seconds s'opposerait ainsi à l'intensité de celle des premiers.
La recherche du temps : Individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations
Nicole Aubert
Nicole Aubert
Bien sûr, le temps réel ne se compresse ni ne se contracte, il ne s’accélère pas. C’est nous qui devons accélérer toujours plus et les raisons de cette accélération sont d’ordre à la fois technologique et économique. Sur le premier registre, le changement de notre rapport au temps est en lien avec la révolution survenue dans les technologies de la communication qui ont instauré l’instantanéité, dont découle une exigence d’immédiateté dans la réponse attendue.
Une constante universelle recoupe cependant tous ces degrés de l’inégalité et la diversité des domaines qu’elle touche : c’est la différence basée sur le dimorphisme sexuel. En effet, même dans les sociétés les moins élaborées, « la vie sociale et culturelle... est basée dans ses formes en grande partie sur la différenciation des deux sexes, sur la disparité de rôles attribués à l’homme et à la femme.
C'est donc cette personnalité fondamentalement individualiste que nous tentons d'appréhender dans cet ouvrage. Une personnalité qui s'inscrit dans l'univers de la mondialisation économique, de plus en plus dominé par les lois du marché et structuré par un temps mondial qui s'accélère et se compresse. Une personnalité qui évolue dans une société de la satisfaction immédiate et de "l'éclatement des limites", dans laquelle la notion de sens, souvent cantonnée à l'instant et au moment présent, ne semble plus guère trouver d'autre référent commun que celui du "risque partagé". Dans ce contexte, où l'adhésion se fait plus à soi-même qu'à une cause, et où l'individu, devenu avant tout un consommateur, doit aussi lutter pour son existence sociale, on assiste à une recomposition de l'identité personnelle, à la fois renforcée et fragilisée, au renouvellement des profils psychologiques, à l'émergence de nouveaux types de pathologies, à une hyper-compétitivité permanente et à un rapport au temps inédit.
Pour comprendre l'évolution qui s'est effectuée, on peut opposer, comme le fait Marcel Gauchet (1998), la personnalité contemporaine aux types de personnalités qui l'ont précédée. A la personnalité traditionnelle, correspond aux mondes sociaux d'avant l'individualisme et qui s'était constituée par l'incorporation des normes collectives, aurait ainsi succédé la personnalité moderne, incarnée peu ou prou dans l'individu "classique" des XVIIIe et XIXe siècles, et mettant au premier plan les notions de conscience, de responsabilité et d'intériorisation de ce qui est reçu de la société. La personnalité contemporaine, quant à elle, serait caractérisée par un effacement de cette "structuration par l'appartenance" et se présenterait comme un individu "déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout", et pour lequel "il n'y a plus de sens à se placer au point de vue de l'ensemble".
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Libérer le temps
Annagau
13 livres
Auteurs proches de Nicole Aubert
Lecteurs de Nicole Aubert (66)Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous Hunger Games
Quel est le titre du premier tome?
Hunger Games
L'embrasement
La révolution
La moisson
43 questions
88 lecteurs ont répondu
Thème : Hunger Games, tome 1 de
Suzanne CollinsCréer un quiz sur cet auteur88 lecteurs ont répondu