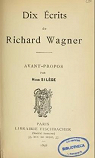Citations de Richard Wagner (64)
UNE SOIRÉE HEUREUSE 2
On nous donna de fort belles choses, entre autres la symphonie de Mozart en mi bémol et celle de Beethoven en la. Quant le concert fut fini, mon ami resta en face de moi, les bras croisés sur la poitrine, muet, la figure souriante. La foule s’écoulait à petit bruit ; quelques personnes demeurèrent attablées çà et là dans les bosquets ; l’air du soir se refroidissait aux premières bouffées du vent de la nuit.
— Si nous prenions un verre de punch ? dit R... en se levant pour appeler le garçon.
Nous nous trouvions dans une de ces dispositions d’esprit qui sont trop précieuses pour ne pas chercher à les prolonger. Le punch ne pouvait que bien faire, et nous maintenir dans notre exaltation artistique. J’acceptai avec joie l’offre de R…, et bientôt après, un bol assez volumineux faisait jouer devant nous ses flammes bleuâtres.
— Que dis-tu de l’orchestre, demandai-je à R… après les premières rasades ? Es-tu satisfait de la manière dont il a exécuté la symphonie ?
— Eh ! que parles-tu d’exécution, répondit-il ! Il y a des moments où les ouvrages que j’affectionne, si mal qu’ils soient joués, ne m’en plongent pas moins dans le ravissement ; et tu sais que j’ai l’ouïe très susceptible. Ces moments sont rares, à la vérité, et ils n’exercent leur doux empire sur moi, que quand mon âme est en parfaite harmonie avec ses organes matériels. Il suffit alors de la plus légère impulsion extérieure, pour que le morceau qui répond complètement à ce que j’éprouve en moi-même retentisse aussitôt dans mon cœur avec une perfection idéale, et telle que le meilleur orchestre du monde ne saurait y atteindre. Dans ces moments-là, mon ouïe, si difficile d’ailleurs, est assez souple pour que le couac d’un hautbois ne provoque tout au plus chez moi qu’un léger mouvement d’impatience ; avec un indulgent sourire je laisse glisser sur mon oreille le son faux d’une trompette, sans que le sentiment de béatitude où je me trouve en souffre, et sans que je cesse pour cela de me faire accroire que j’assiste à une exécution irréprochable. Or, dans une telle disposition d’esprit, rien ne me révolte plus que de voir un fat à l’oreille dédaigneuse qui s’indigne contre ces petits accidents, et qui s’en ira demain admirer au théâtre les roulades discordantes de quelque cantatrice en renom, qui blessent tout à la fois les nerfs et l’âme. C’est que chez les connaisseurs au goût si subtil et si superbe, la musique n’est qu’une affaire d’oreilles, souvent même ils n’en jugent que par les yeux. Je me rappelle avoir vu de ces messieurs qui, après avoir laissé passer une note fausse sans froncer le sourcil, l’instant d’après se bouchaient les oreilles, quand ils voyaient l’artiste, troublé et confus, hocher la tête en signe de dépit.
On nous donna de fort belles choses, entre autres la symphonie de Mozart en mi bémol et celle de Beethoven en la. Quant le concert fut fini, mon ami resta en face de moi, les bras croisés sur la poitrine, muet, la figure souriante. La foule s’écoulait à petit bruit ; quelques personnes demeurèrent attablées çà et là dans les bosquets ; l’air du soir se refroidissait aux premières bouffées du vent de la nuit.
— Si nous prenions un verre de punch ? dit R... en se levant pour appeler le garçon.
Nous nous trouvions dans une de ces dispositions d’esprit qui sont trop précieuses pour ne pas chercher à les prolonger. Le punch ne pouvait que bien faire, et nous maintenir dans notre exaltation artistique. J’acceptai avec joie l’offre de R…, et bientôt après, un bol assez volumineux faisait jouer devant nous ses flammes bleuâtres.
— Que dis-tu de l’orchestre, demandai-je à R… après les premières rasades ? Es-tu satisfait de la manière dont il a exécuté la symphonie ?
— Eh ! que parles-tu d’exécution, répondit-il ! Il y a des moments où les ouvrages que j’affectionne, si mal qu’ils soient joués, ne m’en plongent pas moins dans le ravissement ; et tu sais que j’ai l’ouïe très susceptible. Ces moments sont rares, à la vérité, et ils n’exercent leur doux empire sur moi, que quand mon âme est en parfaite harmonie avec ses organes matériels. Il suffit alors de la plus légère impulsion extérieure, pour que le morceau qui répond complètement à ce que j’éprouve en moi-même retentisse aussitôt dans mon cœur avec une perfection idéale, et telle que le meilleur orchestre du monde ne saurait y atteindre. Dans ces moments-là, mon ouïe, si difficile d’ailleurs, est assez souple pour que le couac d’un hautbois ne provoque tout au plus chez moi qu’un léger mouvement d’impatience ; avec un indulgent sourire je laisse glisser sur mon oreille le son faux d’une trompette, sans que le sentiment de béatitude où je me trouve en souffre, et sans que je cesse pour cela de me faire accroire que j’assiste à une exécution irréprochable. Or, dans une telle disposition d’esprit, rien ne me révolte plus que de voir un fat à l’oreille dédaigneuse qui s’indigne contre ces petits accidents, et qui s’en ira demain admirer au théâtre les roulades discordantes de quelque cantatrice en renom, qui blessent tout à la fois les nerfs et l’âme. C’est que chez les connaisseurs au goût si subtil et si superbe, la musique n’est qu’une affaire d’oreilles, souvent même ils n’en jugent que par les yeux. Je me rappelle avoir vu de ces messieurs qui, après avoir laissé passer une note fausse sans froncer le sourcil, l’instant d’après se bouchaient les oreilles, quand ils voyaient l’artiste, troublé et confus, hocher la tête en signe de dépit.
UNE SOIRÉE HEUREUSE
Fantaisie sur la musique pittoresque.
C’était par une belle soirée de printemps ; de chaudes ondulations glissaient par intervalles dans les airs, et nous annonçaient l’été, comme de brûlants soupirs d’amour. Nous suivions la foule qui se dirigeait vers un jardin public hors barrière : un corps de musiciens ouvrait ce soir-là une série de concerts qu’ils donnent annuellement dans cette localité. C’était une véritable fête : mon ami R… semblait dans l’extase. Avant que le concert ne commençât, il était déjà tout enivré d’harmonie ; il prétendait que c’était la musique intérieure qui d’avance vibrait et retentissait en lui. Nous nous établîmes sous un grand chêne : c’était notre place ordinaire ; on y était isolé de la foule, et l’on y entendait très distinctement la musique. De tout temps nous avons pris en pitié les malheureux auditeurs qui s’obstinent à se placer le plus près possible de l’orchestre ; nous ne pouvons nous expliquer le plaisir qu’ils semblent trouver à voir en quelque sorte la musique au lieu de l’entendre ; à suivre avec une anxiété curieuse les moindres mouvements des exécutants ; à guetter le moment où le timbalier, après avoir scrupuleusement compté les pauses, se dispose enfin à prendre sa part de la fête, et à faire gronder son instrument sous quelques coups vigoureux. Rien de plus prosaïque, rien qui désillusionne plus que les joues bouffies, les traits grotesquement contractés du trombone ou du cor, les mouvements saccadés des mains qui grimpent le long des chanterelles, des basses et des violoncelles, ou même l’éternel va et vient, de l’archet des violons. Voilà pourquoi nous avions choisi une place, où sans rien perdre des nuances les plus délicates du jeu des instruments, nous nous épargnions l’aspect de l’orchestre.
Fantaisie sur la musique pittoresque.
C’était par une belle soirée de printemps ; de chaudes ondulations glissaient par intervalles dans les airs, et nous annonçaient l’été, comme de brûlants soupirs d’amour. Nous suivions la foule qui se dirigeait vers un jardin public hors barrière : un corps de musiciens ouvrait ce soir-là une série de concerts qu’ils donnent annuellement dans cette localité. C’était une véritable fête : mon ami R… semblait dans l’extase. Avant que le concert ne commençât, il était déjà tout enivré d’harmonie ; il prétendait que c’était la musique intérieure qui d’avance vibrait et retentissait en lui. Nous nous établîmes sous un grand chêne : c’était notre place ordinaire ; on y était isolé de la foule, et l’on y entendait très distinctement la musique. De tout temps nous avons pris en pitié les malheureux auditeurs qui s’obstinent à se placer le plus près possible de l’orchestre ; nous ne pouvons nous expliquer le plaisir qu’ils semblent trouver à voir en quelque sorte la musique au lieu de l’entendre ; à suivre avec une anxiété curieuse les moindres mouvements des exécutants ; à guetter le moment où le timbalier, après avoir scrupuleusement compté les pauses, se dispose enfin à prendre sa part de la fête, et à faire gronder son instrument sous quelques coups vigoureux. Rien de plus prosaïque, rien qui désillusionne plus que les joues bouffies, les traits grotesquement contractés du trombone ou du cor, les mouvements saccadés des mains qui grimpent le long des chanterelles, des basses et des violoncelles, ou même l’éternel va et vient, de l’archet des violons. Voilà pourquoi nous avions choisi une place, où sans rien perdre des nuances les plus délicates du jeu des instruments, nous nous épargnions l’aspect de l’orchestre.
Je finis par envoyer mon nouveau travail à Meyerbeer à Berlin, en le priant de le faire recevoir au Théâtre royal de cette ville. La chose fut faite assez vite. Mon Rienzi étant déjà reçu au théâtre royal de Dresde, j’envisageai la représentation de deux de mes œuvres sur les premières scènes allemandes, et je fus involontairement obsédé de cette pensée, que par une fortune singulière Paris m’avait été du plus grand secours pour l’Allemagne. Quant à Paris même, je n’y avais maintenant plus rien en perspective de quelques années : je le quittai donc au printemps de 1842. Pour la première fois je vis le Rhin....; les yeux mouillés de claires larmes, je jurai, pauvre musicien, une fidélité éternelle à ma patrie allemande.
Pendant ce temps, je fus engagé par Schlesinger à écrire dans sa Gazette musicale : je fournis plusieurs articles développés Sur la musique allemande, etc. On goûta surtout vivement une petite nouvelle intitulée : une Visite à Beethoven. Ces travaux ne m’ont pas peu aidé à être connu et estimé à Paris. Au mois de novembre de cette année, j’avais complètement terminé la partition de mon Rienzi, et je l’envoyai sans retard à Dresde. Ce fut le point culminant de ma situation absolument déplorable : j’écrivis pour la Gazette musicale une petite nouvelle, la Fin d’un musicien allemand à Paris, dans laquelle je faisais mourir l’infortuné héros avec la profession de foi suivante : « Je crois en Dieu, en Mozart et en Beethoven ». Il était heureux que mon opéra fût terminé, car je me vis forcé de renoncer pour longtemps à l’exercice de tout ce qui était art ; je dus entreprendre, au service de Schlesinger, des arrangements[21] pour tous les instruments du monde, même pour cornet à pistons[22] ; à ce prix, je trouvai à ma situation un léger adoucissement. Je passai donc l’hiver de 1841 de la façon la moins glorieuse. Au printemps, je me retirai à la campagne, à Meudon ; la chaude approche de l’été me fit soupirer de nouveau après un travail intellectuel ; l’occasion devait s’en présenter plus tôt que je ne le pensais. J’appris positivement que mon projet de texte pour le Hollandais errant avait été déjà communiqué à un poète, Paul Fouché[23], et je vis que si je ne finissais pas par me déclarer prêt à m’en dessaisir, j’en serais entièrement frustré sous n’importe quel prétexte ; je finis par consentir, pour une certaine somme, à céder ce canevas. Je n’eus alors rien de plus pressé que de traiter mon sujet moi-même en vers allemands. Pour me mettre à l’œuvre, j’avais besoin d’un piano ; car, après avoir interrompu pendant neuf mois toute production musicale, je dus chercher d’abord à me replacer dans une atmosphère musicale : je louai un piano. L’instrument arrivé, je tournai autour, pris d’une véritable angoisse : je tremblais maintenant d’avoir à découvrir que je n’étais plus du tout musicien. Je commençai d’abord par le chœur des matelots et la chanson des fileuses ; en un clin d’œil tout marcha à souhait, et je poussai de bruyants cris de joie à cette constatation, profondément ressentie, que j’étais encore musicien. En sept semaines, l’opéra entier fut composé. Mais, à la fin de ce laps de temps, les plus vulgaires soucis matériels m’accablèrent : il fallut deux grands mois avant que je pusse parvenir à écrire l’ouverture de l’opéra terminé, bien que je la portasse à peu près achevée dans ma tête. Naturellement je n’eus rien de plus à cœur que de chercher à faire promptement représenter cet opéra en Allemagne : de Munich et de Leipzig on me répondit par cette formule de refus, que l’œuvre ne convenait pas à l’Allemagne. Naïf que j’étais, j’avais cru qu’elle ne convenait qu’à l’Allemagne, parce qu’elle touchait des cordes qui ne sont en état de vibrer que chez l’Allemand.
La seule chose, digne de remarque pour le musicien, que renferme Paris, c’est l’orchestre du Conservatoire. Les exécutions des œuvres symphoniques allemandes dans ces concerts ont produit sur moi une impression profonde, et m’ont initié de nouveau aux merveilleux mystères de l’art véritable. Qui veut apprendre à connaître à fond la neuvième symphonie de Beethoven, doit l’entendre jouer par l’orchestre du Conservatoire de Paris… Mais ces concerts sont complètement isolés, rien ne s’y rattache.
Je ne frayais presque pas du tout avec des musiciens : des lettrés, des peintres, formaient ma société ; j’ai fait à Paris plus d’une belle expérience d’amitié.
Me trouvant ainsi dans cette ville sans la moindre perspective en vue, je repris la composition de mon Rienzi ; je le destinais maintenant à Dresde, d’abord parce que je savais qu’à ce théâtre on avait sous la main les meilleurs interprètes, la Devrient, Tichatschek[20], etc., ensuite parce que je pouvais espérer, avec l’aide de mes relations de jeunesse, y trouver accès du premier coup. Je renonçai donc à peu près entièrement à ma Défense d’aimer ; je sentis que son auteur n’avait plus droit à mon estime. Je n’en fus que plus indépendant pour me conformer à ma vraie foi artistique pendant l’achèvement de mon Rienzi. Des soucis de diverses sortes, une misère noire, tourmentèrent ma vie à cette époque. Soudain Meyerbeer reparut pour quelque temps à Paris ; il s’informa avec le plus aimable intérêt de l’état de mes affaires, et voulut me venir en aide. Il me mit alors en relations avec le directeur du Grand Opéra, Léon Pillet : à cette occasion, il fut question d’un opéra en deux ou trois actes dont on me confierait la composition pour ce théâtre. Dans cette éventualité, je m’étais déjà pourvu d’un canevas de sujet. Le Hollandais errant, dont j’avais fait sur mer la connaissance intime, avait persisté à captiver mon imagination ; de plus, j’eus connaissance de l’emploi caractéristique qu’avait fait Henri Heine de cette légende dans une partie de son Salon. En particulier, le mode de rédemption de cet Ahasvérus de l’Océan, emprunté par Heine à une pièce hollandaise du même titre, acheva de me mettre en main tous les moyens propres à faire de cette légende un sujet d’opéra. Je m’entendis là-dessus avec Heine lui-même, je composai le canevas et le transmis à M. Léon Pillet, avec la proposition de faire faire d’après lui un livret français. Les choses en étaient arrivées là, quand Meyerbeer quitta encore Paris et dut abandonner au destin l’accomplissement de mes vœux. Bientôt j’appris avec stupéfaction que l’esquisse présentée à M. Pillet lui plaisait tellement, qu’il désirait que je la lui cédasse. Il se disait obligé, par une ancienne promesse, de confier un livret à un autre compositeur le plus tôt possible ; l’esquisse par moi imaginée lui semblait parfaitement appropriée à ce but ; il pensait que je n’hésiterais pas à consentir à la cession demandée, si je réfléchissais qu’il m’était impossible d’espérer obtenir, avant un laps de quatre ans, la commande immédiate d’un opéra, vu qu’il avait d’abord à remplir les promesses faites à plusieurs candidats ; naturellement il me semblerait trop long, en attendant cette époque, d’aller colportant mon sujet ; j’en inventerais un nouveau, et je me consolerais certainement d’avoir fait ce sacrifice. Je combattis opiniâtrement cette prétention, sans pouvoir obtenir autre chose que l’ajournement provisoire de la question. Je comptais sur un prompt retour de Moyerbeer, et je gardai le silence.
Je ne frayais presque pas du tout avec des musiciens : des lettrés, des peintres, formaient ma société ; j’ai fait à Paris plus d’une belle expérience d’amitié.
Me trouvant ainsi dans cette ville sans la moindre perspective en vue, je repris la composition de mon Rienzi ; je le destinais maintenant à Dresde, d’abord parce que je savais qu’à ce théâtre on avait sous la main les meilleurs interprètes, la Devrient, Tichatschek[20], etc., ensuite parce que je pouvais espérer, avec l’aide de mes relations de jeunesse, y trouver accès du premier coup. Je renonçai donc à peu près entièrement à ma Défense d’aimer ; je sentis que son auteur n’avait plus droit à mon estime. Je n’en fus que plus indépendant pour me conformer à ma vraie foi artistique pendant l’achèvement de mon Rienzi. Des soucis de diverses sortes, une misère noire, tourmentèrent ma vie à cette époque. Soudain Meyerbeer reparut pour quelque temps à Paris ; il s’informa avec le plus aimable intérêt de l’état de mes affaires, et voulut me venir en aide. Il me mit alors en relations avec le directeur du Grand Opéra, Léon Pillet : à cette occasion, il fut question d’un opéra en deux ou trois actes dont on me confierait la composition pour ce théâtre. Dans cette éventualité, je m’étais déjà pourvu d’un canevas de sujet. Le Hollandais errant, dont j’avais fait sur mer la connaissance intime, avait persisté à captiver mon imagination ; de plus, j’eus connaissance de l’emploi caractéristique qu’avait fait Henri Heine de cette légende dans une partie de son Salon. En particulier, le mode de rédemption de cet Ahasvérus de l’Océan, emprunté par Heine à une pièce hollandaise du même titre, acheva de me mettre en main tous les moyens propres à faire de cette légende un sujet d’opéra. Je m’entendis là-dessus avec Heine lui-même, je composai le canevas et le transmis à M. Léon Pillet, avec la proposition de faire faire d’après lui un livret français. Les choses en étaient arrivées là, quand Meyerbeer quitta encore Paris et dut abandonner au destin l’accomplissement de mes vœux. Bientôt j’appris avec stupéfaction que l’esquisse présentée à M. Pillet lui plaisait tellement, qu’il désirait que je la lui cédasse. Il se disait obligé, par une ancienne promesse, de confier un livret à un autre compositeur le plus tôt possible ; l’esquisse par moi imaginée lui semblait parfaitement appropriée à ce but ; il pensait que je n’hésiterais pas à consentir à la cession demandée, si je réfléchissais qu’il m’était impossible d’espérer obtenir, avant un laps de quatre ans, la commande immédiate d’un opéra, vu qu’il avait d’abord à remplir les promesses faites à plusieurs candidats ; naturellement il me semblerait trop long, en attendant cette époque, d’aller colportant mon sujet ; j’en inventerais un nouveau, et je me consolerais certainement d’avoir fait ce sacrifice. Je combattis opiniâtrement cette prétention, sans pouvoir obtenir autre chose que l’ajournement provisoire de la question. Je comptais sur un prompt retour de Moyerbeer, et je gardai le silence.
Mes opinions prématurées et inconsidérées sur les procédés musicaux reçurent le coup de grâce… des Italiens. Ces héros du chant si vantés, Rubini en tête, m’ont complètement dégoûté de leur musique. Le public qui les écoute a contribué pour sa part à cet effet. Le Grand Opéra me laissa tout à fait mécontent par l’absence de tout esprit supérieur dans ses interprétations : je trouvai tout commun et médiocre. La mise en scène[17] et les décors, je le dis franchement, sont ce que je préfère dans toute l’Académie royale de musique[18] L’Opéra-Comique aurait été bien plutôt en état de me satisfaire ; il possède les premiers talents, et ses représentations offrent quelque chose de complet et d’original, que nous ignorons en Allemagne. Mais ce qu’on écrit actuelfement pour ce théâtre appartient aux plus détestables productions qui aient jamais paru aux époques de dégénération artistique. Où s’est enfuie la grâce de Méhul, d’Isouard[19], de Boïeldieu et du jeune Auber, devant les ignobles rythmes de quadrille qui, à l’heure qu’il est, remplissent ce théâtre de leur fracas ?
C’est ainsi que j’entrai dans l’été de 1840, complètement dénué de toute perspective prochaine ; mes relations avec Habeneck, Halévy, Berlioz, etc., ne pouvaient nullement contribuer à m’en ouvrir quelqu’une : à Paris, il n’existe pas d’artiste qui ait le temps de lier amitié avec un autre, chacun se démène et s’agite pour son propre compte. Halévy, comme tous les compositeurs parisiens de notre époque, n’a été enflammé d’enthousiasme pour son art que juste le temps qu’il fallut avant d’arriver à obtenir un grand succès : à peine celui-ci remporté, et l’auteur rangé dans la catégorie privilégiée des lions[15] de la musique, qu’il n’eut en tête qu’une chose, faire des opéras et en tirer argent. La renommée[16] est tout à Paris, elle fait le bonheur et la perte des artistes. — Berlioz, en dépit de son caractère déplaisant, m’attira beaucoup plus : il y a entre lui et ses collègues parisiens cette immense différence qu’il ne fait pas sa musique pour gagner de l’argent. Mais il ne peut écrire pour l’art pur, le sens du beau lui manque. Il reste complètement isolé dans sa tendance : il n’a personne à ses côtés qu’une troupe d’adorateurs, qui, platement et sans le moindre jugement, saluent en lui le créateur d’un système de musique tout battant neuf, et lui ont complètement tourné la tête ; en dehors d’eux, tout le monde l’évite comme un fou.
Pour nous remettre de ce voyage extrêmement fatigant, nous nous arrêtâmes huit jours à Londres ; rien ne m’intéressa autant que la ville même et les deux Chambres ; quant aux théâtres, je n’y mis pas les pieds. À Boulogne-sur-Mer, je restai quatre semaines : là, j’entrai pour la première fois en relations avec Meyerbeer, et je lui fis connaître les deux actes terminés de mon Rienzi ; il me promit son appui à Paris le plus amicalement du monde. Avec fort peu d’argent, mais force espérances, j’entrai donc à Paris. Je n’avais absolument pas d’autres recommandations que l’unique adresse de Meyerbeer ; celui-ci parut s’employer, avec les attentions les plus marquées, à tout ce qui pouvait servir à mes fins, et je me croyais certain d’atteindre bientôt le but désiré, sans la malchance qui voulut que, pendant presque tout le temps de mon séjour à Paris, Meyerbeer, le plus souvent, et même à peu près constamment, en fût éloigné. Il est vrai qu’il eut l’intention de m’être utile même de loin ; mais, d’après ses propres prédictions, des démarches par lettres ne pouvaient être suivies d’aucun résultat, dans des cas où c’était surtout une insistance personnelle sans relâche qui devait être de quelque effet. J’entrai d’abord en rapport avec le théâtre de la Renaissance, qui donnait alors à la fois des drames et des opéras. La partition de ma Défense d’aimer me sembla tout à fait appropriée à ce théâtre ; je me disais même que le sujet tant soit peu léger serait bon à arranger pour la scène française. J’étais si chaudement recommandé par Meyerbeer au directeur du théâtre, qu’il ne pouvait faire autrement que de me donner les meilleures assurances. En conséquence, un des dramaturges parisiens les plus féconds, Dumersan[14], s’offrit à moi pour entreprendre l’arrangement du sujet. Trois morceaux, destinés à une audition, furent traduits par lui avec un si grand bonheur, que ma musique avait l’air de mieux s’adapter au nouveau texte français qu’elle ne marchait sur les vers allemands primitifs ; c’était même de la musique telle que les Français ont le moins de peine à la comprendre et tout me promettait le meilleur succès, quand, sur ces entrefaites, le théâtre de la Renaissance fît faillite. Tous mes efforts, tous mes espoirs étaient donc vains. Pendant cette même saison d’hiver de 1839 à 1840, je composai, outre une ouverture pour la première partie du Faust de Gœthe, plusieurs mélodies françaises, parmi lesquelles une traduction française faite pour moi des Deux Grenadiers d’Henri Heine. Quant à la possibilité de réaliser une exécution de mon Rienzi à Paris, je n’y ai jamais songé ; je prévoyais avec certitude qu’il me faudrait attendre au moins cinq ou six ans, avant qu’un tel plan, même dans le cas le plus heureux, pût devenir exécutable ; la traduction de cet opéra, déjà à moitié achevé, aurait même créé d’insurmontables obstacles.
Quand je me mis, en automne, à la composition musicale de mon Rienzi, je ne m’assujettis à rien autre qu’au but unique de répondre à mon sujet ; je ne me proposai pas de modèle, mais je m’abandonnai exclusivement au sentiment qui me consumait, au sentiment que j’avais d’être maintenant assez avancé pour exiger du développement de mes facultés artistiques quelque chose qui marquât, et pour ne rien en attendre d’insignifiant. La pensée d’être sciemment plat ou trivial, ne fût-ce qu’une seule mesure, m’était insupportable. Plein d’enthousiasme, je continuai à composer pendant l’hiver, si bien qu’au printemps de 1839, j’avais terminé les deux grands premiers actes. À ce moment, mon engagement avec le directeur du théâtre prenait fin, et des circonstances spéciales me dégoûtaient de rester plus longtemps à Riga. Déjà, depuis deux ans, je nourrissais le dessein d’aller à Paris ; dans ce but, j’avais déjà envoyé à Scribe, de Kœnigsberg, l’esquisse d’un sujet d’opéra, avec la proposition de le traiter pour son compte au cas où il lui plairait, et de me procurer la commande d’en faire un opéra pour Paris. Naturellement Scribe n’en avait fait aucun cas. Néanmoins, je n’abandonnai pas mes projets ; bien plus, dans l’été de 1830, je les repris activement ; bref, je décidai ma femme à s’embarquer avec moi à bord d’un voilier qui devait nous conduire jusqu’à Londres. Cette traversée restera pour moi éternellement inoubliable ; elle dura trois semaines et demie, et fut féconde en accidents. Trois fois nous eûmes à subir la plus violente tempête et, dans un des cas, le capitaine se vit forcé de se réfugier dans un port norwégien. Le passage à travers les brisants des côtes norwégiennes produisit sur mon imagination une impression merveilleuse. La légende du Hollandais errant, telle que j’en reçus confirmation par la bouche des matelots, revêtit en moi une couleur tranchée, spéciale, que purent seules lui prêter les aventures par moi courues.
Pendant l’été de 1837, je fis un court séjour à Dresde. J’y fus ramené, par la lecture du roman de Bulwer, Rienzi, à l’idée, déjà couvée et caressée, de faire du dernier tribun romain le héros d’un grand opéra tragique. J’en fus empêché par des circonstances extérieures contraires, et je cessai d’ébaucher des projets. Pendant l’automne de cette même année, je me rendis à Riga pour entrer en fonction comme premier Musikdirector dans le théâtre récemment inauguré sous la direction d’Holtei. Je trouvai réunies là d’excellentes ressources pour l’exécution de l’opéra, et je me mis à les employer avec beaucoup d’ardeur. C’est alors que je composai, au service particulier de chaque chanteur, plusieurs morceaux à intercaler dans des opéras. Je fis aussi le texte d’un opéra comique en deux actes, l’Heureuse famille des ours, dont j’empruntai le sujet à un conte des Mille et une nuits. J’en avais déjà composé deux numéros, quand je m’aperçus avec dégoût que j’étais encore en train de faire de la musique à la Adam[12] ; mon sens le plus intime se trouva inconsolablement blessé par cette découverte. J’abandonnai mon travail avec horreur. La mise à l’étude et la direction quotidienne de la musique d’Adam et de Bellini avaient donc fini par produire leur effet, en me gâtant bientôt à fond l’insouciant plaisir que j’y prenais. La complète incapacité du public de théâtre de nos villes provinciales, en ce qui concerne un premier jugement à porter sur une œuvre nouvelle (habitué qu’il est à ne voir représenter que des œuvres déjà appréciées et accréditées à l’étranger), me suggéra la résolution de ne faire représenter pour la première fois dans des théâtres inférieurs, à aucun prix, une œuvre de quelque importance. C’est pourquoi, ayant éprouvé de nouveau le besoin d’entreprendre une œuvre de la sorte, je renonçai complètement à sa prompte et prochaine exécution ; je supposai qu’il y avait quelque part un théâtre d’importance qui la jouerait quelque jour, et m’embarrassai peu de savoir quand et où la chose se passerait. C’est dans ces dispositions que je conçus le projet d’un grand opéra tragique en cinq actes : Rienzi, le dernier des tribuns ; le plan, a priori, était si considérable, qu’il devenait impossible, au moins pour la première fois, de faire représenter cet opéra sur un petit théâtre. De plus, le despotique sujet n’admettait rien en dehors de lui, et dans ma conduite, la prévoyance cédait plutôt le pas à la nécessité. Je traitai le sujet pendant l’été de 1838. À cette époque, je faisais étudier à notre personnel d’opéra, avec beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme, Jacob et ses fils[13], de Méhul.
Pendant ce temps, la rigueur de la vie avait frappé à ma porte : la rapide prise de possession de mon indépendance extérieure m’avait induit à toute espèce de folies ; j’étais à bout d’argent, criblé de dettes. Je m’avisai de risquer n’importe quel moyen exceptionnel pour ne pas glisser dans l’ornière banale de la misère. Sans la moindre perspective, je me rendis à Berlin, et je présentai ma Défense d’aimer au directeur du théâtre royal-municipal. Accueilli dès l’abord par les meilleures promesses, je dus reconnaître, après une longue attente, qu’aucune d’elles n’avait été loyalement faite. Je quittai Berlin dans la plus fâcheuse situation, et je me rendis à Kœnigsberg en Prusse, pour solliciter la place de Musikdirector au théâtre de cette ville, place que je réussis à obtenir plus tard. De plus, je m’y mariai pendant l’automne de 1836, et pour tout dire, dans une situation des plus hasardeuses. L’année que je passai à Kœnigsberg, au milieu des soucis les plus mesquins, fut entièrement perdue pour mon art. Je n’écrivis qu’une ouverture : Rule Britannia.
Tout, autour de moi, me semblait en fermentation : me laisser gagner par cette fermentation me parut la chose du monde la plus naturelle. Dans un beau voyage d’été aux eaux de la Bohême, j’esquissai le plan d’un nouvel opéra, Défense d’aimer, dont j’empruntai le sujet au drame de Shakespeare, Mesure pour mesure, avec la seule différence que j’en supprimai le ton sérieux prédominant, et le façonnai si bien dans le sens de la Jeune Europe, que la libre et franche sensualité, par sa seule et unique puissance, l’emportait sur le puritanisme hypocrite.
C’est aussi pendant l’été de cette même année 1834 que j’acceptai la place de Musikdirector au théâtre de Magdebourg. L’application pratique de mes connaissances musicales, dans les fonctions de chef d’orchestre, me causa bientôt un vif plaisir ; les relations insolites avec les chanteurs et les chanteuses, dans les coulisses et aux feux de la rampe, répondaient tout à fait à mou goût pour des distractions variées. La composition de ma Défense d’aimer était commencée. J’exécutai dans un concert l’ouverture de mes Fées : elle plut beaucoup. Néanmoins je me dégoûtai de cet opéra, et, ne pouvant surtout continuer à poursuivre en personne mes intérêts à Leipzig, je résolus bientôt de ne plus m’inquiéter de cette œuvre, ce qui revenait à y renoncer. À l’occasion d’un festival pour la nouvelle année 1835, je composai à la volée une musique qui intéressa généralement. De tels succès, facilement obtenus, me confirmaient fort dans l’opinion qu’il n’était nullement besoin, pour plaire, d’apporter dans le choix des moyens un soin par trop scrupuleux. C’est dans cet esprit que je poursuivis la composition de ma Défense d’aimer ; je ne me donnai pas la moindre peine pour éviter les réminiscences françaises et italiennes. Interrompu dans mon travail pendant quelque temps, je le repris dans l’hiver de 1835 à 1836, et je l’achevai peu de temps avant que la troupe du théâtre de Magdebourg se dispersât. Il ne me restait plus que douze jours jusqu’au départ des premiers sujets ; il fallait que, dans cet intervalle, non seulement mon opéra fût appris, mais encore représenté par eux. Avec plus d’étourderie que de réflexion, je laissai passer à la scène, après une étude de dix jours, un opéra qui contenait de très forts rôles ; je me fiais au souffleur et à mon bâton de chef d’orchestre. Malgré cela, je ne pus empêcher que les chanteurs ne sussent leurs rôles qu’à moitié tout au plus. Pour tout le monde, la représentation fut comme un rêve ; personne ne put se faire une idée de la chose ; ce qui marcha à moitié bien n’en fut pas moins dûment applaudi. La deuxième représentation, pour divers motifs, ne put avoir lieu.
C’est aussi pendant l’été de cette même année 1834 que j’acceptai la place de Musikdirector au théâtre de Magdebourg. L’application pratique de mes connaissances musicales, dans les fonctions de chef d’orchestre, me causa bientôt un vif plaisir ; les relations insolites avec les chanteurs et les chanteuses, dans les coulisses et aux feux de la rampe, répondaient tout à fait à mou goût pour des distractions variées. La composition de ma Défense d’aimer était commencée. J’exécutai dans un concert l’ouverture de mes Fées : elle plut beaucoup. Néanmoins je me dégoûtai de cet opéra, et, ne pouvant surtout continuer à poursuivre en personne mes intérêts à Leipzig, je résolus bientôt de ne plus m’inquiéter de cette œuvre, ce qui revenait à y renoncer. À l’occasion d’un festival pour la nouvelle année 1835, je composai à la volée une musique qui intéressa généralement. De tels succès, facilement obtenus, me confirmaient fort dans l’opinion qu’il n’était nullement besoin, pour plaire, d’apporter dans le choix des moyens un soin par trop scrupuleux. C’est dans cet esprit que je poursuivis la composition de ma Défense d’aimer ; je ne me donnai pas la moindre peine pour éviter les réminiscences françaises et italiennes. Interrompu dans mon travail pendant quelque temps, je le repris dans l’hiver de 1835 à 1836, et je l’achevai peu de temps avant que la troupe du théâtre de Magdebourg se dispersât. Il ne me restait plus que douze jours jusqu’au départ des premiers sujets ; il fallait que, dans cet intervalle, non seulement mon opéra fût appris, mais encore représenté par eux. Avec plus d’étourderie que de réflexion, je laissai passer à la scène, après une étude de dix jours, un opéra qui contenait de très forts rôles ; je me fiais au souffleur et à mon bâton de chef d’orchestre. Malgré cela, je ne pus empêcher que les chanteurs ne sussent leurs rôles qu’à moitié tout au plus. Pour tout le monde, la représentation fut comme un rêve ; personne ne put se faire une idée de la chose ; ce qui marcha à moitié bien n’en fut pas moins dûment applaudi. La deuxième représentation, pour divers motifs, ne put avoir lieu.
Vint alors la révolution de Juillet : du coup me voici révolutionnaire et parvenu à la conviction que tout homme tant soit peu ambitieux ne devait s’occuper exclusivement que de politique. Je ne me plaisais plus qu’en la compagnie d’écrivains politiques ; j’entrepris aussi une ouverture sur un thème politique. C’est dans ces circonstances que je quittai le collège et que j’entrai à l’Université, non plus pour me vouer à une étude de Faculté (car on me destinait encore à la musique), mais pour suivre les cours d’esthétique et de philosophie. Je profitai aussi peu que possible de cette occasion de m’instruire ; en revanche, je m’abandonnai à tous les écarts de la vie d’étudiant, et je le fis, à vrai dire, avec tant d’étourderie et si peu de retenue, que j’en fus bientôt dégoûté. Ma famille, à cette époque, eut beaucoup de mal avec moi ; j’avais laissé ma musique presque entièrement de côté. Mais je ne tardai pas à revenir à la raison ; je sentis la nécessité d’une étude de la musique entreprise à nouveau, rigoureusement réglée, et la Providence me fit trouver l’homme qu’il fallait pour m’inspirer une ardeur nouvelle et m’éclaircir la chose par l’enseignement le plus approfondi.
Cet homme était Théodore Weinlig[4], cantor à la Thomasschule de Leipzig. Déjà je m’étais exercé à la fugue ; pourtant ce ne fut qu’avec lui que je commençai l’étude approfondie du contrepoint, étude qu’il avait l’heureux don de rendre attrayante comme un jeu. J’appris seulement à cette époque à connaître et à aimer profondément Mozart. Je composai une sonate dans laquelle je me dégageai de toute enflure et m’abandonnai à un élan naturel et sans contrainte. Ce travail extrêmement simple et modeste fut gravé et publié chez Breitkopf et Hærtel. En moins de six mois, j’eus terminé mes études avec Weinlig ; il me dispensa lui-même de continuer, après m’avoir poussé assez loin pour me mettre en état de résoudre aisément les problèmes les plus difficiles du contrepoint. « Ce que vous avez gagné par cette étude aride, me dit-il, c’est l’indépendance. » Pendant ces mêmes six mois, je composai aussi une ouverture sur le modèle de celles de Beethoven, alors un peu mieux comprises par moi ; ce morceau, joué dans un des concerts du Gewandhaus à Leipzig, obtint un accueil encourageant. Après plusieurs autres travaux, je me mis à une symphonie : à mon modèle principal, Beethoven, se joignit Mozart, surtout avec sa grande symphonie en ut majeur. La clarté et la vigueur, à côté de mainte étrange aberration, étaient l’objet de mes efforts. La symphonie terminée, je me mis en route pour Vienne, pendant l’été de 1832, sans autre but que de faire une connaissance rapide avec cette cité musicale, autrefois si vantée. Ce que je vis et entendis là m’édifia peu ; partout où j’allais, c’étaient Zampa et des pots-pourris de Strauss sur Zampa, deux choses qui, surtout alors, m’étaient en abomination. En revenant, je m’arrêtai quelque temps à Prague où je fis la connaissance de Dionys Weber[5] et de Tomaschek[6] ; le premier fit jouer au Conservatoire plusieurs de mes compositions, parmi
lesquelles la symphonie. J’écrivis aussi dans cette ville un poème d’opéra dans le genre tragique : la Noce. Je ne sais plus où j’avais trouvé ce sujet moyen âge : un homme fou d’amour escalade la fenêtre de la chambre nuptiale où la fiancée de son ami attend son fiancé ; celle-ci lutte avec l’insensé, et le rejette sur le pavé où il se brise et rend l’âme ; à l’office mortuaire, la fiancée, avec un cri, s’affaisse inanimée sur le cadavre. — De retour à Leipzig, je composai aussitôt le premier numéro de cet opéra ; il y avait là-dedans un grand sextuor qui faisait le bonheur de Weinlig. Le livret déplut à ma sœur ; je le détruisis sans qu’il en restât trace. — En janvier 1833, ma symphonie, exécutée aux concerts du Gewandhaus, y reçut un très engageant accueil. C’est alors que je fis la connaissance de Laube[7]. Pour aller voir un de mes frères, je fis le voyage de Würzbourg et j’y restai toute l’année 1833 ; mon frère, en sa qualité de chanteur expérimenté, avait pour moi quelque importance. Je composai cette année-là un opéra romantique en trois actes, les Fées, dont je m’étais fabriqué le texte moi-même d’après la Femme serpent de Gozzi[8]. Beethoven et Weber étaient mes modèles : dans les ensembles il y avait plus d’une chose réussie : le finale du deuxième acte surtout promettait de faire grand effet. Tout ce que je fis entendre de cet opéra dans les concerts à Wiirzbourg fit plaisir. Animé des meilleures espérances au sujet de mon œuvre terminée, je revins à Leipzig, au commencement de 1834, et je la présentai au directeur du tliéâtre de cette ville. Malgré sa bonne volonté tout d’abord déclarée de se prêter à mon désir, je dus bientôt faire l’expérience d’une chose que tout compositeur allemand a l’occasion d’apprendre aujourd’hui : par suite du succès des auteurs français et italiens, nous avons perdu tout crédit sur notre scène nationale, et l’exécution de nos opéras est une faveur qu’il faut mendier. L’exécution de mes Fées fut trahiée en longueur. Pendant ce temps, j’entendis la Devrient[9] chanter dans le Roméo et Juliette de Bellini : je fus étonné de voir réaliser une interprétation aussi extraordinaire d’une musique aussi complètement insignifiante. J’en vins à douter du choix des moyens qui peuvent conduire aux grands succès : j’étais fort loin de reconnaître à Bellini une grande valeur ; mais les éléments de sa musique me paraissaient toutefois plus heureusement appropriés à répandre chaleur et vie, que la pénible et laborieuse conscience avec laquelle, nous autres Allemands, nous ne pouvons guère arriver qu’à produire un semblant de vérité tourmentée. L’art flasque et sans caractère de l’Italie actuelle, aussi bien que l’esprit léger et frivole de la France contemporaine[10], me semblaient exiger des graves et consciencieux Allemands qu’ils se rendissent maîtres des procédés plus heureusement choisis et perfectionnés de leurs rivaux, afin d’arriver à l’emporter décidément sur eux par la production de vraies œuvres d’art.
J’avais alors vingt et un ans ; j’étais disposé à prendre plaisir à la vie, à trouver satisfaction au spectacle des choses ; Ardinghello et la Jeune Europe[11] me mettaient le diable au corps : l’Allemagne ne m’apparaissait que comme une infime portion du monde. J’étais sorti du mysticisme abstrait, et j’apprenais à aimer la réalité. La beauté de la matière, l’esprit et le génie, étaient pour moi de magnifiques choses ; en ce qui concernait mon art, je trouvais tout cela chez les Italiens et les Français. Je renonçai à mon modèle, Beethoven ; sa dernière symphonie, conclusion d’une grande époque artistique, me parut être la clef d’une voûte au-dessus de laquelle personne ne pouvait s’élever, et à l’abri de laquelle personne ne pouvait obtenir l’indépendance. C’est ce que Mendelssohn me sembla avoir senti, quand, laissant de côté la grande forme arrêtée de la symphonie beethovénienne, il se fit remarquer par des compositions orchestrales plus restreintes ; il me parut qu’il voulait, en débutant par une forme plus restreinte et entièrement indépendante, s’en créer lui-même une plus grande.
Cet homme était Théodore Weinlig[4], cantor à la Thomasschule de Leipzig. Déjà je m’étais exercé à la fugue ; pourtant ce ne fut qu’avec lui que je commençai l’étude approfondie du contrepoint, étude qu’il avait l’heureux don de rendre attrayante comme un jeu. J’appris seulement à cette époque à connaître et à aimer profondément Mozart. Je composai une sonate dans laquelle je me dégageai de toute enflure et m’abandonnai à un élan naturel et sans contrainte. Ce travail extrêmement simple et modeste fut gravé et publié chez Breitkopf et Hærtel. En moins de six mois, j’eus terminé mes études avec Weinlig ; il me dispensa lui-même de continuer, après m’avoir poussé assez loin pour me mettre en état de résoudre aisément les problèmes les plus difficiles du contrepoint. « Ce que vous avez gagné par cette étude aride, me dit-il, c’est l’indépendance. » Pendant ces mêmes six mois, je composai aussi une ouverture sur le modèle de celles de Beethoven, alors un peu mieux comprises par moi ; ce morceau, joué dans un des concerts du Gewandhaus à Leipzig, obtint un accueil encourageant. Après plusieurs autres travaux, je me mis à une symphonie : à mon modèle principal, Beethoven, se joignit Mozart, surtout avec sa grande symphonie en ut majeur. La clarté et la vigueur, à côté de mainte étrange aberration, étaient l’objet de mes efforts. La symphonie terminée, je me mis en route pour Vienne, pendant l’été de 1832, sans autre but que de faire une connaissance rapide avec cette cité musicale, autrefois si vantée. Ce que je vis et entendis là m’édifia peu ; partout où j’allais, c’étaient Zampa et des pots-pourris de Strauss sur Zampa, deux choses qui, surtout alors, m’étaient en abomination. En revenant, je m’arrêtai quelque temps à Prague où je fis la connaissance de Dionys Weber[5] et de Tomaschek[6] ; le premier fit jouer au Conservatoire plusieurs de mes compositions, parmi
lesquelles la symphonie. J’écrivis aussi dans cette ville un poème d’opéra dans le genre tragique : la Noce. Je ne sais plus où j’avais trouvé ce sujet moyen âge : un homme fou d’amour escalade la fenêtre de la chambre nuptiale où la fiancée de son ami attend son fiancé ; celle-ci lutte avec l’insensé, et le rejette sur le pavé où il se brise et rend l’âme ; à l’office mortuaire, la fiancée, avec un cri, s’affaisse inanimée sur le cadavre. — De retour à Leipzig, je composai aussitôt le premier numéro de cet opéra ; il y avait là-dedans un grand sextuor qui faisait le bonheur de Weinlig. Le livret déplut à ma sœur ; je le détruisis sans qu’il en restât trace. — En janvier 1833, ma symphonie, exécutée aux concerts du Gewandhaus, y reçut un très engageant accueil. C’est alors que je fis la connaissance de Laube[7]. Pour aller voir un de mes frères, je fis le voyage de Würzbourg et j’y restai toute l’année 1833 ; mon frère, en sa qualité de chanteur expérimenté, avait pour moi quelque importance. Je composai cette année-là un opéra romantique en trois actes, les Fées, dont je m’étais fabriqué le texte moi-même d’après la Femme serpent de Gozzi[8]. Beethoven et Weber étaient mes modèles : dans les ensembles il y avait plus d’une chose réussie : le finale du deuxième acte surtout promettait de faire grand effet. Tout ce que je fis entendre de cet opéra dans les concerts à Wiirzbourg fit plaisir. Animé des meilleures espérances au sujet de mon œuvre terminée, je revins à Leipzig, au commencement de 1834, et je la présentai au directeur du tliéâtre de cette ville. Malgré sa bonne volonté tout d’abord déclarée de se prêter à mon désir, je dus bientôt faire l’expérience d’une chose que tout compositeur allemand a l’occasion d’apprendre aujourd’hui : par suite du succès des auteurs français et italiens, nous avons perdu tout crédit sur notre scène nationale, et l’exécution de nos opéras est une faveur qu’il faut mendier. L’exécution de mes Fées fut trahiée en longueur. Pendant ce temps, j’entendis la Devrient[9] chanter dans le Roméo et Juliette de Bellini : je fus étonné de voir réaliser une interprétation aussi extraordinaire d’une musique aussi complètement insignifiante. J’en vins à douter du choix des moyens qui peuvent conduire aux grands succès : j’étais fort loin de reconnaître à Bellini une grande valeur ; mais les éléments de sa musique me paraissaient toutefois plus heureusement appropriés à répandre chaleur et vie, que la pénible et laborieuse conscience avec laquelle, nous autres Allemands, nous ne pouvons guère arriver qu’à produire un semblant de vérité tourmentée. L’art flasque et sans caractère de l’Italie actuelle, aussi bien que l’esprit léger et frivole de la France contemporaine[10], me semblaient exiger des graves et consciencieux Allemands qu’ils se rendissent maîtres des procédés plus heureusement choisis et perfectionnés de leurs rivaux, afin d’arriver à l’emporter décidément sur eux par la production de vraies œuvres d’art.
J’avais alors vingt et un ans ; j’étais disposé à prendre plaisir à la vie, à trouver satisfaction au spectacle des choses ; Ardinghello et la Jeune Europe[11] me mettaient le diable au corps : l’Allemagne ne m’apparaissait que comme une infime portion du monde. J’étais sorti du mysticisme abstrait, et j’apprenais à aimer la réalité. La beauté de la matière, l’esprit et le génie, étaient pour moi de magnifiques choses ; en ce qui concernait mon art, je trouvais tout cela chez les Italiens et les Français. Je renonçai à mon modèle, Beethoven ; sa dernière symphonie, conclusion d’une grande époque artistique, me parut être la clef d’une voûte au-dessus de laquelle personne ne pouvait s’élever, et à l’abri de laquelle personne ne pouvait obtenir l’indépendance. C’est ce que Mendelssohn me sembla avoir senti, quand, laissant de côté la grande forme arrêtée de la symphonie beethovénienne, il se fit remarquer par des compositions orchestrales plus restreintes ; il me parut qu’il voulait, en débutant par une forme plus restreinte et entièrement indépendante, s’en créer lui-même une plus grande.
ESQUISSE AUTOBIOGRAPHIQUE
(1813-1842)
Je me nomme Guillaume-Richard Wagner, et je suis né le 22 mai 1813 à Leipzig. Mon père était greffier de la police et mourut six mois après ma naissance. Mon beau-père, Ludwig Geyer, était acteur et peintre ; il a écrit aussi quelques comédies, parmi lesquelles celle intitulée le Massacre des Innocents eut du succès ; avec lui ma famille se retira à Dresde. Il voulait que je devinsse peintre ; mais j’étais très maladroit au dessin. Mon beau-père, lui aussi, mourut de bonne heure....., je n’avais que sept ans. Peu de temps avant sa mort, j’avais appris à jouer au piano Sois toujours loyal et fidèle, et la Couronne virginale, alors dans toute sa fraîcheur : la veille de sa mort, je dus lui jouer les deux morceaux dans la pièce voisine ; je l’entendis alors dire à ma mère d’une voix faible : « Aurait-il par hasard des dispositions pour la musique ? » Le lendemain, de bon matin, comme il était mort, notre mère entra dans la chambre des enfants, dit quelques mots à chacun de nous et m’adressa ces paroles : « Il voulait faire quelque chose de toi. » J’ai ressouvenir de m’être longtemps imaginé que je ferais quelque chose.
À neuf ans, j’entrai à la Kreuzschule de Dresde ; j’allais faire mes études ; de musique il n’était pas question ; deux de mes sœurs apprenaient à bien jouer du piano, et je les écoutais, sans recevoir moi-même d’instruction instrumentale. Rien ne me plaisait autant que le Freischütz : souvent je vis Weber passer devant chez nous, quand il revenait des répétitions ; je le considérai toujours avec un effroi sacré. Un répétiteur à domicile, qui m’expliquait Cornélius Népos, dut finir par me donner aussi des leçons de piano ; à peine eus-je dépassé les premiers exercices des doigts, que j’appris secrètement pour mon compte, sans partition tout d’abord, l’ouverture du Freischütz ; mon professeur entendit un jour la chose et dit qu’on ne ferait rien de moi. Il avait raison : je n’ai de ma vie appris à jouer du piano.
À cette époque je ne jouais encore que pour moi : les ouvertures étaient mon fort, et j’y employais les plus épouvantables doigtés. Il m’était impossible de jouer une gamme proprement, aussi j’en conçus pour tout ce qui était trait une grande aversion. De Mozart je n’aimais que l’ouverture de la Flûte enchantée ; Don Juan me déplaisait pour être écrit sur un texte italien, et qui me semblait si fade.
Mais ces occupations musicales n’étaient que fort accessoires : le grec, le latin, la mythologie, l’histoire ancienne, étaient l’essentiel. Je faisais aussi des vers. Un de nos camarades vint à mourir, et nos maîtres nous imposèrent la tâche d’écrire une poésie sur sa mort ; la meilleure devait être imprimée....., ce fut la mienne, mais seulement après que j’en eus fait disparaître l’excessive enflure. En ce temps-là j’avais onze ans. Je voulus alors être poète : j’ébauchai des drames d’après le type grec, poussé par la connaissance que je fis des tragédies d’Apel[1], Polyidos, les Étoliens, etc. ; je passais d’ailleurs dans le collège pour une forte tête en littérature : en troisième j’avais déjà traduit les douze premiers livres de l’Odyssée. Un beau jour j’appris aussi l’anglais, simplement, à vrai dire, pour connaître Shakespeare bien à fond : je traduisis, en imitant le mètre, le monologue de Roméo. L’anglais bientôt fut aussi délaissé ; mais Shakespeare resta mon modèle ; je projetai un grand drame, à peu près composé d’Hamlet et du Roi Lear ; le plan était extrêmement grandiose : quarante-deux personnages mouraient au cours de la pièce, et je me vis forcé, au moment de la réalisation, de faire réapparaître la plupart d’entre eux sous forme de fantômes, sans quoi, dans les derniers actes, il ne restait plus personne. Cette pièce m’occupa pendant deux ans. Là-dessus je quittai Dresde et la Kreuzschule, et je vins à Leipzig. Dans cette ville on me mit en troisième au collège Nicolaï, alors qu’à Dresde j’avais déjà pris place sur les bancs de la classe de seconde ; cette circonstance m’exaspéra si fort, que désormais toute ardeur pour les études philologiques m’abandonna. Je devins paresseux et négligent ; seul, mon grand drame me tenait encore au cœur. Pendant que je l’achevais, j’apprenais pour la première fois à connaître la musique de Beethoven dans les concerts de la Halle aux Draps (Gewandhaus) de Leipzig ; son impression sur moi fut toute-puissante. Je me familiarisai aussi avec Mozart, surtout avec son Requiem. La musique de Beethoven pour Egmont m’enthousiasma tellement, que pour tout au monde je n’aurais laissé mon drame, cette fois terminé, sortir du chantier autrement que muni d’une musique de ce genre. Je me crus capable, sans plus de réflexion, d’écrire moi-même cette musique si indispensable ; pourtant je trouvai bon de me mettre d’abord au courant de quelques règles essentielles de la basse générale[2]. Afin de faire la chose à la volée, j’empruntai pour huit jours la méthode de basse générale de Logier[3] et je l’étudiai avec ardeur. Mais cette étude ne porta pas des fruits aussi rapides que je l’avais pensé ; les difficultés qu’elle présentait me stimulèrent et m’attachèrent ; je résolus de devenir musicien.
Cependant mon grand drame avait été découvert par ma famille : elle tomba dans une vive affliction, car il fut manifeste que pour
cela j’avais radicalement, négligé mes études classiques, et je n’en fus que plus rigoureusement tenu de les poursuivre avec assiduité. Dans de telles circonstances, je gardai pour moi l’intime conviction que j’avais acquise de ma vocation musicale, mais je n’en composai pas moins, dans le plus grand secret, une sonate, un quatuor et un air. Quand je me sentis suffisamment avancé dans mes études musicales personnelles, je m’enhardis enfin à les révéler. Naturellement j’eus alors de rudes assauts à soutenir, étant donné que les miens devaient regarder mon penchant pour la musique comme un simple caprice, d’autant plus qu’il n’était justifié par aucune étude préalable, et surtout par aucune habileté déjà quelque peu acquise sur un instrument.
J’étais alors dans ma seizième année, et porté, principalement par la lecture d’Hoffmann, au mysticisme le plus extravagant : pendant le jour, en un demi-sommeil, j’avais des visions, dans lesquelles la Fondamentale, la Tierce et la Quinte m’apparaissaient en personne, et me dévoilaient leur importante signification : les notes que je rédigeais là-dessus étaient un tissu d’absurdités. On me fit enfin donner des leçons par un bon musicien : le pauvre homme eut grand mal avec moi ; il dut m’expliquer que ce que je prenais pour des êtres surnaturels et des puissances étranges était des intervalles et des accords. Que pouvait-il y avoir de plus affligeant pour les miens, sinon d’apprendre que dans cette étude même je me montrais négligent et irrégulier ? Mon professeur secouait la tête, et les choses se passaient en apparence comme si, même en cette matière, on ne pouvait tirer de moi rien de bon. Mon goût pour l’étude faiblit de plus en plus ; je préférais composer des ouvertures pour grand orchestre, dont l’une fut jouée un jour au théâtre de Leipzig. Cette ouverture fut le point culminant de mes absurdités : pour mieux aider à l’intelligence de la partition, j’avais eu positivement l’idée de l’écrire avec trois encres ditrérentes, les cordes en rouge, les bois en vert, les cuivres en noir. La neuvième symphonie de Beethoven semblerait une sonate de Pleyel auprès de cette ouverture aux combinaisons étonnantes. À l’exécution, ce qui surtout me fit du tort fut un roulement de timbales fortissimo, lequel revenait régulièrement toutes les quatre mesures, tout le long du morceau : la surprise qu’éprouva d’abord le public devant l’entêtement du timbalier se changea en une mauvaise humeur non dissimulée, puis en une gaieté qui m’affligea fort. Cette première exécution d’un morceau par moi composé me laissa sous le coup d’une vive impression.
(1813-1842)
Je me nomme Guillaume-Richard Wagner, et je suis né le 22 mai 1813 à Leipzig. Mon père était greffier de la police et mourut six mois après ma naissance. Mon beau-père, Ludwig Geyer, était acteur et peintre ; il a écrit aussi quelques comédies, parmi lesquelles celle intitulée le Massacre des Innocents eut du succès ; avec lui ma famille se retira à Dresde. Il voulait que je devinsse peintre ; mais j’étais très maladroit au dessin. Mon beau-père, lui aussi, mourut de bonne heure....., je n’avais que sept ans. Peu de temps avant sa mort, j’avais appris à jouer au piano Sois toujours loyal et fidèle, et la Couronne virginale, alors dans toute sa fraîcheur : la veille de sa mort, je dus lui jouer les deux morceaux dans la pièce voisine ; je l’entendis alors dire à ma mère d’une voix faible : « Aurait-il par hasard des dispositions pour la musique ? » Le lendemain, de bon matin, comme il était mort, notre mère entra dans la chambre des enfants, dit quelques mots à chacun de nous et m’adressa ces paroles : « Il voulait faire quelque chose de toi. » J’ai ressouvenir de m’être longtemps imaginé que je ferais quelque chose.
À neuf ans, j’entrai à la Kreuzschule de Dresde ; j’allais faire mes études ; de musique il n’était pas question ; deux de mes sœurs apprenaient à bien jouer du piano, et je les écoutais, sans recevoir moi-même d’instruction instrumentale. Rien ne me plaisait autant que le Freischütz : souvent je vis Weber passer devant chez nous, quand il revenait des répétitions ; je le considérai toujours avec un effroi sacré. Un répétiteur à domicile, qui m’expliquait Cornélius Népos, dut finir par me donner aussi des leçons de piano ; à peine eus-je dépassé les premiers exercices des doigts, que j’appris secrètement pour mon compte, sans partition tout d’abord, l’ouverture du Freischütz ; mon professeur entendit un jour la chose et dit qu’on ne ferait rien de moi. Il avait raison : je n’ai de ma vie appris à jouer du piano.
À cette époque je ne jouais encore que pour moi : les ouvertures étaient mon fort, et j’y employais les plus épouvantables doigtés. Il m’était impossible de jouer une gamme proprement, aussi j’en conçus pour tout ce qui était trait une grande aversion. De Mozart je n’aimais que l’ouverture de la Flûte enchantée ; Don Juan me déplaisait pour être écrit sur un texte italien, et qui me semblait si fade.
Mais ces occupations musicales n’étaient que fort accessoires : le grec, le latin, la mythologie, l’histoire ancienne, étaient l’essentiel. Je faisais aussi des vers. Un de nos camarades vint à mourir, et nos maîtres nous imposèrent la tâche d’écrire une poésie sur sa mort ; la meilleure devait être imprimée....., ce fut la mienne, mais seulement après que j’en eus fait disparaître l’excessive enflure. En ce temps-là j’avais onze ans. Je voulus alors être poète : j’ébauchai des drames d’après le type grec, poussé par la connaissance que je fis des tragédies d’Apel[1], Polyidos, les Étoliens, etc. ; je passais d’ailleurs dans le collège pour une forte tête en littérature : en troisième j’avais déjà traduit les douze premiers livres de l’Odyssée. Un beau jour j’appris aussi l’anglais, simplement, à vrai dire, pour connaître Shakespeare bien à fond : je traduisis, en imitant le mètre, le monologue de Roméo. L’anglais bientôt fut aussi délaissé ; mais Shakespeare resta mon modèle ; je projetai un grand drame, à peu près composé d’Hamlet et du Roi Lear ; le plan était extrêmement grandiose : quarante-deux personnages mouraient au cours de la pièce, et je me vis forcé, au moment de la réalisation, de faire réapparaître la plupart d’entre eux sous forme de fantômes, sans quoi, dans les derniers actes, il ne restait plus personne. Cette pièce m’occupa pendant deux ans. Là-dessus je quittai Dresde et la Kreuzschule, et je vins à Leipzig. Dans cette ville on me mit en troisième au collège Nicolaï, alors qu’à Dresde j’avais déjà pris place sur les bancs de la classe de seconde ; cette circonstance m’exaspéra si fort, que désormais toute ardeur pour les études philologiques m’abandonna. Je devins paresseux et négligent ; seul, mon grand drame me tenait encore au cœur. Pendant que je l’achevais, j’apprenais pour la première fois à connaître la musique de Beethoven dans les concerts de la Halle aux Draps (Gewandhaus) de Leipzig ; son impression sur moi fut toute-puissante. Je me familiarisai aussi avec Mozart, surtout avec son Requiem. La musique de Beethoven pour Egmont m’enthousiasma tellement, que pour tout au monde je n’aurais laissé mon drame, cette fois terminé, sortir du chantier autrement que muni d’une musique de ce genre. Je me crus capable, sans plus de réflexion, d’écrire moi-même cette musique si indispensable ; pourtant je trouvai bon de me mettre d’abord au courant de quelques règles essentielles de la basse générale[2]. Afin de faire la chose à la volée, j’empruntai pour huit jours la méthode de basse générale de Logier[3] et je l’étudiai avec ardeur. Mais cette étude ne porta pas des fruits aussi rapides que je l’avais pensé ; les difficultés qu’elle présentait me stimulèrent et m’attachèrent ; je résolus de devenir musicien.
Cependant mon grand drame avait été découvert par ma famille : elle tomba dans une vive affliction, car il fut manifeste que pour
cela j’avais radicalement, négligé mes études classiques, et je n’en fus que plus rigoureusement tenu de les poursuivre avec assiduité. Dans de telles circonstances, je gardai pour moi l’intime conviction que j’avais acquise de ma vocation musicale, mais je n’en composai pas moins, dans le plus grand secret, une sonate, un quatuor et un air. Quand je me sentis suffisamment avancé dans mes études musicales personnelles, je m’enhardis enfin à les révéler. Naturellement j’eus alors de rudes assauts à soutenir, étant donné que les miens devaient regarder mon penchant pour la musique comme un simple caprice, d’autant plus qu’il n’était justifié par aucune étude préalable, et surtout par aucune habileté déjà quelque peu acquise sur un instrument.
J’étais alors dans ma seizième année, et porté, principalement par la lecture d’Hoffmann, au mysticisme le plus extravagant : pendant le jour, en un demi-sommeil, j’avais des visions, dans lesquelles la Fondamentale, la Tierce et la Quinte m’apparaissaient en personne, et me dévoilaient leur importante signification : les notes que je rédigeais là-dessus étaient un tissu d’absurdités. On me fit enfin donner des leçons par un bon musicien : le pauvre homme eut grand mal avec moi ; il dut m’expliquer que ce que je prenais pour des êtres surnaturels et des puissances étranges était des intervalles et des accords. Que pouvait-il y avoir de plus affligeant pour les miens, sinon d’apprendre que dans cette étude même je me montrais négligent et irrégulier ? Mon professeur secouait la tête, et les choses se passaient en apparence comme si, même en cette matière, on ne pouvait tirer de moi rien de bon. Mon goût pour l’étude faiblit de plus en plus ; je préférais composer des ouvertures pour grand orchestre, dont l’une fut jouée un jour au théâtre de Leipzig. Cette ouverture fut le point culminant de mes absurdités : pour mieux aider à l’intelligence de la partition, j’avais eu positivement l’idée de l’écrire avec trois encres ditrérentes, les cordes en rouge, les bois en vert, les cuivres en noir. La neuvième symphonie de Beethoven semblerait une sonate de Pleyel auprès de cette ouverture aux combinaisons étonnantes. À l’exécution, ce qui surtout me fit du tort fut un roulement de timbales fortissimo, lequel revenait régulièrement toutes les quatre mesures, tout le long du morceau : la surprise qu’éprouva d’abord le public devant l’entêtement du timbalier se changea en une mauvaise humeur non dissimulée, puis en une gaieté qui m’affligea fort. Cette première exécution d’un morceau par moi composé me laissa sous le coup d’une vive impression.
3/Une visite à Beethoven
— Et comment lui demandai-je, faudrait-il s’y prendre pour composer un semblable opéra ? — Comme Shakspeare dans ses drames, répondit-il ; et il ajouta : Quand on consent à adapter au timbre de voix d’une actrice de ces misérables colifichets musicaux destinés à lui procurer les bravos frénétiques d’un parterre frivole, on est digne d’être rangé dans la classe des coiffeurs ou des fabricants de corsets, mais il ne faut pas aspirer au titre de compositeur. Quant à moi, de semblables humiliations me répugnent. Je n’ignore pas que bien des gens raisonnables, tout en me reconnaissant un certain mérite en fait de composition instrumentale, se montrent beaucoup plus sévères à mon égard au sujet de la musique vocale. Ils ont raison, si par musique vocale ils entendent la musique d’opéra, et Dieu me préserve à jamais de me complaire à des niaiseries de ce genre.
Je me permis de lui demander si jamais quelqu’un avait osé, après avoir entendu sa cantate d’Adélaïde, lui refuser la vocation la plus caractérisée pour le genre de la musique vocale. — Eh bien ! me répondit-il après une courte pause, Adélaïde et quelques autres morceaux de la même nature ne sont que des misères qui tombent assez tôt dans le domaine de la vulgarité, pour fournir aux virtuoses de profession un thème de plus qui puisse servir de cadre à leurs tours de force gutturaux. Mais pourquoi la musique vocale n’offrirait-elle pas, aussi bien que le genre rival, matière à une école sévère et grandiose ? La voix humaine est pourtant un instrument plus noble et plus beau que tout autre ; pourquoi ne pourrait-on pas lui créer un rôle aussi indépendant ? Et à quels résultats inconnus ne conduirait pas un pareil système ? Car la nature si multiple des voix humaines, et en même temps si différente de celle de nos instruments, donnerait à cette nouvelle musique un caractère tout spécial en lui permettant les combinaisons les plus variées. Les sons des instruments, sans qu’il soit possible pourtant de préciser leur vraie signification, préexistaient en effet dans le monde primitif comme organes de la nature créée, et avant même qu’il y eût des hommes sur terre pour recueillir ces vagues harmonies. Mais il en est tout autrement du génie de la voix humaine ; celle-ci est l’interprète directe du cœur humain, et traduit nos sensations abstraites et individuelles. Son domaine est donc essentiellement limité, mais ses manifestations sont toujours claires et précises. Eh bien ! réunissez ces deux éléments ; traduisez les sentiments vagues et abrupts de la nature sauvage par le langage des instruments, en opposition avec les idées positives de l’âme représentées par la voix humaine, et celle-ci exercera une influence lumineuse sur le conflit des premiers, en réglant leur élan et modérant leur violence. Alors le cœur humain s’ouvrant à ces émotions complexes, agrandi et dilaté par ces pressentiments infinis et délicieux, accueillera avec ivresse, avec conviction, cette espèce de révélation intime d’un monde surnaturel.
Ici Beethoven essoufflé s’arrêta un moment, puis il reprit en soupirant : — Il est vrai qu’une pareille tâche présente mille obstacles dans la pratique ; car pour faire chanter il faut des paroles, et qui serait capable de formuler en paroles la poésie sublime qui serait le brillant résultat de la fusion de tous ces éléments ? L’art de l’écrivain serait évidemment impuissant pour y parvenir. Je publierai bientôt un nouvel ouvrage qui vous rappellera les idées que je viens d’émettre : c’est une symphonie avec chœurs ; mais je dois appuyer sur les difficultés que m’a suscitées en cette circonstance l’insuffisance du langage poétique. Enfin j’ai arrêté mon choix sur la belle hymne de Schiller : À la joie. Ce sont là assurément de nobles et beaux vers, et pourtant qu’ils sont loin d’exprimer tout ce que j’ai rêvé à ce sujet
À présent même, j’ai peine à maîtriser l’émotion de mon cœur en me rappelant ces confidences par lesquelles le grand artiste m’initiait dès lors à l’intelligence complète de sa dernière et prodigieuse symphonie, qu’il venait à peine de terminer. Je lui exprimai ma reconnaissance avec toute l’effusion que devait provoquer cette insigne faveur, et je lui témoignai combien j’étais transporté d’apprendre la prochaine apparition d’un nouvel ouvrage de son génie. Je sentais mes yeux mouillés de larmes, et je fus presque tenté de m’agenouiller devant lui. Beethoven parut comprendre ce qui se passait en moi, il fixa sur moi un regard mélangé de tristesse et d’ironie, et me dit : — Vous pourrez prendre ma défense lorsqu’il s’agira de mon nouvel ouvrage. Rappelez- vous alors cet entretien, car je serai sans doute accusé de folie et de déraison par mainte personne raisonnable. Vous voyez pourtant bien, mon cher monsieur R..., que je ne suis pas encore précisément atteint de démence, quoique j’aie subi assez de tribulations depuis longtemps pour en courir la chance. Le monde voudrait que je prisse pour règle les idées qu’il se forme du beau, et non les miennes ; mais il ne songe pas que dans mon triste état de surdité, je ne puis obéir qu’à mes inspirations intimes, qu’il me serait impossible de mettre dans ma musique autre chose que mes propres sentiments, et que le cercle restreint de ma pensée n’embrasse pas, comme lui, leurs mille perceptions enivrantes, qui me sont totalement inconnues, ajouta-t-il avec ironie, et voilà mon malheur !
À ces mots, il se leva et se mit à marcher d’un pas rapide dans la chambre. Dans l’excès de mon émotion, je me levai pareillement, et je me sentis frissonner : il m’eût été impossible de pousser plus loin cet entretien en n’ayant recours qu’à des gestes ou à l’écriture. Il me sembla qu’en demeurant davantage je me rendrais importun ; mais je dédaignai de tracer froidement sur le papier quelques mots de remercîment et d’adieu ; je me bornai à prendre mon chapeau et à m’approcher du maître en lui laissant lire mon respectueux attendrissement dans mes regards. Il parut me comprendre et me dit : — Vous partez ? Restez-vous encore quelque temps à Vienne ? J’écrivis alors que l’unique but de mon voyage avait été de faire sa connaissance, et que, puisqu’il avait daigné m’accueillir avec autant de bonté, il ne me restait qu’à partir pénétré de joie et de reconnaissance. Il me répondit en souriant : — Vous m’avez écrit par quel moyen vous vous étiez procuré l’argent nécessaire à votre voyage. Vous pourriez rester à Vienne pour y publier de nouveaux galops ; c’est une denrée qui se débite ici à merveille. Je déclarai à Beethoven que j’avais renoncé pour jamais à ce genre de travail, et que je ne pouvais concevoir quel motif assez puissant pourrait me déterminer désormais à un pareil acte d’abnégation. — Bah ! bah ! répliqua-t-il, pourquoi donc pas ? Et moi, vieux fou que je suis, ne serais-je pas mille fois plus heureux de composer des galops ; au lieu qu’il me faudra végéter à tout jamais dans la carrière que j’ai embrassée. Bon voyage ! ajouta-t-il, pensez quelquefois à moi, et tâchons d’oublier les déceptions et les traverses de la vie.
Ému jusqu’aux larmes, j’allais me retirer ; mais il me retint encore en me disant : — Arrêtez ! nous allons expédier l’affaire de l’Anglais mélomane. Voyons où il faut mettre des croix ? Il prit en même temps l’album de l’Anglais et le parcourut en souriant, puis il le referma, et l’enveloppant d’une feuille de papier, il fit avec sa plume une énorme croix sur cette blanche enveloppe, en me disant : — Tenez ! remettez, je vous prie, à cet heureux mortel son chef-d’œuvre, et félicitez-le de ma part d’avoir deux oreilles bonnes et valides. J’envie réellement son sort. Adieu, mon cher, et conservez-moi votre amitié.
Ce fut ainsi qu’il me congédia, et je sortis de la maison dans un trouble extrême.
En rentrant à l’hôtel, je trouvai le domestique de l’Anglais occupé à attacher sa valise sur la voiture. Ainsi cet homme avait aussi bien que moi atteint son but, et je fus obligé de convenir qu’il avait fait preuve, à sa manière, de persévérance. Je montai à ma mansarde et fis mes préparatifs de départ pour le lendemain matin. Mes yeux tombèrent sur la grande croix apposée sur l’album de l’Anglais, et je ne pus réprimer un grand éclat de rire. Pourtant cette croix était un souvenir de Beethoven, et je me gardai bien de m’en dessaisir pour le gentleman musicien qui avait été le mauvais génie de mon saint pèlerinage. J’ôtai donc cette enveloppe que je réservai pour la collection de mes galops dignes de ce stigmate réprobateur. Quant à l’Anglais, je lui renvoyai son album intact avec un petit billet où je lui marquais que Beethoven avait été enchanté de sa musique, au point qu’il n’avait pas su où poser une seule croix de blâme.
Comme je quittais l’hôtel, l’Anglais montait justement dans sa voiture : — Oh ! adieu, me criait-il ; vous m’avez rendu un très grand service, et je suis entièrement content d’avoir vu de près Beethoven. Voulez-vous que je vous emmène en Italie ?
— Qui donc allez-vous voir ? lui dis-je.
— Je veux faire la connaissance de M. Rossini. Oh ! c’est un bien grand compositeur.
— Merci, lui répondis-je, je connais Beethoven, et cela me suffit pour ma vie entière.
Nous nous séparâmes. Je jetai un dernier coup d’œil d’attendrissement sur la maison de Beethoven, et je me dirigeai du côté du nord, ennobli et relevé à mes propres yeux.
— Et comment lui demandai-je, faudrait-il s’y prendre pour composer un semblable opéra ? — Comme Shakspeare dans ses drames, répondit-il ; et il ajouta : Quand on consent à adapter au timbre de voix d’une actrice de ces misérables colifichets musicaux destinés à lui procurer les bravos frénétiques d’un parterre frivole, on est digne d’être rangé dans la classe des coiffeurs ou des fabricants de corsets, mais il ne faut pas aspirer au titre de compositeur. Quant à moi, de semblables humiliations me répugnent. Je n’ignore pas que bien des gens raisonnables, tout en me reconnaissant un certain mérite en fait de composition instrumentale, se montrent beaucoup plus sévères à mon égard au sujet de la musique vocale. Ils ont raison, si par musique vocale ils entendent la musique d’opéra, et Dieu me préserve à jamais de me complaire à des niaiseries de ce genre.
Je me permis de lui demander si jamais quelqu’un avait osé, après avoir entendu sa cantate d’Adélaïde, lui refuser la vocation la plus caractérisée pour le genre de la musique vocale. — Eh bien ! me répondit-il après une courte pause, Adélaïde et quelques autres morceaux de la même nature ne sont que des misères qui tombent assez tôt dans le domaine de la vulgarité, pour fournir aux virtuoses de profession un thème de plus qui puisse servir de cadre à leurs tours de force gutturaux. Mais pourquoi la musique vocale n’offrirait-elle pas, aussi bien que le genre rival, matière à une école sévère et grandiose ? La voix humaine est pourtant un instrument plus noble et plus beau que tout autre ; pourquoi ne pourrait-on pas lui créer un rôle aussi indépendant ? Et à quels résultats inconnus ne conduirait pas un pareil système ? Car la nature si multiple des voix humaines, et en même temps si différente de celle de nos instruments, donnerait à cette nouvelle musique un caractère tout spécial en lui permettant les combinaisons les plus variées. Les sons des instruments, sans qu’il soit possible pourtant de préciser leur vraie signification, préexistaient en effet dans le monde primitif comme organes de la nature créée, et avant même qu’il y eût des hommes sur terre pour recueillir ces vagues harmonies. Mais il en est tout autrement du génie de la voix humaine ; celle-ci est l’interprète directe du cœur humain, et traduit nos sensations abstraites et individuelles. Son domaine est donc essentiellement limité, mais ses manifestations sont toujours claires et précises. Eh bien ! réunissez ces deux éléments ; traduisez les sentiments vagues et abrupts de la nature sauvage par le langage des instruments, en opposition avec les idées positives de l’âme représentées par la voix humaine, et celle-ci exercera une influence lumineuse sur le conflit des premiers, en réglant leur élan et modérant leur violence. Alors le cœur humain s’ouvrant à ces émotions complexes, agrandi et dilaté par ces pressentiments infinis et délicieux, accueillera avec ivresse, avec conviction, cette espèce de révélation intime d’un monde surnaturel.
Ici Beethoven essoufflé s’arrêta un moment, puis il reprit en soupirant : — Il est vrai qu’une pareille tâche présente mille obstacles dans la pratique ; car pour faire chanter il faut des paroles, et qui serait capable de formuler en paroles la poésie sublime qui serait le brillant résultat de la fusion de tous ces éléments ? L’art de l’écrivain serait évidemment impuissant pour y parvenir. Je publierai bientôt un nouvel ouvrage qui vous rappellera les idées que je viens d’émettre : c’est une symphonie avec chœurs ; mais je dois appuyer sur les difficultés que m’a suscitées en cette circonstance l’insuffisance du langage poétique. Enfin j’ai arrêté mon choix sur la belle hymne de Schiller : À la joie. Ce sont là assurément de nobles et beaux vers, et pourtant qu’ils sont loin d’exprimer tout ce que j’ai rêvé à ce sujet
À présent même, j’ai peine à maîtriser l’émotion de mon cœur en me rappelant ces confidences par lesquelles le grand artiste m’initiait dès lors à l’intelligence complète de sa dernière et prodigieuse symphonie, qu’il venait à peine de terminer. Je lui exprimai ma reconnaissance avec toute l’effusion que devait provoquer cette insigne faveur, et je lui témoignai combien j’étais transporté d’apprendre la prochaine apparition d’un nouvel ouvrage de son génie. Je sentais mes yeux mouillés de larmes, et je fus presque tenté de m’agenouiller devant lui. Beethoven parut comprendre ce qui se passait en moi, il fixa sur moi un regard mélangé de tristesse et d’ironie, et me dit : — Vous pourrez prendre ma défense lorsqu’il s’agira de mon nouvel ouvrage. Rappelez- vous alors cet entretien, car je serai sans doute accusé de folie et de déraison par mainte personne raisonnable. Vous voyez pourtant bien, mon cher monsieur R..., que je ne suis pas encore précisément atteint de démence, quoique j’aie subi assez de tribulations depuis longtemps pour en courir la chance. Le monde voudrait que je prisse pour règle les idées qu’il se forme du beau, et non les miennes ; mais il ne songe pas que dans mon triste état de surdité, je ne puis obéir qu’à mes inspirations intimes, qu’il me serait impossible de mettre dans ma musique autre chose que mes propres sentiments, et que le cercle restreint de ma pensée n’embrasse pas, comme lui, leurs mille perceptions enivrantes, qui me sont totalement inconnues, ajouta-t-il avec ironie, et voilà mon malheur !
À ces mots, il se leva et se mit à marcher d’un pas rapide dans la chambre. Dans l’excès de mon émotion, je me levai pareillement, et je me sentis frissonner : il m’eût été impossible de pousser plus loin cet entretien en n’ayant recours qu’à des gestes ou à l’écriture. Il me sembla qu’en demeurant davantage je me rendrais importun ; mais je dédaignai de tracer froidement sur le papier quelques mots de remercîment et d’adieu ; je me bornai à prendre mon chapeau et à m’approcher du maître en lui laissant lire mon respectueux attendrissement dans mes regards. Il parut me comprendre et me dit : — Vous partez ? Restez-vous encore quelque temps à Vienne ? J’écrivis alors que l’unique but de mon voyage avait été de faire sa connaissance, et que, puisqu’il avait daigné m’accueillir avec autant de bonté, il ne me restait qu’à partir pénétré de joie et de reconnaissance. Il me répondit en souriant : — Vous m’avez écrit par quel moyen vous vous étiez procuré l’argent nécessaire à votre voyage. Vous pourriez rester à Vienne pour y publier de nouveaux galops ; c’est une denrée qui se débite ici à merveille. Je déclarai à Beethoven que j’avais renoncé pour jamais à ce genre de travail, et que je ne pouvais concevoir quel motif assez puissant pourrait me déterminer désormais à un pareil acte d’abnégation. — Bah ! bah ! répliqua-t-il, pourquoi donc pas ? Et moi, vieux fou que je suis, ne serais-je pas mille fois plus heureux de composer des galops ; au lieu qu’il me faudra végéter à tout jamais dans la carrière que j’ai embrassée. Bon voyage ! ajouta-t-il, pensez quelquefois à moi, et tâchons d’oublier les déceptions et les traverses de la vie.
Ému jusqu’aux larmes, j’allais me retirer ; mais il me retint encore en me disant : — Arrêtez ! nous allons expédier l’affaire de l’Anglais mélomane. Voyons où il faut mettre des croix ? Il prit en même temps l’album de l’Anglais et le parcourut en souriant, puis il le referma, et l’enveloppant d’une feuille de papier, il fit avec sa plume une énorme croix sur cette blanche enveloppe, en me disant : — Tenez ! remettez, je vous prie, à cet heureux mortel son chef-d’œuvre, et félicitez-le de ma part d’avoir deux oreilles bonnes et valides. J’envie réellement son sort. Adieu, mon cher, et conservez-moi votre amitié.
Ce fut ainsi qu’il me congédia, et je sortis de la maison dans un trouble extrême.
En rentrant à l’hôtel, je trouvai le domestique de l’Anglais occupé à attacher sa valise sur la voiture. Ainsi cet homme avait aussi bien que moi atteint son but, et je fus obligé de convenir qu’il avait fait preuve, à sa manière, de persévérance. Je montai à ma mansarde et fis mes préparatifs de départ pour le lendemain matin. Mes yeux tombèrent sur la grande croix apposée sur l’album de l’Anglais, et je ne pus réprimer un grand éclat de rire. Pourtant cette croix était un souvenir de Beethoven, et je me gardai bien de m’en dessaisir pour le gentleman musicien qui avait été le mauvais génie de mon saint pèlerinage. J’ôtai donc cette enveloppe que je réservai pour la collection de mes galops dignes de ce stigmate réprobateur. Quant à l’Anglais, je lui renvoyai son album intact avec un petit billet où je lui marquais que Beethoven avait été enchanté de sa musique, au point qu’il n’avait pas su où poser une seule croix de blâme.
Comme je quittais l’hôtel, l’Anglais montait justement dans sa voiture : — Oh ! adieu, me criait-il ; vous m’avez rendu un très grand service, et je suis entièrement content d’avoir vu de près Beethoven. Voulez-vous que je vous emmène en Italie ?
— Qui donc allez-vous voir ? lui dis-je.
— Je veux faire la connaissance de M. Rossini. Oh ! c’est un bien grand compositeur.
— Merci, lui répondis-je, je connais Beethoven, et cela me suffit pour ma vie entière.
Nous nous séparâmes. Je jetai un dernier coup d’œil d’attendrissement sur la maison de Beethoven, et je me dirigeai du côté du nord, ennobli et relevé à mes propres yeux.
2/Une visite à Beethoven
On ne peut nier, à la vérité, que l’ouvrage n’ait beaucoup gagné à son remaniement ; mais cela vient surtout de ce que l’auteur du second libretto offrit au musicien plus d’occasions de développer son brillant génie ; Fidelio possède d’ailleurs en propre ses admirables finales et plusieurs autres morceaux d’élite. Je ne connaissais, du reste, que l’opéra primitif. Qu’on juge donc de mon ravissement à l’audition de ce nouveau chef-d’œuvre ! Une très jeune fille était chargée du rôle de Léonore ; mais cette actrice paraissait tellement s’être identifiée, dès son âge le plus tendre, avec le génie de Beethoven, qu’elle remplissait sa tâche avec une énergie poétique faite pour émouvoir l’âme la plus insensible ; elle s’appelait Schrœder. Qui ne connaît aujourd’hui la réputation européenne de la cantatrice qui porte maintenant le double nom de Schrœder-Devrient ? À elle appartient la gloire d’avoir révélé au public allemand le sublime mérite de Fïdelio, et je vis ce soir-là le parterre étourdi de Vienne fasciné et fanatisé par son merveilleux talent. Pour ma part, j’étais ravi au troisième ciel.
Je ne pus fermer l’œil de la nuit. C’en était trop de ce que je venais d’entendre et du bonheur que me réservait le lendemain, pour que mes sens se laissassent captiver par l’illusion décevante d’un rêve. Je demeurai donc éveillé, livré à une ardente extase et tâchant de préparer dignement mes idées à l’entrevue solennelle qui m’était promise. Enfin le jour parut. J’attendis avec anxiété l’heure la plus convenable pour me présenter, et quand elle sonna, je tressaillis jusqu’à la moelle des os, enivré du bonheur dont j’allais jouir après tant de traverses et de mécomptes.
Mais une horrible épreuve m’attendait encore. Je trouvai froidement accoudé contre la porte de la maison de Beethoven un homme, un démon, cet Anglais acharné. Le diabolique personnage avait semé l’or de la corruption, et l’aubergiste vendu tout le premier à mon implacable ennemi, l’aubergiste qui avait lu le billet non cacheté de Beethoven, avait tout révélé au gentleman. Une sueur froide m’inonda à sa vue. Tout mon enthousiasme, toute la poésie de mes rêves furent glacés, anéantis ; je retombai sous la griffe maudite de mon mauvais ange.
— Venez ! me dit-il dès qu’il m’aperçut, allons ! entrons chez Beethoven. Je voulus d’abord le dérouter en niant que tel fût l’objet de ma démarche ; mais il m’en ôta bientôt la faculté en m’avouant par quel moyen il avait surpris mon secret, et il affirma qu’il ne me quitterait pas avant d’avoir vu Beethoven avec moi. J’essayai d’abord de lui démontrer combien son projet était déraisonnable : vaines paroles ! Je me mis en colère et m’efforçai de le quereller : vains efforts ! À la fin, j’espérai pouvoir me soustraire à cette contrainte par la vivacité de mes jambes ; je montai l’escalier quatre à quatre, et tirai violemment le cordon de la sonnette. Mais avant qu’on eût ouvert la porte, l’Anglais m’avait atteint, et se cramponnant par derrière à mon habit : — J’ai, me dit-il, un droit sur vos basques, et je ne lâcherai prise, mon cher, que devant Beethoven lui-même ! Poussé à bout, je me retourne avec fureur, presque résolu à me servir des voies de fait pour me débarrasser de l’orgueilleux insulaire, quand la porte s’ouvre, et une vieille gouvernante, d’une mine assez revêche, à l’aspect de cet étrange conflit, s’apprêtait déjà à la refermer. Dans une angoisse extrême, je criai mon nom avec éclat en protestant que Beethoven lui-même m’avait donné rendez-vous à cette heure. Mais la vieille ne paraissait pas parfaitement convaincue, tant la vue du gentleman lui inspirait une juste méfiance, lorsque Beethoven parut lui-même sur la porte de son cabinet. Je m’avançai aussitôt pour lui présenter mes excuses, mais j’entraînai à ma suite l’Anglais damné qui ne m’avait pas lâché, et qui en effet ne me laissa libre que lorsque nous fûmes précisément en face de Beethoven. Je dis à celui-ci mon nom qu’il ne pouvait comprendre étant complètement sourd, mais pourtant il parut deviner que c’était moi qui lui avais écrit la veille. Alors il me dit d’entrer ; et aussitôt, sans se laisser troubler le moins du monde par la contenance pleine de surprise de Beethoven, l’Anglais se glissa sur mes pas dans le cabinet.
J’étais donc enfin dans le sanctuaire ; mais la gêne affreuse où me jetait l’incroyable procédé de mon compagnon m’ôtait toute la sérénité d’esprit qui m’eût été nécessaire pour apprécier toute l’étendue de mon bonheur. Beethoven n’avait dans son extérieur, il faut en convenir, rien de séduisant. Vêtu d’un négligé fort en désordre, il avait le corps ceint d’une écharpe de laine rouge. Son abondante chevelure grise encadrait son visage, et l’expression de ses traits, sombre et même dure, n’était guère capable de mettre un terme à mon embarras. Nous nous assîmes devant une table couverte de papiers ; mais une préoccupation pénible nous dominait tous, personne ne parlait, et Beethoven était visiblement contrarié de donner audience à deux personnes au lieu d’une. Enfin il me dit d’un ton brusque : — Vous venez de L… ? J’allais lui répondre, mais il m’arrêta en me présentant une main de papier avec un crayon, et il ajouta : — Ecrivez, s’il vous plaît. Je n’entends pas.
J’étais instruit de la surdité de Beethoven, et pourtant ce fut comme un coup de poignard que ces mots articulés de sa voix rauque : Je n’entends pas ! Vivre dans la pauvreté et les privations, n’avoir au monde d’autre consolation, d’autre joie que la pensée de sa puissance comme musicien, et se dire, à toute heure, à toute minute : Je n’entends pas !… Je lus dans ce seul mot tout le secret de l’aspect défavorable de Beethoven ; je compris la raison de cette tristesse profonde empreinte dans sa physionomie, de la sombre humeur de son regard, et du dépit concentré d’ordinaire sur ses lèvres : il n’entendait pas !… Plein de trouble et d’émotion, et à peine maître de moi, j’écrivis pourtant quelques mots d’excuse accompagnés d’une brève explication des circonstances qui avaient amené chez lui l’Anglais à mes trousses. Celui-ci était demeuré immobile, en silence, et très satisfait de lui-même, en face de Beethoven qui, après avoir lu mes lignes manuscrites, lui demanda assez brusquement ce qu’il y avait pour son service.
— J’ai l’honneur, répliqua l’Anglais… — Monsieur, dit Beethoven, je ne vous entends pas, et je ne puis pas beaucoup parler non plus. Écrivez ce que vous désirez de moi. L’Anglais réfléchit un moment, puis il tira de sa poche un élégant album de musique, en me disant : Très bien ! voulez-vous écrire que je prie M. Beethoven d’examiner mes compositions, et s’il y trouve quelque passage qu’il n’approuve pas, de vouloir bien les signaler par une croix.
J’écrivis sa réclamation mot à mot dans l’espoir d’être bientôt débarrassé de sa présence ; et j’avais deviné juste. Beethoven, après avoir lu, écarta de la main sur la table, avec un étrange sourire, l’album de l’Anglais, et lui dit enfin : Je vous le renverrai, monsieur. Mon gentleman enchanté se leva, fit une superbe révérence, et se retira.
Je respirai enfin ! La physionomie de Beethoven lui-même perdit quelque chose de son austérité, il me considéra quelques secondes, et me dit : « Cet Anglais paraît vous avoir beaucoup tourmenté ; consolez-vous-en avec moi, car il y a longtemps que je suis en butte à ces odieuses persécutions. Ils viennent visiter un pauvre musicien comme ils iraient voir une bête curieuse. Je suis peiné de vous avoir un moment confondu avec cette sorte de gens. Votre lettre témoigne que mes compositions vous ont satisfait ; cela me fait plaisir, car j’ai renoncé à peu près à conquérir les suffrages de la multitude ». Ces paroles simples et familières dissipèrent toute ma timidité, et, pénétré de joie, j’écrivis que j’étais loin assurément d’être le seul qui brûlât du même enthousiasme pour les productions de son brillant génie, et que le plus ardent de mes vœux serait de le voir un jour dans l’enceinte de ma ville natale, où il jouirait de l’admiration unanime inspirée par son talent.
— Les Viennois, en effet, me dit-il, m’impatientent souvent, ils entendent journellement trop de futilités déplorables pour pouvoir écouter de la musique sérieuse avec la gravité convenable.
Je voulus réfuter cette critique en citant les transports dont j’avais été témoin la veille à la représentation de Fidelio. — Hum, hum ! fit-il, Fidelio ?… Mon Dieu, c’est par vanité personnelle qu’ils applaudissent cet ouvrage de la sorte, à cause de la docilité pour leurs conseils dont ils s’imaginent que j’ai fait preuve dans le remaniement de cette partition, et ils croient que leur approbation de commande est une parfaite compensation de mon pénible travail. Ce sont de braves gens, mais légers de science ; et c’est pour cela, du reste, que leur société me plaît davantage que la vôtre, messieurs les érudits. Du reste, comment trouvez-vous Fidelio maintenant ?
— Je lui fis part de l’impression délicieuse que j’avais ressentie la veille, en observant que l’adjonction des nouveaux morceaux avait merveilleusement modifié et complété tout l’ensemble. — Maudite besogne ! répartit Beethoven. L’opéra n’est point mon fait ; du moins je ne connais pas de théâtre au monde pour lequel je voudrais m’engager à composer un nouvel ouvrage. Si j’écrivais une partition conformément à mes propres instincts, personne ne voudrait l’entendre, car je n’y mettrais ni ariettes, ni duos, ni rien de tout ce bagage convenu qui sert aujourd’hui à fabriquer un opéra, et ce que je mettrais à la place ne révolterait pas moins les chanteurs que le public. Ils ne connaissent tous que le mensonge et le vide musical déguisés sous de brillants dehors, le néant paré d’oripeaux. Celui qui ferait un drame lyrique vraiment digne de ce nom passerait pour un fou, et le serait en effet, s’il exposait son œuvre à la critique du public, au lieu de la garder pour lui seul.
On ne peut nier, à la vérité, que l’ouvrage n’ait beaucoup gagné à son remaniement ; mais cela vient surtout de ce que l’auteur du second libretto offrit au musicien plus d’occasions de développer son brillant génie ; Fidelio possède d’ailleurs en propre ses admirables finales et plusieurs autres morceaux d’élite. Je ne connaissais, du reste, que l’opéra primitif. Qu’on juge donc de mon ravissement à l’audition de ce nouveau chef-d’œuvre ! Une très jeune fille était chargée du rôle de Léonore ; mais cette actrice paraissait tellement s’être identifiée, dès son âge le plus tendre, avec le génie de Beethoven, qu’elle remplissait sa tâche avec une énergie poétique faite pour émouvoir l’âme la plus insensible ; elle s’appelait Schrœder. Qui ne connaît aujourd’hui la réputation européenne de la cantatrice qui porte maintenant le double nom de Schrœder-Devrient ? À elle appartient la gloire d’avoir révélé au public allemand le sublime mérite de Fïdelio, et je vis ce soir-là le parterre étourdi de Vienne fasciné et fanatisé par son merveilleux talent. Pour ma part, j’étais ravi au troisième ciel.
Je ne pus fermer l’œil de la nuit. C’en était trop de ce que je venais d’entendre et du bonheur que me réservait le lendemain, pour que mes sens se laissassent captiver par l’illusion décevante d’un rêve. Je demeurai donc éveillé, livré à une ardente extase et tâchant de préparer dignement mes idées à l’entrevue solennelle qui m’était promise. Enfin le jour parut. J’attendis avec anxiété l’heure la plus convenable pour me présenter, et quand elle sonna, je tressaillis jusqu’à la moelle des os, enivré du bonheur dont j’allais jouir après tant de traverses et de mécomptes.
Mais une horrible épreuve m’attendait encore. Je trouvai froidement accoudé contre la porte de la maison de Beethoven un homme, un démon, cet Anglais acharné. Le diabolique personnage avait semé l’or de la corruption, et l’aubergiste vendu tout le premier à mon implacable ennemi, l’aubergiste qui avait lu le billet non cacheté de Beethoven, avait tout révélé au gentleman. Une sueur froide m’inonda à sa vue. Tout mon enthousiasme, toute la poésie de mes rêves furent glacés, anéantis ; je retombai sous la griffe maudite de mon mauvais ange.
— Venez ! me dit-il dès qu’il m’aperçut, allons ! entrons chez Beethoven. Je voulus d’abord le dérouter en niant que tel fût l’objet de ma démarche ; mais il m’en ôta bientôt la faculté en m’avouant par quel moyen il avait surpris mon secret, et il affirma qu’il ne me quitterait pas avant d’avoir vu Beethoven avec moi. J’essayai d’abord de lui démontrer combien son projet était déraisonnable : vaines paroles ! Je me mis en colère et m’efforçai de le quereller : vains efforts ! À la fin, j’espérai pouvoir me soustraire à cette contrainte par la vivacité de mes jambes ; je montai l’escalier quatre à quatre, et tirai violemment le cordon de la sonnette. Mais avant qu’on eût ouvert la porte, l’Anglais m’avait atteint, et se cramponnant par derrière à mon habit : — J’ai, me dit-il, un droit sur vos basques, et je ne lâcherai prise, mon cher, que devant Beethoven lui-même ! Poussé à bout, je me retourne avec fureur, presque résolu à me servir des voies de fait pour me débarrasser de l’orgueilleux insulaire, quand la porte s’ouvre, et une vieille gouvernante, d’une mine assez revêche, à l’aspect de cet étrange conflit, s’apprêtait déjà à la refermer. Dans une angoisse extrême, je criai mon nom avec éclat en protestant que Beethoven lui-même m’avait donné rendez-vous à cette heure. Mais la vieille ne paraissait pas parfaitement convaincue, tant la vue du gentleman lui inspirait une juste méfiance, lorsque Beethoven parut lui-même sur la porte de son cabinet. Je m’avançai aussitôt pour lui présenter mes excuses, mais j’entraînai à ma suite l’Anglais damné qui ne m’avait pas lâché, et qui en effet ne me laissa libre que lorsque nous fûmes précisément en face de Beethoven. Je dis à celui-ci mon nom qu’il ne pouvait comprendre étant complètement sourd, mais pourtant il parut deviner que c’était moi qui lui avais écrit la veille. Alors il me dit d’entrer ; et aussitôt, sans se laisser troubler le moins du monde par la contenance pleine de surprise de Beethoven, l’Anglais se glissa sur mes pas dans le cabinet.
J’étais donc enfin dans le sanctuaire ; mais la gêne affreuse où me jetait l’incroyable procédé de mon compagnon m’ôtait toute la sérénité d’esprit qui m’eût été nécessaire pour apprécier toute l’étendue de mon bonheur. Beethoven n’avait dans son extérieur, il faut en convenir, rien de séduisant. Vêtu d’un négligé fort en désordre, il avait le corps ceint d’une écharpe de laine rouge. Son abondante chevelure grise encadrait son visage, et l’expression de ses traits, sombre et même dure, n’était guère capable de mettre un terme à mon embarras. Nous nous assîmes devant une table couverte de papiers ; mais une préoccupation pénible nous dominait tous, personne ne parlait, et Beethoven était visiblement contrarié de donner audience à deux personnes au lieu d’une. Enfin il me dit d’un ton brusque : — Vous venez de L… ? J’allais lui répondre, mais il m’arrêta en me présentant une main de papier avec un crayon, et il ajouta : — Ecrivez, s’il vous plaît. Je n’entends pas.
J’étais instruit de la surdité de Beethoven, et pourtant ce fut comme un coup de poignard que ces mots articulés de sa voix rauque : Je n’entends pas ! Vivre dans la pauvreté et les privations, n’avoir au monde d’autre consolation, d’autre joie que la pensée de sa puissance comme musicien, et se dire, à toute heure, à toute minute : Je n’entends pas !… Je lus dans ce seul mot tout le secret de l’aspect défavorable de Beethoven ; je compris la raison de cette tristesse profonde empreinte dans sa physionomie, de la sombre humeur de son regard, et du dépit concentré d’ordinaire sur ses lèvres : il n’entendait pas !… Plein de trouble et d’émotion, et à peine maître de moi, j’écrivis pourtant quelques mots d’excuse accompagnés d’une brève explication des circonstances qui avaient amené chez lui l’Anglais à mes trousses. Celui-ci était demeuré immobile, en silence, et très satisfait de lui-même, en face de Beethoven qui, après avoir lu mes lignes manuscrites, lui demanda assez brusquement ce qu’il y avait pour son service.
— J’ai l’honneur, répliqua l’Anglais… — Monsieur, dit Beethoven, je ne vous entends pas, et je ne puis pas beaucoup parler non plus. Écrivez ce que vous désirez de moi. L’Anglais réfléchit un moment, puis il tira de sa poche un élégant album de musique, en me disant : Très bien ! voulez-vous écrire que je prie M. Beethoven d’examiner mes compositions, et s’il y trouve quelque passage qu’il n’approuve pas, de vouloir bien les signaler par une croix.
J’écrivis sa réclamation mot à mot dans l’espoir d’être bientôt débarrassé de sa présence ; et j’avais deviné juste. Beethoven, après avoir lu, écarta de la main sur la table, avec un étrange sourire, l’album de l’Anglais, et lui dit enfin : Je vous le renverrai, monsieur. Mon gentleman enchanté se leva, fit une superbe révérence, et se retira.
Je respirai enfin ! La physionomie de Beethoven lui-même perdit quelque chose de son austérité, il me considéra quelques secondes, et me dit : « Cet Anglais paraît vous avoir beaucoup tourmenté ; consolez-vous-en avec moi, car il y a longtemps que je suis en butte à ces odieuses persécutions. Ils viennent visiter un pauvre musicien comme ils iraient voir une bête curieuse. Je suis peiné de vous avoir un moment confondu avec cette sorte de gens. Votre lettre témoigne que mes compositions vous ont satisfait ; cela me fait plaisir, car j’ai renoncé à peu près à conquérir les suffrages de la multitude ». Ces paroles simples et familières dissipèrent toute ma timidité, et, pénétré de joie, j’écrivis que j’étais loin assurément d’être le seul qui brûlât du même enthousiasme pour les productions de son brillant génie, et que le plus ardent de mes vœux serait de le voir un jour dans l’enceinte de ma ville natale, où il jouirait de l’admiration unanime inspirée par son talent.
— Les Viennois, en effet, me dit-il, m’impatientent souvent, ils entendent journellement trop de futilités déplorables pour pouvoir écouter de la musique sérieuse avec la gravité convenable.
Je voulus réfuter cette critique en citant les transports dont j’avais été témoin la veille à la représentation de Fidelio. — Hum, hum ! fit-il, Fidelio ?… Mon Dieu, c’est par vanité personnelle qu’ils applaudissent cet ouvrage de la sorte, à cause de la docilité pour leurs conseils dont ils s’imaginent que j’ai fait preuve dans le remaniement de cette partition, et ils croient que leur approbation de commande est une parfaite compensation de mon pénible travail. Ce sont de braves gens, mais légers de science ; et c’est pour cela, du reste, que leur société me plaît davantage que la vôtre, messieurs les érudits. Du reste, comment trouvez-vous Fidelio maintenant ?
— Je lui fis part de l’impression délicieuse que j’avais ressentie la veille, en observant que l’adjonction des nouveaux morceaux avait merveilleusement modifié et complété tout l’ensemble. — Maudite besogne ! répartit Beethoven. L’opéra n’est point mon fait ; du moins je ne connais pas de théâtre au monde pour lequel je voudrais m’engager à composer un nouvel ouvrage. Si j’écrivais une partition conformément à mes propres instincts, personne ne voudrait l’entendre, car je n’y mettrais ni ariettes, ni duos, ni rien de tout ce bagage convenu qui sert aujourd’hui à fabriquer un opéra, et ce que je mettrais à la place ne révolterait pas moins les chanteurs que le public. Ils ne connaissent tous que le mensonge et le vide musical déguisés sous de brillants dehors, le néant paré d’oripeaux. Celui qui ferait un drame lyrique vraiment digne de ce nom passerait pour un fou, et le serait en effet, s’il exposait son œuvre à la critique du public, au lieu de la garder pour lui seul.
Une visite à Beethoven
Effectivement, je devais ce jour-là même jouir enfin pour la première fois de la vue de l’illustre compositeur. Rien ne saurait peindre mon ravissement et ma secrète rage tout à la fois, quand, assis côte à côte avec mon gentleman, je vis s’avancer le musicien allemand dont la tournure et les manières répondaient de tout point au signalement que m’avait fourni l’aubergiste. Une taille élevée, que dessinait une longue redingote bleue, des cheveux gris ébouriffés, et les mêmes traits, la même expression de visage que depuis si longtemps évoquait mon imagination. Il était impossible de s’y tromper, et je l’avais reconnu au premier coup d’œil. Il s’avança vivement, quoiqu’à petits pas, de notre côté. Le respect et la surprise enchaînaient tous mes sens. L’Anglais ne perdit pas un seul de mes mouvements, et examinait d’un œil curieux le nouveau venu, qui, après s’être retiré, dans l’endroit le plus écarté du jardin, peu fréquenté, du reste, à cette heure, se fit apporter par le garçon une bouteille de vin, et puis demeura quelque temps dans une attitude pensive, les mains appuyées sur le pommeau de sa canne. Mon cœur palpitant me disait : c’est lui ! Pendant quelques minutes, j’oubliai mon voisin, et je contemplai d’un regard avide, avec une émotion indéfinissable, cet homme de génie qui seul maîtrisait tous mes sentiments et toutes mes idées, depuis que j’avais appris à penser et à sentir. Involontairement je me mis à parler tout bas, et j’entamai une sorte de soliloque qui se termina par ces mots trop significatifs : « Beethoven ! c’est donc toi que je vois ! » Mais rien n’échappa à mon inquisiteur, et je fus subitement réveillé de ma profonde extase par ces paroles confirmatives : — Yes ! ce gentleman est Beethoven lui-même ! venez avec moi et abordons-le tous deux.
Plein d’anxiété et de dépit, je saisis par le bras le maudit Anglais pour le retenir à sa place : « Qu’allez-vous faire ? lui dis-je ; voulez-vous donc nous compromettre, ici, sans plus de cérémonie ?…
— Mais, répliqua-t-il, c’est une excellente occasion, qui ne se retrouvera peut-être jamais. En même temps, il tira de sa poche une espèce d’album, et se dirigea tout droit vers l’homme à la redingote bleue. Exaspéré au dernier point, je saisis de nouveau cet insensé par les basques de son habit, en lui criant avec force : — Avez-vous donc le diable au corps !
Cette altercation éveilla l’attention de l’étranger. Il paraissait deviner avec un sentiment pénible qu’il était l’objet de ce conflit, et s’étant empressé de vider son verre, il se leva pour s’en aller. Mais l’Anglais s’en fut à peine aperçu qu’il fit un violent effort pour s’arracher à ma contrainte, et me laissant un pan de son frac entre les mains, il se précipita sur le passage de Beethoven. Celui-ci chercha à l’éviter, mais le traître ne lui en laissa pas la faculté, il lui adressa un élégant salut selon les règles de la fashion britannique, et l’apostropha en ces termes : — J’ai l’honneur de me présenter au très illustre compositeur et très honorable monsieur Beethoven. — Il fut dispensé d’en dire davantage, car à la première syllabe Beethoven avait fait un écart rapide, et en jetant un regard furtif de mon côté, avait franchi le seuil du jardin avec la rapidité de l’éclair. Cependant l’imperturbable Anglais se disposait à courir après lui ; mais je l’arrêtai d’un mouvement furieux en m’accrochant à sa dernière basque, et lui, se retournant d’un air surpris, dit avec un ton singulier : — Goddam ! ce gentleman est digne d’être Anglais. C’est un bien grand homme, et je ne tarderai pas à faire sa connaissance.
Je demeurai pétrifié ; cette affreuse aventure m’ôtait désormais tout espoir de voir s’accomplir le plus ardent de mes vœux.
Je restai convaincu dès lors que toutes mes démarches pour avoir accès auprès de Beethoven seraient désormais infructueuses ; et, d’après la position de mes finances, je n’avais plus d’autre parti à prendre que de retourner sur mes pas, ou bien de risquer encore, pour parvenir à mon but, quelque tentative désespérée. La première alternative me faisait frissonner ; et qui ne se serait pas révolté à l’idée de se voir à jamais exclu du port après en avoir déjà franchi le seuil ? Avant de subir une aussi cruelle déception, je résolus donc de tenter un suprême effort. Mais à quel procédé avoir recours ? Quel chemin pouvait m’offrir l’issue favorable ? Je fus longtemps sans rien imaginer d’ingénieux. Toutes mes facultés, hélas ! étaient frappées d’atonie, et mon esprit était uniquement préoccupé de ce que j’avais vu tandis que j’étais accroché aux basques du maudit Anglais. Le regard furtif que m’avait lancé Beethoven dans cette affreuse conjoncture n’était que trop significatif : il m’avait assimilé à un Anglais ! Comment détruire cette funeste prévention dans l’esprit du grand compositeur ? Comment lui faire savoir que j’étais un franc et naïf Allemand, aussi pauvre d’argent que riche d’enthousiasme ? — Enfin, je me décidai à soulager mon cœur oppressé en lui écrivant. Je traçai donc sur le papier une brève histoire de ma vie ; je lui racontais de quelle manière j’étais devenu musicien, quelle adoration je professais pour son génie, et quelle était ma tentation de le connaître et de le voir de près. Je ne lui cachais pas que j’avais sacrifié, pour y parvenir, deux années entières à me créer une réputation dans la facture des galops et des pots-pourris ; enfin, je lui décrivais les détails de mon pèlerinage et quelles souffrances m’avaient causées la rencontre et l’obstination de l’horrible touriste anglais.
Tout en rédigeant ce récit de mes infortunes, mon cœur se dilatait, et j’arrivai, en finissant ma lettre, à une sorte d’épanchement confidentiel qui m’inspira même quelques reproches nettement articulés sur sa cruauté à mon égard et l’injustice de ses soupçons. Ma péroraison était pleine de feu, et j’eus pour ainsi dire un éblouissement en relisant l’adresse que je venais d’écrire : À Monsieur Louis de Beethoven. J’adressai au Ciel une muette prière, et j’allai moi-même remettre ma lettre au concierge.
Mais en rentrant à mon hôtel, ivre d’espérance, quel fut mon désappointement en apercevant encore l’Anglais à sa fenêtre ! Il m’avait vu sortir de la maison de Beethoven ; il avait remarqué l’expression joyeuse et fière de ma physionomie, et il n’en fallait pas davantage pour réveiller les importunités de sa malveillance tyrannique. Il vint à ma rencontre sur l’escalier en me disant : — Eh bien ! bon espoir ! Quand reverrons-nous Beethoven ? — Jamais, jamais ! lui dis-je ; Beetheven ne sera plus visible pour vous. Laissez-moi, monsieur ! il n’y a rien de commun entre nous ! — Oh ! pardonnez-moi, répondit-il ; et la basque de mon habit ? De quel droit, monsieur, avez-vous agi ainsi avec moi ? C’est vous qui êtes cause de la réception que m’a faite M. Beethoven. Il est clair qu’il a dû se formaliser de cette inconvenance.
Outré d’une aussi ridicule prétention, je m’écriai : — Monsieur, je vous rendrai la basque de votre frac. Vous pourrez le conserver comme un souvenir honteux de votre offense envers l’illustre Beethoven, et de vos persécutions inouïes envers un pauvre musicien. Adieu, monsieur, et puissions-nous ne jamais nous revoir ! Il chercha à me retenir, en me disant, pour me tranquilliser, qu’il avait encore bon nombre d’habits en parfait état, et me demandant par grâce de lui apprendre quel jour Beethoven consentirait à nous recevoir. Mais je m’élançai avec impétuosité jusqu’à ma mansarde, et je m’y enfermai pour attendre impatiemment la réponse à ma lettre.
Comment exprimer ce qui se passa en moi lors qu’au bout d’une heure à peu près, on m’apporta un petit fragment de papier à musique sur lequel étaient tracées à la hâte les lignes suivantes :
« Pardonnez-moi, monsieur R…, de ne pouvoir vous recevoir que demain avant midi, étant occupé aujourd’hui à préparer un paquet de musique, qui doit partir par le courrier. Demain je vous attendrai.
« Beethoven. ».
Je tombai involontairement à genoux, les yeux baignés de larmes délicieuses, et je rendis grâce à Dieu de cette insigne faveur. Mon ravissement se traduisit ensuite par des bonds sauvages, et je me livrai dans ma petite chambre aux contorsions les plus folles. J’ignore quelle figure de danse j’exécutai dans mon délire ; mais je me rappelle encore avec quelle confusion je m’interrompis subitement en entendant quelqu’un qui semblait m’accompagner en sifflant l’air d’un de mes galops. Rendu à mon sang-froid par cette allusion ironique, je pris mon chapeau, je sortis de l’hôtel, et je m’élançai à travers les rues de Vienne, léger et fringant comme un écolier en maraude. Mes tribulations, hélas ! m’avaient jusque-là fait oublier que j’habitais Vienne. Aussi combien ne fus-je pas alors émerveillé du brillant aspect de cette ville impériale ! Dans mon état d’exaltation, tout s’offrait à moi sous les plus séduisantes couleurs. La sensualité superficielle des habitants me paraissait une ardeur vitale pleine de fécondité, et dans leur manie de jouissances futiles et éphémères, je ne voyais qu’une active passion de l’art et du beau. Je lus les cinq affiches journalières des spectacles, dont l’une portait en gros caractères l’annonce de Fidelio, musique de Beethoven.
Comment me dispenser d’une semblable fête, malgré la piteuse situation de ma bourse ? On commençait l’ouverture au moment même où j’entrais au parterre. Je reconnus aussitôt que c’était un remaniement de l’opéra donné d’abord sous le titre de Léonore, et qui, à l’honneur du public viennois, n’avait obtenu à sa première apparition aucun succès.
Effectivement, je devais ce jour-là même jouir enfin pour la première fois de la vue de l’illustre compositeur. Rien ne saurait peindre mon ravissement et ma secrète rage tout à la fois, quand, assis côte à côte avec mon gentleman, je vis s’avancer le musicien allemand dont la tournure et les manières répondaient de tout point au signalement que m’avait fourni l’aubergiste. Une taille élevée, que dessinait une longue redingote bleue, des cheveux gris ébouriffés, et les mêmes traits, la même expression de visage que depuis si longtemps évoquait mon imagination. Il était impossible de s’y tromper, et je l’avais reconnu au premier coup d’œil. Il s’avança vivement, quoiqu’à petits pas, de notre côté. Le respect et la surprise enchaînaient tous mes sens. L’Anglais ne perdit pas un seul de mes mouvements, et examinait d’un œil curieux le nouveau venu, qui, après s’être retiré, dans l’endroit le plus écarté du jardin, peu fréquenté, du reste, à cette heure, se fit apporter par le garçon une bouteille de vin, et puis demeura quelque temps dans une attitude pensive, les mains appuyées sur le pommeau de sa canne. Mon cœur palpitant me disait : c’est lui ! Pendant quelques minutes, j’oubliai mon voisin, et je contemplai d’un regard avide, avec une émotion indéfinissable, cet homme de génie qui seul maîtrisait tous mes sentiments et toutes mes idées, depuis que j’avais appris à penser et à sentir. Involontairement je me mis à parler tout bas, et j’entamai une sorte de soliloque qui se termina par ces mots trop significatifs : « Beethoven ! c’est donc toi que je vois ! » Mais rien n’échappa à mon inquisiteur, et je fus subitement réveillé de ma profonde extase par ces paroles confirmatives : — Yes ! ce gentleman est Beethoven lui-même ! venez avec moi et abordons-le tous deux.
Plein d’anxiété et de dépit, je saisis par le bras le maudit Anglais pour le retenir à sa place : « Qu’allez-vous faire ? lui dis-je ; voulez-vous donc nous compromettre, ici, sans plus de cérémonie ?…
— Mais, répliqua-t-il, c’est une excellente occasion, qui ne se retrouvera peut-être jamais. En même temps, il tira de sa poche une espèce d’album, et se dirigea tout droit vers l’homme à la redingote bleue. Exaspéré au dernier point, je saisis de nouveau cet insensé par les basques de son habit, en lui criant avec force : — Avez-vous donc le diable au corps !
Cette altercation éveilla l’attention de l’étranger. Il paraissait deviner avec un sentiment pénible qu’il était l’objet de ce conflit, et s’étant empressé de vider son verre, il se leva pour s’en aller. Mais l’Anglais s’en fut à peine aperçu qu’il fit un violent effort pour s’arracher à ma contrainte, et me laissant un pan de son frac entre les mains, il se précipita sur le passage de Beethoven. Celui-ci chercha à l’éviter, mais le traître ne lui en laissa pas la faculté, il lui adressa un élégant salut selon les règles de la fashion britannique, et l’apostropha en ces termes : — J’ai l’honneur de me présenter au très illustre compositeur et très honorable monsieur Beethoven. — Il fut dispensé d’en dire davantage, car à la première syllabe Beethoven avait fait un écart rapide, et en jetant un regard furtif de mon côté, avait franchi le seuil du jardin avec la rapidité de l’éclair. Cependant l’imperturbable Anglais se disposait à courir après lui ; mais je l’arrêtai d’un mouvement furieux en m’accrochant à sa dernière basque, et lui, se retournant d’un air surpris, dit avec un ton singulier : — Goddam ! ce gentleman est digne d’être Anglais. C’est un bien grand homme, et je ne tarderai pas à faire sa connaissance.
Je demeurai pétrifié ; cette affreuse aventure m’ôtait désormais tout espoir de voir s’accomplir le plus ardent de mes vœux.
Je restai convaincu dès lors que toutes mes démarches pour avoir accès auprès de Beethoven seraient désormais infructueuses ; et, d’après la position de mes finances, je n’avais plus d’autre parti à prendre que de retourner sur mes pas, ou bien de risquer encore, pour parvenir à mon but, quelque tentative désespérée. La première alternative me faisait frissonner ; et qui ne se serait pas révolté à l’idée de se voir à jamais exclu du port après en avoir déjà franchi le seuil ? Avant de subir une aussi cruelle déception, je résolus donc de tenter un suprême effort. Mais à quel procédé avoir recours ? Quel chemin pouvait m’offrir l’issue favorable ? Je fus longtemps sans rien imaginer d’ingénieux. Toutes mes facultés, hélas ! étaient frappées d’atonie, et mon esprit était uniquement préoccupé de ce que j’avais vu tandis que j’étais accroché aux basques du maudit Anglais. Le regard furtif que m’avait lancé Beethoven dans cette affreuse conjoncture n’était que trop significatif : il m’avait assimilé à un Anglais ! Comment détruire cette funeste prévention dans l’esprit du grand compositeur ? Comment lui faire savoir que j’étais un franc et naïf Allemand, aussi pauvre d’argent que riche d’enthousiasme ? — Enfin, je me décidai à soulager mon cœur oppressé en lui écrivant. Je traçai donc sur le papier une brève histoire de ma vie ; je lui racontais de quelle manière j’étais devenu musicien, quelle adoration je professais pour son génie, et quelle était ma tentation de le connaître et de le voir de près. Je ne lui cachais pas que j’avais sacrifié, pour y parvenir, deux années entières à me créer une réputation dans la facture des galops et des pots-pourris ; enfin, je lui décrivais les détails de mon pèlerinage et quelles souffrances m’avaient causées la rencontre et l’obstination de l’horrible touriste anglais.
Tout en rédigeant ce récit de mes infortunes, mon cœur se dilatait, et j’arrivai, en finissant ma lettre, à une sorte d’épanchement confidentiel qui m’inspira même quelques reproches nettement articulés sur sa cruauté à mon égard et l’injustice de ses soupçons. Ma péroraison était pleine de feu, et j’eus pour ainsi dire un éblouissement en relisant l’adresse que je venais d’écrire : À Monsieur Louis de Beethoven. J’adressai au Ciel une muette prière, et j’allai moi-même remettre ma lettre au concierge.
Mais en rentrant à mon hôtel, ivre d’espérance, quel fut mon désappointement en apercevant encore l’Anglais à sa fenêtre ! Il m’avait vu sortir de la maison de Beethoven ; il avait remarqué l’expression joyeuse et fière de ma physionomie, et il n’en fallait pas davantage pour réveiller les importunités de sa malveillance tyrannique. Il vint à ma rencontre sur l’escalier en me disant : — Eh bien ! bon espoir ! Quand reverrons-nous Beethoven ? — Jamais, jamais ! lui dis-je ; Beetheven ne sera plus visible pour vous. Laissez-moi, monsieur ! il n’y a rien de commun entre nous ! — Oh ! pardonnez-moi, répondit-il ; et la basque de mon habit ? De quel droit, monsieur, avez-vous agi ainsi avec moi ? C’est vous qui êtes cause de la réception que m’a faite M. Beethoven. Il est clair qu’il a dû se formaliser de cette inconvenance.
Outré d’une aussi ridicule prétention, je m’écriai : — Monsieur, je vous rendrai la basque de votre frac. Vous pourrez le conserver comme un souvenir honteux de votre offense envers l’illustre Beethoven, et de vos persécutions inouïes envers un pauvre musicien. Adieu, monsieur, et puissions-nous ne jamais nous revoir ! Il chercha à me retenir, en me disant, pour me tranquilliser, qu’il avait encore bon nombre d’habits en parfait état, et me demandant par grâce de lui apprendre quel jour Beethoven consentirait à nous recevoir. Mais je m’élançai avec impétuosité jusqu’à ma mansarde, et je m’y enfermai pour attendre impatiemment la réponse à ma lettre.
Comment exprimer ce qui se passa en moi lors qu’au bout d’une heure à peu près, on m’apporta un petit fragment de papier à musique sur lequel étaient tracées à la hâte les lignes suivantes :
« Pardonnez-moi, monsieur R…, de ne pouvoir vous recevoir que demain avant midi, étant occupé aujourd’hui à préparer un paquet de musique, qui doit partir par le courrier. Demain je vous attendrai.
« Beethoven. ».
Je tombai involontairement à genoux, les yeux baignés de larmes délicieuses, et je rendis grâce à Dieu de cette insigne faveur. Mon ravissement se traduisit ensuite par des bonds sauvages, et je me livrai dans ma petite chambre aux contorsions les plus folles. J’ignore quelle figure de danse j’exécutai dans mon délire ; mais je me rappelle encore avec quelle confusion je m’interrompis subitement en entendant quelqu’un qui semblait m’accompagner en sifflant l’air d’un de mes galops. Rendu à mon sang-froid par cette allusion ironique, je pris mon chapeau, je sortis de l’hôtel, et je m’élançai à travers les rues de Vienne, léger et fringant comme un écolier en maraude. Mes tribulations, hélas ! m’avaient jusque-là fait oublier que j’habitais Vienne. Aussi combien ne fus-je pas alors émerveillé du brillant aspect de cette ville impériale ! Dans mon état d’exaltation, tout s’offrait à moi sous les plus séduisantes couleurs. La sensualité superficielle des habitants me paraissait une ardeur vitale pleine de fécondité, et dans leur manie de jouissances futiles et éphémères, je ne voyais qu’une active passion de l’art et du beau. Je lus les cinq affiches journalières des spectacles, dont l’une portait en gros caractères l’annonce de Fidelio, musique de Beethoven.
Comment me dispenser d’une semblable fête, malgré la piteuse situation de ma bourse ? On commençait l’ouverture au moment même où j’entrais au parterre. Je reconnus aussitôt que c’était un remaniement de l’opéra donné d’abord sous le titre de Léonore, et qui, à l’honneur du public viennois, n’avait obtenu à sa première apparition aucun succès.
Désireux de se mêler au monde artistique, de courir fortune et d'acquérir de la gloire, Wagner, ayant abandonné ses fonctions de premier Musikdirector du théâtre de Riga, arriva à Paris, au mois de septembre 1839, avec sa jeune et vénuste femme, Wilhelmine Planer, et un magnifique terre-neuve obéissant au nom de Robber. « Absolument sans ressources et avec une connaissance à peine suffisante de la langue française », mais le coeur gonflé d'espérance, il s'installa dans une maison pauvrement meublée de la rue de la Tonnellerie.
Né le 23 mai 1813, à Leipzig, sur le Brühl, au deuxième étage du « Lion rouge et blanc », j ’ai été baptisé, deux jours plus tard, en l’église Saint-Thomas, sous le nom de Guillaume-Richard. A ma naissance, mon père, Frédéric Wagner, était secrétaire à la direction de la police. Il avait l’espoir de devenir directeur, quand il mourut au mois d’octobre de cette même année. Surmenée par l’énorme travail qu’imposèrent a son département les affaires résultant des troubles de ce temps-là et de la bataille de Leipzig, sa constitution ne put résister à la fièvre typhoïde, alors épidémique.
Nos animaux domestiques, Peps et Papo, contribuèrent d’abord pour leur grande part à l’agrément de notre ménage. Chien et perroquet m’aimaient passionnément parfois même de façon importune. Peps prétendait avoir sa place derrière moi, sur ma chaise de travail, et Pap m’appelait par mon nom : Richard, lorsque je m'absentais trop longtemps du salon où il se tenait. Quand je répondais pas, il arrivait en voletant dans mon cabinet et posé sur ma table, se mettait à jouer d'une manière inquiétante avec les plumes et le papier. Il était si bien dressé que jamais il ne poussait son cri naturel d'oiseau on ne l’entendait que parler ou chanter. Des qu il percevait mes pas dans l’escalier, il m’accueillait par la marche finale de la Symphonie en ut mineur de la Huitième symphonie en fa majeur, ou encore par un des joyeux motifs de l ’ouverture de Rienzi.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Richard Wagner
Quiz
Voir plus
Les trois mousquetaires
De quelle couleur est le cheval de d'Artagnan ?
Rouge
Bleu
Noir
Jaune
16 questions
1035 lecteurs ont répondu
Thème : Les Trois Mousquetaires de
Alexandre DumasCréer un quiz sur cet auteur1035 lecteurs ont répondu