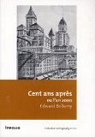Nationalité : France
Né(e) à : Saint-Denis , le 12/01/1952
Né(e) à : Saint-Denis , le 12/01/1952
Biographie :
Thierry Paquot est un philosophe et urbaniste.
Il a soutenu en 1979 une thèse de doctorat en économie intitulée "Nationalisation : propriété et pouvoir : éléments pour une histoire de l'idéologie économiste au sein du mouvement ouvrier français", à l'Université de Lille.
Il a enseigné dans différentes institutions, notamment à l'École d'architecture de Paris-La Défense et à l'Institut d'urbanisme de Paris où il est professeur émérite.
Il occupe également plusieurs postes dans les médias consacrés à l'urbanisme. Il a été éditeur de la revue "Urbanisme" (1994-2012), le producteur de l'émission "Permis de construire" sur France-Culture (1996-2000).
Il a été producteur de "Côté ville", sur France-Culture dans Métropolitains de François Chaslin et le responsable scientifique du programme "La forme d'une ville au Forum des Images" (Paris).
Il a donné des cours à l’École d'architecture de La Cambre (Bruxelles) et au Département d'urbanisme de l'Université d'architecture de Venise, ainsi que de nombreuses conférences en France et à l'étranger.
Il a appartenu à l'Académie Nationale des Arts de la Rue (ANAR), à la Commission de néologie et de terminologie du Ministère de l'équipement auprès de l'Académie Française, à la Commission audiovisuelle de la Dapa (Ministère de la Culture), à la Commission du Vieux Paris, et a été membre des comités de rédaction des revues Esprit, Hermès, Prospero, La Revue du MAUSS, Diversité-Ville École Intégration et a collaboré régulièrement au Monde Diplomatique, à Informations Sociales, Projet et Études.
En 2014, il crée une revue annuelle, "L'Esprit des villes", aux éditions Infolio, dont il dirige le second numéro, paru en décembre 2015.
Il est l’auteur de plus de quarante ouvrages, dont "Un philosophe en ville" (2011) et "Poétique de l’eau, actualité de Bachelard" (2013).
+ Voir plusThierry Paquot est un philosophe et urbaniste.
Il a soutenu en 1979 une thèse de doctorat en économie intitulée "Nationalisation : propriété et pouvoir : éléments pour une histoire de l'idéologie économiste au sein du mouvement ouvrier français", à l'Université de Lille.
Il a enseigné dans différentes institutions, notamment à l'École d'architecture de Paris-La Défense et à l'Institut d'urbanisme de Paris où il est professeur émérite.
Il occupe également plusieurs postes dans les médias consacrés à l'urbanisme. Il a été éditeur de la revue "Urbanisme" (1994-2012), le producteur de l'émission "Permis de construire" sur France-Culture (1996-2000).
Il a été producteur de "Côté ville", sur France-Culture dans Métropolitains de François Chaslin et le responsable scientifique du programme "La forme d'une ville au Forum des Images" (Paris).
Il a donné des cours à l’École d'architecture de La Cambre (Bruxelles) et au Département d'urbanisme de l'Université d'architecture de Venise, ainsi que de nombreuses conférences en France et à l'étranger.
Il a appartenu à l'Académie Nationale des Arts de la Rue (ANAR), à la Commission de néologie et de terminologie du Ministère de l'équipement auprès de l'Académie Française, à la Commission audiovisuelle de la Dapa (Ministère de la Culture), à la Commission du Vieux Paris, et a été membre des comités de rédaction des revues Esprit, Hermès, Prospero, La Revue du MAUSS, Diversité-Ville École Intégration et a collaboré régulièrement au Monde Diplomatique, à Informations Sociales, Projet et Études.
En 2014, il crée une revue annuelle, "L'Esprit des villes", aux éditions Infolio, dont il dirige le second numéro, paru en décembre 2015.
Il est l’auteur de plus de quarante ouvrages, dont "Un philosophe en ville" (2011) et "Poétique de l’eau, actualité de Bachelard" (2013).
Source : urbanisme.univ-paris12.fr
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (14)
Voir plusAjouter une vidéo
Rachel Carson, figure majeure de la pensée écologiste du XXe siècle, est plutôt méconnue du grand public, bien que ses travaux aient une résonance particulière face aux enjeux environnement actuels. Pour en parler, le Book Club reçoit la romancière Isabelle Collombat et l'essayiste Thierry Paquot.
#bookclubculture #environnement #rachelcarson
________
Venez participer au Book club, on vous attend par ici https://www.instagram.com/bookclubculture_
Et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #bookclubculture
Retrouvez votre rendez-vous littéraire quotidien https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqL4fBA4¤££¤6Le Book Club18¤££¤
ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club-part-2
Suivez France Culture sur :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture
Twitter : https://twitter.com/franceculture
Instagram : https://www.instagram.com/franceculture
TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture
Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
+ Lire la suite
Citations et extraits (60)
Voir plus
Ajouter une citation
Personne ne s’étonne de trouver un(e) philosophe dans un amphithéâtre ou une bibliothèque. Pas plus du reste que de l’entendre s’exprimer à la radio ou à la télévision sur « la violence », « la peur », « le bonheur », « le bien », « le foot », « l’obésité », « la mort », Facebook , ou d’autres sujets dignes du baccalauréat. Certains d’entre eux se sont même spécialisés en philosophie du droit, de la technique, des médias, de la bioéthique, du don d’organe, que sais-je encore ! Mais pour la ville, les banlieues, l’urbain, vous repasserez ! Dans les banlieues qui rencontrent-nous ? Des sauvageons, des rappeurs, des tagueurs, et bien sûr des banlieusards, selon un large éventail de types socio-générationnels, mais point de philosophe ! Pourtant on nous raconte que la philosophie est fille de la ville, que c’est à l’ombre de la stoa (le « portique » en grec, d’où le « stoïcisme » qui désigne l’école des philosophes qui se retrouvaient à cet endroit) que des hommes, plutôt jeunes, discutaient entre eux, et que ces échanges d’idées et de raisonnements constituaient leur corpus philosophique également constitué de dialogues.
Le médiéviste Jacques Le Goff explique comment l'Eglise, qui avait imposé son temps liturgique à l'ensemble des sociétés médiévales en le rythmant au son des cloches (le clocher est une invention des VIe et VIIe siècles), va, à partir du XIIe siècle, être concurrencée par le « temps des marchands », temps laïc, temps du travail « salarié », temps urbain par excellence. Il insiste sur un fait, pas assez étudié : à son avis le « glissement significatif de l'heure dite de la none, heure de la pause et du repas dans le haut Moyen Age où elle se situait aux alentours de quatorze heures, s'opère vers le moment de midi. Sur le chantier urbain naît ainsi au XIVe siècle une nouvelle entité de mesure concrète du temps : la demi-journée ».
1090 - [p. 32]
1090 - [p. 32]
Les Pays-Bas, de leur côté, se trouvent par endroits au-dessous du niveau de la mer, entraînant de récurrents affrontements contre la montée des eaux qui laissent parfois certains territoires totalement inondés. Le calendrier des catastrophes égrène ses dates funestes : 1170, 1219, 1251, 1277, 1282, 1337, 1395, 1421, 1530, 1809, 1825... Chacun connaît la blague selon laquelle Dieu a créé le monde et les Hollandais la Hollande. Elle possède sa vérité : les Hollandais ont dû apprendre à dompter les eaux en inventant des systèmes de retenue, des canaux, des polders, des constructions sur pilotis, des maisons flottantes... Les Hollandais sont aussi les premiers à prendre au sérieux les effets du réchauffement climatiques sur la montée des eaux, en conséquence de quoi ils déplacent des maisons, des hôtels et des équipements de bord de mer sur des sites mieux protégés et interdisent toute construction à proximité du rivage.
« “Habiter” est un verbe qui impressionne, qui dit plus qu’il ne contient, qui se prend pour une corne d’abondance, s’ouvre telle la boîte de Pandore, se charge de tous les désirs clandestins que le vaste monde adopte comme possibles.
Exister, c'est se lever.
Personne ne regrette qu'un Jean-Paul Sartre ou un Michel Foucault pourtant engagés pour la légalisation de l'avortement ou pour une amélioration des conditions carcérales,ne se soient jamais prononcés sur les grands ensembles, l'architecture autoritaire de tel tribunal et l'urbanisme indécent de bien des quartiers de villes ou de villages. Pourtant, les técis sont remplies d'hommes et de femmes qui philosophent. Avec leurs mots à eux, ils parlent de leur vie, de leurs difficultés et aussi de leurs plaisirs et surtout de leurs espérances. Un philosophe y trouverait du grain à moudre, non ? Partout où l'existence est en jeu, c'est-à-dire en question, le philosophe est requis. La philosophie, ne l'oublions pas, est une activité et non pas une action. Elle exige une écoute, une interprétation, une proposition. Prenons, par exemple, un philosophe qui réside en banlieue. Celle-ci devient son « terrain » - au sens de l’anthropologue qui mène une enquête en un lieu précis parmi une population particulière - , et lui apporte la matière première brute de sa réflexion. Tout s’impose à lui sous forme de questionnement : Qu’est-ce qu’habiter en un territoire déconsidérée ? Pourquoi la ségrégation se manifeste-elle à la plus ouvertement qu’ailleurs ? En quoi une population est-elle stigmatisées par son habitat, son adresse, son voisinage ? Comment un adolescent vit son passage à l’âge adulte alors meme qu’aucune promesse de futur ne lui est faite ? Vous me direz, ces questions se posent à chacun, n’importe où. Certes, mais elles ne sont ni hors-sol, ni désincarnées. Il s’agit d’Ahmed ou de Sophie, de Kevin ou de Charlie qui loge dans le bâtiment B, appartement 7236 de la cité « Le Clos joli » à Aulnay-sous-Bois, à Bobigny ou dans les quartiers déshérités aux confins du Havre, de Lyon ou au coeur même de Marseille.
Dans un livre d'histoire progressiste de la ville productiviste, ces "objets" auraient été célébrés, encensés. Or il convient d'entreprendre une géohistoire critique environnementale qui contrebalance, éclaire, corrige, dénonce, revisite et réécrit l'histoire dominante, convenue, bardée de certitudes, qui figure dans la plupart des ouvrages et continue à être imperturbablement enseignée. Nous voyons ça et là des signes de cette tendance qui, je l'espère, ne fait qu'émerger et va enfler au point de balayer ce qu'elle dénonce. En ce qui concerne l'urbanisation des territoires et des populations ("l'urbanisation des moeurs"), le logement, les villes, les modes de vie et les pratiques des citadins, tout reste à faire. Cela devient d'autant plus urgent que l'imitation qui affecte le milieu des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture et des élus politiques - et parfois même des habitants - répand à l'échelle planétaire des modèles qui uniformisent les architectures, homogénéisent les manières de penser et de faire les milieux habités et nient toute réflexion critique. Or nous avons besoin d'expérimentations nouvelles pour rompre avec ces modèles du "toujours plus", devenus profondément antagoniques à ceux du "toujours mieux".
De la même manière que certains promoteurs ont ambitionné (et continuent de le faire) d'édifier le plus haut gratte-ciel, des architectes ont rêvé de construire la barre la plus longue : la Caravelle de Jean Dubuisson, à Villeneuve-la-Garenne, s'étend sur 385 mètres ; la cité du Haut-du-Lièvre de Bernard Zehrfuss, à Nancy, 700 mètres (en deux morceaux, le "Cèdre bleu" fait 400 mètres et le "Tilleul argenté" 300).
Une ville, par définition, est composite, sensorielle, rythmique ; elle ne peut se résumer à un plan-masse et une grille d'équipements, chacun d'eux rapporté à un ratio valable en tout temps et en tous lieux. C'est cela le paradoxe du "grand ensemble" : il est conçu pour le bonheur d'habitants-abstraits par des décideurs qui ne connaissent pas ces habitants-en-vrai et qui s'étonnent de leur ingratitude, du moins ce qu'ils jugent comme tel. Le "grand ensemble" dépossède tout résident de son art d'habiter et lui impose avec la remise des clés de son appartement un mode d'emploi normé et normalisateur. C'est "grand", oui cela ne fait aucun doute. Mais "ensemble" ? Non, pas "ensemble", plutôt "identique".
Après l'aliénation par le travail industriel, si bien décrite et analysée par Marx, l'aliénation par la consommation, explorée et dénoncée par Günther Anders, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, ou encore Henri Lefebvre ou Bernard Charbonneau, l'aliénation par les les technologies, dont les mécanismes ont été révélés par Lewis Mumford, Jacques Elul ou André Gorz, l'aliénation du corps de chacun, dorénavant confisqué par l'idéologie de l'"homme augmenté", que diagnostiquent Michel Foucault, Ivan Illich, Barbara Duden, ou Jean-pierre Dupuy, il nous faut nous préoccuper de l'aliénation spatio-temporelle. La biopolitique à l'oeuvre, en effet, ne s'emploie pas seulement à contrôler les territoires (logement, commerce, loisir, travail, etc.), elle cherche aussi à définir les emplois du temps (organisation du travail, rythmes du quotidien, absence de "temps morts", valorisation de la seule vitesse comme mesure du progrès et de l'excellence, etc.).
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Thierry Paquot
Lecteurs de Thierry Paquot (253)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quand les enquêteurs parlent...
— Il s’en est fallu d’un cheveu ! Sans son regard rapide, sans ses yeux de lynx, XXX XXXX, en ce moment, ne serait peut-être plus de ce monde ! Quel désastre pour l’humanité ! Sans parler de vous, Hastings ! Qu’auriez-vous fait sans moi dans la vie, mon pauvre ami ? Je vous félicite de m’avoir encore à vos côtés ! Vous-même d’ailleurs, auriez pu être tué. Mais cela, au moins, ce ne serait pas un deuil national ! Héros de Agatha Christie
Arsène Lupin
Hercule Poirot
Rouletabille
Sherlock Holmes
13 questions
66 lecteurs ont répondu
Thèmes :
romans policiers et polars
, humour
, enquêteursCréer un quiz sur cet auteur66 lecteurs ont répondu