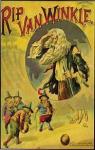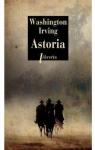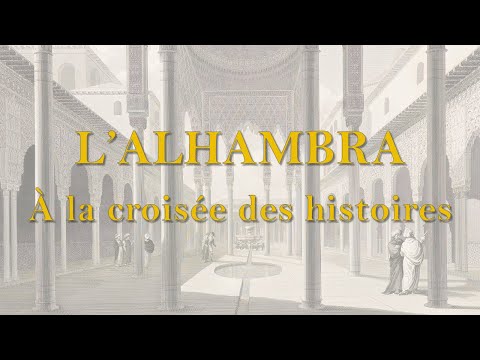Né(e) à : New York , le 03/04/1782
Mort(e) à : Tarrytown , le 28/11/1859
Washington Irving est un écrivain américain.
Son prénom lui a été donné en hommage à George Washington (1732-1799).
Il a publié sous les pseudonymes de Geoffrey Crayon, gentleman, de Dietrich Knickerbocker et de Jonathan Oldstyle. Il est surtout connu pour ses nouvelles, mais il a aussi écrit de nombreux essais et biographies.
La carrière littéraire d'Irving débute dans la presse. Il contribue, entre 1802 et 1803, à The Morning Chronicle. De 1812 à 1814, il est rédacteur à l'Analetic magazine, à Philadelphie et à New York.
En 1809 paraît une "Histoire de New York racontée par Dietrich Knickerbocker". Devant le succès de ce premier ouvrage, Irving écrit dans la même veine, en 1819-1820, "Le Livre de croquis de Geoffrey Crayon, gentleman" (The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.), un recueil d'histoires fortement influencé par les contes populaires allemands, qui comprend quelques-unes de ses nouvelles parmi les plus connues notamment "La Légende de Sleepy Hollow" (The Legend of Sleepy Hollow) et "Rip van Winkle". En 1822 est publiée une suite, "Le Château de Bracebridge" (Bracebridge Hall).
Par la suite, il s'établit en Espagne, où il travaille pour l’ambassade des États-Unis à Madrid (1826-1829). De 1829 à 1832, sous la présidence de Martin Van Buren, Irving est secrétaire de légation américaine. Pendant ce séjour en Espagne, il écrit une série de livres sur l'Espagne du XVe siècle dont "Les Contes de l'Alhambra" (1832).
En 1832, Irving rentre à New York, où il est accueilli avec enthousiasme comme le premier auteur américain à avoir conquis une renommée internationale. Il voyage dans le sud et l'ouest des États-Unis et écrit "Le Mélange de Crayon" (The Crayon Miscellany, 1835).
En 1842, Irving est nommé par Daniel Webster, secrétaire d'État, ambassadeur des États-Unis en Espagne, poste qu'il occupera jusqu'en 1845. De retour en Amérique, il passe les dernières années de sa vie à Tarrytown.
Un essai d'Edhem ELDEM, professeur au Collège de France, à retrouver en librairie et sur : https://www.lesbelleslettres.com/livre/4460-l-alhambra L'Alhambra, ensemble palatial fondé aux XIIIe et XIVe siècles par les souverains arabes de Grenade, est resté dans l'ombre pendant plusieurs siècles après la fin de la Reconquista. Les Espagnols furent les premiers à « redécouvrir » l'Alhambra au XVIIIe siècle, alors que ses visiteurs étrangers en firent l'une des premières destinations touristiques du XIXe siècle. Beaucoup ont laissé de précieuses traces de leur passage : des écrits, des photographies et, surtout, des commentaires dans le livre des visiteurs de l'Alhambra, tenu depuis 1829. L'historien Edhem Eldem a analysé ce document fascinant pour proposer une vision tout à fait nouvelle de l'Alhambra et de ce qu'il représentait. De Chateaubriand à Owen Jones et de Washington Irving à Jean-Léon Gérôme, les Occidentaux ont bâti une image de l'Andalousie toute empreinte de romantisme et d'orientalisme. Mais l'engouement occidental ne doit pas faire oublier les visiteurs « orientaux » du monument : des Maghrébins, nombreux mais peu loquaces ; des diplomates et voyageurs ottomans, parfois plus orientalistes que les Européens ; des Arabes du Machrek, de plus en plus influencés par le nationalisme arabe prôné par la Nahda, la « renaissance arabe ». Autant de regards croisés que le registre des visiteurs, la presse de l'époque, les mémoires et les récits de voyage ont permis à l'auteur de reconstituer pour en tirer une histoire culturelle des rapports entre Orient et Occident, Nord et Sud, islam et chrétienté, centre et périphérie. Ouvrage publié avec le soutien de l'Académie du Royaume du Maroc.
Un homme en ce temps-là pouvait
Contre le froid opiniâtre
Voir un bon feu lutter dans l'âtre.
Petits et grands faisaient régal.
On conviait le voisinage ;
On les traitait, selon l'usage,
En amis, et l'accueil brutal
Ne contristait pas l'infortune,
Qui prenait place et s'étonnait
De ne point paraître importune ....
(Le Livre d’esquisses)
(page 235)
— Eh bien, dit le philosophe, j’aimerais bien avoir quelques danseuses.
— Des danseuses ! répéta le trésorier abasourdi.
— Oui, des danseuses, affirma gravement le sage... Oh, quelques unes seulement, car je suis un vieux philosophe, qui se contente de peu. Il faudrait, tout de même, qu’elles soient jeunes et agréables à voir, car la vue de la jeunesse et de la beauté rafraîchit la vieillesse.
Douze, quinze, dix-huit mois s'écoulaient parfois sans qu'on eût d'eux aucune nouvelle. Mais un beau jour ils redescendaient en chantant la rivière Ottawa, et leurs canots étaient remplis de peaux de castors. C'était alors le temps des plaisirs et du repos...
- Trop bien, hélas, mon prince. Pour un, c'est le tourment; pour deux, le bonheur; pour trois, la discorde...
(Page 182)
qu’il n’avait jamais besoin de soutenir son opinion par un argument. L’aubergiste le soignait d’une manière particulière, non qu’il payât mieux
que ses voisins, mais parce que l’argent du riche semble toujours de meilleur aloi. L’hôte avait sans cesse une plaisanterie ou un bon mot à
insinuer dans l’oreille de l’auguste Ramm. À la vérité, Ramm ne riait jamais ; il conservait une imperturbable gravité et un maintien plein de morgue ; mais il récompensait de temps en temps l’aubergiste par un signe d’approbation qui, quoique ce ne fût qu’une sorte de grognement, réjouissait plus l’hôte que les francs éclats de rire d’un homme pauvre.
Les plus grands classiques de la science-fiction
Qui a écrit 1984
4873 lecteurs ont répondu