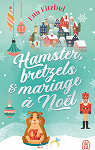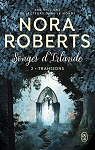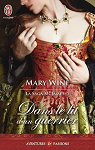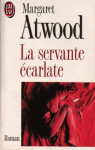A la demande d`Henri Flammarion en 1958, Frédéric Ditis créé la maison d`édition française J`ai lu, qui publie principalement en format poche. Sa ligne éditoriale est variée, allant de la littérature générale à la science-fiction, en passant par le roman policier et le roman d`amour. Les éditions J`ai lu publient chaque année plus de 400 nouveautés au format poche.
Livres populaires
voir plus
Dernières parutions
Collections de J`ai lu
Dernières critiques
Le cerveau et les neurosciences étant des sujets complexes, ce livre peut faire peur, mais Albert Moukheiber arrive à les vulgariser.
Il arrive à expliquer de façon simple et concrète (notamment grâce à des histoires vraies) comment notre cerveau nous joue des tours.
C’est un livre qui devrait être lu par tout le monde, il est important aujourd’hui de savoir analyser une information, avoir une pensée critique, connaître les principaux biais cognitifs, afin de prendre des décisions et de revoir nos croyances en toute connaissance de cause.
Il arrive à expliquer de façon simple et concrète (notamment grâce à des histoires vraies) comment notre cerveau nous joue des tours.
C’est un livre qui devrait être lu par tout le monde, il est important aujourd’hui de savoir analyser une information, avoir une pensée critique, connaître les principaux biais cognitifs, afin de prendre des décisions et de revoir nos croyances en toute connaissance de cause.
La SERVANTE ECARLATE
Une histoire sous fond de totalitarisme...
Qui sommes-nous ? Rien.. nous ne sommes que des marionnettes dont les manettes sont tenues par des hautsssss placés .
Ici l'écrivain défend (LA LIBERTÉ, surtout celle de LA FEMME) Ce roman n'est qu'une dystopie, elle est l'histoire d'une femme rendue au rang de
l 'esclavage. (De toutes les femmes )
Nous avons ici des groupes
LES COMMANDANTS, LES GARDIENS, L'OEIL, les EPOUX DES ECONOFEMMES.
il y a les MARTHAS, les ÉCARLATES
Ce n'est qu'une dystopie (dans un fond réel)
Difficile à accepter toute cette violence, des familles sont séparées.
June (héroïne principale)est jeune femme qui vit sous le contrôle d'un état chrétien. Elle est séparée de son époux Luke et de sa fille.
June deviendra SERVANTE ECARLATE elle est à la merci du COMMANDANT. Elle doit lui donner un enfant. Scène lue choquante, l'épouse assiste à la scène tenant les mains de June.
Les servantes doivent assister à des scènes de morts effroyables.
Les Marthas sont des femmes sympathiques , un peu comme une maman, elle prépare les repas, toujours souriantes . Il y a l'œil qui sont les fils des servantes ou garçons enlevés à leur famille au début du régime.
Ce roman ne raconte que la saison 1 d'une série de 6 ou 7 je ne sais pas. 🙃🤪
Intéressant. Sincèrement triste et dur ..
Une histoire sous fond de totalitarisme...
Qui sommes-nous ? Rien.. nous ne sommes que des marionnettes dont les manettes sont tenues par des hautsssss placés .
Ici l'écrivain défend (LA LIBERTÉ, surtout celle de LA FEMME) Ce roman n'est qu'une dystopie, elle est l'histoire d'une femme rendue au rang de
l 'esclavage. (De toutes les femmes )
Nous avons ici des groupes
LES COMMANDANTS, LES GARDIENS, L'OEIL, les EPOUX DES ECONOFEMMES.
il y a les MARTHAS, les ÉCARLATES
Ce n'est qu'une dystopie (dans un fond réel)
Difficile à accepter toute cette violence, des familles sont séparées.
June (héroïne principale)est jeune femme qui vit sous le contrôle d'un état chrétien. Elle est séparée de son époux Luke et de sa fille.
June deviendra SERVANTE ECARLATE elle est à la merci du COMMANDANT. Elle doit lui donner un enfant. Scène lue choquante, l'épouse assiste à la scène tenant les mains de June.
Les servantes doivent assister à des scènes de morts effroyables.
Les Marthas sont des femmes sympathiques , un peu comme une maman, elle prépare les repas, toujours souriantes . Il y a l'œil qui sont les fils des servantes ou garçons enlevés à leur famille au début du régime.
Ce roman ne raconte que la saison 1 d'une série de 6 ou 7 je ne sais pas. 🙃🤪
Intéressant. Sincèrement triste et dur ..
Salut les Babelionautes
Dans ce tome cinq, Catalina va endosser une autre casquette, celle de Gardiens, et cela n'a pas l'air d'un boulot facile.
La Romance avec Alessandro suit son cours, et ils vont devoirs s'alliés pour combattre les menaces qui pèsent sur Houston.
Et des menaces ce n'est pas ce qui va manquer
Si vous aimé ce type de littérature, vous pouvez sans crainte plonger dans cette série qui s'étale sur sept tomes.
Merci à Tiphaine Scheuer pour la traduction
Dans ce tome cinq, Catalina va endosser une autre casquette, celle de Gardiens, et cela n'a pas l'air d'un boulot facile.
La Romance avec Alessandro suit son cours, et ils vont devoirs s'alliés pour combattre les menaces qui pèsent sur Houston.
Et des menaces ce n'est pas ce qui va manquer
Si vous aimé ce type de littérature, vous pouvez sans crainte plonger dans cette série qui s'étale sur sept tomes.
Merci à Tiphaine Scheuer pour la traduction

Etiquettes
voir plus