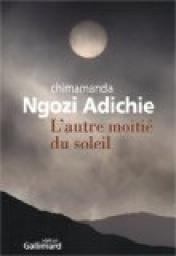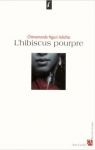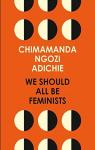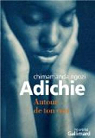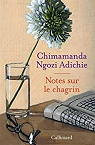Après « Americanah », ceci est le deuxième roman de cette auteure nigériane que j'ai eu le bonheur de découvrir.
Même plaisir et même passion de lecture que pour le précédent.
L'histoire romancée se déroule sur un fond historique, celui de la guerre qui a éclaté au Nigéria à la fin des années 60, suite à la déclaration d'indépendance d'une partie du pays, le Biafra.
Le Nigéria est un grand pays où se côtoient plusieurs ethnies, les unes majoritairement chrétiennes, les autres musulmanes… Les personnages principaux du récit font partie de la première catégorie et sont Igbos. Chimamanda Adichie a tissé une trame de leur vie sur une décennie, de façon à englober l'avant, pendant et l'après-guerre.
L'écriture est riche, profonde et sensible. Chaque personnage est travaillé, qu'il soit principal, secondaire ou même simplement de passage ! C'est avant tout une histoire d'amours, d'amitiés et de fraternité.
Ce roman est historiquement très intéressant, mais surtout culturellement extrêmement enrichissant. La vie de la bourgeoisie nigériane empreinte des manières de la Grande Bretagne (ancienne domination), son enrichissement et sa corruption face à une majorité de paysans qui vit dans une extrême pauvreté.
La guerre et ses ravages va précipiter les uns dans l'abime, faire fuir les autres ou encore séparer des familles sans espoir de retour…
Cette histoire est magnifique et bouleversante, et qu'elle n'a pas été ma surprise d'apprendre l'existence d'une adaptation cinématographique ! L'extrait correspond bien à ce que j'ai lu en tout cas… à voir !
Voici la bande annonce du film :
https://www.youtube.com/watch?v=jfHjGUX71KQ
Lien : http://lebouddhadejade.blogs..
Même plaisir et même passion de lecture que pour le précédent.
L'histoire romancée se déroule sur un fond historique, celui de la guerre qui a éclaté au Nigéria à la fin des années 60, suite à la déclaration d'indépendance d'une partie du pays, le Biafra.
Le Nigéria est un grand pays où se côtoient plusieurs ethnies, les unes majoritairement chrétiennes, les autres musulmanes… Les personnages principaux du récit font partie de la première catégorie et sont Igbos. Chimamanda Adichie a tissé une trame de leur vie sur une décennie, de façon à englober l'avant, pendant et l'après-guerre.
L'écriture est riche, profonde et sensible. Chaque personnage est travaillé, qu'il soit principal, secondaire ou même simplement de passage ! C'est avant tout une histoire d'amours, d'amitiés et de fraternité.
Ce roman est historiquement très intéressant, mais surtout culturellement extrêmement enrichissant. La vie de la bourgeoisie nigériane empreinte des manières de la Grande Bretagne (ancienne domination), son enrichissement et sa corruption face à une majorité de paysans qui vit dans une extrême pauvreté.
La guerre et ses ravages va précipiter les uns dans l'abime, faire fuir les autres ou encore séparer des familles sans espoir de retour…
Cette histoire est magnifique et bouleversante, et qu'elle n'a pas été ma surprise d'apprendre l'existence d'une adaptation cinématographique ! L'extrait correspond bien à ce que j'ai lu en tout cas… à voir !
Voici la bande annonce du film :
https://www.youtube.com/watch?v=jfHjGUX71KQ
Lien : http://lebouddhadejade.blogs..
Je ne connaissais pas grand chose à l'Histoire du Nigeria, encore moins à la guerre du Biafra. En découvrir des pans au travers de trajectoires individuelles, fussent-elles fictives, est incontestablement ma porte d'entrée préférée en la matière.
Le roman se construit autour de jumelles de classe moyenne voire privilégiée, différentes tant qu'éloignées sur bien des plans. Leur vie s'articule, se désarticule, se réarticule. Au Nigeria comme dans leur relation, l'avenir réside dans le choix de voir ce qui rapproche ou ce qui divise et de déterminer ce que l'on va faire de ça.
C'est aussi dans le choix des mots que l'autrice incarne au mieux les frictions, les fissures ou le liant qui s'opère dans la société. Car la langue est un personnage à part entière dans "L'autre moitié du soleil". Parler igbo, anglais ou pidgin c'est projeter une image particulière, c'est aussi octroyer une place particulière à son interlocuteur.
A cet égard et à bien d'autres, j'ai trouvé l'écriture intelligente et réfléchie. Nous suivons certains personnages directement, tandis que d'autres ne sont abordés que par le regard des premiers. Ainsi il y a ceux qui nous sont proches, et ceux qui nous attirent, drapés d'une aura de mystère qu'ils conserveront du début à la fin.
J'ai adoré le relief donné aux personnages masculins, qui sont loin de faire de la figuration autour des jumelles. Il est de ces romans denses et profonds où chaque personnage mériterait sa propre chronique mais je manque de temps pour ça, donc lisez-le, tout simplement.
Le roman se construit autour de jumelles de classe moyenne voire privilégiée, différentes tant qu'éloignées sur bien des plans. Leur vie s'articule, se désarticule, se réarticule. Au Nigeria comme dans leur relation, l'avenir réside dans le choix de voir ce qui rapproche ou ce qui divise et de déterminer ce que l'on va faire de ça.
C'est aussi dans le choix des mots que l'autrice incarne au mieux les frictions, les fissures ou le liant qui s'opère dans la société. Car la langue est un personnage à part entière dans "L'autre moitié du soleil". Parler igbo, anglais ou pidgin c'est projeter une image particulière, c'est aussi octroyer une place particulière à son interlocuteur.
A cet égard et à bien d'autres, j'ai trouvé l'écriture intelligente et réfléchie. Nous suivons certains personnages directement, tandis que d'autres ne sont abordés que par le regard des premiers. Ainsi il y a ceux qui nous sont proches, et ceux qui nous attirent, drapés d'une aura de mystère qu'ils conserveront du début à la fin.
J'ai adoré le relief donné aux personnages masculins, qui sont loin de faire de la figuration autour des jumelles. Il est de ces romans denses et profonds où chaque personnage mériterait sa propre chronique mais je manque de temps pour ça, donc lisez-le, tout simplement.
Début des années 60, le jeune Nigéria indépendant se construit et une classe moyenne nait pendant cette période post coloniale.
Des intellectuels construisent la pensée émancipatrice. C'est à ce groupe que s'apparente Olanna, professeure et amoureuse d'un enseignant chercheur, partisan d'une Afrique noire forte et insoumise.
Ils ont un boy de 13 ans, Ugwu, fraîchement débarqué de la brousse et l'envoient à l'école.
Sa soeur, Kainene, est plutôt dans les affaires et n'hésite à faire du pognon avec tout ce qui est banquable, y compris les anciennes puissances coloniales. Son amoureux est par ailleurs un journaliste britannique.
Les deux soeurs, très indépendantes et fortes, construisent leur vie dans ce Nigéria très mouvementé et sous tension, où les multiples ethnies commencent à s'opposer, voire se haïr.
Jusqu'au jour où les Haoussas et les Yaroubas musulmans massacrent des milliers de chrétiens Igbos. Ceux-ci avaient largement été favorisés par les colonialistes et détenaient la plupart des richesses du pays.
Olanna et Kainene sont Igbos. Elles choisissent de rester, de ne pas fuir avec leurs riches parents en Grande-Bretagne et de participer à la construction du Biafra qui fait sécession.
Une terrible guerre commence, doublé d'un blocus du Biafra qui laissera mourir de faim plus de deux millions de civils Igbos.
Je finis ce roman complètement sonnée, abasourdie par cet épisode sanglant de l'Histoire du XXe. Un de plus.
L'écriture de Chimamanda Ngozi Adichie est absolument envoûtante et je viens de passer une semaine en totale immersion au Nigéria.
Ses personnages sont incarnés, les femmes ont leur mot à dire.
Si vous n'avez encore jamais lu cette autrice, je vous conseille de commencer par celui-ci et de lire ensuite le fabuleux Americanah.
J'ai adoré les deux 🖤🤍 et j'ai hâte de lire L'hibiscus pourpre.p
Des intellectuels construisent la pensée émancipatrice. C'est à ce groupe que s'apparente Olanna, professeure et amoureuse d'un enseignant chercheur, partisan d'une Afrique noire forte et insoumise.
Ils ont un boy de 13 ans, Ugwu, fraîchement débarqué de la brousse et l'envoient à l'école.
Sa soeur, Kainene, est plutôt dans les affaires et n'hésite à faire du pognon avec tout ce qui est banquable, y compris les anciennes puissances coloniales. Son amoureux est par ailleurs un journaliste britannique.
Les deux soeurs, très indépendantes et fortes, construisent leur vie dans ce Nigéria très mouvementé et sous tension, où les multiples ethnies commencent à s'opposer, voire se haïr.
Jusqu'au jour où les Haoussas et les Yaroubas musulmans massacrent des milliers de chrétiens Igbos. Ceux-ci avaient largement été favorisés par les colonialistes et détenaient la plupart des richesses du pays.
Olanna et Kainene sont Igbos. Elles choisissent de rester, de ne pas fuir avec leurs riches parents en Grande-Bretagne et de participer à la construction du Biafra qui fait sécession.
Une terrible guerre commence, doublé d'un blocus du Biafra qui laissera mourir de faim plus de deux millions de civils Igbos.
Je finis ce roman complètement sonnée, abasourdie par cet épisode sanglant de l'Histoire du XXe. Un de plus.
L'écriture de Chimamanda Ngozi Adichie est absolument envoûtante et je viens de passer une semaine en totale immersion au Nigéria.
Ses personnages sont incarnés, les femmes ont leur mot à dire.
Si vous n'avez encore jamais lu cette autrice, je vous conseille de commencer par celui-ci et de lire ensuite le fabuleux Americanah.
J'ai adoré les deux 🖤🤍 et j'ai hâte de lire L'hibiscus pourpre.p
J'avais adoré Americanah, j'ai donc poursuivi avec L'autre moitié du soleil. Deux points communs entre ces deux romans : le Nigeria et les personnages de femmes, toujours belles et courageuses.
Olanna et Kainene sont jumelles. Très séduisantes, elles sont issues d'une famille Ibo, riche et influente. La première est universitaire et amoureuse d'Odenigbo, un intellectuel très engagé, chez qui tous les enseignants se réunissent pour parler de l'Afrique, des relations avec le colonisateur et débattre de ce que sera le monde de demain.
Kainene est une femme d'affaires avisée qui développe les entreprises de son père. Elle entretient une relation amoureuse avec Richard, un anglais qui s'est découvert une passion pour des moulages de bronze, datant du IXème siècle, découverts en pays Ibo et qui souhaite écrire un ouvrage (un récit, un roman, une monographie ??). Nous sommes à la fin des années 60 et la période de décolonisation met à jour des tensions entre les ethnies des Haoussas, des Yorubas et des Ibos dont les biens et les positions dans l'administration suscitent des convoitises. le conflit perdurant, l'est du Nigeria fait sécession et se proclame République du Biafra. Un formidable espoir nait, la population porte ce projet mais va vite d'échanger.
C'est sur fond de guerre civile, de famine et d'errance que se déroule la plus grande partie de l'Histoire, à travers notamment le regard d'Ugwu le boy d'Odenigbo, entièrement dévoué à son master et à sa famille. le personnage incarne l'Afrique ici, entre croyances dans les traditions et les coutumes et appétence pour un savoir plus académique. C'est le héros de l'histoire, plus silencieux, moins romanesque que la belle Olanna, moins idéaliste qu'Odenigbo mais humain, loyal et engagé auprès de ceux qu'il sert.
L'Histoire, on la connaît, on ne se fait donc pas vraiment d'illusion sur ce qui va advenir du Biafra et on tremble à l'avance de ce que va avoir à subir le peuple Ibo. Là où on redécouvre le rôle lamentable des pays occidentaux (le passage où les journalistes anglais viennent faire un reportage est particulièrement révélateur), les positions stratégiques des anglais, des américains, des français dont les biafrais ont attendu en vain une reconnaissance de leur État.
Un beau roman, avec des personnages ciselés, qui évoquent une période que je connaissais mal (à part la thématique de la famine) qui m'a amenée à relire des choses sur ce conflit.
Olanna et Kainene sont jumelles. Très séduisantes, elles sont issues d'une famille Ibo, riche et influente. La première est universitaire et amoureuse d'Odenigbo, un intellectuel très engagé, chez qui tous les enseignants se réunissent pour parler de l'Afrique, des relations avec le colonisateur et débattre de ce que sera le monde de demain.
Kainene est une femme d'affaires avisée qui développe les entreprises de son père. Elle entretient une relation amoureuse avec Richard, un anglais qui s'est découvert une passion pour des moulages de bronze, datant du IXème siècle, découverts en pays Ibo et qui souhaite écrire un ouvrage (un récit, un roman, une monographie ??). Nous sommes à la fin des années 60 et la période de décolonisation met à jour des tensions entre les ethnies des Haoussas, des Yorubas et des Ibos dont les biens et les positions dans l'administration suscitent des convoitises. le conflit perdurant, l'est du Nigeria fait sécession et se proclame République du Biafra. Un formidable espoir nait, la population porte ce projet mais va vite d'échanger.
C'est sur fond de guerre civile, de famine et d'errance que se déroule la plus grande partie de l'Histoire, à travers notamment le regard d'Ugwu le boy d'Odenigbo, entièrement dévoué à son master et à sa famille. le personnage incarne l'Afrique ici, entre croyances dans les traditions et les coutumes et appétence pour un savoir plus académique. C'est le héros de l'histoire, plus silencieux, moins romanesque que la belle Olanna, moins idéaliste qu'Odenigbo mais humain, loyal et engagé auprès de ceux qu'il sert.
L'Histoire, on la connaît, on ne se fait donc pas vraiment d'illusion sur ce qui va advenir du Biafra et on tremble à l'avance de ce que va avoir à subir le peuple Ibo. Là où on redécouvre le rôle lamentable des pays occidentaux (le passage où les journalistes anglais viennent faire un reportage est particulièrement révélateur), les positions stratégiques des anglais, des américains, des français dont les biafrais ont attendu en vain une reconnaissance de leur État.
Un beau roman, avec des personnages ciselés, qui évoquent une période que je connaissais mal (à part la thématique de la famine) qui m'a amenée à relire des choses sur ce conflit.
Je me décide à faire ce commentaire, même si je ne suis pas sûre qu'il ne vaudrait pas mieux que j'attende un petit moment pour essayer d'être un petit peu plus objective pour parler de ce livre, car il a éveillé en moi des réactions négatives, qui dépassent en réalité uniquement ce roman, mais concernent une certaine façon d'écrire, de concevoir la littérature, qui ne me convient pas vraiment.
Le livre de Chimamanda Ngozi Adichie raconte la guerre civile au Nigeria dans les années soixante, marquée par la tentative de sécession du Biafra, la riposte militaire très violente, la famine dans la population civile. Nous suivons une série de personnages, en particulier des jumelles (fausses) Kainene et Olanna, ainsi que leurs familles et proches. Elles sont issues d'une famille très riche, ont suivi leurs études en Grande-Bretagne, Kainene devient femme d'affaires à qui tout réussi, et Olanna universitaire. Et les événements arrivent et tout leur monde bascule.
C'est un roman très habilement fabriqué, j'ai trouvé le début très prenant, l'auteur nous décrit ses personnages d'une façon qui fait que l'on a envie de les suivre, de voir ce qu'ils deviennent. L'écriture est très efficace, sans rien de superflu ni d'enflé. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, une lassitude s'installait de plus en plus forte, et un méchant génie que m'envahit régulièrement, me glissait des choses de plus en plus méchantes à l'oreille.
Déjà en ce qui concerne les personnages principaux, après un début prometteur, je trouve que l'auteur ne les développe pas suffisament. Olanna et son mari sont les seuls qui ont vraiment du relief, Kainene est une sorte de sphinx impénétrable, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, demeure parfaitement inconnu. le personnage d'Ugwu, le boy, après un début très prometteur, n'évolue plus, il reste toujours le gamin impressionné et admiratif devant son Master, et en adoration devant Olanna, sa maîtresse.
Mais c'est surtout la façon dont le livre est fabriqué qui me pose question. La construction et l'écriture sont très efficaces. D'une efficacité qui sent terriblement les ateliers d'écriture tels qu'on les pratique aux USA, pays dans lequel l'auteur d'après ce que j'ai lu a fait ses études, elle y a obtenu entre autres un master en création littéraire. Et cette façon aseptisée et somme toute impersonnelle de produire un roman me gêne terriblement. Pour celui-ci comme pour d'autres. Il n'y a finalement pas grand-chose de très personnel dans ce livre, rien de vraiment inspiré. Je trouve que compte tenu du sujet, c'est vraiment dommage. Là je vais peut être aller très loin, mais j'ai eu la sensation que l'auteur nous débitait un peu les passages obligés lorsqu'on parle de guerre civile. Ainsi à un moment donné nous faisons connaissance avec un voisin de la famille d'Olanna. Lorsque ce passage est arrivé, il m'a fait me poser des questions, je ne comprenais pas très bien pourquoi ce passage que je trouvais artificiel et un peu maladroit se trouvait là. Et puis la réponse arrivait plus tard. Parce que le gentil voisin se transformait en assassin sanguinaire et participait au massacre de ses voisins. Je ne veux pas paraître dure et cynique, mais ce genre de récits, on les entend systématiquement dans les récits de différentes victimes de guerres civiles, le choc de voir les gens avec qui on vit et que l'on considère comme des amis se transformer en tueur. Et j'ai eu la sensation que voilà, c'était un truc obligé à mettre dans le roman, et le terrible c'est que l'horreur se transformait en cliché par manque d'inspiration véritable pour en parler. de même que les enfants soldats, réalité terrible, mais en parler uniquement parce qu'il faut en parler, parce que le lecteur attend ces passages, sans arriver à trouver le ton juste et vraiment personnel, m'a mis mal à l'aise.
J'ai eu la sensation d'un livre fabriqué par une universitaire anglo-saxonne, avec un indéniable savoir faire, pour un public international, et en premier lieu anglo-saxon, un truc un peu comme la bouffe internationale dans les hôtels. Pas de mauvaise surprise, mais rien de vraiment excitant. Un peu comme certains de romans indiens récents, fabriqué visiblement pour l'export, selon les règles standard, avec la petite touche d'exotisme, mais surtout pas trop forte pour ne pas déranger le lecteur.
Le livre de Chimamanda Ngozi Adichie raconte la guerre civile au Nigeria dans les années soixante, marquée par la tentative de sécession du Biafra, la riposte militaire très violente, la famine dans la population civile. Nous suivons une série de personnages, en particulier des jumelles (fausses) Kainene et Olanna, ainsi que leurs familles et proches. Elles sont issues d'une famille très riche, ont suivi leurs études en Grande-Bretagne, Kainene devient femme d'affaires à qui tout réussi, et Olanna universitaire. Et les événements arrivent et tout leur monde bascule.
C'est un roman très habilement fabriqué, j'ai trouvé le début très prenant, l'auteur nous décrit ses personnages d'une façon qui fait que l'on a envie de les suivre, de voir ce qu'ils deviennent. L'écriture est très efficace, sans rien de superflu ni d'enflé. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, une lassitude s'installait de plus en plus forte, et un méchant génie que m'envahit régulièrement, me glissait des choses de plus en plus méchantes à l'oreille.
Déjà en ce qui concerne les personnages principaux, après un début prometteur, je trouve que l'auteur ne les développe pas suffisament. Olanna et son mari sont les seuls qui ont vraiment du relief, Kainene est une sorte de sphinx impénétrable, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, demeure parfaitement inconnu. le personnage d'Ugwu, le boy, après un début très prometteur, n'évolue plus, il reste toujours le gamin impressionné et admiratif devant son Master, et en adoration devant Olanna, sa maîtresse.
Mais c'est surtout la façon dont le livre est fabriqué qui me pose question. La construction et l'écriture sont très efficaces. D'une efficacité qui sent terriblement les ateliers d'écriture tels qu'on les pratique aux USA, pays dans lequel l'auteur d'après ce que j'ai lu a fait ses études, elle y a obtenu entre autres un master en création littéraire. Et cette façon aseptisée et somme toute impersonnelle de produire un roman me gêne terriblement. Pour celui-ci comme pour d'autres. Il n'y a finalement pas grand-chose de très personnel dans ce livre, rien de vraiment inspiré. Je trouve que compte tenu du sujet, c'est vraiment dommage. Là je vais peut être aller très loin, mais j'ai eu la sensation que l'auteur nous débitait un peu les passages obligés lorsqu'on parle de guerre civile. Ainsi à un moment donné nous faisons connaissance avec un voisin de la famille d'Olanna. Lorsque ce passage est arrivé, il m'a fait me poser des questions, je ne comprenais pas très bien pourquoi ce passage que je trouvais artificiel et un peu maladroit se trouvait là. Et puis la réponse arrivait plus tard. Parce que le gentil voisin se transformait en assassin sanguinaire et participait au massacre de ses voisins. Je ne veux pas paraître dure et cynique, mais ce genre de récits, on les entend systématiquement dans les récits de différentes victimes de guerres civiles, le choc de voir les gens avec qui on vit et que l'on considère comme des amis se transformer en tueur. Et j'ai eu la sensation que voilà, c'était un truc obligé à mettre dans le roman, et le terrible c'est que l'horreur se transformait en cliché par manque d'inspiration véritable pour en parler. de même que les enfants soldats, réalité terrible, mais en parler uniquement parce qu'il faut en parler, parce que le lecteur attend ces passages, sans arriver à trouver le ton juste et vraiment personnel, m'a mis mal à l'aise.
J'ai eu la sensation d'un livre fabriqué par une universitaire anglo-saxonne, avec un indéniable savoir faire, pour un public international, et en premier lieu anglo-saxon, un truc un peu comme la bouffe internationale dans les hôtels. Pas de mauvaise surprise, mais rien de vraiment excitant. Un peu comme certains de romans indiens récents, fabriqué visiblement pour l'export, selon les règles standard, avec la petite touche d'exotisme, mais surtout pas trop forte pour ne pas déranger le lecteur.
Encore une fois, une excellente lecture pour laquelle je pourrais reprendre les mots de ma chronique d'Americanah bien que ces romans soient bien différents (ce qui serait plus simple car, le livre quelque part dans un carton et mes notes égarées dans le déménagement, j'avoue avoir du mal à poser des mots sur cette lecture vieille de plus de deux mois …).
Chimamanda Ngozi Adichie nous immerge dans le Nigeria des années 1960 et 1970 et m'a permis d'en savoir plus sur cette guerre dont je ne savais pas grand-chose, je l'avoue (à part la famine liée à ce conflit). En l'abordant par le prisme de l'intime – des histoires individuelles bouleversées par la guerre civile –, elle facilite l'entrée dans ce pan de l'Histoire nigériane (en tout cas, elle m'a immédiatement captivée) et le résultat est bouleversant grâce à ces personnages vivants et touchants, contradictoires, faillibles, humains, vrais. L'immersion dans la sauvagerie de la guerre – la brutalité, la famine, la peur et l'espoir qui se mêlent sans cesse, la perte, les inévitables exactions… – est intense et terrible.
La diversité d'âge, de situation, de nationalité, permet de tracer un riche portrait des interactions sociales : privilèges de classe, colonialisme, discrimination, préjugés et tensions entre ethnies, la lutte entre éducation et superstitions… Avec les deux couples – non conventionnels – qui constituent le noyau des personnages, c'est également un récit sur le couple, ce qui le porte, ce qui le construit, ce qui le renforce ou le détruit. C'est enfin un roman sensoriel, porté par les bonnes odeurs des plats d'Ugwu, chauffé par la lumière brûlante du soleil dans laquelle flotte la poussière des chemins...
L'écriture de Chimamanda Ngozi Adichie est une nouvelle fois d'une grande efficacité : fluide, vibrante, précise, marquante. Grâce à elle et à ces personnages, plus qu'instructif, ce roman s'est révélé puissant, éloquent et déchirant.
Lien : https://oursebibliophile.wor..
Chimamanda Ngozi Adichie nous immerge dans le Nigeria des années 1960 et 1970 et m'a permis d'en savoir plus sur cette guerre dont je ne savais pas grand-chose, je l'avoue (à part la famine liée à ce conflit). En l'abordant par le prisme de l'intime – des histoires individuelles bouleversées par la guerre civile –, elle facilite l'entrée dans ce pan de l'Histoire nigériane (en tout cas, elle m'a immédiatement captivée) et le résultat est bouleversant grâce à ces personnages vivants et touchants, contradictoires, faillibles, humains, vrais. L'immersion dans la sauvagerie de la guerre – la brutalité, la famine, la peur et l'espoir qui se mêlent sans cesse, la perte, les inévitables exactions… – est intense et terrible.
La diversité d'âge, de situation, de nationalité, permet de tracer un riche portrait des interactions sociales : privilèges de classe, colonialisme, discrimination, préjugés et tensions entre ethnies, la lutte entre éducation et superstitions… Avec les deux couples – non conventionnels – qui constituent le noyau des personnages, c'est également un récit sur le couple, ce qui le porte, ce qui le construit, ce qui le renforce ou le détruit. C'est enfin un roman sensoriel, porté par les bonnes odeurs des plats d'Ugwu, chauffé par la lumière brûlante du soleil dans laquelle flotte la poussière des chemins...
L'écriture de Chimamanda Ngozi Adichie est une nouvelle fois d'une grande efficacité : fluide, vibrante, précise, marquante. Grâce à elle et à ces personnages, plus qu'instructif, ce roman s'est révélé puissant, éloquent et déchirant.
Lien : https://oursebibliophile.wor..
Attention voici une petite merveille. A travers des personnages touchant et plus humain les uns que les autres, l'auteure nous plonge en plein milieu d'un conflit, la guerre du Biafra. Ugwu sort de la misère en se mettant au service de l'élite intellectuelle, Olana une jeune professeure pleine d'idéaux, Kainene une femme d'affaires... autant de personnages déchirés et plongeant en pleine tourmente dans cette guerre que tout le monde ne comprend pas, entraînant avec eux le lecteur.
Corruption, famine, mort, isolement... comment survivre après tant d'horreurs ?
Corruption, famine, mort, isolement... comment survivre après tant d'horreurs ?
Troisième livre de cet auteur, et troisième coup de coeur. L'auteur m'a permis de découvrir la guerre du Biafra, dont je n'avais jamais entendu parler. Elle a su, sous forme de roman, nous plonger totalement dans une réalité historique très dure.
Le Biafra, c'était pour moi le nom d'une famine, une de celles qui ont donné naissance à l'aide humanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après avoir lu Une moitié de soleil jaune' (traduction littérale), c'est aussi le nom d'un des premiers conflits interethniques post-décolonisation, l'histoire d'une utopie et celle d'une guerre sanglante qui a affamé des millions de personnes.
Ce roman a été écrit pour rendre justice à ceux qui ont vécu cette guerre côté Biafrais et nous raconte leur vie au début de l'indépendance du Nigeria, les premiers massacres, l'exode, et finalement le retour après la fin de la guerre. Les trois narrateurs sont issus de milieux différents (un pauvre villageois, une riche bourgeoise et un Anglais écrivailleur), ce qui nous permet de découvrir aussi bien le Nigeria dans son ensemble que la variété des craintes et des souffrances imposées par la guerre et la famine aux populations. J'ai apprécié dans ce roman la virtuosité du récit et la découverte d'un épisode peu glorieux de l'histoire humaine. Comme dit le roman écrit par l'un des personnages : "le monde se taisait quand ils sont morts". le problème, c'est que le Nigeria maintient encore ce silence...
Ce roman a été écrit pour rendre justice à ceux qui ont vécu cette guerre côté Biafrais et nous raconte leur vie au début de l'indépendance du Nigeria, les premiers massacres, l'exode, et finalement le retour après la fin de la guerre. Les trois narrateurs sont issus de milieux différents (un pauvre villageois, une riche bourgeoise et un Anglais écrivailleur), ce qui nous permet de découvrir aussi bien le Nigeria dans son ensemble que la variété des craintes et des souffrances imposées par la guerre et la famine aux populations. J'ai apprécié dans ce roman la virtuosité du récit et la découverte d'un épisode peu glorieux de l'histoire humaine. Comme dit le roman écrit par l'un des personnages : "le monde se taisait quand ils sont morts". le problème, c'est que le Nigeria maintient encore ce silence...
Le récit tragique du parcours d Ugwu ,jeune garçon engagé comme "boy"(pour utiliser le jargon colonialiste ) par un universitaire nigérian progressiste et sa jeune femme:ils connaîtront la guerre civile qui déchire leur pays ,le Nigeria.
Le grand roman sur cet épisode oublié ou mal connu de l histoire africaine que constitue la sanglante guerre fratricide du Biafra.( années soixante)
J ai lu ce livre en Anglais ,style impeccable ,récit passionnant et poignant de la premiere a la dernière page,la traduction est certainement impeccable .
Déjà ,les enfants soldats,le viol collectif comme arme de guerre,les famines programmées ,les ethnies fratricides...
A lire sans hésiter.
J ai préféré ce roman a "americanah" ,plus récent qui n apporte pas grand chose de neuf dans le paysage littéraire:les tribulations d une nigériane qui ne se rend compte qu arrivée aux états unis qu elle est noire :bien sûr victime du racisme ,bien sûr aigrie par toutes ces epreuves...et des pages entières sur le cheveu africain et les difficultés a le coiffer...cfr white girl black girl de jc Oates,the Time of our singing( beaucoup mieux!) de R Powers,ou un roman dont j ai oublié l auteur et qui s appelait je crois " not the right type of hair"
De plus ,l intrigue de americanah est on ne peut moins plausible: la narratrice, Ifemelu , à bout de ressources financières et échappant de justesse à la prostitution ,est engagée comme baby-sitter par une riche famille Wasp (type les Kennedy ) et là,attention:le jeune et bel héritier celibataire de cette lignée de pur sang tombe amoureux d elle et la prend comme fiancée au mépris de toutes les convenances et du quand dira t on
Las,,Ifemelu lassée des vols en première classe et des lounges d aerport ,le largue pour un intello végétarien a moitié black et bien sous tout rapport( peut être un peu moralisateur ?)pour finalement retourner au Nigeria lassée de son existence dorée aux usa!
Dans son pays natal elle retrouve son amour d adolescence ( à qui elle n avait fort abruptement plus jamais écrit ni telephone pendant plus de 10 ans)et entreprend de le séduire....bof bof...je vous disais ,rien de nouveau sous cette moitie ci du soleil...
Le grand roman sur cet épisode oublié ou mal connu de l histoire africaine que constitue la sanglante guerre fratricide du Biafra.( années soixante)
J ai lu ce livre en Anglais ,style impeccable ,récit passionnant et poignant de la premiere a la dernière page,la traduction est certainement impeccable .
Déjà ,les enfants soldats,le viol collectif comme arme de guerre,les famines programmées ,les ethnies fratricides...
A lire sans hésiter.
J ai préféré ce roman a "americanah" ,plus récent qui n apporte pas grand chose de neuf dans le paysage littéraire:les tribulations d une nigériane qui ne se rend compte qu arrivée aux états unis qu elle est noire :bien sûr victime du racisme ,bien sûr aigrie par toutes ces epreuves...et des pages entières sur le cheveu africain et les difficultés a le coiffer...cfr white girl black girl de jc Oates,the Time of our singing( beaucoup mieux!) de R Powers,ou un roman dont j ai oublié l auteur et qui s appelait je crois " not the right type of hair"
De plus ,l intrigue de americanah est on ne peut moins plausible: la narratrice, Ifemelu , à bout de ressources financières et échappant de justesse à la prostitution ,est engagée comme baby-sitter par une riche famille Wasp (type les Kennedy ) et là,attention:le jeune et bel héritier celibataire de cette lignée de pur sang tombe amoureux d elle et la prend comme fiancée au mépris de toutes les convenances et du quand dira t on
Las,,Ifemelu lassée des vols en première classe et des lounges d aerport ,le largue pour un intello végétarien a moitié black et bien sous tout rapport( peut être un peu moralisateur ?)pour finalement retourner au Nigeria lassée de son existence dorée aux usa!
Dans son pays natal elle retrouve son amour d adolescence ( à qui elle n avait fort abruptement plus jamais écrit ni telephone pendant plus de 10 ans)et entreprend de le séduire....bof bof...je vous disais ,rien de nouveau sous cette moitie ci du soleil...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Chimamanda Ngozi Adichie (16)
Voir plus
Quiz
Voir plus
NOUS SOMMES TOUS DES FEMINISTES
Selon Chimamanda, être Féministe c'est...
être une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique
l'homme est supérieur dans tous les domaines à la femme
7 questions
31 lecteurs ont répondu
Thème : Nous sommes tous des féministes (Album) de
Chimamanda Ngozi AdichieCréer un quiz sur ce livre31 lecteurs ont répondu