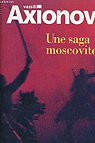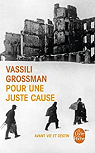Svetlana Allilouïeva
EAN : 978B002T88X82
Robert Laffont (30/11/-1)
/5
2 notes
Robert Laffont (30/11/-1)
Résumé :
Née le 28 février 1926 à Moscou et morte le 22 novembre 2011 à Richland Center (Wisconsin), Svetlana Allilouïeva est le plus jeune enfant et la seule fille de Joseph Staline née de son second mariage avec Nadejda Allilouïeva-Staline. Née à la polyclinique du Kremlin à Moscou. Svetlana est l'enfant préférée de Staline qui la gâte pendant son enfance.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après En une seule annéeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Lorsque j'ai emprunté ce récit autobiographique (Tолько один год) dans une boite à livres, j'ai vu sa thématique, mais pas identifié son auteure, qui m'était inconnue. En lisant les premiers chapitres, j'ai été surpris par sa proximité avec les dirigeants de l'Union soviétique, proximité qu'elle explique par sa filiation d'un ex-membre éminent du Parti Communiste qui n'est pas nommé explicitement au début du récit.
Internet m'a alors appris que Svetlana Alliluyeva (1926-2011) avait pour père l'un des pires criminels de l'Histoire de l'humanité : Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit « le Père des peuples », ou « le Tyran rouge » (ce qui lui sied mieux), ou « Staline » (1878-1953).
En 1945, Svetlana Alliluyeva eut un fils de Grigori Morozov, son premier époux (juif) dont elle divorça en 1947.
En seconde noce, elle épousa Iouri Jdanov, fils d'Andreï Jdanov (1896-1948, bras droit de Staline, grand artisan de la répression intellectuelle qui donna son nom à la « doctrine Jdanov », théorisation de la division du monde en deux camps : impérialiste à l'Ouest et "anti-impérialiste" à l'Est) ; ils eurent une fille ensemble en 1950, puis divorcèrent rapidement.
Malgré ce lourd héritage, Svetlana Alliluyeva sut prendre du recul avec le régime soviétique, à tel point qu'en mars 1967, à New Delhi - où elle avait été autorisée à venir disperser les cendres de son concubin - elle demanda l'asile à l'ambassade des États-Unis. Elle laissait alors en Union soviétique ses deux enfants âgés de 17 et de 12, sans les avoir préalablement informés de sa volonté d'exil (elle écrit avoir pris sa décision en Inde).
En 1962, elle avait demandé à porter le nom de sa mère, plutôt que celui de son père, comme c'était permis en URSS. Cette même année elle s'était fait baptiser selon le rituel orthodoxe ; par prudence le prêtre ne fit pas figurer son vrai nom sur les registres. le récit de son éveil à la foi (chapitre 12) m'a laissé dubitatif, Svetlana m'apparaissant "habitée" (au sens de la métaphore "avoir une araignée au plafond"). Heureusement elle semble avoir tiré le meilleur de sa foi : une aide, et des valeurs humanistes dont elle n'avait guère constaté la présence au sein du pouvoir soviétique…
L'auteure centre son récit sur l'année 1967 durant laquelle elle décida de quitter l'Union soviétique mais elle évoque aussi son passé.
Au chapitre 7, l'auteure explique sa découverte du "côté sombre" de son père.
Alors que Svetlana n'était âgée que de 6 ans, sa mère s'est suicidée, le 7 novembre 1962, soir du 15ième anniversaire de la révolution. Svetlana n'apprit les causes de cette mort, et n'en comprit les raisons, que 10 ans plus tard.
A l'école, la composition de sa classe changeait au fur et à mesure que des parents d'autres élèves étaient envoyés au Goulag ou exécutés ! Elle comprit que son père pouvait empêcher ces condamnations (ayant une première fois réussi à le convaincre de le faire) mais qu'il n'en faisait rien et qu'il commandait la répression dans le pays. Elle fut témoin (indirecte) d'assassinats politiques ; par exemple lorsque son père lui annonça la mort "accidentelle" de l'acteur S. Nichoels qu'il avait commanditée peu avant devant elle. Elle note que Staline encouragea vivement le retour de l'antisémitisme en Union soviétique à la fin des années 1920. D'ailleurs, la judaïté de Grigori Morozov, premier époux de Svetlana fut un sujet de brouille avec son père.
Au chapitre 17, elle complète de manière lucide le portrait de son père. Elle ne fait cependant pas peser la responsabilité des dérives de son pouvoir sur lui seul, considérant que le système de Parti unique issu de la révolution a permis l'émergence d'un tel autocrate et l'expression de ses travers (« Lénine avait jeté les bases d'un régime totalitaire fondé sur l'élimination des hommes et sur la peur », page 335).
Elle décrit aussi l'inculture de son père et son manque d'ouverture d'esprit : « Cette incapacité de se laisser convaincre, cette façon de rejeter automatiquement l'opinion contraire (…) lui avaient été inculqués au séminaire, école de fanatisme et d'intolérance, - d'autant plus qu'il n'avait été qu'aux mains des prêtres, et qu'il ne compléta pas leur éducation par quelque chose d'autre. (…). Il n'avait aucune idée des autres civilisations, des démocraties d'Europe, de la liberté de pensée. (…) En plein 20ième siècle, le « chef du prolétariat mondial » ne gouvernait pas le pays avec des hommes de progrès, mais en s'appuyant sur l'ignorance de millions de retardés (…). Mon père avait compris qu'en Russie, seuls ces aveugles accepteraient de l'aider, et que les hommes au courant, ouverts, les intellectuels, ne lui apporteraient pas, à lui, leur concours. Il savait qu'ils ne le tiendraient jamais pour un des leurs. », page 334).
L'auteure écrit avoir culpabilisé de son soulagement en apprenant la mort de Staline, et avoir compris les espoirs de changement que cette mort fit naître dans la population.
Elle approuva d'ailleurs les constats accablants (bien qu'incomplets) du rapport Krouchtchev, et écrit avoir été déçue de l'insuffisance des changements politiques intervenus dans le pays après la période stalinienne.
Elle constate que son père n'a pas seulement fait assassiner, incarcérer, et soumis aux travaux forcés des centaines de milliers de personnes. Staline a aussi détruit les Arts, en particulier littéraires (susceptibles de véhiculer des idées qu'il considérait comme une menace) et a réécrit l'Histoire. Tout récit de la Révolution devait lui conférer un rôle central qu'il n'avait pas tenu. Les sciences étaient elles aussi soumises aux dictats de l'idéologie : « à partir de 1948, une décision du Parti (…) mettait hors la loi la théorie des chromosomes. Dans la pratique cela équivalait à interdire presque tout l'exercice d'une science. le Parti (…) déclara (…) que la théorie de Mendel-Morgan était une "hérésie". (…) Cette hérésie continua pourtant à vivre, dans la clandestinité. Les savants poursuivaient leurs expériences, sous le prétexte d'en faire d'autres. » (page 228).
La fuite de Svetlana Alliluyeva vers les USA fut un symbole fort, d'autant plus qu'elle intervint pendant la Guerre froide.
Arrivée en occident, elle travailla à faire publier un premier récit fondé sur une partie de sa vie (« Vingt lettre à un ami »), mais dut subir une campagne de dénigrement orchestrée par les autorités soviétiques à partir de témoignages truqués et de photographies volées.
Ce récit est un témoignage très intéressant sur l'histoire de l'Union soviétique au 20ième siècle, et sur la vie d'une femme qui sut rester humaine et positive.
Le destin de ses deux frères fut moins heureux que le sien : Iakov (1907-1943) se serait suicidé durant sa captivité en Allemagne (Staline n'a pas accompli de démarche en sa faveur, considérant que tout prisonnier russe en Allemagne était un traitre), et Vassili (1921-1962) est mort alcoolique, interné dans un asile.
Internet m'a alors appris que Svetlana Alliluyeva (1926-2011) avait pour père l'un des pires criminels de l'Histoire de l'humanité : Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit « le Père des peuples », ou « le Tyran rouge » (ce qui lui sied mieux), ou « Staline » (1878-1953).
En 1945, Svetlana Alliluyeva eut un fils de Grigori Morozov, son premier époux (juif) dont elle divorça en 1947.
En seconde noce, elle épousa Iouri Jdanov, fils d'Andreï Jdanov (1896-1948, bras droit de Staline, grand artisan de la répression intellectuelle qui donna son nom à la « doctrine Jdanov », théorisation de la division du monde en deux camps : impérialiste à l'Ouest et "anti-impérialiste" à l'Est) ; ils eurent une fille ensemble en 1950, puis divorcèrent rapidement.
Malgré ce lourd héritage, Svetlana Alliluyeva sut prendre du recul avec le régime soviétique, à tel point qu'en mars 1967, à New Delhi - où elle avait été autorisée à venir disperser les cendres de son concubin - elle demanda l'asile à l'ambassade des États-Unis. Elle laissait alors en Union soviétique ses deux enfants âgés de 17 et de 12, sans les avoir préalablement informés de sa volonté d'exil (elle écrit avoir pris sa décision en Inde).
En 1962, elle avait demandé à porter le nom de sa mère, plutôt que celui de son père, comme c'était permis en URSS. Cette même année elle s'était fait baptiser selon le rituel orthodoxe ; par prudence le prêtre ne fit pas figurer son vrai nom sur les registres. le récit de son éveil à la foi (chapitre 12) m'a laissé dubitatif, Svetlana m'apparaissant "habitée" (au sens de la métaphore "avoir une araignée au plafond"). Heureusement elle semble avoir tiré le meilleur de sa foi : une aide, et des valeurs humanistes dont elle n'avait guère constaté la présence au sein du pouvoir soviétique…
L'auteure centre son récit sur l'année 1967 durant laquelle elle décida de quitter l'Union soviétique mais elle évoque aussi son passé.
Au chapitre 7, l'auteure explique sa découverte du "côté sombre" de son père.
Alors que Svetlana n'était âgée que de 6 ans, sa mère s'est suicidée, le 7 novembre 1962, soir du 15ième anniversaire de la révolution. Svetlana n'apprit les causes de cette mort, et n'en comprit les raisons, que 10 ans plus tard.
A l'école, la composition de sa classe changeait au fur et à mesure que des parents d'autres élèves étaient envoyés au Goulag ou exécutés ! Elle comprit que son père pouvait empêcher ces condamnations (ayant une première fois réussi à le convaincre de le faire) mais qu'il n'en faisait rien et qu'il commandait la répression dans le pays. Elle fut témoin (indirecte) d'assassinats politiques ; par exemple lorsque son père lui annonça la mort "accidentelle" de l'acteur S. Nichoels qu'il avait commanditée peu avant devant elle. Elle note que Staline encouragea vivement le retour de l'antisémitisme en Union soviétique à la fin des années 1920. D'ailleurs, la judaïté de Grigori Morozov, premier époux de Svetlana fut un sujet de brouille avec son père.
Au chapitre 17, elle complète de manière lucide le portrait de son père. Elle ne fait cependant pas peser la responsabilité des dérives de son pouvoir sur lui seul, considérant que le système de Parti unique issu de la révolution a permis l'émergence d'un tel autocrate et l'expression de ses travers (« Lénine avait jeté les bases d'un régime totalitaire fondé sur l'élimination des hommes et sur la peur », page 335).
Elle décrit aussi l'inculture de son père et son manque d'ouverture d'esprit : « Cette incapacité de se laisser convaincre, cette façon de rejeter automatiquement l'opinion contraire (…) lui avaient été inculqués au séminaire, école de fanatisme et d'intolérance, - d'autant plus qu'il n'avait été qu'aux mains des prêtres, et qu'il ne compléta pas leur éducation par quelque chose d'autre. (…). Il n'avait aucune idée des autres civilisations, des démocraties d'Europe, de la liberté de pensée. (…) En plein 20ième siècle, le « chef du prolétariat mondial » ne gouvernait pas le pays avec des hommes de progrès, mais en s'appuyant sur l'ignorance de millions de retardés (…). Mon père avait compris qu'en Russie, seuls ces aveugles accepteraient de l'aider, et que les hommes au courant, ouverts, les intellectuels, ne lui apporteraient pas, à lui, leur concours. Il savait qu'ils ne le tiendraient jamais pour un des leurs. », page 334).
L'auteure écrit avoir culpabilisé de son soulagement en apprenant la mort de Staline, et avoir compris les espoirs de changement que cette mort fit naître dans la population.
Elle approuva d'ailleurs les constats accablants (bien qu'incomplets) du rapport Krouchtchev, et écrit avoir été déçue de l'insuffisance des changements politiques intervenus dans le pays après la période stalinienne.
Elle constate que son père n'a pas seulement fait assassiner, incarcérer, et soumis aux travaux forcés des centaines de milliers de personnes. Staline a aussi détruit les Arts, en particulier littéraires (susceptibles de véhiculer des idées qu'il considérait comme une menace) et a réécrit l'Histoire. Tout récit de la Révolution devait lui conférer un rôle central qu'il n'avait pas tenu. Les sciences étaient elles aussi soumises aux dictats de l'idéologie : « à partir de 1948, une décision du Parti (…) mettait hors la loi la théorie des chromosomes. Dans la pratique cela équivalait à interdire presque tout l'exercice d'une science. le Parti (…) déclara (…) que la théorie de Mendel-Morgan était une "hérésie". (…) Cette hérésie continua pourtant à vivre, dans la clandestinité. Les savants poursuivaient leurs expériences, sous le prétexte d'en faire d'autres. » (page 228).
La fuite de Svetlana Alliluyeva vers les USA fut un symbole fort, d'autant plus qu'elle intervint pendant la Guerre froide.
Arrivée en occident, elle travailla à faire publier un premier récit fondé sur une partie de sa vie (« Vingt lettre à un ami »), mais dut subir une campagne de dénigrement orchestrée par les autorités soviétiques à partir de témoignages truqués et de photographies volées.
Ce récit est un témoignage très intéressant sur l'histoire de l'Union soviétique au 20ième siècle, et sur la vie d'une femme qui sut rester humaine et positive.
Le destin de ses deux frères fut moins heureux que le sien : Iakov (1907-1943) se serait suicidé durant sa captivité en Allemagne (Staline n'a pas accompli de démarche en sa faveur, considérant que tout prisonnier russe en Allemagne était un traitre), et Vassili (1921-1962) est mort alcoolique, interné dans un asile.
je suis d'acor. petite rectification sur un detail: les enfants de Svetlana, lorsqu elle est parti en Inde avait 17 et 20 ans. ( son fils commencait a devenir medecin, et venait de se marier.) les deux avait leur péres, et mais habitait à Moscou avec Svetlana. le départ les a autant plus choqué, que les autoritée russes ont bloqué le courrier, pour qu' les enfants n' ont pas des explications directe de leur mere, ensuite, les autorité creent un scandale, pour bien dicrediter la mere aux enfants. Dans les medias, politiquement etc.
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Cette incapacité de se laisser convaincre, cette façon de rejeter automatiquement l’opinion contraire (…) lui avaient été inculqués au séminaire, école de fanatisme et d’intolérance, - d’autant plus qu’il n’avait été qu’aux mains des prêtres, et qu’il ne compléta pas leur éducation par quelque chose d’autre. (…). Il n’avait aucune idée des autres civilisations, des démocraties d’Europe, de la liberté de pensée. (…) En plein 20ième siècle, le « chef du prolétariat mondial » ne gouvernait pas le pays avec des hommes de progrès, mais en s’appuyant sur l’ignorance de millions de retardés (…). Mon père avait compris qu’en Russie, seuls ces aveugles accepteraient de l’aider, et que les hommes au courant, ouverts, les intellectuels, ne lui apporteraient pas, à lui, leur concours. Il savait qu’ils ne le tiendraient jamais pour un des leurs. - page 334
A partir de 1948, une décision du Parti (…) mettait hors la loi la théorie des chromosomes. Dans la pratique cela équivalait à interdire presque tout l'exercice d'une science. Le Parti (…) déclara (…) que la théorie de Mendel-Morgan était une "hérésie". (…) Cette hérésie continua pourtant à vivre, dans la clandestinité. Les savants poursuivaient leurs expériences, sous le prétexte d'en faire d'autres. - page 228
Lénine avait jeté les bases d'un régime totalitaire fondé sur l'élimination des hommes et sur la peur. - page 335
Video de Svetlana Allilouïeva (1)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : histoire de la russieVoir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Svetlana Allilouïeva (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
776 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre776 lecteurs ont répondu